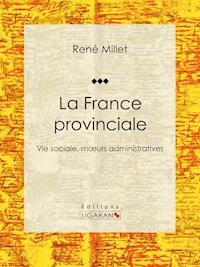
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "Lorsqu'un voyageur visite les îles Britanniques, les Etats de la couronne d'Autriche ou les provinces de la Turquie, il a soin de distinguer, non seulement les contrées, mais les races, et il a raison, car il a devant lui, rangés sous le même sceptre, des peuples bien tranchées : Irlandais contre Saxons, Magyars contre Slaves, chrétiens contre musulmans."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335031188
©Ligaran 2015
Un certain nombre de nos compatriotes et presque tous les étrangers s’imaginent qu’il suffit de connaître. Paris pour connaître la France, de même qu’on regarde les personnes au visage et qu’on néglige les parties inférieures du corps. Paris leur semble l’expression complète, unique et définitive de notre civilisation. Ils n’aperçoivent la province qu’à travers un brouillard qui confond toutes les nuances. C’est assez pour eux de savoir qu’elle existe. Un convive attablé devant un bon dîner ne s’informe pas du boulanger qui fait le pain ni du cuisinier qui combine les sauces. De bonne foi, le dernier des Parisiens se considère comme un être privilégié dont 36 millions de provinciaux ne seraient que les pourvoyeurs.
Je ne connais pas de jugement plus faux ni plus injurieux pour notre pays. Sans doute un peuple doit être fier d’avoir créé Paris. Mais Paris n’est pas la France. On l’a compris un peu Lard : en donnant trop de prépondérance à la capitale, on troublerait tout l’équilibre de l’État moderne. Les grandes nations contemporaines perdraient leur raison d’être et retomberaient dans les défauts de la cité antique, si elles ne traitaient sur le même pied tous les habitants de leur territoire, et si elles n’évitaient de lier leur sort au caprice d’une minorité turbulente. Nos ancêtres n’ont pas cimenté de leur sang l’unité française, ajouté lentement les provinces aux provinces, repoussé les ennemis du dehors et comprimé ceux du dedans, pour que deux millions de Parisiens, accourus de tous les points de l’horizon, confondus dans une plèbe anonyme, disposent de nos institutions, de nos mœurs et de notre avenir, comme autrefois la plèbe de Rome se jouait des destinées du monde.
On n’ose pas dire : le règne de Paris est terminé, nous n’aurons plus de révolutions d’Hôtel-de-Ville. Il semble cependant qu’elles soient devenues plus difficiles. Tout au moins ne verra-t-on pas de ces coups de théâtre qui entraînaient la province par surprise, car celle-ci est dûment avertie. À coup sûr, ce sera toujours un grave embarras qu’une petite république enclavée dans la grande, et supérieure par sa population à beaucoup d’États qui font figure en Europe, à la Grèce, à la Serbie, au Danemark, à la Norvège. Il faudra compter avec les dispositions agressives de ces assemblées parisiennes qui se considèrent modestement comme la lumière du globe et qui opposent le plus parfait dédain aux remontrances des pouvoirs publics. Elles ne cesseront pas de traîner à leur suite une énorme clientèle de mécontents et de déclassés.
Mais la province à son tour est lasse d’être absorbée ou tyrannisée par la capitale. Depuis 1871, il s’est élevé, dans les parties saines de la population, un sentiment de révolte contre ce despotisme d’un nouveau genre. Ce n’est pas sans fruit que le réveil du patriotisme a coïncidé chez nous avec la terrible épreuve de la Commune, et la leçon ne sera pas perdue. Nos rêveries humanitaires, notre indifférence cosmopolite ont été doublement battues en brèche. Atteints à la fois au cœur et aux extrémités, nous avons souffert dans toutes nos fibres. Le premier siège de Paris nous a désabusés de la fraternité des peuples, le second des théories creuses. Les observateurs superficiels ont seuls pu croire que rien n’était changé en France. Ces tristes journées devaient avoir un écho prolongé dans nos idées et dans nos mœurs. En refusant d’obéir aux folles injonctions de sa capitale, le pays a renoncé du même coup au penchant exclusif pour les abstractions qu’on lui reproche en termes si amers. Paris ressemble à un immense alambic où s’élaborent les idées générales ; mais c’est aussi le lieu où les caractères, émoussés par le frottement, perdent le plus vite leur saveur et leur originalité. Or, les Français se sont dégoûtés peu à peu d’être les théoriciens de l’univers. Ils ne veulent plus fabriquer un homme abstrait, gonflé de formules et sevré de faits. Ils n’ont plus d’indulgence pour l’astronome qui tombe dans un puits en contemplant les astres. Il leur paraît plus important de prévoir et de mesurer les évènements contemporains que d’avoir des vues sur la marche de l’humanité. La plupart des critiques qu’on nous adresse à cet égard étaient justes hier et ne le seront plus demain. On instruit le procès de notre esprit classique et de notre logique à outrance, au moment même où nous sentons le besoin de nous renfermer dans nos frontières, de redevenir exclusivement français, en un mot de travailler sur la peau humaine, au lieu de polir des phrases.
Nul doute que cette transformation n’ait commencé après nos malheurs. J’en appelle aux hommes de ma génération, et je leur demande si, fatigués du bavardage des clubs ou des salons, ils ne se sont pas penchés sur la France mutilée pour l’étudier de près, pour la mieux connaître ; s’ils n’ont pas été repris jusqu’au fond des entrailles d’une tendresse farouche pour ce noble pays, non point subtilisé et quintessencié comme il nous apparaissait dans nos chimères de jeunesse, lorsque nous apprenions l’histoire dans le Contrat social, mais tel qu’il a été pétri par quinze siècles d’une laborieuse croissance et par cinq ou six révolutions, avec ses qualités et ses défauts, même avec ses difformités, comme on aime un être cher sur les traits duquel l’âge, le sourire et les lamies ont laissé leur trace.
Cette patrie en chair et en os, je voudrais l’évoquer sous la forme où elle m’est apparue, lorsque je tournais le dos aux livres pour étudier les hommes. Il serait présomptueux de prétendre faire un tableau complet ; mais j’aurai atteint mon but si je fais toucher du doigt une société originale et des institutions fécondes. On verra peut-être quelles réserves de vigueur et d’initiative la province recèle dans son sein, quelles ressources elle nous garde malgré les agitations de la surface. C’est aux époques de crise qu’il importe le plus d’éprouver la solidité des assises nationales, pour garder son sang-froid au milieu des orages.
Lorsqu’un voyageur visite les îles Britanniques, les États de la couronne d’Autriche ou les provinces de la Turquie, il a soin de distinguer, non seulement les contrées, mais les races, et il a raison, car il a devant lui, rangés sous le même sceptre, des peuples bien tranchés : Irlandais contre Saxons, Magyars contre Slaves, chrétiens contre musulmans. Chez nous, la fusion est si parfaite et le sang tellement mélangé, que d’un bout à l’autre du territoire, les couleurs sont remplacées par de simples nuances. À la vérité, si l’on met brusquement face à face un Provençal et un Picard, un Gascon et un Flamand, on obtient un contraste tout extérieur d’accent, de geste et de complexion. Mais les âmes diffèrent moins que les visages, et, comme on dit, le ton ne fait pas la chanson. Ces hommes, si dissemblables à première vue, ne sont séparés par aucune opposition essentielle d’intérêt, ou de sentiment. Si même ils arrivent à se comprendre, au régiment par exemple, lorsqu’ils échangent leurs patois respectifs contre l’idiome national, ils sont étonnés de se trouver une foule d’idées communes.
Aussi, nombre d’écrivains me semblent faire fausse route lorsqu’ils cherchent à tirer leurs effets littéraires de la différence des races, et qu’ils veulent pousser cette gageure plus loin que le badinage. Ils imitent ces paysagistes qui notent minutieusement, au-dessous de leur toile, le lieu, l’heure et la date de l’inspiration, tandis que leurs devanciers, bien supérieurs, peignaient tout uniment la nature comme ils la voyaient. Je consens qu’un vaudevilliste nous amuse un instant avec le jargon de Provence ou l’exubérance gasconne ; mais attribuer au soleil du Midi une influence décisive sur les pensées et les actes d’un bon quart de nos compatriotes, cela me paraît aussi judicieux que de considérer l’innocente protestation des félibres comme la revanche de la guerre des Albigeois. On nous a forgé ainsi un type de Méridional hâbleur et vaniteux dans lequel il serait difficile de reconnaître le concitoyen d’un Thiers, d’un Mignet ou d’un Guizot, de même que la littérature a inventé une Bretagne de granit qui ne ressemble guère à la patrie de M. Renan et de M. Jules Simon.
Balzac était beaucoup mieux inspiré lorsqu’il cherchait l’intérêt de la comédie humaine dans la variété des conditions sociales, et non dans la diversité des territoires. Son tableau a certainement vieilli, mais sa conception était juste. En France, c’est la profession et non la naissance qui met le plus de différence entre les hommes. On aperçoit plus d’analogie entre un fermier de la Beauce et son confrère de Normandie, qu’entre celui-ci et l’ouvrier de Rouen. S’il existe chez nous une relation étroite du sol à l’habitant, c’est une relation naturelle, qui tient au degré de bien-être, à la manière de vivre, aux impressions que les yeux reçoivent chaque jour d’un horizon familier, mais qui n’a presque rien à voir avec les anciennes divisions des provinces. Le terroir, c’est-à-dire le mode de culture, a plus d’influence sur le caractère des hommes que des souvenirs historiques bien effacés, ou que la prétendue fatalité du sang. Cette action visible de la terre sur celui qui l’arrose de ses sueurs n’est-elle pas encore un pli du métier ? Il m’est arrivé bien souvent de rencontrer aux extrémités opposées de la France, par exemple au fond du Berry et en Bretagne, les mêmes horizons étroits, les mêmes landes en friche, et par suite les mêmes dispositions morales.
Si donc je devais servir de guide à quelque étranger désireux de connaître notre pays, je ne lui montrerais pas les régions les plus excentriques ni les plus frappantes, celles qu’on visite par curiosité. Je le mènerais plutôt dans une France moyenne et tempérée, je le ferais séjourner longtemps dans les départements du centre, et j’aurais soin de lui montrer quelques-uns de ces terroirs en blés, vignes ou pâturages, dont les alternatives de richesse et de pauvreté reproduisent le plus exactement la physionomie générale du pays. Je ne manquerais pas d’ailleurs de le prémunir contre les premières impressions qu’il recevrait en causant avec des provinciaux de la classe éclairée. Je lui expliquerais par quel malentendu ceux-ci voient des complots partout, et se tiennent perpétuellement en défense contre les ruses du paysan. Joseph Prudhomme foisonne en province, et ne manque jamais de vous peindre son propre pays comme un repaire de brigands uniquement occupés à se déchirer les uns les autres. Heureusement, un aussi fâcheux pronostic est démenti par l’aspect laborieux des campagnes et par la face bien nourrie du bourgeois qui vous parle. Tout en décrivant l’état social avec la plume de Hobbes et le pinceau de Salvator Rosa, il boit tranquillement le lait que de farouches conspirateurs lui apportent le matin, et, le soir, il ne trouve pas de vipère au fond des corbeilles de fruits qui décorent sa table.
Une circonstance contribue beaucoup à assombrir les perspectives des hautes classes sur les paysans, et sur les gens du peuple en général : ils les jugent d’après les échantillons qu’ils ont le plus souvent sous les yeux, c’est-à-dire d’après la foule des petits marchands, maraîchers, jardiniers, manœuvres et hommes de peine qui font la navette entre la ville et la campagne. Ce sont eux qu’on voit d’abord en faisant une pointe dans la banlieue. Ils viennent en ville les jours de marché. Leur physionomie est triviale comme la borne au coin d’une place. La plupart des littérateurs ne vont pas plus avant. Ils ont la prétention de nous montrer le fond et le tréfond du paysan : ils ne connaissent que le fruitier du coin. Or il faut reconnaître que cette engeance n’est pas aimable. Fournisseurs presque toujours anonymes de la classe supérieure, travaillant de leur mieux à transformer nos écus en gros sous, ils passent leur temps à considérer l’envers du luxe ; et les sentiments peu recommandables qui se développent dans ce petit commerce ne sont pas tempérés par le caractère affectueux des relations. Ils ont les défauts d’une espèce hybride. Ils ne sont ni chair ni poisson, ni ville ni campagne, trop inquiets pour des ruraux, trop rustres pour des citadins. À leurs yeux, tout homme qui ne gratte pas la terre avec ses ongles est un oisif, par suite un inutile. Ils ne lui reconnaissent qu’un mérite, celui de jeter l’argent par les fenêtres, à la condition qu’il se trouve quelqu’un pour le ramasser. Si l’on vient à leur aide, ils sont d’une candeur d’ingratitude admirable. On juge alors quels trésors de bile s’amassent dans le cœur de ceux dont le travail alimente la jouissance d’autrui. Cependant, il entre plus de sotte vanité que de haine raisonnée dans les passions qui fermentent autour de la richesse. Le plus grand grief de ces gens-là, c’est précisément qu’on les tienne à distance. Quelques bonnes paroles opèrent davantage auprès d’eux qu’un bienfait à longueur de bras. Entrez en vous promenant dans une des maisons qui entourent la ville. Jamais on ne vous refusera un abri, s’il pleut ; un morceau de pain, si vous avez faim. Avez-vous été seulement poli, on se dérange pour vous indiquer votre chemin. Avec les amours-propres malades les procédés ont plus d’importance que les actes.
Cette population suburbaine n’est qu’une minorité dans les départements, mais elle est intelligente, laborieuse, perfectible. Elle fait rendre à la terre 50 pour 100, lit dans le journal le cours des balles, tire parti des chemins de fer, et ne redoute pas de lancer ses produits au-delà des mers. Le type le plus complet, c’est le maraîcher : être insupportable, mais industrieux, flottant entre ses intérêts et ses convoitises, insolent par accès, conservateur par tempérament, déclamant le lundi contre l’infâme capital, parce qu’il a bu avec les ouvriers de la ville ; recueilli et sentencieux le mardi, lorsqu’il a cuvé son vin ; esprit fort le dimanche, mais tous les jours courbé sur ce sol nourricier qu’il triture avec un acharnement sans égal. En politique, il incline vers le despotisme, qui lui paraît être le régime des grands dîners et des pêches à trente sous.
Les vignerons ne sont pas non plus en odeur de sainteté. Arrêtons-nous au pied des collines où l’on récolte un de ces petits vins bien français qui ont peu de corps et beaucoup de montant. Ce cru tout à fait paysan tient le milieu entre les vins de Bourgogne et ceux de Bordeaux. Il a un goût de pierre à fusil et procure à ceux qui en abusent une ivresse bavarde, mais promptement dissipée. Le caractère de nos vignerons ressemble à leur vin. Ils se montent, s’échauffent sur un rien, et s’apaisent de même. Distribués par groupes compacts sur les coteaux où la vigne réussit, serrés autour de petites villes très prospères et très anciennes, ils ne manquent jamais de voter pour le candidat le plus radical. Les terrains de vignobles sont marqués d’une teinte rouge sur la carte politique du préfet. Si, en passant, vous admirez les lignes douces et molles des collines chargées de ceps et couronnées de forêts, un conservateur sourit avec amertume. « Contemplez, dit-il, de loin ce paradis. De près c’est un enfer. » D’où vient ce penchant décidé des vignerons pour les opinions violentes ? Serait-ce, pour employer le langage de leur ami Rabelais, quelque vertu latente et propriété spécifique cachée au fond des cuves, qui attire le radicalisme comme l’aimant attire le fer ? La vérité, c’est qu’ils sont tout enivrés de la lutte qu’ils poursuivent avec succès contre la grande propriété. La grosse chevalerie de l’agriculture a, depuis longtemps, abandonné les pentes où pousse la vigne, et concentré ses forces sur les plateaux. C’est là qu’elle se défend, solidement campée en plaine, adossée à des forêts d’aspect féodal, ravitaillée par des fermes aussi massives que des châteaux forts. Les vignerons ressemblent à des tirailleurs agiles qui montent à l’assaut des collines, cherchent les points faibles des positions retranchées, inquiètent les gros bataillons. Ils se considèrent modestement comme l’avant-garde des petits cultivateurs, et de la démocratie en général. Ils s’imaginent de bonne foi qu’ils sont les rois du monde, parce qu’ils règnent sur quelques arpents pierreux. Ce n’est pas le premier peuple qui cède à pareille illusion. Toutefois, ces mauvaises têtes valent mieux que leur réputation. Il faut les excuser d’être un peu quinteux : ils sont à la merci d’une gelée ou d’un rayon de soleil. Il y a du jeu dans leur affaire ; impatients dans la mauvaise fortune, arrogants dans la bonne, ces joueurs voudraient risquer beaucoup et ne jamais perdre. Quand la grappe a coulé, l’édifice social leur paraît manquer par la base. Ils veulent tout remanier, hormis, bien entendu, la petite, propriété dont ils jouissent. En somme, ces impatiences d’enfants gâtés ne sont pas plus redoutables que les plumets scandaleux dont leurs filles coiffent un front hâlé pour faire enrager les dames de la ville.
Un peu plus loin, nos yeux se reposent sur de magnifiques pâturages. Il y a là des juments poulinières primées dans les concours, des taureaux de race Durham, à la croupe rectiligne, et des bœufs tellement gras qu’ils peuvent à peine marcher en écartant les jambes : ce ne sont plus des animaux, c’est de la viande sur pied. Quand un fermier passe devant eux, ses yeux se mouillent d’attendrissement. De même que ces ruminants participent de la physionomie plantureuse du sol, de même on croit saisir une vague ressemblance entre l’élève et l’éleveur : même encolure, même charpente, même imposante majesté. L’herbager paraît riche, bon vivant, et fréquente plus le café que l’église. Vous l’avez probablement rencontré, en casquette de soie et en blouse flottante, car il vient souvent jusque sur le marché de La Villette. Il est monté dans votre wagon, heureux de frotter à votre habit noir son orgueilleux bourgeron. Sans demander pardon de la liberté grande, il a tiré un cigare de sa poche, et il s’est mis à l’aise, en étalant sa large personne sur les banquettes capitonnées. Vous vous êtes écarté avec horreur, en maudissant intérieurement les privautés démocratiques. Une malice ingénieuse forme le fond du caractère de ce pachyderme. D’autres, les jours d’aubaine, aiment à revêtir la livrée bourgeoise ; mais lui trouve un plaisir plus raffiné à vous imposer le contact de la sienne, et à vous agacer les nerfs par le spectacle de son sans-gêne. Ne croyez pas cependant qu’il se livre tous les jours à ces ébats innocents. Vous le jugez riche ; il l’est par moments : c’est un spéculateur. Mais il n’est pas son maître. Il relève le plus souvent d’un petit bourgeois de la ville voisine, qui vit à l’étroit du produit des fermages. On pourrait même citer telle commune où les propriétaires, pour tenir plus sûrement leurs turbulents vassaux, n’ont point de bail écrit, et gardent ainsi le droit de les congédier du jour au lendemain, comme en Irlande.
C’est une remarque fort ancienne que la Providence, dans sa bonté, a départi plus de finesse aux gros animaux empêtrés dans leurs membres. Nos herbagers ne se piquent pas de consistance politique. Ils ne peuvent sauver leurs intérêts privés qu’aux dépens, non de leur conscience, qui n’a rien à voir dans ces matières, mais de leurs préférences secrètes. Leur penchant pour les opinions avancées n’est pas douteux ; cependant ils savent attendre. Courtisés par tous les partis, ils se laissent caresser, solliciter, s’assoient à la table du baron, ne repoussent pas les avances du député. La politique du jour, en attendant mieux, leur paraît un excellent moyen de manger à tous les râteliers. Si les vignerons sont les troupes légères de la démocratie rurale, ceux-ci forment le corps de bataille. Ils rachètent leur lenteur par des manœuvres savantes. Leurs hésitations apparentes sont profondément calculées. Parmi tant de marches et contremarches qui déconcertent l’adversaire, ils ne cessent d’avancer ; demain on sera surpris de les voir dans la place.
Il est temps de gravir les plateaux, réserves de notre agriculture. Nous sommes en rase campagne. De tous côtés s’étendent les longues rangées de sillons. Le vent, qu’aucun obstacle n’arrête, souffle rudement au visage et apporte des odeurs saines et fortes. On se croirait en mer. La ligne monotone de l’horizon n’est rompue que par le maigre profil de quelques ormes oubliés au bord d’une route, ou par la silhouette d’une grande ferme. Les labours, les semailles, la moisson viennent successivement animer cette solitude. Le soir, les grandes meules de paille, allongeant leur ombre, semblent des bouées énormes au milieu d’un océan immobile. Sur le chaume où croît une herbe rare, un troupeau de moutons, se pressant autour de la hutte du berger, donne un aspect mélancolique à ce sahara cultivé. La ferme oppose aux assauts du vent ses épais contreforts. À l’intérieur, c’est une arche de Noé. Grand et petit bétail, percherons vigoureux, troupeaux d’oies, volaille familière, pintades criardes, enfants, valets de ferme, moissonneurs à gages, tout vit et grouille pêle-mêle, sous les larges poutres à peine équarries, dans une atmosphère de foin, de grains et d’étable. Cependant le maître du lieu est un solitaire, en ce sens qu’il voit rarement ses supérieurs et que, dans l’enceinte de ce caravansérail, on ne connaît d’autre autorité que la sienne : image à peine altérée de la vie patriarcale. Regardez l’air soumis des valets de charrue et des gens d’août, lorsqu’ils se glissent le long de la grande table, à l’heure du souper. La maîtresse leur distribue des portions d’une soupe épaisse qu’ils dévorent en silence ; quand elle ordonne, sa voix chantante et rude ressemble à une bise d’hiver. Chacune de ses paroles tombe de haut : c’est une reine en sabots.
Voici le patron qui entre. On ne peut pas dire qu’il soit beau : trapu, large d’épaules, roux de poil, la mâchoire encadrée dans d’épais favoris, la peau durcie, les yeux rougis et fatigués par le vent, cet ensemble ne compose pas une physionomie avenante. Cependant on distingue dans toute sa personne un air de commandement. Sur ses traits ingrats on lit tant de sérieux, de virilité et de force, qu’il est impossible de méconnaître un homme. Au prix de ces grandes qualités, la différence d’éducation n’est rien : vous n’hésiterez pas à accepter la franche poignée de main qu’il vous offre. Demandez-lui de vous montrer la terre qu’il exploite : d’un geste dominateur, il étend le bras vers les quatre points cardinaux, et taille dans l’immense plaine un grand cercle. Planté ainsi solidement sur ses jambes, humant l’air vif, promenant un regard de maître sur les moissons, il a une mine assez fière. Il passe en revue la ligne des moissonneurs, et soudain les rires se taisent, les faux ronflent plus fort. Il parle peu, mais chaque mot bref, accentué dans le patois du pays, porte juste, et tombe sur le paresseux comme un coup d’aiguillon sur le col d’un bœuf. Il est permis de se demander si ce maître redouté, accoutumé dès l’enfance à se faire obéir des animaux d’abord, des hommes ensuite, libre de pétrir le sol à sa fantaisie, soigneux du détail, attentif à l’ensemble des opérations, n’est pas l’égal, sinon le supérieur, d’une demi-douzaine de désœuvrés, auxquels il verse une fois par an ses fermages, et qu’il aborde, le jour du terme, avec une contenance embarrassée.
C’est une question qu’il se pose peut-être à lui-même, mais il ne dit pas volontiers son secret. Le temps lui manque pour approfondir la philosophie sociale. Il est trop absorbé par l’expérience, qu’il poursuit, c’est-à-dire par un essai, timide encore, de grande culture industrielle. Les capitaux et la science lui font défaut. Son père s’en tenait au métayage et croyait à la vertu des jachères. Le fils ressemble à un navigateur, qui, après avoir longtemps serré de près la côte, se lancerait en pleine mer, avec une boussole mal réglée. L’anxiété se peint souvent sur les traits du pilote, et il s’abandonne rarement à ces accès de joyeuse humeur si familiers à ses confrères de la vallée. Il faut une noce ou même un enterrement pour le dérider. Auprès de ses combats intérieurs et de ses calculs, les jeux de la politique sont un pur enfantillage. Tous ces grands intérêts d’un jour passent comme la nuée sur sa tête : lui seul demeure. Tant de générations qui ont arrosé de leurs sueurs le même sol, labouré et semé à travers les révolutions des empires, tiré de siècle en siècle le pain du sillon, supporté successivement le poids du colonat, celui du servage et les inquiétudes de la liberté, ont pu transmettre à leur dernier représentant la conscience vague de quelque chose de grand et de stable qui survit aux orages. Cependant, il ne saurait plus laisser à autrui le soin de la chose publique. Au fardeau déjà si lourd de ses soucis professionnels s’ajoute la défense de ses droits. Fût-il sourd à l’appel des partis, la crise agricole le réveille brusquement et lui arrache une plainte, qui, de proche en proche, se répand d’un bout de la France à l’autre. N’en doutez pas, c’est lui qui souffre, plus que le petit propriétaire vivant sur son propre fonds, plus que l’homme aux machines, plus que l’éleveur et que le vigneron. Si la main-d’œuvre augmente, si les journaliers s’en vont à la ville, le fermier des grandes plaines est atteint. À considérer les responsabilités qui pèsent sur sa tête et la somme d’impôts qu’il supporte, on lui pardonne des récriminations un peu vives, une disposition naïve à envelopper dans sa disgrâce le pays tout entier, enfin des méprises trop excusables sur les causes de son malaise.
Tous les visages ne sont pas également dignes d’attention. Il suffira de descendre rapidement cette jolie vallée où s’attarde une rivière aux nonchalants détours. Ce n’est pas que le séjour n’en soit agréable : on le devine au nombre des châteaux de tout âge et de toute forme qui se succèdent à intervalles rapprochés. Les Valois ont aimé ces rives. La rivière semble se complaire autour des vieilles murailles et reflète en courant les fleurs de lis et les salamandres. Le sol porte la trace d’une vie facile et heureuse. Divisé en parcelles aussi petites que les cases d’un damier, ombragé d’arbres à fruits jusque sur les routes, coupant la monotomie des cultures par des bosquets d’essences forestières, il semble mettre l’abondance à portée de la main. La plus grande occupation des habitants est de disputer le moindre lambeau de ce terrain béni à l’étreinte des grands parcs. Il n’existe aucun ensemble dans les cultures : elles présentent à l’œil l’aspect d’un tapis diapré. De même, aucun lien de solidarité durable ne s’est formé entre les paysans. Chacun vit à l’ombre de son noyer ; chacun, philosophe sceptique, cultive son jardin comme il l’entend. On joue des tours au voisin, mais on ne se querelle ni très haut ni très longtemps. Les gens du pays ont conservé la bonne humeur narquoise qui court comme une veine brillante dans le métal du caractère national. On y boit maint verre de vin frais sous la treille et on ne se met point en peine de savoir comment tourne la machine ronde. Cette bonhomie est doublée d’une sagacité qui ne se laisse pas prendre aux grands airs de MM. les châtelains. Mais le menu peuple, condamné à la faiblesse par son isolement, n’a aucune force de résistance ni d’attaque. Il compose une sorte de matière plastique que l’administration façonne à son gré et qui lui échappe avec la même facilité. Ces gens-là tiennent du roseau plus que du chêne.
Mais voici que l’aspect du pays change. Aux vallons accidentés succède un sol plat, coupé de haies vives, avec des alternatives de labours et de landes. Des chemins primitifs, aux ornières profondes, s’enfoncent et tournent sous les doubles rangées de chênes trapus, au tronc vidé par le temps. Comment les lourds chariots de bœufs peuvent circuler à travers les fondrières qui ne sèchent jamais, franchir des pentes invraisemblables, rouler et tanguer comme des bateaux en mer, et cependant arriver au but, c’est ce que les inventeurs du pavé de bois auraient quelque peine à comprendre, mais qui eût paru tout simple aux contemporains de saint Louis. Les bœufs à la robe fauve tachée de boue, aux maigres fanons, attelés deux par deux sous le joug, poursuivent leur marche sans jamais ralentir ni presser l’allure. Non moins flegmatique, le bouvier va devant, son aiguillon sur l’épaule, grave comme un porte-croix. Il chante une chanson monotone qui, dans son opinion, soutient le pas de son attelage ; cela s’appelle tarauder les bœufs. Il est difficile de voir par quels signes extérieurs ces bêtes manifestent leur satisfaction ; mais on serait mal vu dans le pays si l’on mettait en doute l’efficacité de cette musique. L’aspect d’un pareil équipage en dit plus qu’un gros volume sur les mœurs des habitants. Qui peut suivre ainsi son chemin sans se presser, sans éviter un détour, sans interrompre sa chanson, est un homme que l’inquiétude du siècle n’a pas mordu à fond. Un autre trait de cet étrange et charmant pays, c’est que, une fois engagé dans le dédale compliqué des routes, on fait plusieurs lieues sans aucun horizon. La forêt se confond avec le village ; et pour apercevoir un clocher, à moins d’être devant l’église, il faudrait grimper sur un arbre. C’est une vie douce, sinon très active, celle à qui l’horizon fait défaut. La pensée ne franchit pas si rapidement les distances, mais elle n’embrasse rien que la volonté ne puisse atteindre. Il semble qu’un pays si fermé, si bien clos, soit moins ouvert au souffle des idées nouvelles. Ces haies vénérables, barrières vivantes qui ont arrêté longtemps la révolution, ne cachent plus aucun fusil de chouan, mais favorisent la force d’inertie. Elles ralentissent l’invasion des courants du dehors. Elles enveloppent de leur réseau onduleux les champs, les prés et les métairies, retenant au passage ce qui subsiste des vieilles croyances. On se défend difficilement contre le charme de ces lieux, et si l’on reste seulement quelques jours, on est bientôt gagné par un délicieux engourdissement qui endort les soucis.
C’est ainsi que, sur le territoire d’une même nation, bien plus, dans l’enceinte d’une même province, on peut, en se promenant, remonter le cours des âges. Pour connaître les mœurs de nos pères, nous n’avons pas besoin de soulever la poussière des bibliothèques ; il suffit de changer de place et d’ouvrir les yeux. Quelques kilomètres de distance mettent cent ans d’intervalle entre un habitant et un autre. Plaisant progrès qu’une rivière borne ! mais cette borne n’a rien d’immuable : elle se déplace sans cesse ; et toutes les fractions du territoire, ou, pour mieux dire, les cœurs des hommes obéissent un peu plus tôt, un peu plus tard, au mouvement qui emporte la nation tout entière. Le Bocage cède à son tour. Il n’a pu résister aux larges brèches que la civilisation pratique depuis vingt ans à travers ses défenses naturelles. Un chemin bien damé appelle une carriole, laquelle suppose un cheval ; tous deux inspirent à l’individu voiture le goût de l’impulsion rapide, et le conduisent, par une pente irrésistible, au chemin de fer le plus proche. Déjà, les jours de foire, les yeux du métayer ont perdu leur placidité habituelle. Il ne retrouve une partie de son flegme qu’une fois rentré chez lui, lorsqu’il s’enfonce dans les chemins ravinés et qu’il reprend, avec l’aiguillon, sa chanson paisible. Mais le calme profond des anciens jours, le retrouvera-t-il jamais ? Il a senti l’air du dehors. Bon gré mal gré, il faudra qu’il secoue sa nonchalance, et qu’il se mette, comme les autres, à espérer, à craindre, à transformer ses désirs en calculs, ses calculs en actes, en un mot, à vivre.
Tel qu’il est, cet être de transition, suspendu entre les deux abîmes du passé et de l’avenir, tient entre ses mains une petite part de nos destinées présentes, et peut, avec son faible poids, déplacer les majorités. Pénétrons un instant dans son intérieur. Un moyen presque infaillible de savoir quels sentiments se cachent sous la rude écorce du chef de famille, c’est, de regarder la femme. Celle-ci a la voix musicale, les attaches fines, un air modeste et tranquille. Elle porte la coiffe blanche du pays. Évidemment, elle ne fléchit pas sous des travaux trop rudes, et n’est pas non plus secrètement minée par une vanité mal satisfaite. Le dimanche, elle porte avec grâce son costume traditionnel et ne se couvre pas de nouveautés ridicules. Elle se plaît dans sa condition ; elle n’a pas encore la pensée d’en sortir. Déjà, peut-être, le mari couve des projets ambitieux, tandis que la femme, dont la vue est plus bornée, respire l’ancienne sérénité. C’est un moment à saisir : demain, si le hasard la fait entrer en contact avec la ville, ou si son époux la met de moitié dans ses calculs, la simplicité patriarcale s’envolera ; l’honnête petit bonnet blanc sera remplacé par l’horrible chapeau. Moins mesurée que l’homme, elle anticipera sur l’avenir, et le premier effet du progrès sera de la rendre laide. Éspérons que, sous ses atours d’emprunt, elle conservera la plupart de ses vertus domestiques, et qu’elle y joindra la prévoyance et la pénétration des « dames de la grande culture », auxiliaires indispensables des entreprises conjugales. Souhaitons aussi que l’époux apporte à la démocratie un lot de qualités solides. Quels que soient les desseins qu’il forme ou les opinions qu’il embrasse, il y mettra sans doute l’esprit de suite, la ténacité, la réflexion qui, à d’autres époques, ont rendu ses vengeances si redoutables.
On rencontre çà et là dans certains départements, des régions que la nature semble avoir sévèrement traitées. Naguère encore, il n’y a pas trente ans, on les considérait comme à peu près inabordables. Pas un arbre, si ce n’est dans quelques combes étroites ; un sol aride, couvert de bruyères et d’ajoncs ; des eaux stagnantes qu’aucune pente ne sollicite ; de maigres pâturages, marqués de taches sombres ou rougeâtres ; un horizon morne : tel apparaît, dans maint endroit, l’aspect de ces tristes cantons. Bêtes et gens se ressentent d’un pareil milieu. Les maisons sont basses et mal crépies. Les pierres des murs, grossièrement jointes avec un peu de boue, disparaissent dans une teinte grise uniforme. Les étables sont infectes. Le fumier pourrit devant chaque porte, car c’est une opinion bien établie qu’on l’améliore en marchant dessus. Dans ces maisons-là, on se nourrit mal : quelques pommes de terre, un peu de lard, et, les jours de fête seulement, de la viande douce, voilà les plus grands régals qu’on se permette. Le vin y est presque inconnu, et remplacé par de la boisson ou par une mauvaise eau-de-vie de grains. Tous les habitants d’un village pourraient à peine, en réunissant leurs ressources, atteler un bidet à une charrette. Mal nourris et médiocrement vêtus, ils ont moins de force musculaire que la plupart de leurs compatriotes. Ces quartiers sont bien connus des conseils de revision, qui refusent la moitié des conscrits pour arrêt de développement. Un vieil habitant du pays me racontait qu’autrefois on n’en prenait même pas le quart. Ces pauvres êtres, aux membres décharnés, à la face douce et résignée, défilaient humblement devant les autorités, étalant leur triste nudité, comme dans les Jugements derniers de nos cathédrales, où les élus sont aussi piteux que les damnés. C’était un Moyen Âge ambulant. Le général faisait la grimace, et le préfet, avec une impertinence administrative qui était de bon ton dans ce temps-là, s’écriait, à chaque exhibition nouvelle : « Toi, tu es trop laid. Va te cacher ! »
Aujourd’hui, le pays est en pleine transformation. Non seulement les préfets sont plus polis, et les conseils de révision moins difficiles, mais les hommes sont réellement plus forts, parce que la terre est mieux cultivée. Quelques villages seulement ont conservé l’air délabré des anciens jours. Partout ailleurs, les maisons sont mieux aérées, la nourriture plus solide ; la blancheur du plâtre égayé la bâtisse primitive, le bétail engraisse, l’homme s’épanouit. Au dehors, le sol se couvre de gerbes un peu maigres encore. Des canaux de drainage dessèchent les marais. Autour des terres nouvellement retournées, on a semé, pour protéger les frêles moissons contre le vent, une triple rangée d’arbres forestiers. Les jeunes plants de chênes et de peupliers ont déjà passé hauteur d’homme et mêlent un parfum sauvage à l’odeur des granges. Le dimanche, les femmes sont toujours vêtues de droguet et leurs maris de gros drap, mais ils ont un aspect de santé et de propreté. Depuis trente ans, la charrue n’a pas cessé d’attaquer vaillamment ce terroir. La lande et le marécage reculent tous les jours.
Ce résultat est dû principalement à l’accord des petits propriétaires avec les gros. Est-ce que, dans tous les temps, le péril commun n’a pas groupé les petits États derrière les grands ? le péril ici est de mourir de faim, ou tout au moins de rester indéfiniment embourbé dans une misère crasse. On y croupissait depuis une dizaine de siècles sans avoir l’idée d’en sortir : aujourd’hui ces populations paisibles ont entrevu une condition meilleure ; elles ne peuvent plus supporter leur ancienne ordure. Quiconque les en tire est le bienvenu. Peu leur importe au nom de quel principe, sous l’invocation de quel saint on leur tend une main secourable. Elles ne demandent point ce que pense le voisin, mais comment il amende son champ. La seule affaire sérieuse, c’est le défrichement. Le capital ici n’est point un gros monsieur qui se repose après fortune faite, et se drape dans l’immobilité des droits acquis : c’est un personnage actif, familier, nécessaire, et très considéré. Singulier contraste : dans une vallée opulente, on se déteste ; dans un désert repoussant, on s’unit. Pour résoudre la question sociale, n’ouvrez point aux hommes un eldorado : donnez-leur plutôt les marais Pontins à dessécher.
On peut suivre, de commune en commune et presque de porte en porte, tous les degrés par lesquels passe un paysan, depuis l’abrutissement séculaire jusqu’à l’émancipation complète. Parfois, le cultivateur vit dans l’eau ; il a l’œil terne, le dos voûté, les membres racornis, avec l’expression effarouchée et défiante d’un fauve surpris dans sa bauge. Un peu plus loin, il relève déjà l’échine. Il prévoit et réfléchit, mais ce sont des calculs d’enfant. Pour entasser quelques sous au fond d’un vieux bas, il retranche sur sa nourriture, au risque d’affaiblir ses forces. Sur son front bas et obstiné, recouvert d’une toison crépue comme la tête d’un taureau, un pli profond révèle l’idée fixe et la volonté indomptable. Plus loin encore, son confrère se redresse tout à fait. Héritier d’une certaine indépendance, il n’est point déformé par un travail trop lourd. Il est simple et robuste, circonspect plutôt que défiant ; jeune, il a une gravité précoce.
Quel plaisir de longer les rives abruptes d’un fleuve naissant, assez fort pour frayer son chemin, trop voisin de sa source pour charrier des éléments impurs, encore limpide et sentant la forêt ! Tel apparaît le paysan, lorsque l’initiative, qui sommeillait en lui, s’éveille, et que son front s’éclaire d’un rayon de soleil levant. Fidèle encore aux mœurs et aux vêtements de ses pères, étranger aux convoitises déréglées, libre et calme dans ses allures, il s’avance d’un mouvement égal, fécondant le sol sur son passage : mais déjà la pente se précipite, le flot se trouble et une attraction invincible l’entraîne vers des destinées nouvelles.
La population n’est affranchie nulle part des influences locales, et souvent, quand elle croit s’émanciper, elle ne fait que changer de maître.





























