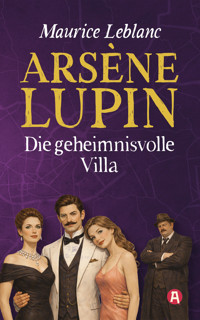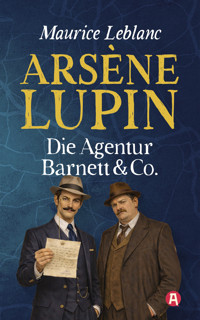0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Morestal, fils et petit-fils de riches paysans, avait décuplé la fortune de ses pères en fondant une scierie mécanique à Saint-Élophe, gros bourg voisin. C’était un homme tout d’une pièce, comme il disait, « sans double fond, rien dans les mains, rien dans les poches »… quelques idées morales directrices, aussi simples et aussi vieilles que possible, et ces quelques idées soumises elles-mêmes à un sentiment qui dominait toute sa vie et réglait tous ses actes, l’amour du pays. Sentiment qui, chez Morestal, signifiait le regret du passé, la haine du présent, et surtout l’âpre souvenir de la défaite.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
LA FRONTIÈRE
ROMAN INÉDIT
par Maurice Leblanc
(Roman-feuilleton publié du 16 décembre 1910 au 23 janvier 1911.)
© 2021 Librorium Editions
ISBN : 9782383830337
première partieI
— Ça y est !
— Quoi ?
— Le poteau allemand… au rond-point de la Butte-aux-Loups.
— Eh bien ?
— Renversé.
— Non !
— Regarde toi-même.
Le vieux Morestal s’écarta. Sa femme sortit du salon et prit place devant le trépied qui supportait la longue-vue, à l’extrémité de la terrasse.
— Je n’aperçois rien, dit-elle au bout d’un instant.
— Tu ne vois pas un arbre plus haut que les autres, avec un feuillage plus clair ?
— Oui.
— Et à droite de cet arbre, un peu au-dessous, un espace vide entre des sapins ?
— Oui.
— C’est le rond-point de la Butte-aux-Loups, qui marque la frontière à cet endroit.
— Ah ! j’y suis… voilà… Par terre, n’est-ce pas ? couché dans l’herbe… absolument comme si l’orage de cette nuit l’avait déraciné…
— Que dis-tu ? On l’a bel et bien abattu à coups de hache… l’entaille est visible d’ici.
— En effet… en effet…
Elle se releva et, hochant la tête :
— C’est le troisième, cette année… Ça va encore faire des histoires.
— Eh ! quoi, s’écria-t-il, ils n’ont qu’à remplacer leur bout de bois par un poteau solide.
Et il ajouta, d’un ton d’orgueil :
— Le poteau français qui est à deux mètres de là ne bouge pas, lui !
— Parbleu ! il est en fonte et scellé dans la pierre.
— Qu’ils en fassent autant ! Ce n’est pas l’argent qui leur manque… Avec les cinq milliards qu’ils nous ont volés !… Non, mais tout de même… le troisième en huit mois… Comment vont-ils prendre la chose, de l’autre côté des Vosges ?
Il ne pouvait dissimuler le sentiment ironique et joyeux qui le remplissait d’aise, et il allait et venait sur la terrasse en frappant des pieds, très fort.
Mais, s’approchant soudain de sa femme, il la saisit par le bras et prononça d’une voix sourde :
— Veux-tu savoir le fond de ma pensée ?
— Oui.
— Eh bien, tout ça finira mal.
— Non, déclara paisiblement la vieille dame.
— Comment, non ?
— Voilà trente-cinq ans que nous sommes mariés, et, depuis trente-cinq ans, tous les huit jours, tu me dis que ça finira mal. Alors, tu comprends…
Elle lui tourna le dos et rentra dans le salon où elle se mit à épousseter les meubles avec un plumeau.
Il haussa les épaules.
— Oh ! toi, évidemment, tu es la mère tranquille. Rien ne t’émeut. Pourvu que tes armoires soient en ordre, ton linge au complet, et tes confitures dans leurs pots !… Tu ne devrais pourtant pas oublier qu’ils ont tué ton pauvre père.
— Je ne l’oublie pas… Seulement, que veux-tu, il y a plus de quarante ans…
— C’était hier, dit-il à voix basse, hier, pas plus tard qu’hier…
— Tiens, voilà le facteur, dit-elle, se hâtant de changer la conversation.
On entendait en effet un pas lourd du côté des fenêtres qui donnaient sur le jardin. Le marteau de la porte, au rez-de-chaussée, retentit. Un instant après, Victor, le domestique, apportait le courrier.
— Ah ! dit Mme Morestal, une lettre du fils… Ouvre-la donc, je n’ai pas mes lunettes… Sans doute, il nous confirme son arrivée pour ce soir, puisqu’il devait quitter Paris ce matin.
— Pas du tout ! s’écria M. Morestal, qui parcourait la lettre. Philippe et sa femme ont conduit leurs deux fils chez des amis à Versailles, et ils sont partis avec l’intention de coucher le soir au ballon de Colnard, d’assister au lever du soleil, et de faire la route à pied, le sac au dos. À midi, ils seront ici.
Elle s’affola.
— Et l’orage ! L’orage de cette nuit ?
— Mon fils s’en moque de l’orage. C’est un gaillard qui en a vu bien d’autres. Il est onze heures. Dans une heure nous l’embrasserons.
— Mais c’est impossible ! Rien n’est prêt pour les recevoir.
Elle se mit à l’œuvre sur-le-champ avec toute son activité de petite vieille, un peu trop grosse, un peu lasse, mais alerte encore, et si méthodique, si ordonnée, qu’elle ne risquait pas un mouvement qui ne fût indispensable et ne lui apportât un avantage immédiat.
Lui, il reprit sa promenade entre la terrasse et le salon. Il marchait à grands pas égaux, le buste droit, les mains dans les poches de son veston, un veston de jardinier en coutil bleu, d’où l’on voyait émerger la pointe d’un sécateur et le tuyau d’une pipe. Il était haut de taille, épais d’encolure, et son visage, au teint coloré, semblait jeune encore, malgré le collier de barbe blanc qui l’encadrait.
— Ah ! s’écria-t-il, ce bon Philippe, quelle joie ! Il y a trois ans déjà qu’on ne s’est vu. Parbleu ! depuis sa nomination à Paris comme professeur d’histoire. Bigre, en voilà un qui a fait son chemin ! Ce que nous allons le soigner pendant ces quinze jours ! De la marche… de l’exercice… Eh ! quoi, c’est un homme de plein air, comme le vieux Morestal !
Il se mit à rire :
— Sais-tu ce qu’il lui faudrait ? Six mois de bivouac du côté de Berlin.
— Je suis tranquille, déclara-t-elle, il a passé par l’École normale. En temps de guerre, les professeurs ne quitteront pas leur garnison.
— Qu’est-ce que tu chantes ?
— C’est l’instituteur qui me l’a dit.
Il sursauta.
— Comment tu lui adresses encore la parole, à ce pleutre-là ?
— C’est un très brave homme, assura-t-elle.
— Lui, un brave homme ! avec de pareilles théories !
Elle s’empressa de sortir pour éviter la bourrasque. Mais Morestal était lancé :
— Oui, oui, des théories ! Je maintiens le mot… des théories ! Comme conseiller d’arrondissement, comme maire de Saint-Élophe, j’ai le droit d’assister à ses leçons. Ah ! tu n’imagines pas !… Il a une manière d’enseigner l’histoire de France !… De mon temps, les héros, c’était le chevalier d’Assas, c’était Bayard, c’était La Tour D’Auvergne, tous ces bougres qui ont illustré un pays. Aujourd’hui, c’est Mossieu Étienne Marcel, Mossieu Dolet… Ah ! elles sont propres, leurs théories.
Il barra le chemin à sa femme qui rentrait, et lui jeta au visage :
— Sais-tu pourquoi Napoléon a perdu la bataille de Waterloo ?
— Impossible de retrouver le bol à café au lait, dit Mme Morestal, tout entière à ses occupations.
— Eh bien, demande-le à ton instituteur, il te donnera sur Napoléon les théories du jour.
— Je l’avais mis moi-même sur ce bahut.
— Mais voilà, on s’ingénie à déformer l’esprit des enfants.
— Ça dépare ma douzaine.
— Ah ! je te jure bien qu’autrefois nous l’aurions fichu à l’eau, notre maître d’école, s’il avait osé… Mais fichtre, la France avait alors sa place au soleil. Et quelle place ! C’était l’époque de Solférino !… de Magenta !… On ne se contentait pas alors de démolir les poteaux des frontières… on les franchissait, les frontières, et au pas de course…
Il s’arrêta, hésitant, l’oreille tendue. Des sonneries de trompettes retentissaient au loin, sautaient de vallon en vallon, doublées et triplées par l’obstacle des grands rochers de granit, et se dispersaient de droite et de gauche comme étouffées par l’ombre des forêts.
Il murmura, tout ému :
— Le clairon français…
— Tu es sûr ? dit-elle.
— Oui, il y a des troupes d’alpins en manœuvre… une compagnie de Noirmont… Écoute… écoute… Quelle gaieté !… Quelle crânerie ! Ah ! à deux pas de la frontière, ça prend une allure…
Elle écoutait aussi, pénétrée de la même émotion, et elle dit avec anxiété :
— Est-ce que tu crois vraiment que la guerre soit possible ?
— Oui, répondit-il, je le crois.
Ils se turent un instant. Et Morestal reprit :
— C’est un pressentiment chez moi… Ça va recommencer comme en 70… Et pour sûr, j’espère bien, cette fois…
Elle déposa son bol à café qu’elle avait découvert dans un placard et, s’appuyant au bras de son mari :
— Dis donc, le fils arrive… avec sa femme, qui est une bonne femme, que nous aimons bien… Je voudrais que la maison soit jolie pour les recevoir, gaie, pleine de fleurs… Va cueillir les plus belles de ton jardin.
Il sourit.
— Autant dire que tu me trouves un peu rengaine, hein ? Que veux-tu ? Je le serai jusqu’au dernier jour. La blessure est trop profonde pour jamais se fermer.
Ils se regardèrent un moment, avec une grande douceur, comme deux vieux compagnons de voyage qui, de temps en temps, sans raison très précise, s’arrêtent, mêlent leurs yeux et leurs pensées, et repartent.
Il lui dit :
— Faut-il couper mes roses… mes Gloires de Dijon ?
— Oui.
— Allons-y ! Soyons héroïque.
Morestal, fils et petit-fils de riches paysans, avait décuplé la fortune de ses pères en fondant une scierie mécanique à Saint-Élophe, gros bourg voisin. C’était un homme tout d’une pièce, comme il disait, « sans double fond, rien dans les mains, rien dans les poches »… quelques idées morales directrices, aussi simples et aussi vieilles que possible, et ces quelques idées soumises elles-mêmes à un sentiment qui dominait toute sa vie et réglait tous ses actes, l’amour du pays. Sentiment qui, chez Morestal, signifiait le regret du passé, la haine du présent, et surtout l’âpre souvenir de la défaite.
Devenu maire de Saint-Élophe, puis conseiller d’arrondissement, il avait vendu son usine et s’était fait construire, en vue de la frontière et sur l’emplacement d’un moulin en ruines, une maison spacieuse, dessinée selon ses plans, et bâtie, pour ainsi dire, en sa présence. Ils y vivaient depuis une dizaine d’années, avec deux domestiques, Victor, brave homme tout rond, à face réjouie, et Catherine, servante bretonne qui avait nourri Philippe.
Ils voyaient peu de monde en dehors de quelques amis, dont les plus assidus étaient le commissaire spécial du gouvernement, Jorancé, et sa fille Suzanne.
Le Vieux-Moulin occupait le sommet arrondi d’une colline aux pentes de laquelle s’étageaient d’assez vastes jardins que Morestal cultivait avec une véritable passion. Un haut mur, garni sur le faîte d’un treillis de fer hérissé de pointes, entourait la propriété. Une source jaillissait de place en place et retombait en cascades au creux de rochers que décoraient des plantes sauvages, de la mousse et des capillaires.
Morestal cueillit une moisson de fleurs, dévasta sa roseraie, immola toutes les Gloires de Dijon dont il était si fier, et revint au salon où il disposa lui-même les bouquets dans de grands vases de cristal.
La pièce, sorte de hall situé au centre de la maison, avec des poutres de bois apparentes et une énorme cheminée où luisaient des cuivres, la pièce était claire et joyeuse, ouverte sur les deux façades ; à l’est, sur la terrasse, par une longue baie ; à l’occident, par deux fenêtres, sur le jardin qu’elle dominait de la hauteur d’un premier étage.
Au mur s’étalaient des cartes d’état-major, des cartes du ministère de l’Intérieur, des cartes de cantons. Il y avait un râtelier de chêne qui portait douze fusils, tous semblables et d’un modèle récent. À côté, clouées à même le bois, grossièrement cousues les unes aux autres, salies, usées, lamentables, trois loques bleu, blanc, rouge.
— Ça fait bon effet, tout cela, qu’en dis-tu ? conclut-il, comme si sa femme eût été dans le salon. Maintenant, je crois qu’une bonne pipe…
Il sortit sa blague, des allumettes et, traversant la terrasse, il s’appuya contre la balustrade de pierre qui la bordait.
Des vallons et des collines se mêlaient en courbes harmonieuses, toutes vertes, par endroits, du vert allègre des pâturages, toutes sombres du vert mélancolique des sapins et des mélèzes.
Au-dessous de lui, à trente ou quarante pieds, passait la route qui monte de Saint-Élophe au Vieux-Moulin. Elle contournait les murs, puis redescendait jusqu’à l’Étang-des-Moines, dont elle suivait la rive gauche. Interrompue soudain, elle se continuait en un mauvais sentier que l’on voyait au loin, dressé comme une échelle contre un rempart, et qui s’engageait dans une coupure étroite, entre deux montagnes d’aspect plus âpre, de forme plus heurtée que les paysages ordinaires des Vosges. C’était le col du Diable, situé à quinze cents mètres et au niveau du Vieux-Moulin.
Quelques bâtisses s’accrochaient à l’un des versants du col, la ferme Saboureux. De la ferme Saboureux à la Butte-aux-Loups, que l’on apercevait sur la gauche, si l’on suivait une ligne dont Morestal connaissait tous les points de repère, toutes les sinuosités invisibles, toutes les montées et toutes les descentes, on discernait et l’on devinait la frontière.
— La Frontière, murmura-t-il… La Frontière ici… à vingt-cinq lieues du Rhin… en pleine France !
Chaque jour, et dix fois par jour, il se torturait ainsi à la contempler, la ligne implacable et douloureuse, et, au-delà d’elle, par des échappées que son imagination découpait à même les Vosges, il évoquait, dans la brume de l’horizon, la plaine allemande.
Et cela aussi, il se le répétait, et il se le répéta cette fois comme les autres, avec une amertume que les années ne calmaient point.
— La plaine allemande… les collines allemandes… tout ce pays d’Alsace où je me promenais, enfant… le Rhin français, qui était mon fleuve et celui de mes pères. Deutschland… Deutsches Rhein…
Un sifflement léger le fit tressaillir. Il se pencha vers l’escalier qui gravissait la terrasse, taillé en plein roc, et par lequel ceux qui venaient de la frontière entraient souvent chez lui pour éviter le tournant de la route. Il n’y avait personne, et personne non plus en face, sur le talus, enchevêtré d’arbustes et de fougères.
Et le même bruit recommença, discret, sournois, formé des mêmes modulations.
— C’est lui… c’est lui… pensa M. Morestal, avec un sentiment de gêne.
Une tête jaillit entre les buissons, une tête où tous les os saillaient, rejoints par des muscles en relief, ce qui lui donnait l’air d’une tête de pièce anatomique. Sur l’os du nez, des lunettes de cuivre. Au travers du visage, comme une balafre, la bouche édentée, grimaçante.
— Encore toi, Dourlowski.
— Je peux venir ? fit l’homme.
— Non… non… tu es fou…
— Ça presse.
— Impossible… Et puis, tu sais, je ne veux plus. Je te l’ai déjà dit…
Mais l’homme insistait :
— Ce serait pour ce soir, pour cette nuit… C’est un soldat de la garnison de Bœrsweilen… Il ne veut plus porter l’uniforme allemand.
— Un déserteur… j’en ai assez… fiche-moi la paix.
— Faites pas le méchant, monsieur Morestal… Réfléchissez… Tenez, on se retrouvera vers quatre heures, au col, près de la ferme Saboureux… comme la dernière fois… Je vous attends. On causera… et c’est bien le diable…
— Silence ! fit Morestal.
Une voix criait du salon :
— Les voilà, monsieur, les voilà !
C’était le domestique, et Mme Morestal accourut également et dit :
— Qu’est-ce que tu fais donc là ? Avec qui parlais-tu ?
— Avec personne.
— Mais si, j’entendais…
— Non, je t’assure…
— Ah ! j’avais cru… Et bien, tu sais, tu avais raison… Il est midi, et les voilà tous deux.
— Philippe et Marthe ?
— Oui, ils arrivent. Ils sont presque à l’entrée du jardin. Dépêchons-nous…
II
Il n’a pas changé… Toujours son teint frais… Les yeux un peu fatigués, peut-être… mais la mine est bonne…
— Avez-vous fini de m’éplucher tous les deux ? dit Philippe en riant. Quelle inspection ! Embrassez plutôt ma femme.
Marthe se jeta dans les bras de Mme Morestal, puis dans les bras de son beau-père, et, à son tour, elle fut examinée des pieds à la tête.
— Oh ! oh ! la figure est moins pleine… Nous avons besoin de nous refaire… Mais ce que vous êtes trempés, mes pauvres enfants !
— Nous avons reçu tout l’orage, dit Philippe.
— Et savez-vous ce qui m’est arrivé ? dit Marthe, j’ai eu peur !… Oui, peur, comme une fillette… et je me suis évanouie… Et Philippe a dû me porter… pendant une heure au moins…
— Hein ! dit le vieux Morestal à sa femme… pendant une demi-heure ! Toujours solide, le garçon. Et tes fils, pourquoi ne les as-tu pas amenés ? C’est dommage. Deux braves petits gosses, je suis sûr. Et bien élevés… Je connais Marthe ! Quel âge ont-ils ? Dix ans, n’est-ce pas, et neuf ans ? À propos, la mère a préparé deux chambres. On fait donc chambre à part, maintenant ?
— Oh ! non, dit Marthe, ici seulement… Philippe veut se lever au petit jour et battre les grands chemins… tandis que moi, j’ai besoin de repos.
— Parfait ! parfait ! Conduis-les, la mère… et sitôt prêts, à table, les enfants ! Le déjeuner fini, je prends la voiture et je vais chercher les malles à Saint-Élophe, où la diligence du chemin de fer les apportera. Et si je rencontre mon ami Jorancé, je le ramène. Il doit être tout triste. Sa fille est partie ce matin pour Lunéville. Mais elle m’a dit qu’elle vous avait écrit…
— Oui, oui, fit Marthe. Suzanne m’a écrit l’autre jour. Elle non plus n’est pas gaie de partir.
Deux heures plus tard, Philippe et sa femme s’installaient dans deux jolies chambres voisines, situées au second étage, et qui avaient vue sur le côté français. Marthe se jetait sur son lit et s’endormait presque aussitôt, tandis que son mari, accoudé à la fenêtre, regardait le paisible vallon où s’étaient écoulés les jours les plus heureux de son enfance.
C’était là-bas, au bourg de Saint-Élophe-la-Côte, dans le modeste logis que ses parents habitaient avant le Vieux-Moulin. Interne au collège d’Épinal, il passait au village d’enthousiastes vacances à jouer ou bien à courir les Vosges en compagnie de son père – papa Trompette, comme il l’appelait, en raison de toutes les trompettes, clairons, cors et cornets, qui constituaient avec des tambours de tous les modèles, avec des épées et des poignards, des casques et des cuirasses, des fusils et des pistolets, les seuls cadeaux que connût son jeune âge. Un peu sévère, Morestal, un peu trop attaché à ce qui concernait les principes, les usages, la discipline, l’exactitude, un peu emporté, mais si bon, et sachant si bien se faire aimer de son fils, d’une affection si respectueuse et si franche !
La seule fois qu’ils se heurtèrent, ce fut le jour où Philippe, alors élève de philosophie, annonça son intention de poursuivre ses études au-delà du baccalauréat et d’entrer à l’École Normale. Tout le rêve du père s’écroulait, son beau rêve de voir Philippe en uniforme, des soutaches d’or à la manche de son dolman, le sabre au côté.
Choc véhément et douloureux où Morestal, stupéfait, se trouva en face d’un Philippe obstiné, réfléchi, maître de lui, et fermement résolu à conduire sa vie comme il l’entendait et selon ses propres aspirations. Durant une semaine, on disputa, on se fit du mal, on se réconcilia pour se fâcher encore. Puis le père céda tout d’un coup, au milieu d’une discussion, et comme s’il comprenait subitement la vanité de ses efforts.
— Tu le veux ? s’écria-t-il, soit ! Tu seras pion, puisque c’est ton idéal, mais je t’avertis que je décline toute responsabilité quant à l’avenir, et que je me lave les mains de ce qui arrivera.
Il arriva tout simplement que la carrière de Philippe fut rapide et brillante et que, après un stage à Lunéville, puis un autre à Châteauroux, il était nommé à Versailles professeur d’histoire. Il publiait alors, à quelques mois d’intervalle, deux livres remarquables et qui soulevèrent d’ardentes controverses : L’Idée de patrie dans la Grèce antique, et L’Idée de patrie avant la Révolution. Trois ans plus tard, on l’appelait à Paris, au lycée Carnot.
Philippe, aujourd’hui, approchait de la quarantaine. Le travail et les veilles ne semblaient pas avoir de prise sur sa rude nature de montagnard. Solidement musclé, aussi robuste que son père, il se reposait de l’étude par de violents exercices, par de longues courses à bicyclette dans les campagnes et dans les bois de la banlieue. Au lycée, les élèves, qui, d’ailleurs, avaient pour lui une sorte de vénération, se racontaient ses exploits et ses tours de force.
Avec cela, un grand air de douceur, et des yeux surtout, des yeux bleus très bons, souriants quand il parlait, et, au repos, naïfs, enfantins presque, emplis de rêve et de tendresse.
Maintenant, le vieux Morestal était fier de son fils. Le jour où il avait appris sa nomination à Carnot, il écrivait ingénument :
« Bravo ! mon cher Philippe, te voilà arrivé, et en passe de prétendre à tout ce que tu voudras. Je t’avouerai que je n’en suis nullement surpris, ayant toujours prévu qu’avec tes qualités, ta persévérance et ta façon sérieuse d’envisager la vie, tu conquerrais la place que tu mérites. Donc, encore bravo ! Te dirai-je pourtant que ton dernier livre, sur l’idée de patrie en France, m’a quelque peu dérouté ? Je suis sûr, évidemment, que tes opinions ne changeront pas à ce propos, mais il me semble que tu cherches à expliquer l’idée de patrie par des motifs plutôt subalternes, et que cette idée te paraît, non pas inhérente aux sociétés humaines, mais passagère et comme un progrès momentané de la civilisation. J’ai mal compris sans doute. N’importe, ton livre n’est pas très clair. On croirait que tu hésites. J’attends avec impatience l’ouvrage que tu annonces sur l’idée de patrie à notre époque et dans l’avenir… »
Ce livre, auquel Morestal faisait allusion, était prêt depuis un an, sans que Philippe, pour des raisons qu’il tenait secrètes, consentît à le livrer à son éditeur.
— Tu es heureux d’être au pays ?
Marthe s’était approchée et avait croisé les deux mains sur son bras.
— Très heureux, dit-il. Et je le serais encore davantage, s’il ne devait pas y avoir entre mon père et moi cette explication… que je suis venu chercher.
— Tout se passera bien, mon Philippe. Ton père a tant d’affection pour toi ! Et puis tu es si sincère !…
— Ma bonne Marthe, dit-il en l’embrassant au front avec tendresse.
Il l’avait connue à Lunéville, par l’intermédiaire de M. Jorancé dont elle était la petite cousine, et tout de suite il avait senti en elle la compagne de sa vie, celle qui le soutiendrait aux heures difficiles, celle qui lui donnerait de beaux enfants, qui saurait les élever et faire d’eux, avec son aide et ses principes, des hommes vigoureux et dignes de porter son nom.
Peut-être Marthe eût-elle souhaité davantage, et peut-être, jeune fille, avait-elle rêvé que la femme n’est pas seulement l’épouse et la mère, qu’elle est aussi l’amante de son mari. Mais elle vit bientôt que l’amour comptait peu pour Philippe, homme d’étude, et qui s’intéressait beaucoup plus aux spéculations de la pensée et aux problèmes sociaux qu’à toutes les manifestations du sentiment. Elle l’aima donc comme il voulait être aimé, étouffant en elle, ainsi que des flammes que l’on recouvre, toute une passion frémissante, faite de désirs inassouvis, d’ardeurs contenues, d’inutiles jalousies, et n’en laissant échapper que ce qu’il fallait pour le réchauffer aux heures du doute et de la défaite.
Petite, mince, d’aspect fragile, elle fut vaillante, dure à la peine, sans peur devant l’obstacle, sans déception après l’échec. Ses yeux noirs et vifs disaient son énergie. Malgré tout l’empire que Philippe exerçait sur elle, malgré l’admiration qu’il lui inspirait, elle garda sa personnalité, sa propre existence, ses goûts et ses haines. Et, pour un homme comme Philippe, rien ne pouvait avoir plus de prix.
— Tu ne dors pas un peu ? demanda-t-elle.
— Non. Je vais le rejoindre.
— Ton père ? dit-elle anxieusement.
— Oui, je ne veux pas tarder davantage. C’est déjà presque une mauvaise action que d’être venu ici et de l’avoir embrassé sans qu’il sache l’exacte vérité sur moi.
Ils demeurèrent silencieux assez longtemps. Philippe semblait indécis, tourmenté.
Il interrogea :
— Tu n’es pas de mon avis ? Tu trouves qu’il faut remettre à demain ?…
Elle lui ouvrit la porte.
— Non, dit-elle, tu as raison.
Elle avait de ces gestes imprévus qui coupent court aux hésitations et vous jettent en face des événements. Une autre se fût répandue en paroles. Marthe, elle, engageait tout de suite sa responsabilité, alors même qu’il s’agissait des plus petits faits de la vie ordinaire. C’est ce que Philippe appelait en riant l’héroïsme quotidien.
Il l’embrassa, tout réconforté par son assurance.
En bas, ayant appris que son père n’était pas de retour, il résolut de l’attendre au salon. Il alluma une cigarette, la laissa s’éteindre et, distraitement d’abord, puis avec un intérêt croissant, il regarda autour de lui, comme s’il cherchait à se renseigner auprès des choses sur celui qui vivait en leur intimité.
Il examina le râtelier où s’alignaient les douze fusils. Ils étaient tous chargés, prêts à servir. Contre quel ennemi ?
Il vit le drapeau qu’il avait si souvent contemplé dans l’ancienne maison de Saint-Élophe, le vieux drapeau déchiré dont il savait la glorieuse histoire.
Il vit les cartes pendues au mur, qui toutes décrivaient, en ses moindres détails, la frontière et les pays qui l’avoisinaient, à gauche et à droite des Vosges.
Il se pencha sur les rayons de la petite bibliothèque et lut les titres des ouvrages : La Guerre de 70, d’après le grand état-major allemand ; la Retraite de Bourbaki ; Comment préparer la revanche ?… ; le Crime des pacifistes.
Mais un volume attira son attention. C’était son livre sur l’idée de patrie. Il le feuilleta et, comme certaines pages étaient couvertes et balafrées de coups de crayon, il s’assit et se mit à lire.
— C’est bien cela, murmura-t-il au bout d’un instant. Pourra-t-on s’entendre désormais ? Sur quel terrain se placer l’un et l’autre ? Il est inadmissible qu’il accepte mes idées. Et comment me soumettre aux siennes ?
Il continua sa lecture, relevant des réflexions dont la rigueur le désolait. Vingt minutes s’écoulèrent ainsi dans un silence que troublait seulement le bruit des feuillets.
Et, soudain, il sentit deux bras nus qui lui entouraient la tête, deux bras nus et frais qui caressaient son visage. Il voulut se dégager. Les deux bras serrèrent leur étreinte.
Il fit un effort brusque et se leva.
— Vous ! s’écria-t-il en reculant, vous ici. Suzanne !
Une jolie créature se tenait devant lui, souriante à la fois et honteuse, en une attitude de provocation et de crainte, les mains jointes et les bras offerts de nouveau, de beaux bras savoureux et blancs qui émergeaient de sa chemisette de fine batiste. Ses cheveux blonds se séparaient en deux bandeaux ondulés et lâches dont les boucles indociles jouaient à l’aventure. Elle avait des yeux gris, très longs, avec des cils noirs qui les voilaient à demi, et ses petites dents riaient au bord de ses lèvres rouges, si rouges qu’on eût dit, bien à tort, qu’elles étaient peintes.
C’était Suzanne Jorancé, la fille de Jorancé, commissaire spécial, et l’amie de Marthe, qui l’avait connue tout enfant à Lunéville. L’hiver précédent, Suzanne avait passé quatre mois à Paris chez les Philippe Morestal.
— Vous, répéta-t-il, vous, Suzanne !
Elle répondit gaiement :
— Moi-même. Votre père est venu chez nous à Saint-Élophe. Comme le mien est en promenade, il m’a emmenée. Je suis descendue de voiture. Et me voici.
Il la saisit aux poignets, en une crise de colère, et, la voix sourde :
— Vous ne deviez pas être à Saint-Élophe ! Vous avez écrit à Marthe que vous partiez ce matin. Il ne fallait pas rester. Vous savez bien qu’il ne fallait pas rester.
— Pourquoi ? murmura-t-elle toute confuse.
— Pourquoi ? Parce que, à la fin de votre séjour à Paris, vous m’avez dit des paroles que j’avais le droit d’interpréter… où j’ai cru comprendre… et je ne serais pas venu… si votre départ…
Il s’interrompit, gêné lui-même par son emportement. Suzanne avait les larmes aux yeux, et une telle rougeur enflammait sa figure que ses lèvres sanglantes paraissaient à peine rouges.
Philippe, stupéfait des mots qu’il avait prononcés, et plus encore de ceux qu’il avait été sur le point de prononcer, Philippe éprouvait subitement, en présence de la jeune fille, le besoin d’être doux, amical, et de réparer son inexplicable brusquerie. Une pitié imprévue l’amollissait. Il saisit entre ses mains les petites mains glacées et, gentiment, avec une intonation de grand frère qui gronde :
— Pourquoi êtes-vous restée, Suzanne ?
— Je puis vous l’avouer, Philippe ?
— Mais oui, puisque je vous le demande, répondit-il, un peu inquiet.
— J’ai voulu vous voir, Philippe… Quand j’ai su que vous arriviez…, et qu’en retardant mon départ d’un jour… d’un seul jour… vous comprenez, n’est-ce pas ?…
Il se tut, pensant bien que, s’il répliquait le moindre mot, elle en dirait aussitôt qu’il ne voulait pas entendre. Et ils ne savaient plus comment se tenir l’un en face de l’autre, et ils n’osaient plus se regarder. Mais Philippe sentait les petites mains tiédir au contact des siennes, et toute la vie, en cet être jeune et tumultueux, affluer de nouveau ainsi qu’une source libérée qui ramène la joie, la force et l’espoir.
Des pas se faisaient entendre, et un bruit de voix s’éleva dans le vestibule.
— Monsieur Morestal, chuchota Suzanne.
Et le vieux Morestal criait, en effet, avant même d’entrer :
— Où es-tu donc, Suzanne ? Voilà ton père qui arrive. Vite, Jorancé, les enfants sont ici. Mais oui, ta fille également… je l’ai ramenée de Saint-Élophe… Mais toi, tu es donc venu par les bois ?
Suzanne enfila de longs gants de suède et, au moment même où la porte s’ouvrit, elle dit, d’un ton de résolution implacable, et comme si cette promesse devait combler Philippe de satisfaction :
— On ne verra plus mes bras nus… Personne ne les verra, je vous le jure, Philippe. Personne ne les caressera jamais…