
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Le mois de juin 1962 est très chaud à Oran. Ce jour-là Maurice, dit Momo, se retrouve seul à la maison avec son petit frère Alain, un bébé en couches. Ses parents ont disparu, alors Momo part chercher de l'aide (surtout pour changer les couches d'Alain), mais leur tante Rosine non plus n'est pas à la maison. Des Algériens en arme défilent dans les rues. Momo et Alain sont recueillis par le vieil Algérien qui leur vendait des légumes au marché. Il les ramène au bled. Mais il faut retourner en ville, retrouver les parents. Tout a changé et, de la famille, nulle trace. "La guerre au bout du couloir" a été récompensé en 2009 lors de sa première parution par la Prix de la Nouvelle Revue Pédagogique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur (sélection non exhaustive, intégralité à retrouver sur www.christophe-leon.fr) :
Littérature Jeunesse:
Longtemps, L'école des loisirs, coll. « Neuf », 2006
Pas demain la veille, éditions Thierry Magnier, 2007
La guerre au bout du couloir, Thierry Magnier, 2008
Silence, on irradie, éd. Thierry Magnier, 2009
Granpa', éd. Thierry Magnier, 2010
Délit de fuite, La Joie de Lire, coll. Encrage, 2011
Le goût de la tomate, éd. Thierry Magnier, coll. Petite Poche, 2011
La balade de Jordan et Lucie, éd. L'école des loisirs, coll. Medium, 2012
Mon père n'est pas un héros, éd Oskar, coll. Court Métrage, 2013
X-RAY la Crise, éd. La joie de lire, coll. Encrage, 2014
Embardée, éd. La joie de lire, coll. Encrage, 2015
Les mangues resteront vertes, éditions Talents Hauts, coll. Les Héroïques, 2016
Et j'irai loin, bien loin , éd. Thierry Magnier, coll. Grand Roman, 2017
La vie commence aujourd'hui, éd. La joie de lire, coll. Encrage, 2018
L'Île, Oskar éditeur, coll. Suspense, 2019
Black Friday, éd Le Muscadier, coll. Rester Vivant, 2020
Les dernières reines, (co-auteur Patricia Vigier), éd. Le Muscadier, coll.
Rester Vivant, 2021
Baba !, éd. La joie de lire, coll. Encrage, 2021
Missié, éd. D'Eux, coll. Hors collection, (illustrations Barroux), 2022
Tag, éd. Le Muscadier, coll. Rester Vivant, 2023
#StopAsiaHate, (co-auteur Patricia Vigier) éd. Le Muscadier, coll. Rester Vivant, 2024
L'affaire Ryan Lacombe, collection Polar, éd. Oskar, 2024
Pas de climat, pas de chocolat, éd. BoD, 2014
Rosemary Kennedy, l’effacée, collection La vie, éd. Oskar, 2024
Littérature Générale :
Tu t'appelles Amandine Keddha, Le Rouergue, coll. « La brune », 2002
Palavas la Blanche, Le Rouergue, coll. « La brune », 2004
Journal d'un étudiant japonais à Paris, éd. du Serpent à plumes, 2007
Beaux-arts, col, Fulgurances, éd. du Somnambule équivoque, 2008
Noces d'airain, éd Arhsens, 2008
ZAD, (co-auteur Julie Jézéquel) éd. JDH, coll. Nouvelles pages, 2021
FRANS 68, éd. Ramsay, coll. Littérature Roman, 2021
L'insurrection impériale, éd. Le Muscadier, coll. Le Muscadier Noir, 2023
Imago, éd. Ramsay, coll. Littérature Roman, 2023
Adaptation audiovisuelle :
Délit de fuite, adaptation télévisuelle du roman éponyme pour France 2
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
1
Ils m’ont crié :
— File !
Alors j’ai filé. J’ai couru longtemps, sans me retourner. Alain s’est pelotonné dans la poussette. Il s’est endormi.
Mes avant-bras sont douloureux. Je m’arrête. Je reprends mon souffle. Je fais quelques moulinets pour activer la circulation du sang.
Dans la rue, personne. Trop de voitures sont garées le long des trottoirs à cette heure de la matinée.
Soudain, Alain crie. Il va attirer l’attention sur nous. Je suis inquiet.
Dans le caniveau, je repère un caillou de la forme et de la grosseur d’un oeuf de pigeon. Je le ramasse. Il est lisse. Je crache dessus. Le nettoie sur la jambe droite de mon pantalon court. Il brille.
Alain braille maintenant à s’en faire friser les gencives. Sa figure est violette. Une grosse veine bleue traverse son front. Les larmes ne trouvent pas la sortie. Alain pleure à sec.
Je lui carre le caillou dans la bouche. Il le saisit d’une main. Il le suce avidement. Ça le calme.
Nous repartons — lui dans la poussette et moi arc-bouté sur les poignées recourbées.
*
Le mois de juin 1962 avait été chaud dans toute l’Algérie — très chaud.
Maman faisait couler l’eau dans l’évier. Avec une serpillière, elle en badigeonnait le carrelage de la cuisine. Ça brillait cinq minutes, puis ça s’assombrissait avant de s’évaporer en quelques secondes.
— Momo, va me chercher une glace. Tu veux bien ?
Maman me confiait une poignée de piécettes. Je les serrais fort dans la paume de la main. Je les comptais mentalement. J’estimais leur valeur.
Je galopais en quatrième vitesse chez le limonadier du coin de la rue, chez qui j’arrivais en sueur.
— Deux boules de citron glacé, s’il vous plaît.
Je demandais à l’Arabe, un bonhomme cartilagineux comme un scorpion de mer. Une grosse verrue sur le bout de son nez était semée d’un long poil en forme de cimeterre.
L’homme ouvrait la glacière. De la buée s’en échappait. Il y plongeait une main. La ressortait, armée d’une sorte de truelle concave au creux de laquelle une boule de citron adhérait.
De sa main libre, il saisissait un cornetbiscuit. Il y laissait choir la boule. La tassait puis la lissait avec le dos de l’instrument.
Pour finir, l’indigène enfilait le cornet dans un présentoir devant lui, juste au-dessus de mon nez, histoire de me faire saliver.
Il renouvelait l’opération. Mais cette fois, après une hésitation théâtrale et un clin d’oeil appuyé à mon intention, il rajoutait une demiboule dans le second cornet.
Je posais l’argent sur le comptoir. Il me tendait alors les deux glaces dont je m’emparais avec précaution.
Au balcon de son visage chevalin, un sourire à décrocher la lune pendulait sous son nez.
Je rentrais à la maison. Des larmichettes de glace fondue gouttaient sur le dos de ma main. Je n’osais pas les lécher de peur d’une catastrophe.
— Tu en as mis un temps…
Disait maman. Elle s’épongeait le front et les aisselles. Elle utilisait un mouchoir brodé aux initiales de mon arrière-grand-mère, morte avant ma naissance.
Elle jaugeait les deux boules de citron glacé dans leur cornet. Des miettes de zeste d’un jaune acide les piquetaient en surface.
Je les tenais bien droites devant moi, les bras raides. Maman faisait mine de prendre la plus grosse glace, puis se ravisait.
— Je crois que celle-ci est pour moi.
Toujours la même comédie, elle choisissait le cornet moins rempli. Jamais je n’ai pensé à la remercier. C’était un dû — du moins, étaisje certain que cela en était un.
*
En contrebas de l’avenue, j’aperçois le port. Au-delà, le miroir éblouissant de la mer, ses reflets électriques sont une invitation à venir y piquer une tête.
Alain dort. Ce n’est pas si mal. Il est calme. Il ne risque pas de me poser de problèmes, là,tel qu’il roupille. La pierre humide de salive est tombée sur ses genoux.
Ce n’est pas toujours facile d’avoir un petit frère. Il faut s’en occuper. Et justement, les parents, eux, s’en occupent — beaucoup trop.
Je prends sur la droite, dans la rue des Tirailleurs. Le port disparaît, caché derrière les immeubles. Plus loin, je remonte la rue des Fédérés. Au bout se trouve la maison de ma tante.
Dès le 1er juillet, nous sommes convenus mes parents et moi, qu’en cas de coup dur, je me réfugierais chez la soeur de mon père, Rosine.
Tante Rosine est célibataire. Elle ne s’est jamais mariée. Elle assure que les hommes ne sont pas faits pour elle.
En vérité, Rosine préfère l’église aux hommes.
Elle y va tous les jours — souvent deux fois par jour. Maman dit que c’est une bigote. Tante Rosine et elle ne s’entendent pas.
Maman est plutôt du style robe d’été bariolée à grosses fleurs, du genre pivoine dodue.
Ma tante, elle, opte plus simplement pour une chasuble demi-deuil sur une robe sac couleur noire de charbon. Le triangle au carré d’un foulard perché sur sa tête et arrimé par un noeud, verrouillé sous le menton, lui donne un petit côté oeuf de Pâques.
Elle ne rit que si on la pince, Rosine. Et je ne vois pas qui se risquerait à la pincer.
Alain se réveille. Il ouvre de grands yeux noirs sur le monde qui l’entoure. Son visage change d’expression. Il grimace. Sa bouche aspire une goulée d’air. Ses poumons ne semblent pas pouvoir l’absorber et il s’étouffe.
À l’inverse, son ventre s’arrondit dangereusement.
Un moment, je crois qu’il va exploser. Mais non, un gargouillis se fait entendre. Un roulement de tambour suivi d’un bruit de crevaison, à la façon d’un pneu qui aurait un clou dans sa peau de caoutchouc.
J’accélère l’allure. Il faut arriver sans délai chez tante Rosine.
La rue est curieusement déserte. Elle ne charrie pas son lot habituel de passants, ni les comètes de ces gens affairés qui courent vers on ne sait où. Les rideaux métalliques des magasins sont baissés.
Nous y sommes.
La maison de Rosine s’élève sur un étage. Les volets du premier sont fermés. Je sonne à la porte.
J’attends.
*
Papa aime la mer. Il dit que la mer a la couleur de la vie — et le parfum de l’amour.
C’est un peu obscur pour moi ces choseslà. Mais pour maman, ça agit comme un détonateur. Elle entoure le cou de papa de ses bras fins et elle l’embrasse.
Les dimanches, avant la naissance d’Alain, nous filions au cabanon sur la côte.
Nous partions tôt le matin. On s’entassait — nous et nos cannes à pêche, nos fouines, nos râteaux, nos matelas et nos chaises pliantes — dans la minuscule voiture de papa.
On roulait une demi-heure. Nous croisions quantité de familles qui comme nous se rendaient en procession à la mer. On finissait par tous se connaître.
Sur la plage, chacun disposait à sa guise d’un petit cabanon dont il était l’heureux propriétaire. Souvent construit avec des voliges en bois déclassé, mal jointées et délavées par les embruns, il fallait le rafistoler vite-fait mal-fait.
On s’installait en milieu de matinée. On saluait nos voisins les Rémy et les Bastien. On chahutait gentiment ou bien on dégoisait sur les nouveaux, ceux qui venaient de s’installer près des Gracia.
Sur cette plage il n’y avait pas d’indigène. Mais, un peu plus loin, du côté des rochers, là où il fallait faire attention à l’endroit où on posait ses fesses sous peine de s’écorcher le derrière, les Arabes occupaient l’espace.
— Je t’interdis d’y aller.
Me prévenait papa dès que nous arrivions.
— Je sais, papa…
— Il ne suffit de savoir, Momo, il faut que tu ne le fasses pas, c’est tout.
Disait mon père d’un air sévère.
J’appliquais la consigne à la lettre. Jamais je ne suis allé voir ce qui se tramait là-bas, sur les rochers.
La journée se passait à pêcher, à ramasser des coquillages et à déjeuner le midi.
Nos voisins nous rejoignaient pour le pique-nique. Un grand barbecue était installé dans le sable que les adultes avaient creusé à la main. On y jetait du bois flotté. On allumait le feu en l’entretenant avec d’autres morceaux de bois sec que nous, les enfants, étions chargés de glaner çà et là sur le rivage.
Les pères s’occupaient de la combustion — et aussi de boire l’apéritif. La chaleur donnait soif.
Les mères préparaient les poissons et les oursins. Ces derniers, elles les décapsulaient à l’aide d’une fourchette plantée dans leur carapace hérissée d’aiguilles articulées.
L’odeur de grillé se mêlait à celle de l’iode. Les clins d’oeil rougeoyants des braises sitôt éteintes voletaient dans l’air.
Le déjeuner durait toujours trop longtemps pour nous, les enfants. Nous partions jouer avant la fin des agapes, lassés d’écouter les parents refaire le monde.
— Deux heures, pas avant deux heures, vous entendez !
À l’unisson nos mères nous avertissaient. Nous ne pouvions pas nous baigner avant que la digestion ne fût achevée.
Très vite la fournaise de l’après-midi devenait insupportable. Nous détalions nous abriter sous les parasols. Commençaient alors les parties de noyaux d’abricots. Chacun de nous en avait son sac rempli.
Souvent le soir, avant de m’endormir, je passais quelques minutes dans mon lit à astiquer ma collection de noyaux d’abricots. Je les comptais, les recomptais et veillais à ce qu’aucun ne fût abîmé.
J’étais un as. Je raflais presque toujours la mise. Je me retrouvais, le dimanche soir en rentrant à la maison, avec un sac dégorgeant de noyaux.
Quand Alain est né, nous sommes restés plusieurs semaines sans aller à la mer.
Papa craignait que d’autres s’accaparent notre cabanon. Il faisait des pieds et des mains pour y retourner. Mais maman était toujours fatiguée et papa devait s’occuper du petit frère.
— La mer…
Soupirait papa.
— Quoi, la mer ?
Demandait maman agacée, Alain fourré dans le creux de son bras tétait gloutonnement un sein.
Papa cédait. Il se contentait de rêver de sa mer. Moi, je râlais un peu, mais maman me faisait vite comprendre que, si je continuais, j’irais me coucher sans manger.
J’apprenais à mes dépens les dures réalités de la vie avec un frangin.
*
Je sonne une énième fois chez la tante Rosine.
Une odeur de caca monte de la poussette. Alain gigote comme un ver de terre dans une boîte d’appâts pour la pêche.
Ça sent horriblement mauvais. Par chance, il n’y a personne dans la rue.
Je prie pour que ma tante vienne ouvrir. Je sonne une nouvelle fois — en vain. Je me démantibule le cou en essayant regarder au premier étage si les volets s’entrouvrent. Mais ils ne bougent pas d’un millimètre.
À l’évidence, Rosine n’est pas là. Je me sens vaincu par les circonstances.
J’observe autour de moi. Cherche une solution. Je me décide enfin à frapper à la porte des voisins, les Estinguy. J’abandonne pour l’instant Alain et sa petite frimousse contrariée dans son caca. Dans peu de temps, il va se mettre à hurler.
Je sonne trois fois de suite à leur porte avant de frapper sans retenue. Je me suis souvenu que les deux petits vieux sont sourds comme des pots.
Je cogne, cogne et cogne. Personne ne vient ouvrir. Où sont-ils donc passés ?
Soudain, j’ai une révélation : ils sont à l’église bien sûr !
Je prends immédiatement la décision de m’y rendre. Je n’ai, je dois bien l’avouer, pas de plan de rechange.
Alain gesticule dans sa poussette. L’odeur, devenue franchement irrespirable, embaume à des kilomètres.
J’vais à de nombreuses reprises regarder maman quand elle changeait Alain.
Je l’avais observé qui enlevait l’épingle à nourrice, démaillotait Alain et le saisissait par les chevilles pour lui soulever les fesses et retirer le lange gorgé.
L’opération m’avait toujours paru dégoûtante. Surtout lorsqu’un peu de matière collait aux mains de maman.
Ensuite, il fallait laver le petit frère, l’essuyer, le talquer et l’emmailloter dans un nouveau carré de coton propre. Par-dessus, une culotte large faisait l’affaire et le tour était joué. Enfin, c’est une façon de parler. Je considérais plutôt l’opération comme un mauvais tour.
Mais là, dans la rue, devant les portes closes de tante Rosine et des Estinguy, que puis-je faire, sans matériel adéquat et sans expérience ?
— Tu aurais pu te retenir.
Je me plains à Alain qui cesse un instant de se trémousser et d’étaler sa commission sous lui, avant de hurler son désespoir à pleins poumons.
Il ne me reste qu’une solution, courir jusqu’à l’église, y trouver ma tante et lui refiler le paquet cadeau.
Je prends mon courage et la poussette à deux mains. Je remonte la rue au pas de charge.
L’église se situe à environ cinq cents mètres de chez Rosine, au sommet d’une côte dite des Pénitents — la bien nommée.
*
Mes parents voulaient croire que les différentes communautés se côtoyaient en plus ou moins bonne harmonie avant le 1er juillet 1962.
Celle des indigènes était la plus importante en nombre, mais certainement pas en responsabilités.
Comme nous, les indigènes avaient leurs lieux de culte. Papa disait qu’ils vénéraient une idole qui leur interdisait de manger une certaine viande.
— Ce sont des gens très différents de nous, ils ne mangent pas de porc.
M’expliqua-t-il quand je lui demandais, et ma question était candide, si les indigènes étaient des êtres humains ou non.
Cette interrogation me turlupinait depuis que j’étais en mesure d’apprécier le traitement particulier qu’on leur réservait.
Dans la vie de tous les jours, les indigènes vaquaient à leurs occupations à côté de nos parents et amis sans qu’on pût distinguer de différences. C’était essentiellement après le travail, et surtout les jours de repos, que leurs singularités apparaissaient.
Ces jours-là, ils ne se mêlaient pas à nous. Ils avaient leurs troquets, leurs passe-temps et leurs propres coutumes.
Notamment, ils se passionnaient pour le jeu des dominos. Jeu que j’avais abandonné à l’âge respectable de six ans, et pour lequel de vénérables indigènes chenus s’enflammaient encore.
Les dominos claquaient sur les tables, des acclamations joyeuses ou rageuses franchissaient les portes des bistrots.
Ces jours-là donc, nous vivions sur deux planètes différentes. Il était même interdit de trop s’en approcher — comme à la plage par exemple.
— C’est parce qu’ils ne mangent pas de porc qu’ils ne sont pas comme nous ?
Avais-je demandé, intrigué par cette caractéristique singulière qui faisait d’eux des anormaux.
Papa semblait embarrassé par ma question. Nous n’abordions jamais ces sujets. Si je m’y étais risqué, c’était parce que j’avais des amis indigènes à l’école.
Il m’était venu à l’idée que je pourrais les inviter un samedi à la maison et que nous partagerions un goûter avant d’aller jouer.
— Du porc et d’autres choses…
Avait dit papa de façon suffisamment énigmatique pour que je remette à plus tard mes projets d’invitation.
La deuxième communauté que nous fréquentions d’égal à égal, et qui nous ressemblait comme deux gousses d’ail, était celle qui ne mangeait pas de porc non plus.
Quand j’avais appris de la bouche de David, mon meilleur copain de classe, que lui non plus ne touchait pas au cochon, j’avais eu le choc de ma vie.
— T’es un indigène ?
L’avais-je questionné, horrifié.
David, à de nombreuses reprises, était venu à la maison partager gâteaux et autres sucreries que maman cuisinait à notre intention. Si j’avais été plus attentif, j’aurais remarqué que David laissait de côté les pâtisseries à base de saindoux.
J’imaginais la tête de mes parents quand je leur apprendrai la vérité : David était un indigène.
La leçon de morale qu’ils allaient m’infliger ne serait pas piquée des vers.
— T’es fou ou quoi ? Indigène ! Et quoi encore ? Crapaud, peut-être ? Tu cherches la bagarre ? Y a pas moins indigène que ma famille, Momo. Et t’avise pas à dire partout qu’on est des indigènes, sinon…
David, c’était certain, n’en était pas. Néanmoins, lui et les siens ne mangeaient pas de cochon. La question était alors de savoir ce qu’ils étaient vraiment.
— Mais alors, si vous ne mangez pas de porc, vous êtes quoi ?
Avais-je interrogé de la manière la plus humble possible, afin d'échapper à la torgnole que je sentais en prévision dans les poings fermés de mon ami.
— Nous sommes le peuple élu. Pauvre cloche, je suis Juif !
M’avait asséné David en travers de la comprenette. Son affirmation avait été plus traumatisante qu’une bonne rouste.
Le soir à table, je n’avais pas faim. Ma mine soucieuse, mon front barré d’une profonde ride et les haricots de mes deux lèvres pincées avaient inquiété maman.
— Qu’as-tu Momo ?
Mes parents avaient cessé de manger. Ils attendaient ma réponse, attentifs, les couverts fichés dans chaque main, prêts à m’étriper si j’optais pour la mauvaise réponse.
— Pourquoi David est un élu, et pas les Arabes, alors qu’il mange pas de porc comme eux ?
M’étais-je contraint à dire d’une voix qui trahissait l’angoisse. Je rentrais la tête dans les épaules dans l'expectative d'une gifle ou autres douceurs parentales.
— Mais voyons, Momo, David c’est pas pareil ! David et les siens font partie du peuple élu. C'est-à-dire que…
Avait commencé maman avant que papa ne lui coupât la parole :
— C'est à dire qu’il n’en mange pas… Mais eux c’est différent… Si tu veux…Ils sont comme nous… Disons… disons… Comme nous mais avec de l’argent en plus…
Pour bizarre et hasardeuse qu’elle fut, cette explication avait clos le débat.
*
L’église est déserte. Ça devient une habitude.
Je viens de grimper la côte des Pénitents en poussant Alain devant moi. Celui-ci braille de plus belle.
Personne.
Nous nous avançons dans l’allée centrale. Mon frère trompette notre renommée. Sa voix est reprise en écho — multipliée à l’infini.
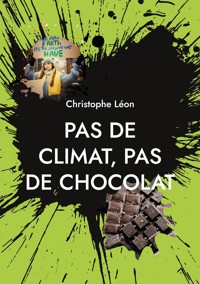
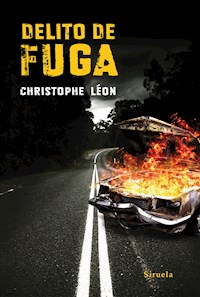














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












