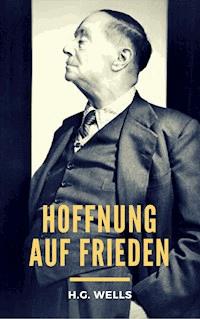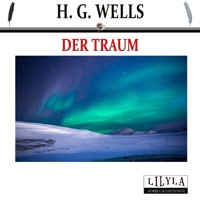3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Cette édition est unique;
- La traduction est entièrement originale et a été réalisée pour l'Ale. Mar. SAS;
- Tous droits réservés.
L'histoire de Bert Smallways, un brillant mécanicien et aéronaute accidentel, qui se retrouve comme passager clandestin réticent à bord du Vaterland, un dirigeable piloté par un prince allemand. Espionnage, intrigues et aventures audacieuses dans les cieux.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Table des matières
Préface à la réédition
Chapitre 2. Comment Bert Smallways s'est retrouvé en difficulté
Chapitre 3. Le ballon
Chapitre 4. La flotte aérienne allemande
Chapitre 5. La bataille de l'Atlantique Nord
Chapitre 6. Comment la guerre est arrivée à New York
Chapitre 7. Le "Vaterland" est désactivé
Chapitre 8. Un monde en guerre
Chapitre 9. Sur l'île aux chèvres
Chapitre 10. Le monde sous la guerre
Chapitre 11. Le grand effondrement
L'épilogue
La guerre dans l'air
H. G. WELLS
1908
Edition et traduction 2021 par Ale.Mar.
Préface à la réédition
Le lecteur doit saisir clairement la date à laquelle ce livre a été écrit. Il a été fait en 1907, il a paru dans diverses revues sous forme de feuilleton en 1908 et il a été publié à l'automne de cette année-là. A cette époque, l'avion n'était, pour la plupart des gens, qu'une rumeur et la "Saucisse" tenait l'air. Le lecteur contemporain a tout l'avantage d'avoir dix ans d'expérience depuis que cette histoire a été imaginée. Il peut corriger son auteur sur une douzaine de points et estimer la valeur de ces avertissements à l'aune d'une décennie de réalités. Le livre est faible sur les canons anti-aériens, par exemple, et encore plus négligent sur les sous-marins. Une grande partie de l'ouvrage, sans aucun doute, frappera le lecteur comme étant pittoresque et limitée, mais l'auteur peut raisonnablement s'enorgueillir d'une grande partie. L'interprétation de l'esprit allemand a dû être lue comme une caricature en 1908. Était-ce une caricature ? Le Prince Karl semblait alors une fantaisie. Depuis, la réalité a copié le prince Carl avec une étonnante fidélité. Est-ce trop espérer qu'un "Bert" démocratique ne finisse pas par se venger de son Altesse ? Notre auteur nous dit dans ce livre, comme il nous l'a dit dans d'autres, plus particulièrement dans The World Set Free, et comme il nous l'a dit cette année dans son ouvrage War and the Future, que si l'humanité continue à faire la guerre, le démantèlement de la civilisation est inévitable. C'est le chaos ou les États-Unis du monde pour l'humanité. Il n'y a pas d'autre choix. Dix ans n'ont fait qu'ajouter une énorme conviction au message de ce livre. Il reste essentiellement juste, une histoire de pamphlet - en faveur de la Ligue pour l'imposition de la paix. K.
Chapitre 1. Du progrès et de la famille Smallways
1
"Ce Progrès," dit M. Tom Smallways, "il continue."
"On pourrait difficilement penser que ça peut continuer", a dit M. Tom Smallways.
C'est bien avant le début de la guerre de l'air que M. Smallways a fait cette remarque. Il était assis sur la clôture au bout de son jardin et observait la grande usine à gaz de Bun Hill d'un œil qui ne faisait ni l'éloge ni le reproche. Au-dessus de l'amas de gazomètres, trois formes inhabituelles apparaissaient, de minces vessies qui battaient et roulaient, et devenaient de plus en plus grosses et rondes, des ballons en cours de gonflage pour l'ascension du samedi après-midi de l'aéro-club du sud de l'Angleterre.
"Ils montent tous les samedis", dit son voisin, M. Stringer, le laitier. "Ce n'est qu'hier, pour ainsi dire, que le tout Londres s'est déplacé pour voir passer un ballon, et maintenant chaque petit endroit du pays a ses sorties hebdomadaires, ou plutôt ses soulèvements. Cela a été le salut de ces compagnies de gaz."
"Samedi dernier, j'ai reçu trois chargements de gravier de mes pétaters," dit M. Tom Smallways. "Trois chargements de barils ! Ce qu'ils ont laissé tomber comme ballase. Certaines plantes étaient cassées, d'autres enterrées."
"Les dames, dit-on, montent !"
"Je suppose que nous devons les appeler des dames", a dit M. Tom Smallways.
"Pourtant, ce n'est pas l'idée que je me fais d'une dame - voler dans les airs et jeter des graviers sur les gens. Ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de considérer comme une dame, que ce soit vrai ou non."
M. Stringer hocha la tête d'un air approbateur et, pendant un certain temps, ils continuèrent à regarder les masses gonflées avec des expressions qui étaient passées de l'indifférence à la désapprobation.
M. Tom Smallways était un épicier vert de métier et un jardinier de nature ; sa petite femme Jessica s'occupait de la boutique, et le Ciel avait prévu pour lui un monde paisible. Malheureusement, le Ciel n'avait pas prévu un monde paisible pour lui. Il vivait dans un monde de changements obstinés et incessants, et dans des régions où ces changements étaient très visibles. La vicissitude se trouvait dans le sol même qu'il cultivait ; même son jardin était loué à l'année, et surplombé d'un énorme panneau qui proclamait qu'il s'agissait moins d'un jardin que d'un terrain à bâtir. C'était un horticulteur sous le coup d'un avis d'expulsion, le dernier coin de campagne dans un quartier inondé de nouveautés et d'autres choses. Il fit de son mieux pour se consoler, pour imaginer des choses proches de la marée montante.
"On pourrait difficilement penser que ça peut continuer", a-t-il dit.
Le père âgé de M. Smallways, se souvenait de Bun Hill comme d'un village idyllique du Kentish. Il avait conduit Sir Peter Bone jusqu'à l'âge de cinquante ans, puis il s'était mis à boire un peu, et à conduire le bus de la gare, ce qui lui a duré jusqu'à l'âge de soixante-dix-huit ans. Puis il prit sa retraite. Il était assis au coin du feu, un cocher ratatiné, très, très vieux, plein de souvenirs, et prêt à répondre à tout étranger imprudent. Il pouvait vous parler du domaine disparu de Sir Peter Bone, depuis longtemps découpé pour être construit, et de la façon dont ce magnat régnait sur la campagne quand c'était la campagne, du tir et de la chasse, et des caches le long de la grande route, de la façon dont "là où se trouve l'usine à gaz" était un terrain de cricket, et de l'arrivée du Crystal Palace. Le Crystal Palace était à six miles de Bun Hill, une grande façade qui scintillait le matin, et était un contour bleu clair contre le ciel l'après-midi, et une nuit, une source de feux d'artifice gratuits pour toute la population de Bun Hill. Puis vint le chemin de fer, puis des villas et des villas, puis l'usine à gaz et l'usine hydraulique, et une grande et laide mer de maisons d'ouvriers, puis le drainage, et l'eau disparut de l'Otterbourne pour ne laisser qu'un affreux fossé, puis une deuxième gare, Bun Hill South, et encore plus de maisons et encore plus de magasins, plus de concurrence, des vitrines, une commission scolaire, des tarifs, des omnibus, des tramways - jusqu'à Londres même - des bicyclettes, des voitures et encore plus de voitures, une bibliothèque Carnegie.
"On pourrait difficilement penser que ça peut continuer", a dit M. Tom Smallways, qui a grandi parmi ces merveilles.
Mais ça continuait. Même dès le début, la boutique de l'épicier vert qu'il avait installée dans l'une des plus petites des vieilles maisons de village qui subsistaient, à la fin de la High Street, avait un air submergé, un air de cachette de quelque chose qui le cherchait. Lorsqu'ils ont refait le trottoir de la High Street, ils l'ont nivelé de sorte qu'il fallait descendre trois marches pour entrer dans la boutique. Tom faisait de son mieux pour ne vendre que sa propre gamme, excellente mais limitée, de produits, mais le Progrès arrivait en poussant des choses dans sa vitrine, des artichauts et des aubergines français, des pommes étrangères - des pommes de l'État de New York, des pommes de Californie, des pommes du Canada, des pommes de Nouvelle-Zélande, "de jolis fruits, mais pas ce que j'appellerais des pommes anglaises", disait Tom - des bananes, des noix inconnues, des fruits de raisin, des mangues.
Les voitures à moteur qui circulaient vers le nord et vers le sud devenaient de plus en plus puissantes et efficaces, sifflaient plus vite et sentaient plus mauvais, de grands chariots à essence bruyants livraient du charbon et des colis à la place des vans à chevaux qui disparaissaient, les omnibus à moteur supplantaient les omnibus à chevaux, même les fraises du Kentish qui se rendaient à Londres la nuit se sont mises aux machines et ont claqué au lieu de grincer, et ont été affectées dans leur goût par le progrès et l'essence.
Et puis le jeune Bert Smallways a eu une bicyclette à moteur.....
2
Bert, il faut l'expliquer, était un Smallways progressiste.
Rien n'est plus éloquent de l'impitoyable insistance du progrès et de l'expansion à notre époque que le fait qu'elle ait pu entrer dans le sang des Smallways. Mais il y avait quelque chose d'avancé et d'entreprenant chez le jeune Smallways avant qu'il n'ait quitté ses petites robes. Il s'est perdu pendant toute une journée avant l'âge de cinq ans, et s'est presque noyé dans le réservoir de la nouvelle usine hydraulique avant l'âge de sept ans. Un vrai pistolet lui a été confisqué par un vrai policier quand il avait dix ans. Et il a appris à fumer, non pas avec des pipes, du papier brun et une canne comme Tom, mais avec un paquet de cigarettes américaines Boys of England à un penny. Son langage choqua son père avant qu'il n'ait douze ans, et à cet âge, avec la vente de colis à la gare et la vente du Bun Hill Weekly Express, il gagnait trois shillings par semaine, ou plus, et les dépensait en Chips, Comic Cuts, Ally Sloper's Half-holiday, cigarettes, et tous les concomitants d'une vie de plaisir et d'illumination. Tout cela sans entraver ses études littéraires, qui l'ont mené jusqu'au septième degré à un âge exceptionnellement précoce. Je mentionne ces choses pour que vous n'ayez aucun doute sur l'étoffe que Bert avait en lui.
Il avait six ans de moins que Tom, et pendant un certain temps, on a essayé de l'utiliser dans la boutique de l'épicier vert lorsque Tom, à vingt et un ans, a épousé Jessica, qui avait trente ans et avait économisé un peu d'argent en travaillant. Mais ce n'était pas le fort de Bert d'être utilisé. Il détestait creuser, et lorsqu'on lui donnait un panier de marchandises à livrer, un instinct nomade surgissait irrésistiblement, il devenait son sac et il ne semblait pas se soucier de son poids ni de l'endroit où il l'emmenait, tant qu'il ne l'amenait pas à destination. Le glamour remplissait le monde, et il s'égarait à sa suite, panier et tout. Tom sortit donc lui-même ses marchandises, et chercha des employeurs pour Bert qui ne connaissait pas ce penchant pour la poésie dans sa nature. Et Bert toucha successivement aux limites de plusieurs métiers : porteur de drap, garçon de pharmacie, page de médecin, jeune assistant gazier, adresseur d'enveloppes, assistant de chariot à lait, caddie de golf, et enfin aide dans un magasin de bicyclettes. C'est là, apparemment, qu'il a trouvé la qualité progressive dont sa nature avait besoin. Son employeur était un jeune homme à l'âme de pirate du nom de Grubb, au visage taché de noir le jour, et à l'allure de music-hall le soir, qui rêvait d'une chaîne à levier brevetée ; et il semblait à Bert qu'il était le modèle parfait du gentleman d'esprit. Il louait les bicyclettes les plus sales et les moins sûres de tout le sud de l'Angleterre, et menait les discussions qui suivaient avec une verve étonnante. Bert et lui se sont très bien installés ensemble. Bert vécut chez lui, devint presque un cavalier de haut vol - il pouvait monter des bicyclettes sur des kilomètres qui se seraient brisées instantanément sous vous ou moi - prit l'habitude de se laver le visage après les affaires, et dépensa son surplus d'argent en cravates et cols remarquables, en cigarettes et en cours de sténographie à l'Institut de Bun Hill.
Il allait parfois voir Tom et lui parlait si brillamment que Tom et Jessie, qui avaient tous deux une tendance naturelle à être respectueux envers n'importe qui ou n'importe quoi, l'admiraient énormément.
"C'est un gars qui va de l'avant, c'est Bert", dit Tom. "Il sait une chose ou deux."
"Espérons qu'il n'en sait pas trop", dit Jessica, qui a un bon sens des limites.
"C'est le temps du feu vert", dit Tom. "Nous les aurons en mars si les choses continuent comme elles le font. Je n'ai jamais vu un tel Times. Tu as vu sa cravate hier soir ?"
"Elle ne lui convenait pas, Tom. C'était une cravate de gentleman. Il n'était pas à la hauteur - pas le reste de son corps, ça ne lui allait pas"...
Puis, Bert a obtenu un costume de cycliste, une casquette, un badge et tout le reste ; et le voir, lui et Grubb, descendre à Brighton (et revenir) - la tête basse, le guidon bas, le dos courbé - a été une révélation sur les possibilités du sang des Smallways.
Les temps sont durs !
Le vieux Smallways s'asseyait au coin du feu et marmonnait la grandeur d'antan, du vieux Sir Peter, qui conduisait son carrosse à Brighton et en revenait en huit heures et vingt minutes, des hauts-de-forme blancs du vieux Sir Peter, de Lady Bone, qui ne mettait jamais pied à terre sauf pour se promener dans le jardin, des grands combats de prix à Crawley. Il parlait de culottes roses et de peaux de porc, de renards à Ring's Bottom, où étaient maintenant enfermés les malades du Conseil du comté, des chintz et des crinolines de Lady Bone. Personne ne l'a écouté. Le monde avait créé un nouveau type de gentleman, un gentleman d'une énergie peu galante, un gentleman en ciré poussiéreux, avec des lunettes de moto et une casquette magnifique, un gentleman qui empeste, un blaireau rapide et de grande classe, qui fuit perpétuellement le long des grandes routes pour échapper à la poussière et à la puanteur qu'il crée perpétuellement. Et sa dame, telle qu'ils ont pu la voir à Bun Hill, était une déesse mordue par le temps, aussi dépourvue de raffinement qu'une gitane - pas tant habillée qu'emballée pour le transit à grande vitesse.
Bert grandit donc, rempli d'idéaux de vitesse et d'esprit d'entreprise, et devint, pour autant qu'il devint quelque chose, une sorte de mécanicien de bicyclette, du genre à jeter un coup d'œil et à écailler l'émail. Même un vélo de course, réglé à cent vingt, ne le satisfaisait pas, et pendant un certain temps, il se languissait en vain à vingt milles à l'heure sur des routes de plus en plus poussiéreuses et encombrées de trafic mécanique. Mais enfin, ses économies se sont accumulées et sa chance est arrivée. Le système de location-vente combla un vide financier, et un dimanche matin lumineux et mémorable, il fit rouler sa nouvelle possession à travers le magasin jusqu'à la route, monta dessus avec les conseils et l'aide de Grubb, et s'en alla dans la brume de la grande route torturée par le trafic, pour s'ajouter comme un danger public volontaire de plus aux agréments du sud de l'Angleterre.
"Orf à Brighton !" dit le vieux Smallways, regardant son plus jeune fils depuis la fenêtre du salon, au-dessus de la boutique de l'épicier vert, avec quelque chose entre la fierté et la réprobation. "Quand j'avais son âge, je n'étais jamais allé à Londres, je n'avais jamais été au sud de Crawley, je n'avais jamais été nulle part par moi-même où je ne pouvais pas marcher. Et personne n'y allait. Sauf si c'était la noblesse. Maintenant, tout le monde est parti de partout ; tout ce foutu pays est en train de voler en éclats. Je me demande s'ils sont tous revenus. Orf à Brighton en effet ! Quelqu'un veut acheter des orphelins ?"
"Vous ne pouvez pas dire que je vais à Brighton, père," dit Tom.
"Je n'ai pas non plus envie d'y aller", a dit Jessica d'un ton tranchant, "pour faire des folies et dépenser votre argent".
3
Pendant un certain temps, les possibilités de la bicyclette à moteur occupèrent tellement l'esprit de Bert qu'il resta indifférent à la nouvelle direction dans laquelle l'âme laborieuse de l'homme trouvait exercice et rafraîchissement. Il n'a pas remarqué que le type de voiture à moteur, comme le type de bicyclette, se stabilisait et perdait son caractère aventureux. En effet, il est aussi vrai qu'il est remarquable que Tom ait été le premier à observer le nouveau développement. Mais son travail de jardinier le rendait attentif aux cieux, et la proximité de l'usine à gaz de Bun Hill et du Crystal Palace, d'où l'on montait continuellement et d'où l'on descendait bientôt avec du lest sur ses pommes de terre, conspiraient pour faire entrer dans son esprit, malgré lui, le fait que la déesse du changement tournait son attention inquiétante vers le ciel. Le premier grand boom de l'aéronautique commençait.
Grubb et Bert en ont entendu parler dans un music-hall, puis le cinématographe leur a fait comprendre, puis l'imagination de Bert a été stimulée par une édition à six pence de ce classique de l'aéronautique, le "Clipper of the Clouds" de M. George Griffith, et c'est ainsi que la chose s'est vraiment imposée à eux.
Au début, l'aspect le plus évident était la multiplication des ballons. Le ciel de Bun Hill a commencé à être infesté de ballons. Le mercredi et le samedi après-midi en particulier, on ne pouvait guère regarder le ciel pendant un quart d'heure sans découvrir un ballon quelque part. Et puis, par un beau jour, Bert, qui se dirigeait vers Croydon, fut arrêté par l'insurrection d'un énorme monstre en forme de polochon provenant des terrains du Crystal Palace, et fut obligé de descendre de voiture pour le regarder. Il ressemblait à un polochon avec un nez cassé, et en dessous, relativement petit, se trouvait une structure rigide portant un homme et un moteur avec une vis qui tournait à l'avant et une sorte de gouvernail en toile à l'arrière. La structure avait l'air de traîner le cylindre à gaz réticent derrière elle, comme un petit terrier vif tirant un timide éléphant dépourvu de gaz dans la société. Le monstre combiné voyageait et se dirigeait certainement. Il passa au-dessus de nous, peut-être à mille pieds d'altitude (Bert entendit le moteur), s'éloigna vers le sud, disparut au-dessus des collines, réapparut sous la forme d'une petite silhouette bleue au loin dans l'est, allant maintenant très vite devant un léger vent de sud-ouest, revint au-dessus des tours de Crystal Palace, les contourna, choisit une position pour la descente, et s'enfonça hors de vue.
Bert soupira profondément et se tourna à nouveau vers son vélo à moteur.
Et ce ne fut que le début d'une succession de phénomènes étranges dans le ciel - des cylindres, des cônes, des monstres en forme de poire, et même enfin une chose en aluminium qui scintillait merveilleusement, et que Grubb, par une certaine confusion d'idées sur les plaques de blindage, était enclin à considérer comme une machine de guerre.
Il s'en est suivi un véritable vol.
Cependant, ce n'était pas une affaire qui était visible de Bun Hill ; c'était quelque chose qui se produisait dans des terrains privés ou d'autres lieux clos et, dans des conditions favorables, et Grubb et Bert Smallways n'en étaient informés qu'au moyen de la page magazine des journaux à un demi-penny ou par des enregistrements cinématographiques. Mais elle était rapportée avec beaucoup d'insistance et, à cette époque, si l'on entendait un homme dire dans un lieu public, d'un ton fort, rassurant et confiant, "Ça va venir", il y avait dix chances sur un qu'il parle de vol. Et Bert prit le couvercle d'une boîte et écrivit dans le style correct d'un billet de fenêtre, et Grubb mit dans la fenêtre cette inscription, "Aéroplanes fabriqués et réparés". Tom en fut tout à fait contrarié - il avait l'impression de prendre sa boutique à la légère ; mais la plupart des voisins, et tous les sportifs, approuvèrent cette initiative, la jugeant très bonne.
Tout le monde parlait de voler, tout le monde répétait encore et encore, "Bound to come", et puis vous savez que ça n'est pas venu. Il y a eu un contretemps. Ils ont volé - c'était bien ; ils ont volé dans des machines plus lourdes que l'air. Mais ils se sont écrasés. Parfois, ils ont détruit le moteur, parfois ils ont détruit l'aéronaute, généralement ils ont détruit les deux. Des machines qui faisaient des vols de trois ou quatre milles et revenaient saines et sauves, se retrouvaient la fois suivante en plein désastre. Il ne semblait pas possible de leur faire confiance. La brise les perturbait, les tourbillons près du sol les perturbaient, une pensée passagère dans l'esprit de l'aéronaute les perturbait. Et puis, ils s'énervent, tout simplement.
"C'est cette 'stabilité' qui les fait," dit Grubb, répétant son journal. "Ils lancent et ils lancent, jusqu'à ce qu'ils se lancent eux-mêmes en morceaux."
Les expériences se sont essoufflées après deux années d'attente de ce genre de succès, le public puis les journaux se sont lassés des coûteuses reproductions photographiques, des rapports optimistes, de la perpétuelle séquence de triomphe et de désastre et de silence. L'aviation s'est effondrée, même la montgolfière est tombée dans une certaine mesure, bien qu'elle soit restée un sport assez populaire et qu'elle ait continué à soulever du gravier sur le quai de l'usine à gaz de Bun Hill pour le déposer sur les pelouses et les jardins de personnes méritantes. Il y eut une demi-douzaine d'années rassurantes pour Tom, du moins en ce qui concerne le vol. Mais c'était la grande époque du développement du monorail, et son anxiété n'était détournée des hautes sphères que par les menaces et les symptômes de changement les plus urgents dans le ciel inférieur.
On parle de monorails depuis plusieurs années. Mais le véritable malheur a commencé lorsque Brennan a lancé sa voiture gyroscopique monorail à la Royal Society. Ce fut la principale sensation des soirées de 1907 ; la célèbre salle de démonstration était bien trop petite pour l'exposer. De braves soldats, des sionistes de premier plan, des romanciers méritants, de nobles dames, encombraient l'étroit passage et mettaient des coudes distingués dans des côtes que le monde ne voulait pas laisser se briser, s'estimant heureux de pouvoir voir "juste un petit bout du rail". "Inaudible, mais convaincant, le grand inventeur exposa sa découverte et envoya son petit modèle obéissant des trains de l'avenir sur des pentes, dans des courbes et sur un fil de fer affaissé. Il roulait sur son rail unique, sur ses roues uniques, simples et suffisantes ; il s'arrêtait, s'inversait, restait immobile, en équilibre parfait. Il a maintenu son équilibre stupéfiant au milieu d'un tonnerre d'applaudissements. Le public se dispersa enfin, discutant du plaisir qu'il aurait à traverser un abîme sur un câble métallique. "Supposons que le gyroscope s'arrête !" Peu d'entre eux prévoyaient une dîme de ce que le monorail de Brennan ferait pour leurs titres ferroviaires et la face du monde.
En quelques années, ils ont compris que c'était mieux. En peu de temps, plus personne ne songea à traverser un abîme sur un fil, et le monorail supplanta les lignes de tramway, les chemins de fer et, en fait, toute forme de voie pour la locomotion mécanique. Là où le terrain n'était pas cher, le rail longeait le sol, là où il était cher, il s'élevait sur des rails de fer et passait au-dessus de la tête ; ses wagons rapides et pratiques allaient partout et faisaient tout ce qu'on faisait autrefois sur des rails faits sur le sol.
Quand le vieux Smallways est mort, Tom n'a rien trouvé de plus frappant à dire de lui que : "Quand il était petit, il n'y avait rien de plus haut que vos cheminées, il n'y avait pas un fil ou un câble dans le ciel !".
Le vieux Smallways est allé dans sa tombe sous un réseau complexe de fils et de câbles, car Bun Hill est devenu non seulement une sorte de petit centre de distribution d'électricité - la Home Counties Power Distribution Company a installé des transformateurs et une centrale électrique près de l'ancienne usine à gaz - mais aussi une jonction du système monorail de banlieue. De plus, chaque commerçant de l'endroit, et même presque chaque maison, avait son propre téléphone.
Le standard du câble monorail devint un élément frappant du paysage urbain, pour la plupart de solides érections de fer ressemblant plutôt à des tréteaux effilés, et peintes d'un vert bleuté vif. L'un d'entre eux, par hasard, surplombait la maison de Tom, dont l'immensité lui donnait un air encore plus retiré et apologétique ; un autre géant se tenait juste à l'intérieur du coin de son jardin, qui n'était toujours pas construit et inchangé, à l'exception de quelques panneaux publicitaires, l'un recommandant une montre à deux pence et l'autre un restaurateur de nerfs. Ces panneaux, d'ailleurs, étaient placés presque horizontalement pour attirer l'œil des passagers du monorail qui passaient au-dessus, et servaient ainsi admirablement à couvrir une cabane à outils et un abri à champignons pour Tom. Toute la journée et toute la nuit, les wagons rapides de Brighton et de Hastings passaient en murmurant au-dessus des wagons longs, larges et confortables, qui étaient brillamment éclairés après le crépuscule. Lorsqu'elles passaient la nuit, avec des éclairs passagers et un grondement de passage, elles entretenaient un perpétuel orage et des éclairs d'été dans la rue en dessous.
La Manche fut bientôt pontée - une série de grands piliers en fer de la Tour Eiffel portant des câbles monorails à une hauteur de cent cinquante pieds au-dessus de l'eau, sauf près du milieu, où ils s'élevaient plus haut pour permettre le passage des navires de Londres et d'Anvers et des paquebots Hambourg-Amérique.
Puis de lourdes voitures à moteur ont commencé à rouler sur deux roues seulement, l'une derrière l'autre, ce qui, pour une raison quelconque, a terriblement perturbé Tom et l'a rendu morose pendant des jours après le passage de la première voiture dans le magasin...
Tous ces développements gyroscopiques et monorails absorbaient naturellement une grande partie de l'attention du public, et il y avait aussi une énorme excitation consécutive aux étonnantes découvertes d'or au large de la côte d'Anglesea faites par une prospecteur sous-marine, Miss Patricia Giddy. Elle avait obtenu son diplôme de géologie et de minéralogie à l'université de Londres et, alors qu'elle travaillait sur les roches aurifères du nord du Pays de Galles, après de brèves vacances passées à militer pour le suffrage des femmes, elle avait été frappée par la possibilité que ces récifs réapparaissent sous l'eau. Elle s'était mise en tête de vérifier cette supposition à l'aide de la chenille sous-marine inventée par le docteur Alberto Cassini. Par un heureux mélange de raisonnement et d'intuition propre à son sexe, elle trouva de l'or dès sa première descente, et ressortit après trois heures d'immersion avec environ deux cents livres de minerai contenant de l'or dans la quantité inégalée de dix-sept onces à la tonne. Mais toute l'histoire de son exploitation minière sous-marine, aussi intensément intéressante soit-elle, devra être racontée à un autre moment ; il suffit maintenant de remarquer simplement que c'est au cours de la grande hausse des prix, de la confiance et de l'esprit d'entreprise qui s'ensuivit que le regain d'intérêt pour l'aviation se produisit.
Il est curieux de savoir comment ce réveil a commencé. C'était comme l'arrivée d'une brise par un jour tranquille ; rien ne l'a déclenché, il est venu. Les gens se sont mis à parler d'aviation avec l'air de n'avoir jamais abandonné le sujet. Les photos d'avions et de machines volantes sont revenues dans les journaux ; les articles et les allusions se sont multipliés dans les magazines sérieux. Dans les trains monorail, les gens demandaient : "Quand allons-nous voler ?". Une nouvelle moisson d'inventeurs surgit en une nuit ou deux comme des champignons. L'Aéro-Club annonce le projet d'une grande exposition de vol sur un vaste terrain que la suppression des taudis de Whitechapel a rendu disponible.
La vague qui s'avance produit bientôt une ondulation sympathique dans l'établissement de Bun Hill. Grubb sortit à nouveau son modèle de machine volante, l'essaya dans la cour derrière le magasin, obtint une sorte de vol et brisa dix-sept vitres et neuf pots de fleurs dans la serre qui occupait l'autre cour.
Et puis, surgie de nulle part, soutenue on ne sait comment, une rumeur persistante, inquiétante, selon laquelle le problème avait été résolu, le secret était connu. Bert la rencontra un jour de fin d'après-midi, alors qu'il se rafraîchissait dans une auberge près de Nutfield, où l'avait conduit sa motocyclette. Là, fumait et méditait une personne en kaki, un ingénieur, qui s'intéressa bientôt à la machine de Bert. C'était un appareil robuste, et il avait acquis une sorte de valeur documentaire en ces temps de changement rapide ; il avait maintenant près de huit ans. Après avoir discuté de ces points, le soldat aborde un nouveau sujet en disant : "Mon prochain véhicule sera un avion, d'après ce que je vois. J'en ai assez des routes et des chemins."
"Ils TORK", dit Bert.
"Ils parlent et ils le font", dit le soldat.
"La chose arrive..."
"Ça n'arrête pas d'arriver", a dit Bert. "Je le croirai quand je le verrai".
"Ce ne sera pas long", dit le soldat.
La conversation semblait dégénérer en une aimable querelle de contradictions.
"Je vous dis qu'ils volent", insiste le soldat. "Je le vois moi-même."
"Nous l'avons tous vu", a dit Bert.
"Je ne veux pas dire "flap up and smash up" ; je veux dire un vol réel, sûr, régulier, contrôlé, contre le vent, bon et juste."
"Vous n'avez pas vu ça !"
"JE 'AVE ! Aldershot. Ils essaient de garder le secret. Ils l'ont bien compris. Vous pariez que le ministère de la Guerre ne sera pas pris en défaut cette fois."
L'incrédulité de Bert fut ébranlée. Il posa des questions et le soldat s'étendit.
"Je vous dis qu'ils ont presque un kilomètre carré de clôtures, une sorte de vallée. Des clôtures de fil barbelé de dix pieds de haut, et à l'intérieur, ils font des choses. Les gars du camp, de temps en temps, on a un coup d'oeil. Il n'y a pas que nous non plus. Il y a les Japonais ; tu parles qu'ils l'ont aussi et les Allemands !"
Le soldat se tenait debout, les jambes très écartées, et remplissait sa pipe pensivement. Bert s'est assis sur le muret contre lequel son vélo à moteur était appuyé.
"Les combats seront amusants", a-t-il dit.
"Le vol va éclater," dit le soldat. "Quand ça viendra, quand le rideau se lèvera, je vous dis que vous trouverez tout le monde sur la scène - occupé..... De tels combats, aussi !... Je suppose que vous ne lisez pas les journaux sur ce genre de choses ?"
"Je les lis un peu", dit Bert.
"Eh bien, avez-vous remarqué ce qu'on pourrait appeler le cas remarquable de l'inventeur qui disparaît - l'inventeur qui apparaît dans un feu d'artifice de publicité, lance quelques expériences réussies, et disparaît ?"
"Je ne peux pas dire que je l'ai fait", a dit Bert.
"Eh bien, je l'ai fait, en tout cas. Si vous trouvez quelqu'un qui fait quelque chose de remarquable dans ce domaine, il disparaît. Il s'en va tranquillement, hors de vue. Au bout d'un moment, on n'entend plus parler d'eux du tout. Vous voyez ? Ils disparaissent. Disparus - pas d'adresse. D'abord - c'est une vieille histoire maintenant - il y avait ces frères Wright en Amérique. Ils ont plané - ils ont plané pendant des kilomètres et des kilomètres. Finalement, ils ont glissé hors de la scène. Il doit bien y avoir mille neuf cent quatre ou cinq ans qu'ils ont disparu ! Puis il y avait ces gens en Irlande - non, j'ai oublié leurs noms. Tout le monde disait qu'ils pouvaient voler. ILS sont partis. Ils ne sont pas morts, d'après ce que j'ai entendu dire, mais on ne peut pas dire qu'ils soient vivants. On ne peut pas voir une plume d'eux. Puis ce type qui a volé autour de Paris et s'est renversé dans la Seine. De Booley, c'est ça ? J'ai oublié. C'était un beau vol, malgré l'accident ; mais où est-il passé ? L'accident ne l'a pas blessé. Hein ? Il s'est mis à couvert."
Le soldat se prépare à allumer sa pipe.
"On dirait qu'une société secrète s'est emparée d'eux", dit Bert.
"Société secrète ! NAW !"
Le soldat alluma son allumette, et tira. "Société secrète", répéta-t-il, la pipe entre les dents et l'allumette flamboyant, en réponse à ses paroles. "Départements de guerre ; c'est plutôt ça." Il jeta son allumette de côté, et se dirigea vers sa machine. "Je vous le dis, monsieur, dit-il, il n'y a pas une grande puissance en Europe, en Asie, en Amérique ou en Afrique qui n'ait pas au moins une ou deux machines volantes cachées dans sa manche à l'heure actuelle. Pas une seule. De vraies machines volantes, utilisables. Et l'espionnage ! L'espionnage et les manœuvres pour découvrir ce que les autres ont. Je vous le dis, monsieur, un étranger, ou même un indigène non accrédité, ne peut pas s'approcher à moins de quatre milles de Lydd de nos jours - sans parler de notre petit cirque à Aldershot et du camp expérimental à Galway. Non !"
"Eh bien," dit Bert, "J'aimerais en voir un, de toute façon. Juste pour m'aider à y croire. Je croirai quand je verrai, je vous le promets."
"Vous les verrez assez vite", dit le soldat, et il dirigea sa machine vers la route.
Il a laissé Bert sur son mur, grave et pensif, avec sa casquette sur la nuque, et une cigarette fumant au coin de sa bouche.
"Si ce qu'il dit est vrai," dit Bert, "moi et Grubb, on a perdu notre temps. En plus de faire des dépenses avec cette serre."
5
C'est pendant que cette mystérieuse conversation avec le soldat agitait encore l'imagination de Bert Smallways que se produisit l'incident le plus stupéfiant de tout ce chapitre dramatique de l'histoire humaine, l'avènement de l'aviation. Les gens parlent assez volontiers d'événements qui font date ; celui-ci a fait date. Il s'agissait du vol imprévu et entièrement réussi de M. Alfred Butteridge du Crystal Palace à Glasgow et retour dans une petite machine d'apparence commerciale plus lourde que l'air - une machine entièrement maniable et contrôlable qui pouvait voler aussi bien qu'un pigeon.
On sentait que ce n'était pas tant un nouveau pas en avant dans l'affaire qu'un pas de géant, un saut. M. Butteridge resta en l'air pendant environ neuf heures, et pendant ce temps il vola avec l'aisance et l'assurance d'un oiseau. Sa machine ne ressemblait cependant ni à un oiseau, ni à un papillon, et elle n'avait pas non plus la large expansion latérale de l'avion ordinaire. L'effet produit sur l'observateur était plutôt de l'ordre de celui d'une abeille ou d'une guêpe. Certaines parties de l'appareil tournaient très rapidement et donnaient l'impression brumeuse d'ailes transparentes, mais d'autres parties, y compris deux "boîtiers d'ailes" aux courbes particulières - si l'on peut emprunter une figure aux coléoptères volants - restaient étendues de façon rigide. Au milieu se trouvait un long corps arrondi, semblable à celui d'un papillon de nuit, sur lequel on pouvait voir M. Butteridge assis à califourchon, comme un homme chevauche un cheval. La ressemblance avec une guêpe était renforcée par le fait que l'appareil volait avec un bourdonnement profond, exactement le son produit par une guêpe sur une vitre.
Mr. Butteridge a pris le monde par surprise. Il était l'un de ces messieurs venus de nulle part que le destin réussit encore à produire pour stimuler l'humanité. Il venait, disait-on, d'Australie, d'Amérique et du Sud de la France. On le décrivait aussi, à tort, comme le fils d'un homme qui avait amassé une confortable fortune dans la fabrication de plumes d'or et de stylos à plume Butteridge. Mais il s'agissait d'une toute autre souche de Butteridge. Pendant quelques années, en dépit d'une voix forte, d'une grande présence, d'une démarche agressive et de manières implacables, il avait été un membre peu distingué de la plupart des associations aéronautiques existantes. Un jour, il écrivit à tous les journaux londoniens pour annoncer qu'il avait pris des dispositions pour faire décoller du Crystal Palace une machine qui démontrerait de façon satisfaisante que les difficultés qui subsistaient dans le domaine de l'aviation étaient enfin résolues. Peu de journaux ont imprimé sa lettre, et encore moins de personnes ont cru en ses dires. Personne ne s'est enthousiasmé, même lorsqu'une bagarre sur les marches d'un grand hôtel de Piccadilly, au cours de laquelle il a essayé de cravacher un éminent musicien allemand pour des raisons personnelles, a retardé son ascension promise. La querelle a été rapportée de manière inadéquate, et son nom a été orthographié différemment : Betteridge et Betridge. Jusqu'à sa fuite, en effet, il n'existait pas et ne pouvait pas exister dans l'esprit du public. Il y avait à peine trente personnes qui le guettaient, malgré toutes ses clameurs, lorsque vers six heures, un matin d'été, les portes du grand hangar dans lequel il avait assemblé son appareil s'ouvrirent - c'était près de la grande maquette d'un mégathérium sur le terrain du Crystal Palace - et son insecte géant sortit en bourdonnant dans un monde négligent et incrédule.
Mais avant qu'il n'ait fait son deuxième tour des tours du Crystal Palace, la Fame élevait sa trompette, elle respira profondément lorsque les clochards surpris qui dorment sur les sièges de Trafalgar Square furent réveillés par son bourdonnement et s'éveillèrent pour le découvrir en train de faire le tour de la colonne Nelson, et avant qu'il ne soit arrivé à Birmingham, qu'il traversa vers dix heures et demie, son souffle assourdissant résonnait dans tout le pays. La chose désespérée était faite.
Un homme volait en toute sécurité et bien.
L'Écosse attendait sa venue avec impatience. Il atteignit Glasgow à une heure, et l'on raconte qu'à peine un chantier naval ou une usine de cette ruche d'industrie avait repris le travail avant deux heures et demie. L'esprit public était juste assez instruit de l'impossibilité de voler pour apprécier M. Butteridge à sa juste valeur. Il fit le tour des bâtiments de l'Université, et se laissa tomber à portée de voix de la foule dans le West End Park et sur la pente de Gilmorehill. L'engin volait assez régulièrement à un rythme d'environ trois miles par heure, en décrivant un large cercle, en émettant un bourdonnement profond qui aurait complètement noyé sa voix riche et pleine s'il ne s'était pas muni d'un mégaphone. Il évitait les églises, les bâtiments et les câbles monorail avec une aisance consommée tout en conversant.
"Mon nom est Butteridge", a-t-il crié ; "B-U-T-T-E-R-I-D-G-E.-Vous l'avez ? Ma mère était écossaise."
Et s'étant assuré qu'il avait été compris, il se leva au milieu des acclamations, des cris et des clameurs patriotiques, puis s'envola très rapidement et facilement dans le ciel du sud-est, s'élevant et s'abaissant avec de longues et faciles ondulations d'une manière extraordinairement semblable à celle des guêpes.
Son retour à Londres - il a visité et survolé Manchester, Liverpool et Oxford sur son chemin, et a épelé son nom à chaque endroit - a été l'occasion d'une excitation sans pareille. Tout le monde avait les yeux fixés sur le ciel. Plus de personnes ont été écrasées dans les rues ce jour-là que durant les trois mois précédents, et un bateau à vapeur du conseil du comté, l'Isaac Walton, est entré en collision avec un pilier du pont de Westminster, et a échappé de justesse au désastre en s'échouant sur le rivage - c'était la basse mer - sur la boue du côté sud. Il est retourné au Crystal Palace, ce point de départ classique de l'aventure aéronautique, vers le coucher du soleil, est rentré dans son hangar sans catastrophe, et a vu les portes se refermer immédiatement sur les photographes et les journalistes qui attendaient son retour.
"Écoutez, les gars", dit-il, tandis que son assistant s'exécutait, "je suis fatigué à mort et j'ai mal à la selle. Je ne peux pas vous dire un mot. Je suis trop fatigué. Mon nom est Butteridge. B-U-T-T-E-R-I-D-G-E. Mets-toi bien ça dans la tête. Je suis un Anglais impérial. Je vous parlerai à tous demain."
Des instantanés brumeux subsistent encore pour enregistrer cet incident. Son assistant se débat dans une mer de jeunes hommes agressifs portant des carnets de notes ou tenant des appareils photo et portant des chapeaux melon et des cravates entreprenantes. Lui-même trône dans l'embrasure de la porte, une grande figure avec une bouche - une cavité éloquente sous une vaste moustache noire - déformée par son cri à ces agents de publicité acharnés. Il trône là, l'homme le plus célèbre du pays.
Presque symboliquement, il tient et gesticule avec un mégaphone dans sa main gauche.
6
Tom et Bert Smallways ont tous deux vu ce retour. Ils l'ont observé depuis la crête de Bun Hill, d'où ils avaient si souvent contemplé les feux d'artifice du Crystal Palace. Bert était excité, Tom restait calme et serein, mais aucun d'eux ne réalisait à quel point leur propre vie allait être envahie par les fruits de ce début. "Peut-être que le vieux Grubb va s'occuper un peu de la boutique maintenant," dit-il, "et mettre son modèle béni dans le feu. Non pas que cela puisse nous sauver, si nous ne nous en sortons pas avec le compte de Steinhart."
Bert connaissait suffisamment les choses et le problème de l'aéronautique pour se rendre compte que cette gigantesque imitation d'une abeille allait, pour employer son propre idiome, "donner des crises aux journaux". Le lendemain, il était clair que les crises avaient été provoquées comme il l'avait dit : les pages de leurs magazines étaient noires de photographies hâtives, leur prose était convulsive, ils écumaient au niveau des titres. Le jour suivant, c'était pire. Avant la fin de la semaine, ils n'étaient pas tant publiés que portés dans la rue en hurlant.
Le fait dominant dans le tumulte était la personnalité exceptionnelle de M. Butteridge, et les conditions extraordinaires qu'il exigeait pour le secret de sa machine.
Car c'était un secret et il l'a gardé de la manière la plus élaborée qui soit. Il construisit lui-même son appareil dans l'intimité sûre des grands hangars du Crystal Palace, avec l'aide d'ouvriers inattentifs, et le jour suivant son vol, il le démonta d'une seule main, emballa certaines parties, puis s'assura une aide inintelligente pour emballer et disperser le reste. Des caisses d'emballage scellées ont été envoyées au nord, à l'est et à l'ouest dans diverses pantechniques, et les moteurs ont été emballés avec un soin particulier. Il devint évident que ces précautions n'étaient pas inopportunes en raison de la violente demande de toute sorte de photographies ou d'impressions de sa machine. Mais M. Butteridge, une fois sa démonstration faite, avait l'intention de garder son secret à l'abri de tout autre risque de fuite. Il devait maintenant demander au public britannique s'il voulait ou non de son secret ; il était, disait-il sans cesse, un "Anglais impérial", et son premier et son dernier souhait était de voir son invention devenir le privilège et le monopole de l'Empire. Seulement-
C'est là que les difficultés ont commencé.
Il devint évident que M. Butteridge était un homme singulièrement exempt de toute fausse modestie - en fait, de toute modestie quelle qu'elle soit - particulièrement disposé à rencontrer des intervieweurs, à répondre à des questions sur n'importe quel sujet, sauf l'aéronautique, à offrir des opinions, des critiques et des autobiographies, à fournir des portraits et des photographies de lui-même et, en général, à répandre sa personnalité dans le ciel terrestre. Les portraits publiés insistaient principalement sur une immense moustache noire, et accessoirement sur une férocité derrière la moustache. L'impression générale du public était que Butteridge était un petit homme. On pensait qu'aucune personne de grande taille ne pouvait avoir une expression aussi virulemment agressive, alors qu'en réalité, Butteridge mesurait 1,80 m et avait un poids tout à fait proportionnel. De plus, il avait une histoire d'amour aux dimensions inhabituelles et aux circonstances irrégulières, et le public britannique, encore largement décoratif, apprit avec réticence et inquiétude qu'un traitement sympathique de cette affaire était inséparable de l'acquisition exclusive du secret inestimable de la stabilité aérienne par l'Empire britannique. Les détails exacts de la similitude n'ont jamais été révélés, mais apparemment, la dame avait, dans un accès de haute inadvertance, passé la cérémonie du mariage avec, selon le discours inédit de M. Butteridge, "une mouffette à foie blanc", et cette aberration zoologique a, d'une manière légale et vexatoire, entaché son bonheur social. Il voulait parler de l'affaire, montrer la splendeur de sa nature à la lumière de ses complications. C'était vraiment très embarrassant pour une presse qui a toujours eu un penchant considérable pour la réticence, qui voulait des choses personnelles, à la mode moderne. Mais pas trop personnelles. C'était embarrassant, dis-je, d'être inexorablement confronté au grand cœur de M. Butteridge, de le voir exposé dans une auto-vivisection implacable, et ses dissepiments palpitants ornés d'étiquettes de drapeaux emphatiques.
Ils étaient confrontés, et il n'y avait pas moyen d'y échapper. Il faisait battre et palpiter cet épouvantable viscère devant les journalistes réticents - aucun oncle avec une grosse montre et un petit bébé n'a jamais insisté avec autant d'acharnement sur ce sujet ; il écartait toutes les tentatives d'évitement. Il " se glorifiait de son amour ", disait-il, et les obligeait à l'écrire.
"C'est bien sûr une affaire privée, M. Butteridge", objecteront-ils.
"L'injustice, sorr, est publique. Peu m'importe que je sois contre des institutions ou des individus. Peu m'importe si je me heurte au Tout universel. Je plaide la cause d'une femme, une femme que j'aime, sorr - une femme noble - incomprise. J'ai l'intention de la défendre, sorr, jusqu'aux quatre vents du ciel !"
"J'aime l'Angleterre", disait-il, "j'aime l'Angleterre, mais le puritanisme, désolé, je l'abhorre. Il me remplit de dégoût. Il me donne la nausée. Prenez mon propre cas."
Il insista sans relâche sur son cœur, et sur la nécessité de voir les preuves de l'entretien. S'ils n'avaient pas rendu justice à ses beuglements et à ses gesticulations érotiques, il y collait, dans un grand gribouillage encreux, tout et plus que ce qu'ils avaient omis.
C'était une chose étrangement embarrassante pour le journalisme britannique. Jamais affaire n'avait été plus évidente ou inintéressante ; jamais le monde n'avait entendu l'histoire d'une affection erratique avec moins d'appétit ou de sympathie. D'un autre côté, l'invention de M. Butteridge était extrêmement curieuse. Mais lorsque M. Butteridge pouvait être détourné un instant de la cause de la dame qu'il défendait, il parlait principalement, et généralement avec des larmes de tendresse dans la voix, de sa mère et de son enfance - sa mère qui couronnait une encyclopédie complète de la vertu maternelle en étant "largement écossaise". Elle n'était pas tout à fait soignée, mais presque. Je dois tout ce qui est en moi à ma mère", affirmait-il, "tout". Eh !" et "demandez à n'importe quel homme qui a fait quelque chose. Vous entendrez la même histoire. Tout ce que nous avons, nous le devons aux femmes. Elles sont l'espèce, désolée. L'homme n'est qu'un rêve. Il va et vient. L'âme de la femme nous conduit vers le haut et vers l'avant !"
Il était toujours comme ça.
Ce qu'il attendait en particulier du gouvernement pour son secret n'est pas apparu, ni ce que l'on pouvait attendre d'un État moderne dans une telle affaire, au-delà d'un versement d'argent. L'effet général sur les observateurs judicieux, en effet, n'était pas qu'il traitait pour quoi que ce soit, mais qu'il utilisait une occasion sans précédent pour brailler et se montrer à un monde attentif. Des rumeurs sur sa véritable identité se répandirent à l'étranger. On disait qu'il avait été propriétaire d'un hôtel ambigu au Cap, qu'il y avait hébergé, assisté aux expériences et finalement volé les papiers et les plans d'un jeune inventeur extrêmement timide et sans ami nommé Palliser, qui était venu d'Angleterre en Afrique du Sud à un stade avancé de consommation et y était mort. Telle était, en tout cas, l'allégation de la presse américaine la plus franche. Mais la preuve ou la réfutation de cette allégation n'a jamais atteint le public.
M. Butteridge s'est également impliqué avec passion dans un enchevêtrement de disputes pour la possession d'un grand nombre de prix en argent de grande valeur. Certains de ces prix avaient déjà été offerts en 1906 pour la réussite d'un vol mécanique. A l'époque du succès de M. Butteridge, un nombre vraiment très considérable de journaux, tentés par l'impunité des pionniers dans cette voie, s'étaient engagés à payer, dans certains cas, des sommes tout à fait écrasantes à la première personne qui volerait de Manchester à Glasgow, de Londres à Manchester, à cent milles, à deux cents milles en Angleterre, et ainsi de suite. La plupart d'entre eux s'étaient un peu abrités derrière des conditions ambiguës et offraient maintenant de la résistance ; un ou deux payaient immédiatement et attiraient l'attention sur ce fait avec véhémence ; et M. Butteridge se lançait dans un litige avec les plus récalcitrants, tout en poursuivant une agitation et un démarchage vigoureux pour inciter le gouvernement à acheter son invention.
Un fait, cependant, resta permanent à travers tous les développements de cette affaire, derrière l'intérêt amoureux grotesque de Butteridge, sa politique et sa personnalité, et tous ses cris et fanfaronnades, c'est que, pour autant que la masse des gens le sache, il était en seule possession du secret de l'avion praticable dans lequel, pour tout ce qu'on pouvait dire du contraire, résidait la clé du futur empire du monde. Et bientôt, à la grande consternation d'innombrables personnes, dont M. Bert Smallways, il devint évident que les négociations en cours pour l'acquisition de ce précieux secret par le gouvernement britannique risquaient d'échouer. Le Daily Requiem de Londres a été le premier à exprimer l'alarme universelle et a publié une interview sous le titre formidable de "M. Butteridge dit ce qu'il pense".
C'est là que l'inventeur - s'il était un inventeur - s'est épanché.
"Je suis venu du bout du monde", dit-il, ce qui semble plutôt confirmer l'histoire du Cap, "apportant à ma Mère Patrie le secret qui lui donnerait l'empire du monde. Et qu'est-ce que je reçois ?" Il fit une pause. "Je suis reniflé par de vieux mandarins .... Et la femme que j'aime est traitée comme une lépreuse !"
" Je suis un Anglais impérial ", poursuivit-il dans une splendide explosion, inscrite ensuite de sa propre main dans l'interview ; " mais il y a des limites au cœur humain ! Il y a des nations plus jeunes, des nations vivantes ! Des nations qui ne ronflent pas et ne gargouillent pas impuissantes dans des paroxysmes de pléthore sur des lits de formalités et de paperasserie ! Il y a des nations qui ne jetteront pas l'empire de la terre en pâture à un inconnu et qui n'insulteront pas une noble femme dont elles ne sont pas capables de délier les bottes. Il y a des nations qui ne sont pas aveuglées par la science, qui ne sont pas livrées pieds et poings liés aux snobinards efféminés et aux décadents dégénérés. En bref, notez mes mots - IL Y A D'AUTRES NATIONS !"
C'est ce discours qui a particulièrement impressionné Bert Smallways. "Si les Allemands ou les Américains s'emparent de ça," dit-il à son frère de manière impressionnante, "l'Empire britannique est fini. C'est U-P. L'Union Jack, pour ainsi dire, ne vaudra pas le papier sur lequel il est écrit, Tom."
"Je suppose que vous ne pourriez pas nous donner un coup de main ce matin", dit Jessica, dans sa pause impressionnante. "Tout le monde à Bun Hill semble vouloir des pommes de terre primeurs tout de suite. Tom ne peut pas en porter la moitié."
"Nous vivons sur un volcan", a dit Bert, ne tenant pas compte de la suggestion. "A tout moment, la guerre peut arriver - une telle guerre !"
Il secoue la tête de manière inquiétante.
"Tu ferais mieux de prendre ce lot en premier, Tom", a dit Jessica. Elle se tourne rapidement vers Bert. "Pouvez-vous nous accorder une matinée ?", a-t-elle demandé.
"Je pense que je peux," dit Bert. "Le magasin est très calme ce matin. Bien que tous ces dangers pour l'Empire m'inquiètent terriblement."
"Le travail te changera les idées", dit Jessica.
Et bientôt, lui aussi s'en allait dans un monde de changement et d'émerveillement, courbé sous un fardeau de pommes de terre et d'insécurité patriotique, qui se fondait finalement dans une irritation très nette du poids et du manque de style des pommes de terre et une conception très claire de l'entière détestabilité de Jessica.
Chapitre 2. Comment Bert Smallways s'est retrouvé en difficulté
Il ne vint à l'esprit ni de Tom ni de Bert Smallways que cette remarquable performance aérienne de Mr. Butteridge était susceptible d'affecter l'une ou l'autre de leurs vies d'une manière particulière, qu'elle les distinguerait d'une manière ou d'une autre des millions de personnes qui les entouraient ; et lorsqu'ils l'eurent observée de la crête de Bun Hill et qu'ils eurent vu le mécanisme semblable à un vol, ses plans tournants, une brume dorée dans le coucher du soleil, s'enfoncer de nouveau en bourdonnant vers le port de son hangar, ils se retournèrent vers l'épicerie verte engloutie sous la grande norme de fer du monorail Londres-Brighton, et leurs esprits revinrent à la discussion qui les avait occupés avant que le triomphe de Mr. Butteridge ne surgisse de la brume londonienne.
Ce fut une discussion difficile et infructueuse. Ils devaient les mener en criant à cause des gémissements et des vrombissements des automobiles gyroscopiques qui traversaient la High Street, et, de par sa nature, elle était litigieuse et privée. L'entreprise Grubb était en difficulté, et Grubb, dans un moment d'éloquence financière, avait donné une demi-part à Bert, dont les relations avec son employeur avaient été pendant un certain temps non salariées, pâles et informelles.
Bert essayait d'impressionner Tom avec l'idée que le Grubb & Smallways reconstruit offrait des opportunités sans précédent et inégalées au petit investisseur judicieux. Bert se rendait compte, comme si c'était un fait entièrement nouveau, que Tom était singulièrement imperméable aux idées. Finalement, il mit de côté les questions financières et, faisant de la chose une affaire d'affection fraternelle, réussit à emprunter un souverain sur la garantie de sa parole d'honneur.
La société Grubb & Smallways, anciennement Grubb, avait en effet été singulièrement malchanceuse l'année dernière. Pendant de nombreuses années, l'entreprise s'était débattue avec un goût d'insécurité romantique dans une petite boutique de la High Street, à l'aspect dissolu, ornée de publicités de bicyclettes aux couleurs vives, d'un étalage de sonnettes, de pinces à pantalon, de bidons d'huile, de pinces à pompe, de boîtes de cadre, de portefeuilles et d'autres accessoires, et de l'annonce de "Bicyclettes à louer", "Réparations", "Gonflage gratuit", "Essence" et autres attractions similaires. Ils étaient les agents de plusieurs marques obscures de bicyclettes - deux échantillons constituaient le stock - et occasionnellement, ils effectuaient une vente ; ils réparaient également les crevaisons et faisaient de leur mieux - bien que la chance ne soit pas toujours de leur côté - pour toute autre réparation qui leur était apportée. Ils s'occupaient d'une ligne de gramophones bon marché, et faisaient un peu de boîtes à musique.