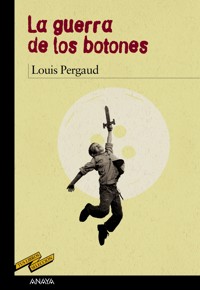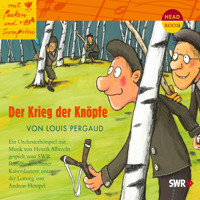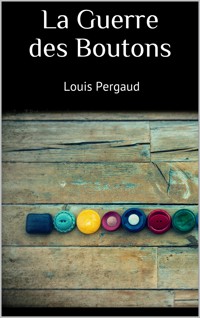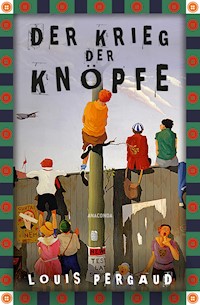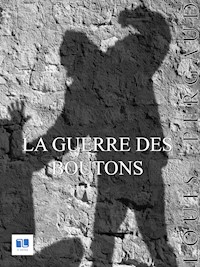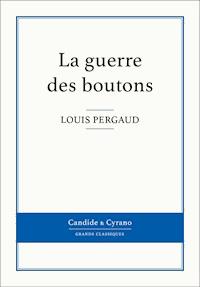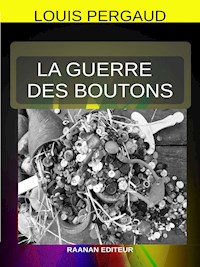
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
La Guerre des boutons est un roman de Louis Pergaud, publié en 1912.
| Les enfants de Longeverne, Lebrac et son armée, et ceux de Velrans, la troupe de l’Aztec des Gués, se livrent une guerre sans merci, à coups de bâtons, de cailloux et surtout de coups de pieds et de poings.
L’humiliation est certaine pour les malheureux qui tombent aux mains de l’ennemi : ils sont en fait dépouillés de leurs boutons, agrafes, lacets, etc., afin de les obliger à rentrer dépenaillés chez eux et de risquer une engueulade parentale.
Au fil des défaites et des revanches, des scènes cocasses se succèdent. L’on voit notamment les enfants faire la guerre nus, pour éviter d’abimer leurs vêtements.|
|Wikipédia|
Extrait
| La déclaration de guerre
— Attends-moi, Grangibus ! héla Boulot, ses livres et ses cahiers sous le bras.
— Grouille-toi, alors, j’ai pas le temps de cotainer1, moi !
— Y a du neuf ?
— Ça se pourrait !
— Quoi ?
— Viens toujours !
Et Boulot ayant rejoint les deux Gibus, ses camarades de classe, tous trois continuèrent à marcher côte à côte dans la direction de la maison commune.
C’était un matin d’octobre. Un ciel tourmenté de gros nuages gris limitait l’horizon aux collines prochaines et rendait la campagne mélancolique. Les pruniers étaient nus, les pommiers étaient jaunes, les feuilles de noyer tombaient en une sorte de vol plané, large et lent d’abord, qui s’accentuait d’un seul coup comme un plongeon d’épervier dès que l’angle de chute devenait moins obtus. L’air était humide et tiède. Des ondes de vent couraient par intervalles. Le ronflement monotone des batteuses donnait sa note sourde qui se prolongeait de temps à autre, quand la gerbe était dévorée, en une plainte lugubre comme un sanglot désespéré d’agonie ou un vagissement douloureux.
L’été venait de finir et l’automne naissait.
Il pouvait être huit heures du matin. Le soleil rôdait triste derrière les nues, et de l’angoisse, une angoisse imprécise et vague, pesait sur le village et sur la campagne...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SOMMMAIRE
PRÉFACE
LIVRE I LA GUERRE
1 La déclaration de guerre
2 Tension diplomatique
3 Une grande journée
4 Premier revers
5 Les conséquences d’un désastre
6 Plan de campagne
7 Nouvelles batailles
8 Justes représailles
LIVRE II DE L’ARGENT
1 Le trésor de guerre
2 Faulte d’argent, c’est doleur non pareille
3 La comptabilité de Tintin
4 Le retour des victoires
5 Au poteau d’exécution
6 Cruelle énigme
7 Les malheurs d’un trésorier
8 Autres combinaisons
LIVRE III LA CABANE
1 La construction de la cabane
2 Les grands jours de Longeverne
3 Le festin dans la forêt
4 Récits des temps héroïques
5 Querelles intestines
6 L’honneur et la culotte de Tintin
7 Le trésor pillé
8 Le traître châtié
9 Tragiques rentrées
10 Dernières paroles
Notes
LOUIS PERGAUD
LA GUERRE DES BOUTONS
roman
Mercure de France | 1912
Raanan Éditeur
Livre 21|édition2
À mon ami Edmond Rocher.
Cy n’entrez pas, hypocrites, bigotz, Vieulx matagots, marmiteux borsouflez… FRANÇOIS RABELAIS.
PRÉFACE
Tel qui s’esjouit à lire Rabelais, ce grand et vrai génie français, accueillera, je crois, avec plaisir, ce livre qui, malgré son titre, ne s’adresse ni aux petits enfants, ni aux jeunes pucelles.
Foin des pudeurs (toutes verbales) d’un temps châtré qui, sous leur hypocrite manteau, ne fleurent trop souvent que la névrose et le poison ! Et foin aussi des purs latins : je suis un Celte.
C’est pourquoi j’ai voulu faire un livre sain, qui fût à la fois gaulois, épique et rabelaisien ; un livre où coulât la sève, la vie, l’enthousiasme ; et ce rire, ce grand rire joyeux qui devait secouer les tripes de nos pères : beuveurs très illustres ou goutteux très précieux. Aussi n’ai-je point craint l’expression crue, à condition qu’elle fût savoureuse, ni le geste leste pourvu qu’il fût épique.
J’ai voulu restituer un instant de ma vie d’enfant, de notre vie enthousiaste et brutale de vigoureux sauvageons dans ce qu’elle eut de franc et d’héroïque, c’est-à-dire libérée des hypocrisies de la famille et de l’école.
On conçoit qu’il eût été impossible, pour un tel sujet, de s’en tenir au seul vocabulaire de Racine.
Le souci de la sincérité serait mon prétexte, si je voulais me faire pardonner les mots hardis et les expressions violemment colorées de mes héros. Mais personne n’est obligé de me lire. Et après cette préface et l’épigraphe de Rabelais adornant la couverture, je ne reconnais à nul caïman, laïque ou religieux, en mal de morales plus ou moins dégoûtantes, le droit de se plaindre.
Au demeurant, et c’est ma meilleure excuse, j’ai conçu ce livre dans la joie, je l’ai écrit avec volupté, il a amusé quelques amis et fait rire mon éditeur: j’ai le droit d’espérer qu’il plaira aux « hommes de bonne volonté » selon l’évangile de Jésus et pour ce qui est du reste, comme dit Lebrac, un de mes héros, je m’en fous.
L. P.
LIVRE I LA GUERRE
1 La déclaration de guerre
Quant à la guerre… il est plaisant à considérer par combien de vaines occasions elle est agitée et par combien légères occasions éteinte : toute l’Asie se perdit et se consomma en guerre pour le maquerelage de Paris.
MONTAIGNE (Livre second, ch. XII).
— Attends-moi, Grangibus ! héla Boulot, ses livres et ses cahiers sous le bras.
— Grouille-toi, alors, j’ai pas le temps de cotainer1 , moi !
— Y a du neuf ?
— Ça se pourrait !
— Quoi ?
— Viens toujours !
Et Boulot ayant rejoint les deux Gibus, ses camarades de classe, tous trois continuèrent à marcher côte à côte dans la direction de la maison commune.
C’était un matin d’octobre. Un ciel tourmenté de gros nuages gris limitait l’horizon aux collines prochaines et rendait la campagne mélancolique. Les pruniers étaient nus, les pommiers étaient jaunes, les feuilles de noyer tombaient en une sorte de vol plané, large et lent d’abord, qui s’accentuait d’un seul coup comme un plongeon d’épervier dès que l’angle de chute devenait moins obtus. L’air était humide et tiède. Des ondes de vent couraient par intervalles. Le ronflement monotone des batteuses donnait sa note sourde qui se prolongeait de temps à autre, quand la gerbe était dévorée, en une plainte lugubre comme un sanglot désespéré d’agonie ou un vagissement douloureux.
L’été venait de finir et l’automne naissait.
Il pouvait être huit heures du matin. Le soleil rôdait triste derrière les nues, et de l’angoisse, une angoisse imprécise et vague, pesait sur le village et sur la campagne.
Les travaux des champs étaient achevés et, un à un ou par petits groupes, depuis deux ou trois semaines, on voyait revenir à l’école les petits bergers à la peau tannée, bronzée de soleil, aux cheveux raides coupés ras à la tondeuse (la même qui servait pour les bœufs), aux pantalons de droguet ou de mouliné rapiécés, surchargés de « pattins » aux genoux et au fond, mais propres, aux blouses de grisette neuves, raides, qui, en déteignant, leur faisaient, les premiers jours, les mains noires comme des pattes de crapauds, disaient-ils.
Ce jour-là, ils traînaient le long des chemins et leurs pas semblaient alourdis de toute la mélancolie du temps, de la saison et du paysage.
Quelques-uns cependant, les grands, étaient déjà dans la cour de l’école et discutaient avec animation. Le père Simon, le maître, sa calotte en arrière et ses lunettes sur le front, dominant les yeux, était installé devant la porte qui donnait sur la rue. Il surveillait l’entrée, gourmandait les traînards, et, au fur et à mesure de leur arrivée, les petits garçons, soulevant leur casquette, passaient devant lui, traversaient le couloir et se répandaient dans la cour.
Les deux Gibus du Vernois et Boulot, qui les avait rejoints en cours de route, n’avaient pas l’air d’être imprégnés de cette mélancolie douce qui rendait traînassants les pas de leurs camarades.
Ils avaient au moins cinq minutes d’avance sur les autres jours, et le père Simon, en les voyant arriver, tira précipitamment sa montre qu’il porta ensuite à son oreille pour s’assurer qu’elle marchait bien et qu’il n’avait point laissé passer l’heure réglementaire.
Les trois compaings entrèrent vite, l’air préoccupé, et immédiatement gagnèrent, derrière les cabinets, le carré en retrait abrité par la maison du père Gugu (Auguste), le voisin, où ils retrouvèrent la plupart des grands qui les y avaient précédés.
Il y avait là Lebrac, le chef, qu’on appelait encore le grand Braque ; son premier lieutenant Camu, ou Camus, le fin grimpeur ainsi nommé parce qu’il n’avait pas son pareil pour dénicher les bouvreuils et que, là-bas, les bouvreuils s’appellent des camus ; il y avait Gambette de sur la Côte dont le père, républicain de vieille souche, fils lui-même de quarante-huitard, avait défendu Gambetta aux heures pénibles ; il y avait La Crique, qui savait tout, et Tintin, et Guignard le bigle, qui se tournait de côté pour vous voir de face, et Tétas ou Tétard, au crâne massif, bref les plus forts du village, qui discutaient une affaire sérieuse.
L’arrivée des deux Gibus et de Boulot n’interrompit pas la discussion ; les nouveaux venus étaient apparemment au courant de l’affaire, une vieille affaire à coup sûr, et ils se mêlèrent immédiatement à la conversation en apportant des faits et des arguments capitaux.
On se tut.
L’aîné des Gibus, qu’on appelait par contraction Grangibus pour le distinguer du P’tit Gibus ou Tigibus son cadet, parla ainsi :
– Voilà ! Quand nous sommes arrivés, mon frère et moi, au contour des Menelots, les Velrans se sont dressés tout d’un coup près de la marnière à Jean-Baptiste. Ils se sont mis à gueuler comme des veaux, à nous foutre des pierres et à nous montrer des triques. Ils nous ont traités de cons, d’andouilles, de voleurs, de cochons, de pourris, de crevés, de merdeux, de couilles molles, de…
– De couilles molles, reprit Lebrac, le front plissé, et qu’est-ce que tu leur z’y as redit là-dessus ?
– Là-dessus on « s’a ensauvé », mon frère et moi, puisque nous n’étions pas en nombre, tandis qu’eusses, ils étaient au moins tienze et qu’ils nous auraient sûrement foutu la pile.
– Ils vous ont traités de couilles molles ! scanda le gros Camus, visiblement choqué, blessé et furieux de cette appellation qui les atteignait tous, car les deux Gibus, c’était sûr, n’avaient été attaqués et insultés que parce qu’ils appartenaient à la commune et à l’école de Longeverne.
– Voilà, reprit Grangibus, je vous dis maintenant, moi, que si nous ne sommes pas des andouilles, des jeanfoutres et des lâches, on leur z’y fera voir si on en est des couilles molles.
– D’abord, qu’est-ce que c’est t’y que ça, des couilles molles ? fit Tintin.
La Crique réfléchissait.
– Couille molle !… Des couilles, on sait bien ce que c’est, pardine, puisque tout le monde en a, même le Miraut de Lisée, et qu’elles ressemblent à des marrons sans bogue, mais couille molle !… couille molle !…
– Sûrement que ça veut dire qu’on est des pas grand-chose, coupa Tigibus, puisque hier soir, en rigolant avec Narcisse, not’meunier, je l’ai appelé couille molle comme ça, pour voir, et mon père, que j’avais pas vu et qui passait justement, sans rien me dire, m’a foutu aussitôt une bonne paire de claques. Alors…
L’argument était péremptoire et chacun le sentit.
– Alors, bon Dieu ! il n’y a pas à rebeuiller plus longtemps, il n’y a qu’à se venger, na ! conclut Lebrac.
– C’est t’y vot’idée, vous autres ?
– Foutez le camp de là, hein, les chie-en-lit, fit Boulot aux petits qui s’approchaient pour écouter.
Ils approuvèrent le grand Lebrac à l’inanimité, comme on disait. À ce moment le père Simon apparut dans l’encadrement de la porte pour frapper dans ses mains et donner ainsi le signal de l’entrée en classe. Tous, dès qu’ils le virent, se précipitèrent avec impétuosité vers les cabinets, car on remettait toujours à la dernière minute le soin de vaquer aux besoins hygiéniques réglementaires et naturels.
Et les conspirateurs se mirent en rang silencieusement, l’air indifférent, comme si rien ne s’était passé et qu’ils n’eussent pris, l’instant d’avant, une grande et terrible décision.
Cela ne marcha pas très bien en classe, ce matin-là, et le maître dut crier fort pour contraindre ses élèves à l’attention. Non qu’ils fissent du potin, mais ils semblaient tous perdus dans un nuage et restaient absolument réfractaires à saisir l’intérêt que peut avoir pour de jeunes Français républicains l’historique du système métrique.
La définition du mètre, en particulier, leur paraissait horriblement compliquée : dix millionième partie du quart, de la moitié… du… ah, merde ! pensait le grand Lebrac.
Et se penchant vers son voisin et ami Tintin, il lui glissa confidentiellement :
– Eurêquart !
Le grand Lebrac voulait sans doute dire : Eurêka ! Il avait vaguement entendu parler d’Archimède, qui s’était battu au temps jadis avec des lentilles. La Crique lui avait laborieusement expliqué qu’il ne s’agissait pas de légumes, car Lebrac à la rigueur comprenait bien qu’on pût se battre avec des pois qu’on lance dans un fer de porte-plume creux, mais pas avec des lentilles.
– Et puis, disait-il, ça ne vaut pas les trognons de pommes ni les croûtes de pain.
La Crique lui avait dit que c’était un savant célèbre qui faisait des problèmes sur des capotes de cabriolet, et ce dernier trait l’avait pénétré d’admiration pour un bougre pareil, lui qui était aussi réfractaire aux beautés de la mathématique qu’aux règles de l’orthographe.
D’autres qualités que celles-là l’avaient, depuis un an, désigné comme chef incontesté des Longeverne. Têtu comme une mule, malin comme un singe, vif comme un lièvre, il n’avait surtout pas son pareil pour casser un carreau à vingt pas, quel que fût le mode de projection du caillou : à la main, à la fronde à ficelle, au bâton refendu, à la fronde à lastique ; il était dans les corps à corps un adversaire terrible ; il avait déjà joué des tours pendables au curé, au maître d’école et au garde champêtre ; il fabriquait des kisses merveilleuses avec des branches de sureau grosses comme sa cuisse, des kisses qui vous giclaient l’eau à quinze pas, mon ami, voui ! parfaitement ! et des topes qui pétaient comme des pistolets et qu’on ne retrouvait plus les balles d’étoupes. Aux billes, c’était lui qui avait le plus de pouce ; il savait pointer et rouletter comme pas un ; quand on jouait au pot, il vous « foutait les znogs sur les onçottes » à vous faire pleurer, et avec ça, sans morgue aucune ni affectation, il redonnait de temps à autre à ses partenaires malheureux quelques-unes des billes qu’il leur avait gagnées, ce qui lui valait une réputation de grande générosité.
À l’interjection de son chef et camarade, Tintin joignit les oreilles ou plutôt les fit bouger comme un chat qui médite un sale coup et devint rouge d’émotion.
– Ah ! ah ! pensa-t-il. Ça y est ! J’en étais bien sûr que ce sacré Lebrac trouverait le joint pour leur z’y faire !
Et il demeura noyé dans un rêve, perdu dans des mondes de suppositions, insensible aux travaux de Delambre, de Méchain, de Machinchouette ou d’autres ; aux mesures prises sous diverses latitudes, longitudes ou altitudes… Ah ! oui, que ça lui était bien égal et qu’il s’en foutait !
Mais qu’est-ce qu’ils allaient prendre, les Velrans !
Ce que fut le devoir d’application qui suivit cette première leçon, on l’apprendra plus tard ; qu’il suffise de savoir que les gaillards avaient tous une méthode personnelle pour rouvrir, sans qu’il y parût, le livre fermé par ordre supérieur et se mettre à couvert contre les défaillances de mémoire. N’empêche que le père Simon était dans une belle rage le lundi suivant. Mais n’anticipons pas.
Quand onze heures sonnèrent à la tour du vieux clocher paroissial, ils attendirent impatiemment le signal de sortie, car tous étaient déjà prévenus on ne sait comment, par infiltration, par radiation ou d’une tout autre manière, que Lebrac avait trouvé quelque chose.
Il y eut comme d’habitude quelques bonnes bousculades dans le couloir, des bérets échangés, des sabots perdus, des coups de poings sournois, mais l’intervention magistrale fit tout rentrer dans l’ordre et la sortie s’opéra quand même normalement.
Sitôt que le maître fut rentré dans sa boîte, les camarades fondirent tous sur Lebrac comme une volée de moineaux sur un crottin frais.
Il y avait là, avec les soldats ordinaires et le menu fretin, les dix principaux guerriers de Longeverne avides de se repaître de la parole du chef.
Lebrac exposa son plan, qui était simple et hardi ; ensuite il demanda quels seraient les ceusses qui l’accompagneraient le soir venu.
Tous briguèrent cet honneur ; mais quatre suffisaient et on décida que Camus, La Crique, Tintin et Grangibus seraient de l’expédition : Gambette, habitant sur la Côte, ne pouvait s’attarder si longtemps, Guignard n’y voyait pas très clair la nuit et Boulot n’était pas tout à fait aussi leste que les quatre autres.
Là-dessus on se sépara.
Au soir, sur le coup de l’Angelus, les cinq guerriers se retrouvèrent.
– As-tu la craie ? fit Lebrac à La Crique, qui s’était chargé, vu sa position près du tableau, d’en subtiliser deux ou trois morceaux dans la boîte du père Simon.
La Crique avait bien fait les choses ; il en avait chipé cinq bouts, de grands bouts ; il en garda un pour lui et en remit un autre à chacun de ses frères d’armes. De cette façon, s’il arrivait à l’un d’eux de perdre en route son morceau, les autres pourraient facilement y remédier.
– Alorsse, filons ! fit Camus.
Par la grande rue du village d’abord, puis par le trajet des Cheminées rejoignant au gros Tilleul la route de Velrans, ce fut un instant une sabotée sonore dans la nuit. Les cinq gars marchaient à toute allure à l’ennemi.
– Il y en a pour une petite demi-heure à pied, avait dit Lebrac, on peut donc y aller dedans un quart d’heure et être rentré bien avant la fin de la veillée.
La galopade se perdit dans le noir et dans le silence ; pendant la moitié du trajet la petite troupe n’abandonna pas le chemin ferré où l’on pouvait courir, mais dès qu’elle fut en territoire ennemi, les cinq conspirateurs prirent les bas côtés et marchèrent sur les banquettes que leur vieil ami le père Bréda, le cantonnier, entretenait, disaient les mauvaises langues, chaque fois qu’il lui tombait un œil. Quand ils furent tout près de Velrans, que les lumières devinrent plus nettes derrière les vitres et les aboiements des chiens plus menaçants, ils firent halte.
– Ôtons nos sabots, conseilla Lebrac, et cachons-les derrière ce mur.
Les quatre guerriers et le chef se déchaussèrent et mirent leurs bas dans leurs chaussures ; puis ils s’assurèrent qu’ils n’avaient pas perdu leur morceau de craie et, l’un derrière l’autre, le chef en tête, la pupille dilatée, l’oreille tendue, le nez frémissant, ils s’engagèrent sur le sentier de la guerre pour gagner le plus directement possible l’église du village ennemi, but de leur entreprise nocturne.
Attentifs au moindre bruit, s’aplatissant au fond des fossés, se collant aux murs ou se noyant dans l’obscurité des haies, ils se glissaient, ils s’avançaient comme des ombres, craignant seulement l’apparition insolite d’une lanterne portée par un indigène se rendant à la veillée ou la présence d’un voyageur attardé menant boire son carcan. Mais rien ne les ennuya que l’aboi du chien de Jean des Gués, un salopiot qui gueulait continuellement.
Enfin ils parvinrent sur la place du moutier et ils s’avancèrent sous les cloches. Tout était désert et silencieux. Le chef resta seul pendant que les quatre autres revenaient en arrière pour faire le guet. Alors prenant son bout de craie au fond de sa profonde, haussé sur ses orteils aussi haut que possible, Lebrac inscrivit sur le lourd panneau de chêne culotté et noirci qui fermait le saint lieu, cette inscription lapidaire qui devait faire scandale le lendemain, à l’heure de la messe, beaucoup plus par sa crudité héroïque et provocante que par son orthographe fantaisiste :
Tou lé Velrant çon dé paigne ku !
Et quand il se fut, pour ainsi dire, collé les quinquets sur le bois pour voir « si ça avait bien marqué », il revint près des quatre complices aux écoutes et, à voix basse et joyeusement, leur dit :
– Filons !
Carrément, cette fois, ils s’engagèrent de front sur le milieu du chemin et repartirent, sans faire de bruit inutile, à l’endroit où ils avaient abandonné leurs sabots et leurs bas. Mais sitôt rechaussés, dédaigneux tout à fait d’inutiles précautions, frappant le sol à pleins sabots, ils regagnèrent Longeverne et leur domicile respectif en attendant avec confiance l’effet de leur déclaration de guerre.
2Tension diplomatique
Les ambassadeurs des deux puissances ont échangé des vues au sujet de la question du Maroc.
Les journaux (été 1911).
Quand « le second » eut sonné au clocher du village, une demi-heure avant le dernier coup de cloche annonçant la messe du dimanche, le grand Lebrac, vêtu de sa veste de drap taillée dans la vieille anglaise de son grand-père, culotté d’un pantalon de droguet neuf, chaussé de brodequins ternis par une épaisse couche de graisse et coiffé d’une casquette à poil, le grand Lebrac, dis-je, vint s’appuyer contre le mur du lavoir communal et attendit ses troupes pour les mettre au courant de la situation et les informer du plein succès de l’entreprise.
Là-bas, devant la porte de Fricot l’aubergiste, quelques hommes, le brûle-gueule aux dents, se préparaient à aller « piquer une larme » avant d’entrer à l’église.
Camus arriva bientôt avec son pantalon limé aux jarrets et sa cravate rouge comme une gorge de bouvreuil : ils se sourirent ; puis vinrent les deux Gibus, l’air flaireur ; puis Gambette, qui n’était pas encore au courant, et Guignard et Boulot. La Crique, Guerreuillas, Bombé, Tétas et tout le contingent au grand complet des combattants de Longeverne, en tout une quarantaine.
Les cinq héros de la veille recommencèrent au moins dix fois chacun le récit de leur expédition, et, la bouche humide et les yeux brillants, les camarades buvaient leurs paroles, mimaient les gestes et applaudissaient à chaque coup frénétiquement.
Ensuite de quoi Lebrac résuma la situation en ces termes :
– Comme ça ils verront si on en est des couilles molles ! Alors, sûrement, cette après-midi ils viendront se rétrainer par les buissons de la Saute, histoire de chercher rogne, et on y sera tous pour les recevoir « un peu ». Faudra prendre tous les lance-pierres et toutes les frondes. Pas besoin de s’embarrasser des triques, on veut pas se colleter. Avec les habits du dimanche il faut faire attention et ne pas trop se salir, parce que, on se ferait beigner, en rentrant. Seulement on leur dira deux mots.
Le troisième coup de cloche (le dernier) sonnant à toute volée, les mit en branle et les ramena lentement à leur place accoutumée dans les petits bancs de la chapelle de saint Joseph, symétrique à celle de la Vierge, où s’installaient les gamines.
– Foutre ! fit Camus en arrivant sous les cloches ; et moi que je dois servir la messe aujourd’hui, j’vas me faire engueuler par le noir !
Et sans prendre le temps de plonger sa main dans le grand bénitier de pierre où les camarades gavouillaient en passant, il traversa la nef en filant tel un zèbre pour aller endosser son surplis de thuriféraire ou d’acolyte.
Quand, à l’Asperges me, il passa entre les bancs, portant son baquet d’eau bénite où le curé faisait trempette avec son goupillon, il ne put s’empêcher de jeter un coup d’œil sur ses frères d’armes.
Il vit Lebrac montrant à Boulot une image que lui avait donnée la sœur de Tintin, une fleur de tulipe ou de géranium, à moins que ce ne fût une pensée, soulignée du mot « souvenir » et il clignait de l’œil d’un air don juanesque.
Alors Camus songea lui aussi à la Tavie, sa bonne amie, à qui il avait offert dernièrement un pain d’épices, de deux sous s’il vous plaît, qu’il avait acheté à la foire de Vercel, un joli pain d’épices en cœur, saupoudré de bonbonnets rouges, bleus et jaunes, orné d’une devise qui lui avait semblé tout à fait très bien :
Je mets mon cœur à vos genoux, Acceptez-le, il est à vous !
Il la chercha de l’œil dans les rangs des petites filles et vit qu’elle le regardait. La gravité de son office lui interdisait le sourire, mais il eut un choc au cœur et, légèrement rougissant, se redressa, le bidon d’eau bénite à son poignet raidi.
Ce mouvement n’échappa point à La Crique, qui confia à Tintin :
– » Ergarde » donc Camus s’il se rebraque ! On voit bien que la Tavie le reluque.
Et Camus en lui-même pensait : Maintenant que c’est l’école, on va se revoir plus souvent !
Oui… mais la guerre était déclarée !
À la sortie de l’office de vêpres, le grand Lebrac réunit toutes ses troupes et parla en chef :
– Allez mettre vos blousons, prenez un chanteau de pain et rappliquez au bas de la Saute à la Carrière à Pepiot.
Ils s’écampillèrent comme une volée de moineaux et, cinq minutes après, l’un courant derrière l’autre, le quignon de pain aux dents, se rejoignirent à l’endroit désigné par le général.
– Faudra pas dépasser le tournant du chemin, recommanda Lebrac, conscient de son rôle et soucieux de sa troupe.
– Alors tu crois qu’ils vont venir ?
– Autrement, ça serait rien foireux de leur part, et il ajouta pour expliquer son ordre : – Il y en a qui sont lestes, vous savez, les culs lourds : t’entends, Boulot ! hein ! s’agit pas de se faire chiper. Prenez des godons « dedans » vos poches ; à ceusses qu’ont des frondes à « lastique » donnez-y les beaux cailloux et attention de pas les perdre. On va monter jusqu’au Gros Buisson.
Le communal de la Saute, qui s’étend du bois du Teuré au nord-est au bois de Velrans au sud-ouest, est un grand rectangle en remblais, long de quinze cents mètres environ et large de huit cents. Les lisières des deux forêts sont les deux petits côtés du rectangle ; un mur de pierre doublé d’une haie protégée elle-même par un épais rempart de buissons le borne en bas vers les champs de la fin ; au-dessus la limite assez indécise est marquée par des carrières abandonnées, perdues dans une bande de bois non classée, avec des massifs de noisetiers et de coudriers formant un épais taillis que l’on ne coupe jamais. D’ailleurs, tout le communal est couvert de buissons, de massifs, de bosquets, d’arbres isolés ou groupés qui font de ce terrain un idéal champ de bataille.
Un chemin ferré venant du village de Longeverne gravit lentement en semi-diagonale le rectangle, puis, à cinquante mètres de la lisière du bois de Velrans, fait un contour aigu pour permettre aux voitures chargées d’atteindre sans trop de peine le sommet du « crêtot ».
Un grand massif avec des chênes, des épines, des prunelliers, des noisetiers, des coudriers, emplit la boucle du contour : on l’appelle le Gros Buisson.
Des carrières à ciel ouvert exploitées par Pepiot le bancal, Laugu du Moulin, qui s’intitulent enterpreneurs après boire, et quelquefois par Abel le Rat, bordent le chemin vers le bas.
Pour les gosses, elles constituent uniquement d’excellents et inépuisables magasins d’approvisionnement.
C’était sur ce terrain fatal, à égale distance des deux villages, que, depuis des années et des années, les générations de Longeverne et de Velrans s’étaient copieusement rossées, fustigées et lapidées, car tous les automnes et tous les hivers ça recommençait.
Les Longevernes s’avançaient habituellement jusqu’au contour, gardant la boucle du chemin, bien que l’autre côté appartînt encore à leur commune et le bois de Velrans aussi, mais comme ce bois était tout près du village ennemi, il servait aux adversaires de camp retranché, de champ de retraite et d’abri sûr en cas de poursuite, ce qui faisait rager Lebrac :
– On a toujours l’air d’être envahi, nom de D… !
Or, il n’y avait pas cinq minutes qu’on avait fini son pain, que Camus le grimpeur, posté en vigie dans les branches du grand chêne, signalait des remuements suspects à la lisière ennemie.
– Quand je vous le disais, constata Lebrac ! Calez-vous, hein ! qu’ils croient que je suis tout seul ! Je m’en vas les houksser ! kss ! kss ! attrape ! et si des fois ils se lançaient pour me prendre… hop !
Et Lebrac, sortant de son couvert d’épines, la conversation diplomatique suivante s’engagea dans les formes habituelles :
(Que le lecteur ici ou la lectrice veuille bien me permettre une incidente et un conseil. Le souci de la vérité historique m’oblige à employer un langage qui n’est pas précisément celui des cours ni des salons. Je n’éprouve aucune honte ni aucun scrupule à le restituer, l’exemple de Rabelais, mon maître, m’y autorisant. Toutefois, MM. Fallières ou Bérenger ne pouvant être comparés à François Ier, ni moi à mon illustre modèle, les temps d’ailleurs étant changés, je conseille aux oreilles délicates et aux âmes sensibles de sauter cinq ou six pages. Et j’en reviens à Lebrac :)
– Montre-toi donc, hé grand fendu, cudot, feignant, pourri ! Si t’es pas un lâche, montre-la ta sale gueule de peigne-cul ! va !
– Hé grand’crevure, approche un peu, toi aussi, pour voir ! répliqua l’ennemi.
– C’est l’Aztec des Gués, fit Camus, mais je vois encore Touegueule, et Bancal et Tatti et Migue la Lune : ils sont une chiée.
Ce petit renseignement entendu, le grand Lebrac continua :
– C’est toi hein, merdeux ! qu’as traité les Longevernes de couilles molles. Je te l’ai-t-y fait voir moi, si on en est des couilles molles ! I gn’a fallu tous vos pantets pour effacer ce que j’ai marqué à la porte de vot’église ! C’est pas des foireux comme vous qu’en auraient osé faire autant.
– Approche donc « un peu » « pisque » t’es si malin, grand gueulard, t’as que la gueule… et les gigues pour « t’ensauver » !
– Fais seulement la moitié du chemin, hé ! pattier19 ! C’est pas passe que ton père tâtait les couilles des vaches sur les champs de foire que t’es devenu riche !
– Et toi donc ! ton bacul où que vous restez est tout crevi d’hypothèques !
– Hypothèque toi-même, traîne-besache ! Quand c’est t’y que tu vas reprendre le fusil de toile de ton grand-père pour aller assommer les portes à coups de « Pater » ?
– C’est pas chez nous comme à Longeverne, où que les poules crèvent de faim en pleine moisson.
– Tant qu’à Velrans c’est les poux qui crèvent sur vos caboches, mais on ne sait pas si c’est de faim ou de poison.
Velri Pourri Traîne la Murie À vau les vies
Ouhe !… ouhe !… ouhe !… fit derrière son chef le chœur des guerriers Longevernes incapable de se dissimuler et de contenir plus longtemps son enthousiasme et sa colère.
L’Aztec des Gués riposta :
Longeverne Pique merde, Tâte merde, Montés sur quatre pieux Les diabl’ te tir’ à eux !
Et le chœur des Velrans applaudit à son tour frénétiquement le général par des Euh ! euh ! prolongés et euphoniques.
Des bordées d’insultes furent jetées de part et d’autre en rafales et en trombes ; puis les deux chefs, également surexcités, après s’être lancé les injures classiques et modernes :
– Enfonceurs de portes ouvertes !
– Étrangleurs de chats par la queue ! etc., ctc., revenant au mode antique, se flanquèrent à la face avec toute la déloyauté coutumière les accusations les plus abracadabrantes et les plus ignobles de leur répertoire :
– Hé ! t’en souviens-tu quand ta mère p… dans le rata pour te faire de la sauce !
– Et toi, quand elle demandait les sacs au châtreur de taureaux pour te les faire bouffer en salade !
– Rappelle-toi donc le jour où ton père disait qu’il aurait plus d’avantage à élever un veau qu’un peut merle comme toi !
– Et toi ? quand ta mère disait qu’elle aimerait mieux faire téter une vache que ta sœur, passe que ça serait au moins pas une putain qu’elle élèverait !
– Ma sœur, ripostait l’autre qui n’en avait pas, elle bat le beurre, quand elle battra la m… tu viendras lécher le bâton ; ou bien : elle est pavée d’ardoises pour que les petits crapauds comme toi n’y puissent pas grimper !
– Attention, prévint Camus, v’là le Touegueule qui lance des pierres avec sa fronde.
Un caillou, en effet, siffla en l’air au-dessus des têtes, auquel des ricanements répondirent, et des grêles de projectiles rayèrent bientôt le ciel de part et d’autre, cependant que le flot écumeux et sans cesse grossissant d’injures salaces continuait de fluctuer du Gros Buisson à la lisière, le répertoire des uns comme des autres étant aussi abondant que richement choisi.
Mais c’était dimanche : les deux partis étaient vêtus de leurs beaux affutiaux et nul, pas plus les chefs que les soldats, ne se souciait d’en compromettre l’ordonnance dans des corps à corps dangereux.
Aussi toute la lutte se borna-t-elle ce jour-là à cet échange de vues, si l’on peut dire, et à ce duel d’artillerie qui ne fit d’ailleurs aucune victime sérieuse, pas plus d’un côté que de l’autre.
Quand le premier coup de la prière sonna à l’église de Velrans, l’Aztec des Gués donna à son armée le signal du retour, non sans avoir lancé aux ennemis, avec une dernière injure et un dernier caillou, cette suprême provocation :
– C’est demain qu’on vous y retrouvera, les couilles molles de Longeverne !
– Tu fous le camp ! hé lâche ! railla Lebrac ; attends un peu, oui, attends à demain, tu verras ce qu’on vous passera, tas de peigne-culs !
Et une dernière bordée de cailloux salua la rentrée des Velrans dans la tranchée du milieu qu’ils suivaient pour le retour.
Les Longevernes, dont l’horloge communale retardait ou dont l’heure de la prière était peut-être reculée, profitèrent de la disparition des ennemis et prirent pour le lendemain leurs dispositions de combat.
Tintin eut une idée de génie.
– Il faudra, dit-il, se caler cinq ou six dans ce buisson-là, avant qu’ils n’arrivent, et ne bouger ni pieds ni pattes, et le premier qui passera pas trop loin lui tomber sus le râb’e et « s’ensauver » avec.
Le chef d’embuscade, immédiatement approuvé, choisit parmi les plus lestes les cinq qui l’accompagneraient, pendant que les autres mèneraient l’attaque de front, et tous rentrèrent au village, l’âme bouillonnante d’ardeur guerrière et assoiffée de représailles.
3Une grande journée
Vae victis !
Un vieux chef gaulois aux Romains.
Ce lundi matin, en classe, cela tourna mal, plus mal encore que le samedi.
Camus, sommé par le père Simon de répéter en leçon d’instruction civique ce qu’on lui avait seriné l’avant-veille sur « le citoyen », s’attira des invectives dépourvues d’aménité.
Rien ne voulait sortir de ses lèvres, toute sa face exprimait un travail de gésine intellectuelle horriblement douloureux : il lui semblait que son cerveau était muré.
– Citoyen ! citoyen ! pensaient les autres, moins ahuris, qu’est-ce que ça peut bien être que cette saloperie-là ?
– Moi, m’sieu ! fit La Crique en faisant claquer son index et son médius contre son pouce.
– Non, pas vous ! et s’adressant à Camus, debout, la tête branlante, les yeux éperdus :
– Alors, vous ne savez pas ce que c’est qu’un citoyen ?
– !…
– Je vais vous coller à tous une heure de retenue pour ce soir !
Des frissons froids coururent le long des échines.
– Enfin, vous ! êtes-vous citoyen ? fit le maître d’école qui voulait absolument avoir une réponse.
– Oui, m’sieu ! répondit Camus, se souvenant qu’il avait assisté avec son père à une réunion électorale où m’sieu le marquis, le député, devait offrir un verre à ses électeurs et leur serrer la main, même qu’il avait dit au père Camus : – C’est votre fils ce citoyen-là ? Il a l’air intelligent !
– Vous êtes citoyen, vous ! ragea l’autre, cramoisi de colère, eh bien ! oui, il est joli le citoyen ! vous m’en faites un propre de citoyen !
– Non, m’sieu, reprit Camus qui, après tout, ne tenait pas à ce titre.
– Alors pourquoi n’êtes-vous pas citoyen ?
– !…
– Dis-y, marmonna entre ses dents La Crique agacé, que c’est parce que t’as pas encore de poil au c…
– Qu’est-ce que vous dites, La Crique ?
– Je… je dis… que… que…
– Que quoi ?
– Que c’est parce qu’il est trop jeune !
– Ah ! eh bien ! maintenant, y êtes-vous ?
On y était. La réponse de La Crique fit l’effet d’une rosée bienfaisante sur le champ desséché de leur mémoire ; des lambeaux de phrases, des morceaux de qualité, des débris de citoyen, se réajustèrent, se replâtrèrent petit à petit, et Camus lui-même, moins ahuri, toute sa personne remerciant véhémentement La Crique le sauveur, contribua à recamper « le citoyen » ! Enfin, c’était toujours ça de passé.
Mais quand on en vint à la correction du devoir de système métrique, cela ne fut pas drôle du tout. Préoccupés comme ils l’étaient l’avant-veille, ils avaient oublié, en copiant, de changer des mots et de faire le nombre de fautes d’orthographe qui correspondait à peu près à leur force respective en la matière, force mathématiquement dosée par des dictées bihebdomadaires. Par contre, ils avaient sauté des mots, mis des majuscules où il n’en fallait pas et ponctué en dépit de tout sens. La copie de Lebrac surtout était lamentable et se ressentait visiblement de ses graves soucis de chef.
Aussi fut-ce lui qui fut amené au tableau par le père Simon, cramoisi de colère, les yeux luisant derrière ses lunettes comme des prunelles de chat dans la nuit.
Comme tous ses camarades d’ailleurs, Lebrac était convaincu d’avoir copié : évidemment, ça ne faisait de doute pour personne, inutile de répliquer ; mais on voulait savoir au moins s’il avait su tirer quelque fruit de cet exercice banni en principe des méthodes de la pédagogie moderne.
– Qu’est-ce que le mètre, Lebrac ?