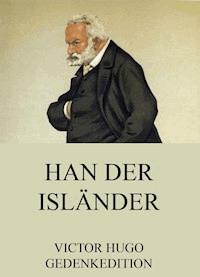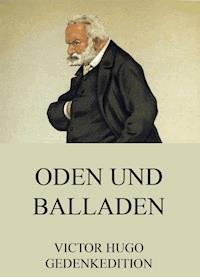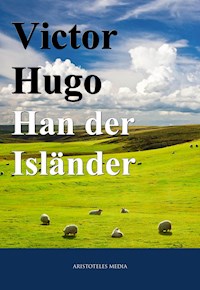Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
La légende des siècles de Victor Hugo. C'est l'histoire de l'Humanité concue non par un savant attaché à la vérité des faits mais par un poète attaché à la vérité symboloque des mythes. Un fil relie entre eux tous ces poèmes, le fil mystérieux du labyrinthe humain, le progrès.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Légende des Siècles
La Légende des SièclesPRÉFACE DE LA PREMIÈRE SÉRIELA CONSCIENCEPUISSANCE ÉGALE BONTÉBOOZ ENDORMIAU LION D’ANDROCLÈSLE MARIAGE DE ROLANDAYMERILLOTBIVAREVIRADNUSI - DÉPART DE L'AVENTURIER POUR L'AVENTUREII - ÉVIRADNUSIII - DANS LA FORÊTIV - LA COUTUME DE L'USAGEV - LA MARQUISE MAHAUDVI - LES DEUX VOISINSVII - LA SALLE À MANGERVIII - CE QU'ON Y VOIT ENCOREIX - BRUIT QUE FAIT LE PLANCHERX - ÉVIRADNUS IMMOBILEXI - UN PEU DE MUSIQUEXII - LE GRAND JOSS ET LE PETIT ZÉNOXIII - ILS SOUPENTXIV - APRÈS SOUPERXV - LES OUBLIETTESXVI - CE QU'ILS FONT DEVIENT PLUS DIFFICILE Á FAIREXVII - LA MASSUEXVIII. LE JOUR REPARAÎTSULTAN MOURADIIIIIIIVVLA CONFIANCE DU MARQUIS FABRICEI - ISORA DE FINAL.-FABRICE D'ALBENGAII - LE DÉFAUT DE LA CUIRASSEIII - AÏEUL MATERNELIV - UN SEUL HOMME SAIT OÙ EST CACHÉ LE TRÉSORV - LE CORBEAUVI - LE PÉRE ET LA MÈREVII - JOIE AU CHÂTEAUVIII - LA TOILETTE D'ISORAIX - JOIE HORS DU CHÂTEAUX - SUITE DE LA JOIEXI - TOUTES LES FAIMS SATISFAITESXII - QUE C'EST FABRICE QUI EST UN TRAÎTREXIII - SILENCEXIV - RATBERT REND L'ENFANT À L'AÏEULXV - LES DEUX TÊTESXVI - APRÈS JUSTICE FAITELA ROSE DE L'INFANTELES RAISONS DU MOMOTOMBOLA CHANSON DES AVENTURIERS DE LA MERAPRÈS LA BATAILLELE CRAPAUDLES PAUVRES GENSI - PLEINE MERII - PLEIN CIELLA TROMPETTE DU JUGEMENTPage de copyrightLa Légende des Siècles
Victor Hugo
PRÉFACE DE LA PREMIÈRE SÉRIE
Hauteville-House, Septembre 1857,
Les personnes qui voudront bien jeter un coup d’œil sur ce livre ne s’en feraient pas une idée précise, si elles y voyaient autre chose qu’un commencement.
Ce livre est-il donc un fragment ?
Non.
Il existe à part. Il a, comme on le verra, son exposition, son milieu et sa fin.
Mais, en même temps, il est, pour ainsi dire, la première page d’un autre livre.
Un commencement peut-il être un tout ?
Sans doute.
Un péristyle est un édifice.
L’arbre, commencement de la forêt, est un tout. Il appartient à la vie isolée, par la racine, et à la vie en commun, par la sève. À lui seul, il ne prouve que l’arbre, mais il annonce la forêt.
Ce livre, s’il n’y avait pas quelque affectation dans des comparaisons de cette nature, aurait, lui aussi, ce double caractère. Il existe solitairement et forme un tout ; il existe solidairement et fait partie d’un ensemble.
Cet ensemble, que sera-t-il ?
Exprimer l’humanité dans une espèce d’œuvre cyclique ; la peindre successivement et simultanément sous tous ses aspects, histoire, fable, philosophie, religion, science, lesquels se résument en un seul et immense mouvement d’ascension vers la lumière ; faire apparaître dans une sorte de miroir sombre et clair-que l’interruption naturelle des travaux terrestres brisera probablement avant qu’il ait la dimension rêvée par l’auteur-cette grande figure une et multiple, lugubre et rayonnante, fatale et sacrée, l’Homme ; voilà de quelle pensée, de quelle ambition, si l’on veut, est sortie La Légende des Siècles.
Le volume qu’on va lire n’en contient que la première partie, la première série, comme dit le titre.
Les poèmes qui composent ce volume ne sont donc autre chose que des empreintes successives du profil humain, de date en date, depuis Ève, mère des hommes, jusqu’à la Révolution, mère des peuples ; empreintes prises, tantôt sur la barbarie, tantôt sur la civilisation, presque toujours sur le vif de l’histoire ; empreintes moulées sur le masque des siècles.
Quand d’autres volumes se seront joints à celui-ci, de façon à rendre l’œuvre un peu moins incomplète, cette série d’empreintes, vaguement disposées dans un certain ordre chronologique, pourra former une sorte de galerie de la médaille humaine.
Pour le poète comme pour l’historien, pour l’archéologue comme pour le philosophe, chaque siècle est un changement de physionomie de l’humanité. On trouvera dans ce volume, qui, nous le répétons, sera continué et complété, le reflet de quelques-uns de ces changements de physionomie.
On y trouvera quelque chose du passé, quelque chose du présent et comme un vague mirage de l’avenir. Du reste, ces poèmes, divers par le sujet, mais inspirés par la même pensée, n’ont entre eux d’autre nœud qu’un fil, ce fil qui s’atténue quelquefois au point de devenir invisible, mais qui ne casse jamais, le grand fil mystérieux du labyrinthe humain, le Progrès.
Comme dans une mosaïque, chaque pierre a sa couleur et sa forme propre ; l’ensemble donne une figure. La figure de ce livre, on l’a dit plus haut, c’est l’Homme.
Ce volume d’ailleurs, qu’on veuille bien ne pas l’oublier, est à l’ouvrage dont il fait partie, et qui sera mis au jour plus tard, ce que serait à une symphonie l’ouverture. Il n’en peut donner l’idée exacte et complète, mais il contient une lueur de l’œuvre entière.
Le poème que l’auteur a dans l’esprit n’est ici qu’entr’ouvert.
Quant à ce volume pris en lui-même, l’auteur n’a qu’un mot à en dire. Le genre humain, considéré comme un grand individu collectif accomplissant d’époque en époque une série d’actes sur la terre, a deux aspects, l’aspect historique et l’aspect légendaire. Le second n’est pas moins vrai que le premier ; le premier n’est pas moins conjectural que le second.
Qu’on ne conclue pas de cette dernière ligne-disons-le en passant-qu’il puisse entrer dans la pensée de l’auteur d’amoindrir la haute valeur de l’enseignement historique. Pas une gloire, parmi les splendeurs du génie humain, ne dépasse celle du grand historien philosophe. L’auteur, seulement, sans diminuer la portée de l’histoire, veut constater la portée de la légende. Hérodote fait l’histoire, Homère fait la légende.
C’est l’aspect légendaire qui prévaut dans ce volume et qui en colore les poèmes. Ces poèmes se passent l’un à l’autre le flambeau de la tradition humaine. Quasi cursores. C’est ce flambeau, dont la flamme est le vrai, qui fait l’unité de ce livre. Tous ces poèmes, ceux du moins qui résument le passé, sont de la réalité historique condensée ou de la réalité historique devinée. La fiction parfois, la falsification jamais ; aucun grossissement de lignes ; fidélité absolue à la couleur des temps et à l’esprit des civilisations diverses. Pour citer des exemples, la Décadence romaine n’a pas un détail qui ne soit rigoureusement exact ; la barbarie mahométane ressort de Cantemir, à travers l’enthousiasme de l’historiographe turc, telle qu’elle est exposée dans les premières pages de Zim-Zizimi et de Sultan Mourad.
Du reste, les personnes auxquelles l’étude du passé est familière reconnaîtront, l’auteur n’en doute pas, l’accent réel et sincère de tout ce livre. Un de ces poèmes (Première rencontre du Christ avec le tombeau) est tiré, l’auteur pourrait dire traduit, de l’évangile.
Deux autres (Le Mariage de Roland, Aymerillot) sont des feuillets détachés de la colossale épopée du moyen âge (Charlemagne, emperor à la barbe florie). Ces deux poèmes jaillissent directement des livres de geste de la chevalerie. C’est de l’histoire écoutée aux portes de la légende.
Quant au mode de formation de plusieurs des autres poèmes dans la pensée de l’auteur, on pourra s’en faire une idée en lisant les quelques lignes placées en note avant la pièce intitulée Les Raisons du Momotombo ; lignes d’où cette pièce est sortie. L’auteur en convient, un rudiment imperceptible, perdu dans la chronique ou dans la tradition, à peine visible à l’œil nu, lui a souvent suffi. Il n’est pas défendu au poète et au philosophe d’essayer sur les faits sociaux ce que le naturaliste essaie sur les faits zoologiques, la reconstruction du monstre d’après l’empreinte de l’ongle ou l’alvéole de la dent.
Ici lacune, là étude complaisante et approfondie d’un détail, tel est l’inconvénient de toute publication fractionnée. Ces défauts de proportion peuvent n’être qu’apparents. Le lecteur trouvera certainement juste d’attendre, pour les apprécier définitivement, que La Légende des Siècles ait paru en entier. Les usurpations, par exemple, jouent un tel rôle dans la construction des royautés au moyen âge et mêlent tant de crimes à la complication des investitures, que l’auteur a cru devoir les présenter sous leurs trois principaux aspects dans les trois drames, Le Petit Roi de Galice, Éviradnus, La Confiance du Marquis Fabrice.
Ce qui peut sembler aujourd’hui un développement excessif s’ajustera plus tard à l’ensemble.
Les tableaux riants sont rares dans ce livre ; cela tient à ce qu’ils ne sont pas fréquents dans l’histoire.
Comme on le verra, l’auteur, en racontant le genre humain, ne l’isole pas de son entourage terrestre. Il mêle quelquefois à l’homme, il heurte à l’âme humaine, afin de lui faire rendre son véritable son, ces êtres différents de l’homme que nous nommons bêtes, choses, nature morte, et qui remplissent on ne sait quelles fonctions fatales dans l’équilibre vertigineux de la création.
Tel est ce livre. L’auteur l’offre au public sans rien se dissimuler de sa profonde insuffisance. C’est une tentative vers l’idéal. Rien de plus.
Ce dernier mot a besoin peut-être d’être expliqué.
Plus tard, nous le croyons, lorsque plusieurs autres parties de ce livre auront été publiées, on apercevra le lien qui, dans la conception de l’auteur, rattache La Légende des Siècles à deux autres poèmes, presque terminés à cette heure, et qui en sont, l’un le dénoûment, l’autre le commencement : La Fin de Satan, Dieu.
L’auteur, du reste, pour compléter ce qu’il a dit plus haut, ne voit aucune difficulté à faire entrevoir, dès à présent, qu’il a esquissé dans la solitude une sorte de poème d’une certaine étendue où se réverbère le problème unique, l’Être, sous sa triple face : l’Humanité, le Mal, l’Infini ; le progressif, le relatif, l’absolu ; en ce qu’on pourrait appeler trois chants, La Légende des Siècles, La Fin de Satan, Dieu.
Il publie aujourd’hui un premier carton de cette esquisse.
Les autres suivront.
Nul ne peut répondre d’achever ce qu’il a commencé, pas une minute de continuation certaine n’est assurée à l’œuvre ébauchée ; la solution de continuité, hélas ! c’est tout l’homme ; mais il est permis, même au plus faible, d’avoir une bonne intention et de la dire.
Or l’intention de ce livre est bonne.
L’épanouissement du genre humain de siècle en siècle, l’homme montant des ténèbres à l’idéal, la transfiguration paradisiaque de l’enfer terrestre, l’éclosion lente et suprême de la liberté, droit pour cette vie, responsabilité pour l’autre ; une espèce d’hymne religieux à mille strophes, ayant dans ses entrailles une foi profonde et sur son sommet une haute prière ; le drame de la création éclairé par le visage du créateur, voilà ce que sera, terminé, ce poème dans son ensemble ; si Dieu, maître des existences humaines, y consent.
LA CONSCIENCE
Lorsque avec ses enfants vêtus de peaux de bêtes,
Échevelé, livide au milieu des tempêtes,
Caïn se fut enfui de devant Jéhovah,
Comme le soir tombait, l’homme sombre arriva
Au bas d’une montagne en une grande plaine ;
Sa femme fatiguée et ses fils hors d’haleine
Lui dirent : « Couchons-nous sur la terre, et dormons. »
Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts
Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres
Il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres,
Et qui le regardait dans l’ombre fixement.
« Je suis trop près », dit-il avec un tremblement.
Il réveilla ses fils dormant, sa femme lasse,
Et se remit à fuir sinistre dans l’espace.
Il marcha trente jours, il marcha trente nuits.
Il allait, muet, pâle et frémissant aux bruits,
Furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve,
Sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève
Des mers dans le pays qui fut depuis Assur.
« Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr.
Restons-y. Nous avons du monde atteint les bornes. »
Et, comme il s’asseyait, il vit dans les cieux mornes
L’œil à la même place au fond de l’horizon.
Alors il tressaillit en proie au noir frisson.
« Cachez-moi », cria-t-il ; et, le doigt sur la bouche,
Tous ses fils regardaient trembler l’aïeul farouche.
Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont
Sous des tentes de poil dans le désert profond :
« Étends de ce côté la toile de la tente. »
Et l’on développa la muraille flottante ;
Et, quand on l’eut fixée avec des poids de plomb
« Vous ne voyez plus rien ? » dit Tsilla, l’enfant blond,
La fille de ses fils, douce comme l’aurore ;
Et Caïn répondit : « je vois cet œil encore ! »
Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs
Soufflant dans des clairons et frappant des tambours,
Cria : « je saurai bien construire une barrière. »
Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière.
Et Caïn dit : « Cet œil me regarde toujours ! »
Hénoch dit : « Il faut faire une enceinte de tours
Si terrible, que rien ne puisse approcher d’elle.
Bâtissons une ville avec sa citadelle.
Bâtissons une ville, et nous la fermerons. »
Alors Tubalcaïn, père des forgerons,
Construisit une ville énorme et surhumaine.
Pendant qu’il travaillait, ses frères, dans la plaine,
Chassaient les fils d’Énos et les enfants de Seth ;
Et l’on crevait les yeux à quiconque passait ;
Et, le soir, on lançait des flèches aux étoiles.
Le granit remplaça la tente aux murs de toiles,
On lia chaque bloc avec des nœuds de fer,
Et la ville semblait une ville d’enfer ;
L’ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes ;
Ils donnèrent aux murs l’épaisseur des montagnes ;
Sur la porte on grava : Défense à Dieu d’entrer.
Quand ils eurent fini de clore et de murer,
On mit l’aïeul au centre en une tour de pierre.
Et lui restait lugubre et hagard. « Ô mon père !
L’œil a-t-il disparu ? » dit en tremblant Tsilla.
Et Caïn répondit :« Non, il est toujours là. »
Alors il dit : « je veux habiter sous la terre,
Comme dans son sépulcre un homme solitaire ;
Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. »
On fit donc une fosse, et Caïn dit : « C’est bien ! »
Puis il descendit seul sous cette voûte sombre.
Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre,
Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain,
L’œil était dans la tombe et regardait Caïn.
PUISSANCE ÉGALE BONTÉ
Au commencement, Dieu vit un jour dans l’espace
Iblis venir à lui ; Dieu dit : « Veux-tu ta grâce ?
— Non, dit le Mal. — Alors que me demandes-tu ?
— Dieu, répondit Iblis de ténèbres vêtu,
Joutons à qui créera la chose la plus belle.
L’Être dit : « J’y consens. — Voici, dit le Rebelle ;
Moi, je prendrai ton œuvre et la transformerai.
Toi, tu féconderas ce que je t’offrirai ;
Et chacun de nous deux soufflera son génie
Sur la chose par l’autre apportée et fournie.
— Soit. Que te faut-il ? Prends, dit l’Être avec dédain.
— La tête du cheval et les cornes du daim.
— Prends. » Le monstre hésitant que la brume enveloppe
Reprit : « J’aimerais mieux celle de l’antilope.
— Va, prends. » Iblis entra dans son antre et forgea.
Puis il dressa le front. « Est-ce fini déjà ?
— Non. — Te faut-il encor quelque chose ? dit l’Être.
— Les yeux de l’éléphant, le cou du taureau, maître.
— Prends. — Je demande en outre, ajouta le Rampant,
Le ventre du cancer, les anneaux du serpent,
Les cuisses du chameau, les pattes de l’autruche.
— Prends. » Ainsi qu’on entend l’abeille dans la ruche,
On entendait aller et venir dans l’enfer
Le démon remuant des enclumes de fer.
Nul regard ne pouvait voir à travers la nue
Ce qu’il faisait au fond de la cave inconnue.
Tout à coup, se tournant vers l’Être, Iblis hurla
« Donne-moi la couleur de l’or. » Dieu dit : « Prends-la. »
Et, grondant et râlant comme un bœuf qu’on égorge,
Le démon se remit à battre dans sa forge ;
Il frappait du ciseau, du pilon, du maillet,
Et toute la caverne horrible tressaillait ;
Les éclairs des marteaux faisaient une tempête ;
Ses yeux ardents semblaient deux braises dans sa tête ;
Il rugissait ; le feu lui sortait des naseaux,
Avec un bruit pareil au bruit des grandes eaux
Dans la saison livide où la cigogne émigre.
Dieu dit : « Que te faut-il encor ?
— Le bond du tigre.
— Prends. — C’est bien, dit Iblis debout dans son volcan,
Viens m’aider à souffler » , dit-il à l’ouragan.
L’âtre flambait ; Iblis, suant à grosses gouttes,
Se courbait, se tordait, et, sous les sombres voûtes,
On ne distinguait rien qu’une sombre rougeur
Empourprant le profil du monstrueux forgeur.
Et l’ouragan l’aidait, étant démon lui-même.
L’Être, parlant du haut du firmament suprême,
Dit : « Que veux-tu de plus ? » Et le grand paria,
Levant sa tête énorme et triste, lui cria :
« Le poitrail du lion et les ailes de l’aigle. »
Et Dieu jeta, du fond des éléments qu’il règle,
À l’ouvrier d’orgueil et de rébellion
L’aile de l’aigle avec le poitrail du lion.
Et le démon reprit son œuvre sous les voiles.
« Quelle hydre fait-il donc ? » demandaient les étoiles.
Et le monde attendait, grave, inquiet, béant,
Le colosse qu’allait enfanter ce géant.
Soudain, on entendit dans la nuit sépulcrale
Comme un dernier effort jetant un dernier râle ;
L’Etna, fauve atelier du forgeron maudit,
Flamboya ; le plafond de l’enfer se fendit,
Et, dans une clarté blême et surnaturelle,
On vit des mains d’Iblis jaillir la sauterelle.
Et l’infirme effrayant, l’être ailé, mais boiteux,
Vit sa création et n’en fut pas honteux,
L’avortement étant l’habitude de l’ombre.
Il sortit à mi-corps de l’éternel décombre,
Et, croisant ses deux bras, arrogant, ricanant,
Cria dans l’infini : « Maître, à toi maintenant ! »
Et ce fourbe, qui tend à Dieu même une embûche,
Reprit : « Tu m’as donné l’éléphant et l’autruche,
Et l’or pour dorer tout ; et ce qu’ont de plus beau
Le chameau, le cheval, le lion, le taureau,
Le tigre et l’antilope, et l’aigle et la couleuvre ;
C’est mon tour de fournir la matière à ton œuvre ;
Voici tout ce que j’ai. Je te le donne. Prends. »
Dieu, pour qui les méchants mêmes sont transparents,
Tendit sa grande main de lumière baignée
Vers l’ombre, et le démon lui donna l’araignée.
Et Dieu prit l’araignée et la mit au milieu
Du gouffre qui n’était pas encor le ciel bleu ;
Et l’esprit regarda la bête ; sa prunelle,
Formidable, versait la lueur éternelle ;
Le monstre, si petit qu’il semblait un point noir,
Grossit alors, et fut soudain énorme à voir ;
Et Dieu le regardait de son regard tranquille ;
Une aube étrange erra sur cette forme vile ;
L’affreux ventre devint un globe lumineux ;
Et les pattes, changeant en sphères d’or leurs nœuds,
S’allongèrent dans l’ombre en grands rayons de flamme.
Iblis leva les yeux ; et tout à coup l’infâme,
Ébloui, se courba sous l’abîme vermeil ;
Car Dieu, de l’araignée, avait fait le soleil.
BOOZ ENDORMI
Booz s’était couché de fatigue accablé ;
Il avait tout le jour travaillé dans son aire ;
Puis avait fait son lit à sa place ordinaire ;
Booz dormait auprès des boisseaux pleins de blé.
Ce vieillard possédait des champs de blés et d’orge ;
Il était, quoique riche, à la justice enclin ;
Il n’avait pas de fange en l’eau de son moulin ;
Il n’avait pas d’enfer dans le feu de sa forge.
Sa barbe était d’argent comme un ruisseau d’avril.
Sa gerbe n’était point avare ni haineuse ;
Quand il voyait passer quelque pauvre glaneuse ;
« Laissez tomber exprès des épis, » disait-il.
Cet homme marchait pur loin des sentiers obliques,
Vêtu de probité candide et de lin blanc ;
Et, toujours du côté des pauvres ruisselant,
Ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques.
Booz était bon maître et fidèle parent ;
Il était généreux, quoiqu’il fût économe ;
Les femmes regardaient Booz plus qu’un jeune homme,
Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand.
Le vieillard, qui revient vers la source première,
Entre aux jours éternels et sort des jours changeants ;
Et l’on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens.
Mais dans l’œil du vieillard on voit de la lumière.
*
Donc, Booz dans la nuit dormait parmi les siens.
Près des meules, qu’on eût prises pour des décombres,
Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres ;
Et ceci se passait dans des temps très-anciens.
Les tribus d’Israël avaient pour chef un juge ;
La terre, où l’homme errait sous la tente, inquiet
Des empreintes de pieds de géants qu’il voyait,
Était encor mouillée et molle du déluge.
*
Comme dormait Jacob, comme dormait Judith,
Booz, les yeux fermés, gisait sous la feuillée ;
Or, la porte du ciel s’étant entre-bâillée
Au-dessus de sa tête, un songe en descendit.
Et ce songe était tel, que Booz vit un chêne
Qui, sorti de son ventre, allait jusqu’au ciel bleu ;
Une race y montait comme une longue chaîne ;
Un roi chantait en bas, en haut mourait un Dieu.
Et Booz murmurait avec la voix de l’âme
« Comment se pourrait-il que de moi ceci vînt ?
Le chiffre de mes ans a passé quatre-vingt.
Et je n’ai pas de fils, et je n’ai plus de femme.
» Voilà longtemps que celle avec qui j’ai dormi,
Ô Seigneur ! a quitté ma couche pour la vôtre ;
Et nous sommes encor tout mêlés l’un à l’autre,
Elle à demi vivante et moi mort à demi.
» Une race naîtrait de moi ! Comment le croire ?
Comment se pourrait-il que j’eusse des enfants ?
Quand on est jeune, on a des matins triomphants ;
Le jour sort de la nuit comme d’une victoire ;
» Mais, vieux, on tremble ainsi qu’à l’hiver le bouleau ;
Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe.
Et je courbe, ô mon Dieu ! mon âme vers la tombe,
Comme un bœuf ayant soif penche son front vers l’eau. »
Ainsi parlait Booz dans le rêve et l’extase.
Tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyés ;
Le cèdre ne sent pas une rose à sa base,
Et lui ne sentait pas une femme à ses pieds.
*
Pendant qu’il sommeillait, Ruth, une moabite,
S’était couchée aux pieds de Booz, le sein nu,
Espérant on ne sait quel rayon inconnu,
Quand viendrait du réveil la lumière subite.
Booz ne savait point qu’une femme était là.
Et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d’elle.
Un frais parfum sortait des touffes d’asphodèle ;
Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala.
L’ombre était nuptiale, auguste et solennelle ;
Les anges y volaient sans doute obscurément.
Car on voyait passer dans la nuit, par moment,
Quelque chose de bleu qui paraissait une aile.
La respiration de Booz qui dormait,
Se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse.
On était dans le mois où la nature est douce,
Les collines ayant des lys sur leur sommet.
Ruth songeait et Booz dormait ; l’herbe était noire ;
Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement ;
Une immense bonté tombait du firmament ;
C’était l’heure tranquille où les lions vont boire.
Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth ;
Les astres émaillaient le ciel profond et sombre ;
Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l’ombre
Brillait à l’occident, et Ruth se demandait,
Immobile, ouvrant l’œil à moitié sous ses voiles,
Quel dieu, quel moissonneur de l’éternel été,
Avait, en s’en allant, négligemment jeté
Cette faucille d’or dans le champ des étoiles.
AU LION D’ANDROCLÈS
La ville ressemblait à l’univers. C’était
Cette heure où l’on dirait que toute âme se tait,
Que tout astre s’éclipse et que le monde change.
Rome avait étendu sa pourpre sur la fange.
Où l’aigle avait plané, rampait le scorpion.
Trimalcion foulait les os de Scipion.
Rome buvait, gaie, ivre et la face rougie ;
Et l’odeur du tombeau sortait de cette orgie.
L’amour et le bonheur, tout était effrayant.
Lesbie, en se faisant coiffer, heureuse, ayant
Son Tibulle à ses pieds qui chantait leurs tendresses,
Si l’esclave persane arrangeait mal ses tresses,
Lui piquait les seins nus de son épingle d’or.
Le mal à travers l’homme avait pris son essor ;
Toutes les passions sortaient de leurs orbites.
Les fils aux vieux parents faisaient des morts subites.
Les rhéteurs disputaient les tyrans aux bouffons.
La boue et l’or régnaient. Dans les cachots profonds,
Les bourreaux s’accouplaient à des martyres mortes.
Rome horrible chantait. Parfois, devant ses portes,
Quelque Crassus, vainqueur d’esclaves et de rois,
Plantait le grand chemin de vaincus mis en croix,
Et, quand Catulle, amant que notre extase écoute,
Errait avec Délie, aux deux bords de la route,
Six mille arbres humains saignaient sur leurs amours.
La gloire avait hanté Rome dans les grands jours ;
Toute honte à présent était la bienvenue.
Messaline en riant se mettait toute nue,
Et sur le lit public, lascive, se couchait.
Épaphrodite avait un homme pour hochet
Et brisait en jouant les membres d’Épictète.
Femme grosse, vieillard débile, enfant qui tette,
Captifs, gladiateurs, chrétiens, étaient jetés
Aux bêtes, et, tremblants, blêmes, ensanglantés,
Fuyaient, et l’agonie effarée et vivante
Se tordait dans le cirque, abîme d’épouvante.
Pendant que l’ours grondait, et que les éléphants,
Effroyables, marchaient sur les petits enfants,
La vestale songeait dans sa chaise de marbre.
Par moments, le trépas, comme le fruit d’un arbre,
Tombait du front pensif de la pâle beauté ;
Le même éclair de meurtre et de férocité