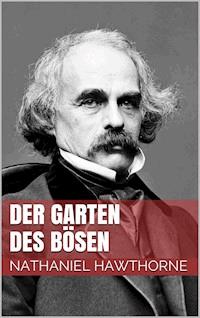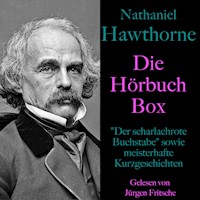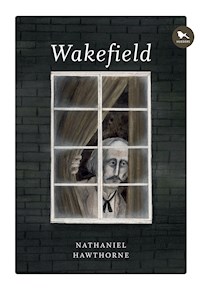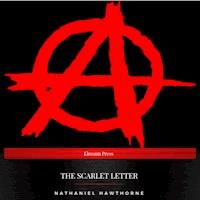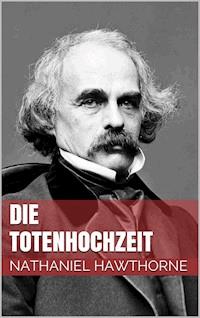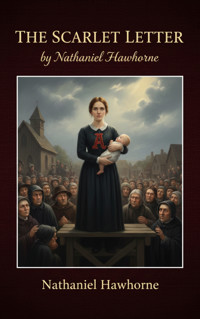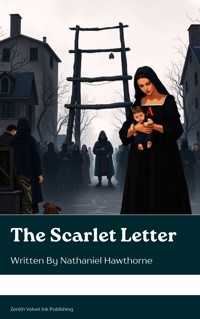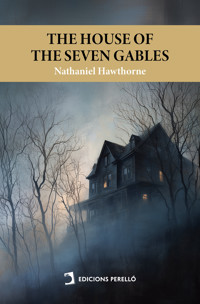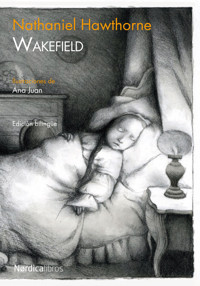0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nathaniel Hawthorne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
À Boston, dans la Nouvelle-Angleterre puritaine du XVIIe siècle, Hester Prynne, jeune épouse d'un vieux savant anglais dont on est maintenant sans nouvelles, a commis le péché d'adultère et refuse de révéler le nom du père de son enfant. Elle est condamné à affronter la vindicte populaire sur le pilori, avec sa fille Pearl de trois mois, puis à porter, brodée sur sa poitrine, la lettre écarlate «A». Elle est bannie et condamnée à l'isolement. Le jour de son exhibition publique, son mari, un temps captif parmi les Indiens, la reconnait sur la place du Marché, s'introduit auprès d'elle en prison grâce à ses talents de médecin et lui fait promettre de ne pas révéler son retour. Il se jure de découvrir qui est le père afin de perdre l'âme de cet homme...Écrit en 1850, La Lettre écarlate est considéré comme le premier chef-d'oeuvre de la littérature américaine. Avec ce roman historique, Nathaniel Hawthorne a écrit un pamphlet contre le puritanisme, base de la société américaine de l'époque, à laquelle appartenaient ses ancêtres qui avaient participé à la chasse aux sorcières de 1692. Honteux de ce passé, Nathaniel Hathorne ira jusqu'à transformer l'orthographe de son nom en Hawthorne...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
La Lettre écarlate
Nathaniel Hawthorne
Nathaniel Hawthorne was born on July 4, 1804, in Salem, Massachusetts, where his birthplace is now a museum. William Hathorne, who emigrated from England in 1630, was the first of Hawthorne's ancestors to arrive in the colonies. After arriving, William persecuted Quakers. William's son John Hathorne was one of the judges who oversaw the Salem Witch Trials. (One theory is that having learned about this, the author added the "w" to his surname in his early twenties, shortly after graduating from college.) Hawthorne's father, Nathaniel Hathorne, Sr., was a sea captain who died in 1808 of yellow fever, when Hawthorne was only four years old, in Raymond, Maine. Hawthorne attended Bowdoin College at the expense of an uncle from 1821 to 1824, befriending classmates Henry Wadsworth Longfellow and future president Franklin Pierce. While there he joined the Delta Kappa Epsilon fraternity. Until the publication of his Twice-Told Tales in 1837, Hawthorne wrote in the comparative obscurity of what he called his "owl's nest" in the family home. As he looked back on this period of his life, he wrote: "I have not lived, but only dreamed about living." And yet it was this period of brooding and writing that had formed, as Malcolm Cowley was to describe it, "the central fact in Hawthorne's career," his "term of apprenticeship" that would eventually result in the "richly meditated fiction." Hawthorne was hired in 1839 as a weigher and gauger at the Boston Custom House. He had become engaged in the previous year to the illustrator and transcendentalist Sophia Peabody. Seeking a possible home for himself and Sophia, he joined the transcendentalist utopian community at Brook Farm in 1841; later that year, however, he left when he became dissatisfied with farming and the experiment. (His Brook Farm adventure would prove an inspiration for his novel The Blithedale Romance.) He married Sophia in 1842; they moved to The Old Manse in Concord, Massachusetts, where they lived for three years. There he wrote most of the tales collected in Mosses from an Old Manse. Hawthorne and his wife then moved to Salem and later to the Berkshires, returning in 1852 to Concord and a new home The Wayside, previously owned by the Alcotts. Their neighbors in Concord included Ralph Waldo Emerson and Henry David Thoreau. Like Hawthorne, Sophia was a reclusive person. She was bedridden with headaches until her sister introduced her to Hawthorne, after which her headaches seem to have abated. The Hawthornes enjoyed a long marriage, often taking walks in the park. Sophia greatly admired her husband's work. In one of her journals, she writes: "I am always so dazzled and bewildered with the richness, the depth, the… jewels of beauty in his productions that I am always looking forward to a second reading where I can ponder and muse and fully take in the miraculous wealth of thoughts." In 1846, Hawthorne was appointed surveyor (determining the quantity and value of imported goods) at the Salem Custom House. Like his earlier appointment to the custom house in Boston, this employment was vulnerable to the politics of the spoils system. A Democrat, Hawthorne lost this job due to the change of administration in Washington after the presidential election of 1848. Hawthorne's career as a novelist was boosted by The Scarlet Letter in 1850, in which the preface refers to his three-year tenure in the Custom House at Salem. The House of the Seven Gables (1851) and The Blithedale Romance (1852) followed in quick succession. In 1852, he wrote the campaign biography of his old friend Franklin Pierce. With Pierce's election as president, Hawthorne was rewarded in 1853 with the position of United States consul in Liverpool. In 1857, his appointment ended and the Hawthorne family toured France and Italy. They returned to The Wayside in 1860, and that year saw the publication of The Marble Faun. Failing health (which biographer Edward Miller speculates was stomach cancer) prevented him from completing several more romances. Hawthorne died in his sleep on May 19, 1864, in Plymouth, New Hampshire while on a tour of the White Mountains with Pierce. He was buried in Sleepy Hollow Cemetery, Concord, Massachusetts. Wife Sophia and daughter Una were originally buried in England. However, in June 2006, they were re-interred in plots adjacent to Nathaniel. Nathaniel and Sophia Hawthorne had three children: Una, Julian, and Rose. Una was a victim of mental illness and died young. Julian moved out west, served a jail term for embezzlement and wrote a book about his father. Rose married George Parsons Lathrop and they became Roman Catholics. After George's death, Rose became a Dominican nun. She founded the Dominican Sisters of Hawthorne to care for victims of incurable cancer. Source: Wikipedia
LES BUREAUX DE LA DOUANE – Pour servir de Prologue à La Lettre écarlate.
Il est assez curieux que, peu enclin comme je le suis à beaucoup parler de mon personnage à mes parents et amis dans l’intimité du coin de mon feu, je me laisse pour la deuxième fois entraîner à donner dans l’autobiographie en m’adressant au public. La première fois remonte à trois ou quatre ans, au temps où je gratifiai le lecteur, sans excuse aucune, d’une description de la vie que je menais en la tranquillité profonde d’un vieux presbytère[1]. Et comme, plus heureux que je ne le méritais, j’eus alors la chance de trouver pour m’écouter une ou deux personnes, voici qu’aujourd’hui je saisis derechef le lecteur par le bouton de sa veste pour lui parler des trois ans que j’ai passés dans les bureaux d’une douane. L’exemple donné par le fameux « P. P. clerc de cette paroisse[2] » ne fut jamais plus fidèlement suivi !
La vérité semble bien être que, lorsqu’il lance ses feuillets au vent, un auteur s’adresse, non à la grande majorité qui jettera ses livres au rebut ou ne les ouvrira jamais, mais à la petite minorité qui le comprend mieux que ses camarades d’école et ses compagnons de vie. Certains écrivains vont même très loin dans cette voie : ils se livrent à des révélations tellement confidentielles qu’on ne saurait décemment les adresser qu’à un esprit et à un cœur entre tous faits pour les comprendre. Ils agissent comme si l’œuvre imprimée, lancée dans le vaste monde, devait immanquablement y trouver un fragment détaché du personnage de son auteur et permettre à celui-ci de compléter, grâce à cette prise de contact, le cycle de sa vie. Il est à peine convenable cependant de tout dire, même lorsque l’on s’exprime impersonnellement. Mais du moment que les paroles se figent, à moins que l’orateur ne se sente rapproché de ses auditeurs par quelque lien sincère, il est pardonnable d’imaginer lorsqu’on prend la parole, qu’un ami bienveillant et compréhensif, sinon des plus intimes, vous écoute parler. Alors, notre réserve naturelle fondant au soleil de cette impression chaleureuse, nous pouvons nous laisser aller à bavarder à notre aise, à deviser des circonstances qui nous entourent, voire de nous-mêmes, sans dévoiler notre secret. Il me paraît qu’en restant dans ces limites, un écrivain peut se permettre de donner dans l’autobiographie sans porter atteinte à ce qui est dû aux lecteurs ni à ce qu’il se doit à lui-même.
Et puis, on va voir que mon esquisse de la vie de bureau a une propriété d’un genre reconnu en littérature : elle explique comment une bonne partie des pages qu’on va lire sont tombées en ma possession et offre des preuves de l’authenticité d’un de mes récits. Ma véritable raison pour entrer en rapport avec le public tient à mon désir de me placer dans ma véritable position, qui n’est en somme guère plus que celle d’un éditeur, vis-à-vis de la plus longue des histoires qui suivent[3]. Du moment que je visais surtout ce but, il m’a paru permis d’entrer dans quelques détails en évoquant un mode de vie jusqu’ici non décrit.
Dans ma ville natale de Salem, tout au bout de ce qui fut, il y a un demi-siècle, un quai des plus animés mais qui s’affaisse, aujourd’hui, sous le poids d’entrepôts croulants et ne montre guère signe de vie commerciale à moins qu’une barque n’y décharge des peaux, ou qu’un schooner n’y lance à toute volée son fret de bois de chauffage – à l’extrémité, dis-je, de ce quai délabré que la marée souvent submerge, s’élève un spacieux édifice de briques. Les fenêtres de la façade donnent sur le spectacle peu mouvementé qu’offre l’arrière d’une rangée de constructions bordées à leur base d’une herbe drue – traces laissées tout au long du quai par le passage d’années languissantes. Au faîte de son toit, le drapeau de la République flotte dans la brise tranquille ou pend dans le calme plat durant trois heures et demie exactement chaque après-midi. Mais ses treize raies sont verticales, non horizontales, ce qui indique qu’il ne s’agit pas là de bureaux militaires mais de bureaux civils du Gouvernement de l’Oncle Sam. Sa façade s’orne d’un portique : une demi-douzaine de colonnes de bois y soutiennent un balcon sous lequel descend un large escalier de granit. Au-dessus de la porte d’entrée plane un énorme spécimen de l’aigle américaine, les ailes larges ouvertes, un écusson barrant sa poitrine et, si mes souvenirs sont exacts, un bouquet d’éclairs et de flèches barbelées dans chaque patte. Avec l’air féroce propre à son espèce, ce malheureux volatile semble menacer de l’œil et du bec la communauté inoffensive ; semble par-dessus tout aviser tout citoyen soucieux de sa sécurité de ne se risquer point dans les lieux placés sous son égide. En dépit de cette expression peu commode, bien des gens recherchent en ce moment même un abri sous les ailes de l’aigle fédérale, imaginant, je présume, que sa poitrine dispense les tiédeurs d’un doux édredon. L’aigle en question, pourtant, n’est jamais bien tendre et a tendance à culbuter, tôt ou tard – plutôt tôt que tard – sa nichée au diable, d’un preste revers de bec, d’une écorchure de serre, ou d’un coup bien cuisant de flèche barbelée.
Le pavé autour de cet édifice – que nous pouvons aussi bien désigner tout de suite comme le bâtiment de la Douane – montre assez d’herbe en ses interstices pour laisser voir qu’il n’a pas été foulé ces derniers temps par grand va-et-vient. Durant certains mois de l’année, cependant, les affaires, certains matins, y marchent d’un pas assez relevé. Ce doit être pour les habitants les plus âgés de la ville, l’occasion de se rappeler la période qui précéda la dernière guerre avec l’Angleterre[4]. Salem avait vraiment droit au titre de port en ce temps-là. Elle n’était pas, comme aujourd’hui, méprisée par ses propres armateurs qui laissent ses quais s’émietter tandis que leurs cargaisons vont grossir imperceptiblement le courant puissant du commerce en des villes comme New York et Boston. Par semblables matins donc, lorsque trois ou quatre vaisseaux se trouvent arriver à la fois – généralement d’Afrique ou d’Amérique du Sud – ou sont sur le point de lever l’ancre, un bruit de pas pressés se fait fréquemment entendre sur les marches de l’escalier de granit. Dans les bureaux de la Douane, vous pouvez accueillir, avant sa femme elle-même, le capitaine qui vient juste d’entrer au port, le teint cuit par l’air de mer et les papiers du bord sous son bras dans une boîte de fer blanc ternie. Vous pouvez aussi voir arriver son armateur, jovial ou renfrogné, selon qu’au cours de la traversée, à présent accomplie, ses projets se sont réalisés sous forme de marchandises aisées à transformer en or, ou se sont écroulés et l’ensevelissent sous un amas de déboires dont nul ne se souciera de le dégager. Vient également à la Douane – germe de l’armateur grisonnant et ridé par les soucis – le jeune employé déluré qui goûte au commerce comme le louveteau au sang et risque des cargaisons sur les navires de son patron alors qu’il ferait mieux de s’en tenir encore à lancer de petits bateaux dans les rigoles. Anime aussi ce décor le marin désireux de reprendre la mer, et à la recherche d’un embaucheur, ou celui qui débarque malade et vient solliciter un bulletin d’hôpital. N’oublions pas non plus les capitaines des petits schooners rouillés qui apportent du bois de chauffage de Grande-Bretagne : bande de loups de mer à l’air peu commode qui, s’ils n’ont pas les allures entreprenantes des Yankees contribuent tout de même, pour leur bonne part, à faire surnager notre commerce en baisse.
Que tous ces gens se trouvent rassemblés, comme il leur arrivait parfois avec, encore, pour prêter de la diversité à leur groupe, quelques individus d’un autre genre, et les bureaux de la Douane devenaient pour un temps le théâtre d’une scène animée. Mais au bout de l’escalier de granit, vous n’aperceviez, le plus souvent – dans l’entrée si c’était l’été, dans leurs bureaux respectifs si c’était l’hiver – qu’une rangée de vénérables personnages renversés dans des fauteuils à l’ancienne mode, en équilibre sur leurs pieds de derrière, et le dossier appuyé aux murs. La plupart du temps ces braves gens dormaient. Mais, parfois, on pouvait les entendre échanger des propos, en accents qui tenaient du langage parlé et du ronflement, et avec ce manque d’énergie qui caractérise les pensionnaires des hospices et tous les humains dont la subsistance dépend de la charité, ou d’un monopole, ou de n’importe quoi, excepté d’un effort indépendant et personnel. Ces vieux messieurs étaient les fonctionnaires de la Douane.
Au fond de l’entrée, à gauche, se trouve une pièce de quelque quinze pieds carrés, majestueusement haute de plafond, nantie de deux fenêtres en ogive ayant vue sur le quai en ruine dont nous avons parlé et d’une troisième donnant sur une ruelle. Toutes trois laissent apercevoir des épiceries et des magasins de fournitures pour la marine. Devant la porte de ces boutiques, on peut généralement voir bavarder et rire les groupes de vieux marins et autres rats de quai qui hantent le quartier. La pièce en question est tapissée de toiles d’araignées et toute sale sous ses vieilles peintures. Un sable gris couvre son plancher selon un usage partout ailleurs depuis longtemps tombé en désuétude. On conclut aisément de la malpropreté de l’ensemble que c’est là un sanctuaire où la femme et ses outils magiques que sont plumeaux et balais n’ont accès que fort rarement. En fait de meubles, il y a un poêle à volumineux tuyau, un vieux bureau de sapin avec un tabouret à trois pieds devant lui, deux ou trois chaises de bois toutes décrépites et branlantes et, pour ne point oublier la bibliothèque, quelques rayons où figurent une douzaine ou deux de tomes des Annales du Congrès et un abrégé ventru des lois sur les recettes. Un tuyau de fer blanc monte transpercer le plafond à titre de moyen de communication vocale avec les autres parties de l’édifice.
Allant et venant dans cette pièce, ou haut perché sur le tabouret, un coude sur le bureau et les regards errant sur les colonnes du journal du matin, vous eussiez pu, il y a six mois, reconnaître, honoré lecteur, l’individu qui vous souhaitait jadis la bienvenue dans son gai petit cabinet de travail du vieux presbytère que le soleil éclairait si agréablement à travers les branches d’un saule. Mais, si vous alliez aujourd’hui le chercher en ces lieux, en vain demanderiez-vous le contrôleur démocrate. Le balai de la réforme l’a chassé de son poste et un successeur plus digne s’est vu revêtir de sa fonction et empoche son traitement.
Cette vieille ville de Salem, ma ville bien que je n’y aie que peu vécu, tant durant mon adolescence qu’en un âge plus mûr, exerce ou exerçait sur mes affections un empire dont je ne me suis jamais rendu compte pendant que j’y résidais. Il faut dire que telle qu’elle se présente – avec sa surface plate couverte surtout de maisons de bois dont très peu peuvent faire valoir des prétentions architecturales, ses irrégularités qui n’ont rien de pittoresque, mais ne font que mieux ressortir sa monotonie, ses rues paresseuses qui s’étirent péniblement entre la Colline du Gibet[5] à un bout et une vue sur l’Hospice à l’autre, ma ville natale n’est guère attachante. Si l’on ne considère que son aspect, tant vaudrait éprouver un penchant envers un échiquier en désordre qu’envers elle. Et pourtant, bien qu’invariablement plus heureux ailleurs, j’éprouve envers ma vieille Salem un sentiment que, faute d’un terme meilleur, je dois me contenter d’appeler de l’affection. Sans doute faut-il en rendre responsables les profondes racines que ma famille enfonça anciennement en ce sol. Il y a aujourd’hui presque deux siècles et quart que l’émigrant de Grande-Bretagne[6] qui, le premier, porta ici mon nom, faisait son apparition sur le sauvage lieu de campement entouré de forêts qui devait devenir ma ville. Ses descendants sont nés et sont morts en ce même endroit. Leur substance terrestre s’y est tellement mêlée au sol que celui-ci doit en bonne partie s’apparenter aujourd’hui à la forme mortelle sous laquelle, tant que durera mon temps, je vais et viens par ces rues. L’attachement dont je parle ne serait donc en partie que simple sympathie sensuelle entre poussière et poussière. Peu de mes compatriotes peuvent savoir de quoi il s’agit et, des transplantations fréquentes étant peut-être préférables pour la race, sans doute n’ont-ils guère à le regretter.
Mais ce sentiment a aussi une valeur spirituelle. Le personnage de ce premier ancêtre, revêtu par la tradition familiale d’une sombre grandeur, a été, d’aussi loin qu’il puisse me souvenir, présent dans mon imagination d’enfant. Il me hante encore et me donne comme un sentiment d’intimité avec le passé, où je ne prétends guère que Salem, en sa phase actuelle, entre pour quelque chose. Il me semble que, plus que les autres, j’ai en cette ville droit de cité à cause de cet aïeul grave et barbu, au noir manteau, au chapeau à calotte en forme de pain de sucre, qui vint, il y a si longtemps, aborder en ces parages avec sa Bible et son épée, marcha d’un pas si majestueux dans les rues toutes neuves et fit si grande figure dans la guerre et dans la paix. Lui a, certes, un droit de cité plus fort que le mien en ces lieux où mon nom n’est presque jamais prononcé, où mon visage est à peine connu.
Ce fut un soldat, un législateur et un juge ; un des chefs de l’Église. Il avait tous les traits de caractère des puritains, les mauvais comme les bons. Il se montra persécuteur impitoyable, comme en témoignent les Quakers qui content, au sujet de sa dureté envers une femme de leur secte[7], une histoire dont le souvenir durera plus longtemps, il faut le craindre, que celui d’aucune de ses meilleures actions qui furent cependant nombreuses. Son fils[8] hérita de cet esprit de persécution. Il joua un tel rôle dans le martyre des sorcières que leur sang l’a marqué d’une tache assez profonde pour que, dans le cimetière de Charter Street, ses vieux os en soient encore rougis, s’ils ne sont pas complètement tombés en poussière ! Je ne sais pas si ces miens ancêtres se repentirent et demandèrent pardon au ciel de leur cruauté ou si, dans une autre existence, ils gémissent sous les lourdes conséquences de leurs erreurs. En tout cas, je prends, moi, l’écrivain actuel, leur honte à ma charge et je prie pour que soient à présent et à jamais retirées les malédictions qu’ils ont pu s’attirer – toutes celles dont j’ai entendu parler et qui, d’après les longues tribulations de ma famille, pourraient bien avoir été agissantes.
Du reste, on ne saurait mettre en doute que ces deux rigides puritains au front sourcilleux se seraient tenus pour suffisamment punis de leurs fautes du fait d’avoir, pour rejeton, un propre à rien comme moi. Aucun des succès que j’ai obtenus – en admettant qu’en dehors de son cercle domestique ma vie ait jamais été éclairée par le succès – ne leur eût paru présenter la moindre valeur ou même n’être pas déshonorant. « Que fait-il ? » murmure à l’autre une des deux ombres grises de mes ancêtres. « Il écrit des contes ? Quelle occupation dans la vie, quelle façon de glorifier le Seigneur et d’être utile aux hommes de son temps est-ce là ! Hé, quoi ! Ce garçon dégénéré pourrait aussi bien être violoneux ! »
Tels sont les compliments que, de l’autre côté de l’abîme du temps, m’envoient mes deux grands-pères ! Mais ils ont beau me mépriser tant et plus, des traits accusés de leur nature n’en font pas moins partie de la mienne.
Profondément implantée dans la ville naissante par ces deux hommes énergiques, notre famille y a toujours vécu et toujours honorablement. Elle n’a jamais eu, que je sache, à rougir d’un seul membre indigne. Mais elle n’a jamais non plus, après les deux premières générations, accompli d’acte mémorable, ni même attiré l’attention du public. Petit à petit, ses membres se sont presque effacés à la vue – telles ces vieilles maisons peu à peu à demi recouvertes par l’accumulation d’un sol nouveau. De père en fils, ils ont depuis plus de cent ans pris la mer. Un capitaine grisonnant s’est, chaque génération, retiré du gaillard d’arrière, tandis qu’un garçon de quatorze ans prenait sa place héréditaire au pied du grand mât, face à l’écume salée et aux tempêtes qui avaient assailli son père et son grand-père. Ce garçon passait, en temps voulu, du poste d’équipage à la cabine, menait une vie aventureuse et revenait de ses courses à travers le monde pour vieillir, mourir et mêler enfin sa poussière à la terre natale. Ces longs rapports entre une famille et son lieu de naissance et de sépulture créent entre un être humain et une localité un lien de parenté qui n’a rien à voir avec l’aspect du pays ni avec les circonstances. Ce n’est pas de l’amour, mais de l’instinct. Le nouvel habitant de Salem, celui qui vient de l’étranger, ou dont en venait le père ou le grand-père, n’a que peu de droits au titre de Salemite. Il n’a aucune idée de la ténacité d’huître avec laquelle un vieux colon qui approche de son tricentenaire s’incruste dans cet endroit de toutes les forces de générations successives. Il n’importe absolument pas qu’à ses yeux la ville soit morne, qu’il soit las des vieilles maisons de bois, de la boue et de la poussière, du bas niveau de l’altitude et des sentiments, du vent d’est glacial et d’une atmosphère sociale plus glaciale encore – tout cela et tous les autres défauts qu’il peut voir ou qu’il imagine ne changent rien à rien. Le charme subsiste et agit aussi puissamment que si ce lieu de naissance était un Paradis Terrestre. Il en a été ainsi en mon cas. Tandis qu’un représentant de ma race descendait au tombeau, un autre n’était-il pas toujours venu le relever, pour ainsi dire, de la garde qu’il montait à titre de passant dans la Grand-Rue ? J’ai senti que c’était en quelque sorte mon destin d’habiter Salem afin qu’un type physique et une tournure de caractère qui, toujours, constituèrent un des traits familiers de la vieille ville, continuent d’y figurer ma courte vie durant. Ce sentiment est pourtant en lui-même la preuve que le lien en question est devenu malsain et qu’il est temps de procéder à une séparation. La nature humaine, pas plus qu’un plant de pommes de terre, ne saurait prospérer si on la pique et repique pendant trop de générations dans le même sol. Mes enfants ont eu d’autres lieux de naissance et, dans la mesure où je pourrai agir sur leurs destinées, ils iront enfoncer des racines dans un sol nouveau.
Quand je quittai le vieux presbytère, ce fut surtout cet étrange, cet indolent et morne attachement pour ma ville natale qui me poussa à venir occuper un poste dans le susdit édifice en briques de l’Oncle Sam alors que j’aurais aussi bien, voire mieux fait d’aller ailleurs. Mon destin se ressaisissait de moi. Ce n’était pas la première fois ni la seconde que j’étais parti de Salem – pour toujours semblait-il – et que je revenais, tel un sou faux, ou comme si Salem était pour moi le centre du monde.
C’est donc ainsi qu’un beau matin j’escaladai l’escalier de granit, nomination en poche, pour apparaître au corps des fonctionnaires qui allaient m’aider à porter mes lourdes responsabilités d’inspecteur des Douanes[9].
Je doute fort – ou plutôt non, je ne mets rien en doute du tout – qu’un chef de service des États-Unis ait jamais eu sous ses ordres un corps de vétérans d’âge aussi patriarcal que celui auquel j’eus affaire. Depuis plus de vingt ans, la position indépendante de leur chef avait tenu à Salem les fonctionnaires de la Douane à l’abri des vicissitudes politiques qui rendent généralement tout poste si fragile. Officier – et officier des plus distingués de la Nouvelle-Angleterre – ce chef, le général Miller[10], se maintenait inébranlablement sur le piédestal de ses valeureux services. Et, se sentant soutenu par le sage libéralisme de ses chefs successifs, il avait, pour sa part, maintenu en place ses subordonnés en plus d’une heure où menaçaient des tremblements de terre administratifs. Le général Miller était radicalement conservateur : sur sa nature de brave homme, l’habitude n’avait pas une mince influence. Il s’attachait avec force aux visages familiers et ne se décidait qu’à grand-peine à opérer des changements, même au cas où ceux-ci auraient entraîné d’indiscutables améliorations. C’est ainsi qu’entrant en fonction je ne trouvai guère en place que des hommes âgés –vieux capitaines de la marine marchande pour la plupart qui, après avoir été secoués par toutes les mers du monde et avoir hardiment tenu tête aux tempêtes de la vie, avaient finalement été poussés vers ce havre paisible. Là, sans être guère inquiétés que par les transes que leur valaient les élections présidentielles, ils avaient passé un nouveau bail avec l’existence. Sans être moins sujets que leurs semblables à la vieillesse et aux infirmités, ils possédaient très évidemment un charme pour tenir la mort à distance. Deux ou trois d’entre eux, atteints de la goutte ou de rhumatismes, n’auraient jamais eu l’idée de se faire voir dans les bureaux durant une grande partie de l’année. Mais au sortir d’un hiver de somnolence, ils se glissaient dehors, sous le chaud soleil de mai ou de juin, pour répondre à l’appel de ce qu’ils nommaient leur devoir. Ensuite de quoi, à leurs heure et convenance, ils allaient se remettre au lit.
Je dois m’avouer coupable d’avoir abrégé le souffle de ces vénérables serviteurs de la République. Ils reçurent, par suite de mes représentations, licence de se reposer de leurs labeurs. Et peu après, comme si seul les avait retenus à la vie – et je suis d’ailleurs convaincu que c’était le cas – leur zèle au service de la communauté, ils se retirèrent en un monde meilleur. Ce m’est une pieuse consolation de me dire que, grâce à mon intervention, un laps de temps suffisant leur fut accordé pour se repentir des pratiques corrompues où tout douanier est supposé tomber – les portes de la Douane n’ouvrant pas sur le chemin du Paradis.
La plus grande partie de mes subordonnés étaient whigs[11]. Il était heureux pour leur confrérie chenue que le nouvel inspecteur ne se mêlât point de politique et, encore que fidèlement attaché en principe à la démocratie, ne dût point son poste à des services rendus à un parti. S’il en avait été autrement, si un politicien militant, nanti de cette place influente, avait assumé la tâche facile de tenir tête au directeur whig que ses infirmités empêchaient de remplir personnellement ses fonctions, c’est à peine si l’un des hommes de la vieille équipe eût conservé souffle officiel. D’après les idées reçues en pareille matière, il eût été du devoir d’un bon démocrate de faire passer toutes ces têtes blanches sous le couperet de la guillotine. Il était clair que ces bons vieux redoutaient de ma part quelque incivilité de ce genre. Cela me faisait de la peine et, en même temps, m’amusait de constater les terreurs que soulevait ma nomination, de voir une joue ravinée par les intempéries d’un demi-siècle de tourmentes devenir blême sous le regard d’un individu aussi inoffensif que moi, de discerner, lorsque l’un d’entre eux m’adressait la parole, un tremblement dans une voix qui avait, dans les temps anciens, hurlé dans un porte-voix assez vigoureusement pour imposer silence à Borée lui-même. Ces braves gens savaient bien qu’ils auraient dû faire place à des hommes plus jeunes, d’une nuance politique plus orthodoxe, de toute façon enfin, mieux qualifiés qu’eux pour servir notre oncle commun. Je le savais aussi, mais ne pouvais trouver le cœur d’agir en conséquence. Au grand dam de ma conscience professionnelle, ces bons vieux continuèrent donc, tant que j’occupai mon emploi, de se traîner au long des quais et de flâner sur l’escalier du bâtiment des Douanes. Ils passaient aussi une bonne partie de leur temps à dormir dans leurs coins habituels, sur leurs chaises appuyées en équilibre contre le mur ; s’éveillant deux ou trois fois dans la journée pour s’assommer les uns les autres par la millième répétition d’une histoire de marin ou d’une des plaisanteries hors d’usage qui étaient devenues parmi eux des mots de passe et de ralliement.
On découvrit, je suppose assez vite, que le nouvel inspecteur n’était pas très redoutable. Alors d’un cœur léger et rendus tout heureux par la conscience de remplir un devoir utile – sinon envers le pays, du moins envers eux-mêmes – ces braves vieux messieurs vaquèrent aux diverses formalités de leur emploi. L’œil sagace derrière leurs lunettes, ils scrutèrent les cargaisons. Grandes étaient les histoires qu’ils faisaient pour des riens et merveilleux parfois, le manque de flair qui permettait à de gros morceaux de leur glisser entre les doigts. Toutes les fois qu’une mésaventure de ce genre arrivait, quand un wagon plein de marchandises de prix avait été débarqué en fraude, au grand jour et juste sous leur nez, rien ne pouvait surpasser le zèle qu’ils mettaient à fermer à double, triple tour et sceller à la cire toutes les ouvertures du vaisseau délinquant.
Au lieu d’une réprimande pour leur négligence précédente, le cas semblait réclamer un éloge pour les précautions qu’ils multipliaient, une fois le mal irréparablement accompli.
À moins que les gens ne soient par trop désagréables, j’ai la folle habitude de me sentir porté à l’affection envers eux. Le bon côté du caractère de mon voisin – si ce bon côté existe – est celui qui l’emporte généralement à mes yeux. Comme la plupart de ces vieux fonctionnaires avaient leurs bons côtés et comme ma position m’imposait envers eux une attitude protectrice favorable au développement de sentiments amicaux, je ne tardai pas à les prendre tous en affection.
Les après-midi d’été, quand l’ardente chaleur qui liquéfiait presque le reste des humains communiquait seulement à leurs organismes engourdis une ravigotante tiédeur, il était agréable de les entendre bavarder dans l’entrée sur leurs rangées de chaises en équilibre contre le mur. Les mots d’esprit des générations passées dégelaient sur leurs lèvres et en découlaient en même temps que des rires. La jovialité des hommes âgés a beaucoup de rapport avec la gaieté des enfants. L’esprit et le sens du comique n’ont pas grand-chose à y voir. Il s’agit, chez les uns comme chez les autres, d’une lumière qui joue en surface et donne un aspect joyeux tant à de verts rameaux qu’à de vermoulus troncs gris. Mais en un cas il s’agit vraiment des rayons du soleil, dans l’autre, il y a de la ressemblance avec la lueur phosphorescente du bois pourrissant.
Il serait tristement injuste, le lecteur doit s’en rendre compte, de représenter tous mes excellents vieux amis comme tombés en enfance. D’abord, tous mes collègues n’étaient pas vieux. Il y avait parmi eux des hommes dans la force de l’âge, énergiques, capables, tout à fait supérieurs au genre de vie apathique, à la situation dépendante que leur avait réservée leur mauvaise étoile. Et, par ailleurs, les boucles blanches de l’âge se trouvaient parfois être le chaume qui recouvrait une charpente intellectuelle en bon état. Mais, en ce qui concerne la majorité de mon corps de vétérans, je ne leur ferai nul tort si je les représente comme un tas de vieux radoteurs n’ayant rien conservé qui valût la peine des nombreuses expériences de leur longue vie. Ils semblaient avoir jeté aux quatre vents les grains d’or de la sagesse pratique, qu’ils auraient eu tant d’occasions d’engranger, et avoir bien soigneusement empli leurs mémoires de balle d’avoine. Ils parlaient avec bien plus d’intérêt et d’onction de leur petit déjeuner du matin ou de leur dîner de la veille que du naufrage qu’ils avaient fait quarante ou cinquante ans auparavant et que des merveilles du monde qu’ils avaient pu, en leur temps, voir de leurs yeux.
Leur aîné à tous, le patriarche, non seulement de cette petite équipe mais, j’ose le déclarer, de tout le respectable corps des fonctionnaires des Douanes aux États-Unis, était certain sous-inspecteur inamovible. Il pouvait vraiment être appelé un fils légitime de l’administration car son père, un colonel de la Révolution, qui avait été auparavant commissaire du port, avait créé un poste pour lui et l’y avait nommé en des temps si reculés que peu de gens en peuvent aujourd’hui garder le souvenir. Cet inspecteur était, lorsque je l’ai connu, un homme d’environ quatre-vingts ans et un des plus merveilleux spécimens de verdeur prolongée que l’on ait chance de rencontrer au long d’une vie. Avec son teint fleuri, sa personne compacte bien sanglée dans une tunique bleue à boutons brillants, son pas vif, son air dispos et de belle humeur, il donnait l’impression, non à vrai dire d’un homme jeune, mais d’une nouvelle invention de notre Mère Nature, d’un être que ni l’âge ni les infirmités ne devaient se mêler de toucher. Sa voix et son rire, qui ne cessaient de retentir dans tout le bâtiment, n’avaient rien de cassé ni de chevrotant, mais jaillissaient de ses poumons avec la sonorité du chant du coq ou du son du clairon. À le regarder simplement comme un animal (et il n’y avait pas grand-chose d’autre à voir en lui), il satisfaisait par sa santé intacte, sa faculté de jouir, en cet âge avancé, de toutes ou presque toutes les délices qu’il avait jamais recherchées. La vie que lui assurait son traitement – vie sans souci que ne troublait qu’à peine et rarement l’appréhension d’être destitué – avait évidemment contribué à lui rendre léger le passage du temps. Mais les raisons véritables et profondes de sa vitalité prolongée, il fallait les chercher dans la rare perfection d’une nature animale où ne se mêlaient qu’une dose très modérée d’intelligence et un appoint très négligeable d’éléments moraux et spirituels. Ces derniers existaient seulement dans une mesure suffisante pour empêcher le vieux monsieur de marcher à quatre pattes. Il ne possédait ni vigueur de pensée, ni profondeur de sentiments, ni gênante sensibilité. Rien, en somme, que quelques instincts ordinaires qui, avec l’aide de cette bonne humeur, inévitable conséquence de son bien-être physique, lui tenaient fort convenablement lieu de cœur. Il avait été l’époux de trois femmes, mortes toutes trois depuis longtemps ; père de quelque vingt enfants qui, un peu à tous les âges, avaient fait eux aussi retour à la poussière. On aurait pu supposer qu’il y avait là matière à suffisamment de chagrin pour assombrir les dispositions les plus joviales. Mais il n’en allait point ainsi avec notre vieux sous-inspecteur ! Un petit soupir suffisait à l’alléger du poids de tant de tristes réminiscences. L’instant d’après, il était aussi disposé à s’amuser qu’un petit garçon encore en robes : bien plus que le commis aux écritures du receveur qui, à dix-neuf ans, se montrait de beaucoup l’aîné des deux.
J’observais ce patriarcal personnage avec bien plus de curiosité que n’importe quel autre des humains qui s’offraient alors à mon attention. C’était vraiment un phénomène rare : si parfait à un point de vue, si creux, si décevant, si insaisissable qu’il en devenait inexistant à tous les autres. Je concluais qu’il n’avait ni cœur, ni âme, ni esprit. Rien, comme je l’ai déjà dit, que des instincts.
Et pourtant, le petit nombre d’éléments qui composaient son personnage avait été si habilement assemblé que cet homme ne donnait aucune impression pénible de lacune. Il m’inspirait, tel quel, une satisfaction complète. Sans doute était-il difficile de concevoir comment il pourrait exister dans l’au-delà tant il semblait fait pour le monde des sens. Mais, même si elle devait se terminer avec son dernier soupir, son existence ici-bas ne lui avait pas été donnée par un geste dépourvu de bonté. Sans avoir plus de responsabilité que les bêtes des champs, le vieux sous-inspecteur avait eu de plus larges possibilités de jouissances qu’elles en même temps que l’immunité bénie qui les préserve des sombres tristesses du vieil âge.
Un point sur lequel il remportait de beaucoup l’avantage sur ses frères à quatre pattes était son don de se souvenir des bons dîners qu’il avait mangés – et manger de bons dîners avait, en grande partie, constitué le bonheur de sa vie. La gourmandise était chez lui un trait fort agréable : l’entendre parler d’un rôti vous mettait en appétit aussi bien qu’un radis ou une huître. Comme il ne possédait aucune qualité plus haute, ne lésait aucun attribut spirituel en vouant toutes ses énergies et ses talents aux délices de son palais, cela m’était toujours un plaisir de l’entendre deviser de poissons, volailles, viandes de boucheries et des meilleures façons de les préparer pour la table. Pour reculée que fût la date des festins évoqués, ses souvenirs de bonne chère semblaient faire monter le fumet de porcs ou de dindes sous vos narines. Des succulences s’attardaient sur sa langue depuis des soixante et soixante-dix ans et gardaient apparemment dans sa bouche une saveur aussi fraîche que la côtelette qu’il avait le matin même dégustée à son petit déjeuner.
Je l’ai vu se pourlécher de repas dont tous les convives, excepté lui, servaient depuis longtemps de nourriture aux vers. Il était merveilleux de voir les fantômes de ces banquets s’élever sans cesse devant lui, non sous le coup de la colère et pour lui demander des comptes, mais comme pour lui manifester leur reconnaissance d’avoir été si bien appréciés. Un tendre filet de bœuf, un jarret de veau, une côte de porc, certaine dinde ou tel poulet entre tous dignes de louanges au temps, peut-être, du premier des deux Adams[12] avaient place en son souvenir. Alors que tout ce qui avait pu se passer entre-temps dans la vie du pays ou dans sa propre existence avait glissé sur lui sans peser beaucoup plus qu’une brise passagère. Le plus tragique événement de la vie du vieil homme était, pour autant que j’aie pu en juger, la déception que lui avait causée une oie qui vécut et mourut il y a quelque vingt ou quarante ans. Une oie à la silhouette on ne peut plus prometteuse mais qui se révéla, à table, si furieusement coriace que le couteau à découper ne put entamer sa carcasse et qu’il y fallut la hache et la scie.
Mais il est temps d’en finir avec cette esquisse. J’aimerais pourtant m’y attarder indéfiniment car, de tous les êtres que j’ai connus, ce personnage était le mieux fait pour être fonctionnaire des Douanes. La plupart des gens, pour des raisons que je n’aurais pas la place d’indiquer ici, pâtissaient moralement du mode de vie qu’implique cet état. Notre vieux sous-inspecteur ne risquait rien de ce genre. S’il lui avait fallu continuer de mener la vie de bureau jusqu’à la fin des temps, il se serait maintenu dans le même parfait état de santé et chaque jour mis à table de tout aussi bon appétit.
Il y a un personnage dont l’absence laisserait ma galerie de portraits étrangement incomplète, mais les occasions relativement rares que j’ai eues de l’observer me permettront seulement d’en esquisser les contours. Je veux parler de notre directeur, de ce vaillant vieux général qui, après avoir rendu dans l’armée de brillants services, puis gouverné un sauvage territoire de l’ouest, était venu ici, voici quelque vingt ans, passer le déclin d’une vie honorable et mouvementée. Ce brave soldat avait déjà atteint, sinon dépassé, soixante et dix ans. Il poursuivait ici-bas sa marche en avant sous le poids d’infirmités que même la musique martiale de ses souvenirs ne pouvait pas beaucoup alléger. Son pas, jadis le premier dans les charges, était paralysé aujourd’hui. C’était seulement avec l’aide d’un serviteur, et en s’appuyant lourdement de la main à la rampe de fer, que notre chef pouvait péniblement et lentement gravir l’escalier du bâtiment des Douanes pour se traîner ensuite jusqu’à son fauteuil habituel, près du feu. Il y restait assis, regardant avec une sérénité quelque peu embuée les gens qui allaient et venaient, parmi le bruissement des papiers, les prestations de serments, les discussions d’affaires, les conversations de bureau. Bruits et circonstances semblaient n’impressionner que bien vaguement ses sens, ne pénétrer qu’à peine dans la sphère intérieure de sa contemplation. Si l’on appelait son attention, une expression d’intérêt courtois montait éclairer son visage, prouvant qu’il y avait de la lumière en lui, que seules les parois extérieures de sa lampe intellectuelle en obstruaient le passage. Plus on pénétrait avant dans son esprit, plus on le trouvait sain. Mais lorsqu’on ne faisait plus appel à lui pour qu’il parlât ou prêtât l’oreille – deux opérations qui lui coûtaient un effort évident – son visage revenait vite à son expression première de tranquillité d’ailleurs nullement morne – une expression qui n’était pas pénible à voir car, si elle était vague, elle n’évoquait en rien l’imbécillité de la décrépitude. La charpente de cette nature, à l’origine forte et massive, ne tombait pas encore en ruine.
Observer et définir ce caractère dans des conditions si désavantageuses n’en restait pas moins aussi difficile que de reconstruire en imagination une vieille forteresse comme celle de Ticonderoga[13] d’après une vue de ses murs gris tout éboulés. Çà et là, des remparts peuvent rester intacts mais, partout ailleurs, on ne trouve qu’une masse informe écrasée sous son propre poids et qu’ont envahie, au cours de longues années de paix et d’abandon, une verdure et des herbes étrangères.
Néanmoins, en regardant le vieux guerrier avec affection – car, pour insignifiantes que fussent entre nous les communications, il m’inspirait, à moi comme à tous les bipèdes ou quadrupèdes qui l’approchaient, un sentiment qui peut très bien s’appeler ainsi – je pouvais discerner les traits principaux de son personnage. Il portait la marque de nobles, d’héroïques qualités qui prouvaient que ce n’avait pas été pur hasard mais justice si cet homme s’était fait un nom. Je me rendais compte que son esprit n’avait jamais dû se distinguer par des activités troublantes. De tout temps il avait dû avoir besoin d’une impulsion pour se mettre en branle ; mais une fois en mouvement avec des obstacles à surmonter et un but digne de lui à atteindre, il n’avait pas été homme à s’avouer battu. L’ardeur qui, autrefois, l’animait, qui n’était pas encore tout à fait éteinte, n’avait jamais été de celles qui fulgurent et flambent haut. Elle avait répandu plutôt cette profonde lueur rouge du fer qu’on forge. Poids, solidité, fermeté – telle était l’expression de son repos même au temps dont je parle, sous les atteintes de la décrépitude précoce.
Il me semblait que, sous l’influence d’une surexcitation qui le pénétrerait assez profondément, qu’au bruit d’un coup de trompette assez fort pour éveiller toutes ses énergies qui n’étaient pas mortes mais seulement endormies, cet homme eût encore été capable de rejeter ses infirmités comme une robe de malade, de lâcher la canne du vieil âge et de se ressaisir de l’épée du combat. Et, en pareil moment, son attitude serait restée calme.
Un spectacle pareil n’était du reste bon à évoquer qu’en imagination. Il ne fallait ni compter ni souhaiter y assister. Aussi indiscutablement que dans les vieux remparts de Ticonderoga, déjà cités comme le meilleur des termes de comparaison, je voyais en lui les traces d’une endurance inébranlable qui, en sa jeunesse, était peut-être allée jusqu’à l’obstination ; d’une intégrité qui, ainsi que la plupart de ses autres qualités, se présentait comme une masse pas mal lourde, aussi peu malléable qu’une tonne de minerai de fer ; d’une bonté qui, pour aussi farouchement qu’il eût manié la baïonnette à Chippewa ou à Fort Erie[14], était tout aussi authentique que celle qui peut animer n’importe quel champion de la philanthropie moderne. Il avait tué des hommes de ses propres mains pour autant que je sache – des hommes qui avaient dû tomber comme l’herbe sous la faux devant les charges que son esprit animait d’énergie triomphale. Pourtant, qu’on se l’explique comme on voudra, il n’y avait jamais eu en son cœur assez de cruauté pour dépouiller de ses vives couleurs l’aile d’un papillon. Je n’ai jamais connu d’homme en la bonté de qui j’eusse fait appel avec plus de confiance.
Plus d’un trait caractéristique du général – et de ceux qui ne contribuent pas le moins à la ressemblance d’une esquisse – devait avoir disparu ou s’être obscurci avant notre rencontre. Les attributs simplement gracieux sont d’habitude les plus éphémères. Et la nature n’orne pas les ruines humaines de beautés nouvelles n’ayant leur terrain que dans les crevasses de la caducité, si elle sème des giroflées sur la forteresse démantelée de Ticonderoga. Pourtant, même du point de vue de la beauté et de la grâce, des détails étaient à noter chez le général. Un rayon de malice humoristique perçait de temps en temps le voile de l’indifférence et venait agréablement éclairer son visage. Un trait d’élégance naturelle, que le caractère masculin ne présente guère une fois l’enfance et la première jeunesse passées, se manifestait aussi chez lui par son goût pour les fleurs.
Un vieux soldat peut sembler devoir n’attacher de prix qu’aux lauriers sanglants qui couronnent son front mais celui-ci paraissait aussi sensible qu’une jeune fille aux charmes de la tribu des fleurs.
Le brave vieux général avait donc coutume de s’asseoir au coin de la cheminée. Là, l’inspecteur, s’il s’abstenait autant que possible de la tâche difficile d’entrer en conversation avec lui, aimait le contempler d’un peu loin dans son calme presque somnolent. Il paraissait éloigné de nous bien qu’à quelques mètres de nos yeux, inaccessible bien qu’à portée de notre main qui aurait pu toucher la sienne au passage. Peut-être menait-il une vie plus réelle au cœur de ses pensées que dans le décor, si peu fait pour lui, d’un bureau de receveur des Douanes ? Les évolutions d’une manœuvre, le tumulte d’une bataille, les accents héroïques d’une vieille marche militaire entendue il y avait quelque trente ans – peut-être ces visions et ces bruits existaient-ils pour ses sens par le souvenir. Cependant les armateurs et les capitaines de vaisseau, les employés proprets et les rudes matelots entraient et sortaient ; le remue-ménage de la vie commerciale et administrative continuait d’élever sa petite rumeur autour de lui – et pas plus avec les hommes qu’avec leurs besognes, le général ne semblait entretenir le moindre rapport. Il était aussi peu à sa place que l’aurait été parmi les encriers, les paperasses, les règles d’acajou du bureau du receveur une vieille épée, rouillée à présent, mais ayant étincelé autrefois sur les champs de bataille et laissant miroiter encore la lueur de l’acier au long de sa lame.
Un détail m’était d’un grand secours pour recréer le vaillant officier des frontières du Niagara – l’homme profondément et simplement énergique. C’était le souvenir de ce mémorable « j’essaierai[15] » qu’il avait prononcé à l’heure d’une entreprise héroïque et désespérée. Un mot qui respire l’âme et l’esprit de cette audace de la Nouvelle-Angleterre qui a clairement conscience de tous les périls et les affronte tous. Si, dans notre pays, la valeur était récompensée par des quartiers de noblesse, ce mot, si facile à dire, semble-t-il, mais que lui seul a prononcé en face d’une tâche glorieuse et dangereuse, serait la meilleure et la mieux appropriée des devises pour l’écu du général.
Un homme gagne beaucoup en santé intellectuelle et morale à la fréquentation de gens qui diffèrent de lui, ne se soucient guère de ses travaux et que lui-même ne peut apprécier qu’en sortant de la sphère de ses capacités. J’ai souvent eu dans ma vie cet avantage, mais jamais d’une façon aussi complète que durant mon séjour prolongé dans l’administration. C’est là qu’il m’a été, en particulier, permis d’observer quelqu’un qui m’a donné une idée nouvelle du talent. C’était un homme foncièrement doué pour les affaires. Il avait l’esprit clair et prompt, un œil qui perçait à jour les pires enchevêtrements, une faculté pour tout arranger qui faisait s’évanouir les difficultés comme sous un coup de baguette magique. Entré dans les Douanes au sortir de l’enfance, il avait là son champ d’activité. Toutes les inextricables complications si épuisantes pour un intrus se présentaient à lui avec le tranquille caractère d’un ensemble parfaitement cohérent. Il ne faisait en vérité qu’un avec les bureaux de la Douane. Il en était, en tout cas, le ressort principal, celui qui maintenait en activité tous leurs rouages.
Dans une administration qui les nomme en vue de leur profit et de leur convenance et ne tient que bien rarement compte de leurs aptitudes à remplir leur emploi, les fonctionnaires sont bien obligés de chercher en dehors d’eux-mêmes l’habileté qui leur manque. Aussi notre homme d’affaires attirait-il à lui, tout aussi naturellement que l’aimant le fer, toutes les difficultés que rencontrait tout le monde. Avec une condescendance pleine d’aisance, une patience pleine de bonté pour notre stupidité – qui à un esprit comme le sien devait paraître quasi criminelle – il nous rendait d’une pichenette l’incompréhensible aussi clair que le jour. Les marchands le mettaient aussi haut que nous le mettions, nous, ses frères ignares. Son intégrité était parfaite – une loi de la nature chez lui plutôt qu’un principe. Un esprit aussi remarquablement clair et précis ne pouvait, en effet, qu’être honnête en affaires. Une tache sur sa conscience à propos d’un détail touchant sa vocation tourmenterait un homme pareil un peu de la même manière – encore que bien plus fortement – qu’une erreur de comptabilité ou une tache d’encre sur la belle page nette d’un registre. Bref, j’ai rencontré là pour une fois dans ma vie une personne parfaitement adaptée à sa situation.
Tels étaient quelques-uns des personnages à qui je me trouvais avoir affaire. J’estimais que cette situation, si éloignée de mes anciennes habitudes, était une bonne chance pour moi et je me mis en devoir d’en retirer tout le bénéfice possible. Après avoir partagé les travaux des rêveurs compagnons de Brook Farm[16] et tenté, avec eux, de mettre l’impraticable en pratique ; après avoir été pénétré trois ans par l’influence subtile d’un esprit comme celui d’Emerson[17] ; après avoir passé des jours et des mois à me livrer, en pleine liberté et en pleine nature, à des spéculations fantastiques près d’un feu de branches mortes avec Ellery Channing[18] ; après avoir discuté sur les vestiges des Indiens avec Thoreau dans son ermitage de Walden[19] ; après m’être imprégné de poésie au foyer de Longfellow[20], le temps était venu d’exercer d’autres facultés de ma nature et de me nourrir d’aliments qui ne m’avaient jusqu’alors guère mis en appétit.
La littérature, ses buts, les efforts qu’elle exige, n’avaient plus que peu d’importance à mes yeux. Il y avait en moi une faculté, un don, qui, s’il ne m’avait pas tout à fait abandonné, s’était assoupi et demeurait inerte.
Il y aurait eu en tout ceci quelque chose d’inexprimablement lugubre, si je n’avais eu conscience de conserver le pouvoir de rappeler à moi ce qui avait eu quelque valeur dans le passé. Sans doute, une vie pareille n’aurait pu être longtemps vécue sans dommage. Elle pouvait faire de moi un être à jamais différent de celui que j’avais été sans me transformer en rien qui en valût la peine. Mais je la considérai toujours comme étant transitoire. Un instinct prophétique ne cessa jamais de me souffler tout bas à l’oreille que, sous peu, dès qu’il me serait devenu essentiel, un changement s’opérerait en ma faveur.