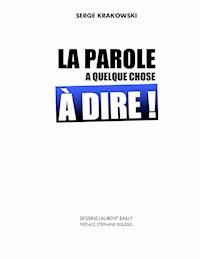
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
La parole ne dit plus rien ! La parole est en panne ! Le sens dépérit, l’orateur disparaît et la communication règne. De ce fait, la méfiance est devenue institutionnelle. Les mots maltraités sont devenus frauduleux, leur sens équivoque et leur impact suspect. « Mal nommer les choses, c’est participer au malheur du monde » disait Albert Camus. Après la description des exemples de délitement de la parole au sein d’une société en relâchement, qui augure de nos prochaines « démocraties totalitaires », se dessinent les fils à renouer d’une parole authentique. Ce livre présente les questions essentielles pour redevenir des humains de parole. Cela n’est pas sans risque, car devenir pertinent dans son discours, c’est apparaître impertinent aux yeux d’une conscience sociale aseptisée. Mais si nous ressentons ce vide d’une parole absente qui nous éloigne du monde et de nous-mêmes, nous devons entrer en résistance et faire contrepoids à la tartufferie ambiante en opposant notre voix. Celle qui s’appuie sur le sens. Celle qui affronte le réel pour agir sur lui. Celle qui réconcilie le souffle, l’idée et l’ambition. Celle qui revendique à nouveau que la parole a quelque chose à dire !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À Joëlle, Anaïs et Juliette
Un grand merci à Michèle pour sa relecture fructueuse
Clin d’œil amical à Jean-Daniel pour nos conversations débridées et inspirantes.
Préface
Ce n’est pas un hasard si ce livre parle de tout autre chose que de la parole. Tout l’art de Serge Krakowski est d’utiliser le travail sur la parole comme « prétexte » à la découverte de soi. S’affranchir de la technique pour vous emmener vers l’authentique, l’éthique. J’ai eu la chance de suivre ce cheminement, et vingt ans après, mon souvenir s’ancre plus sur les difficultés et le plaisir d’une introspection que sur celui d’une formation sur la prise de parole. Toute sa pédagogie repose sur la mise en évidence des paradoxes permanents : Vous croyez apprendre avec lui comment s’habiller, s’armer, pour affronter le public, et, il vous démontre les bienfaits de la nudité. Vous confondez improvisation et authenticité et vous découvrez tout le travail préalable sur soi nécessaire pour que l’impact sur l’autre soit réel. À chacun son contrepied : pour ma part, je me souviens avoir choisi de travailler sur le poème d’Aragon « Il n’y a pas d’amour heureux ». Je l’ai joué comme je le ressentais : en appuyant sur le côté désespérant du texte. Il m’a juste fait comprendre que si je pensais qu’un vers comme : « le temps d’ap-prendre à vivre, il est déjà trop tard » était porteur, par sa puissance, d’une charge émotionnelle forte, il n’était pas nécessaire d’en rajouter... Tout le long de son livre, il nous communique sa conviction basée sur l’expérience que la parole peut enrichir ou appauvrir le rapport à l’autre, par maladresse ou... par une mécanique médiatique vide de sens. C’est cette mécanique désastreuse que Serge démonte patiemment, car c’est elle qui tue insidieusement la parole. Son livre n’est pourtant pas désespérant ; l’humour est là, par l’image, avec l’apport piquant de Laurent Bailly, et il finit par une dernière envolée sur la vie avec la possibilité d’une alternative au cynisme.
Stéphane Roussel
Avant-propos
Il y a maintenant vingt ans que j’enseigne aux entreprises, écoles et autres institutions les techniques de l’Art oratoire.
Cela a commencé par la découverte du profond désarroi de nombreux adultes qui, n’ayant pas été initiés dès l’école aux techniques fondatrices de la communication orale, ont vu leur appréhension s’intensifier au fur et à mesure de leurs grandissantes obligations professionnelles de prises de parole.
Puis ce fut, tout au long de ces vingt années d’enseignement, l’observation du lent mais inexorable affaiblissement des contenus dans les présentations.
Non seulement la forme constituait un handicap de départ, faute d’appren-tissage, mais le fond également était atteint par une curieuse maladie lancinante et invasive : la vacuité.
Que dire par exemple de ces nombreuses réunions intitulées Point d’avan-cement qui sont à prendre au pied de la lettre puisque le plus souvent, effectivement, il y est constaté qu’il n’y a point d’avancement.
Les prestations orales sans contenus mais copieuses en informations se mirent à envahir les espaces dédiés à la communication.
Espaces qui par ailleurs, identiques à ces théâtres conçus par des architectes qui n’y vont jamais, empilent tous les défauts de conceptions propres à rendre inefficaces toutes tentatives d’éloquence.
Par ailleurs, la pernicieuse progression d’une rationalité tyrannique voulant par absolutisme, supplanter le bon sens, c’est l’ineptie qui prit bientôt le masque de la légitimité.
Pour parfaire le désastre, le politiquement correct surenchérissant la déviance initiale, c’est le sens lui-même qui amorça sa disparition du champ de l’intelligible.
De plus, je fis le constat effrayant que tous les langages, qu’ils soient institutionnels, politiques, médiatiques, revendicatifs ou autres, s’étaient ligués au fil du temps pour créer, tous ensemble, avec une paradoxale inconscience délibérée, la communication virtuelle.
Tout cela m’a conduit à entamer ce décryptage d’un monde malade d’une parole dévoyée.
Ce livre commence par une analyse des causes et effets de cette lente destruction de la parole, puis tente de dégager les pistes d’un retour vers l’efficience du discours et enfin, dans sa dernière partie, essaie de réconcilier l’esprit critique avec la réflexion et propose d’abandonner le prêt à penser si cher à notre époque, afin de revivifier le raisonnement et la parole qui doivent rester inséparables.
Le ton volontairement provocateur et par moment iconoclaste de cette remise en cause systématique de vérités communément admises par tous a été rendu nécessaire par la violence sournoise d’une société qui s’autorise de moins en moins à se réfléchir.
Je demande pardon à ceux qui pourraient se sentir visés par des paroles excessives.
Mon but n’est pas de blesser, mais seulement de faire réagir et il est grand temps de réamorcer notre discernement.
« L’homme est un homo loquens. Le langage nous a été donné, parler est notre tâche. Mais les mots humains sont plus que des signaux pour nos sentiments ou des signes pour nos concepts. Ce monde est un univers symbolique, et le langage est le principal organe humain pour participer à la vivante réalité symbolique de cet univers. »
Raimon Panikkar
Table
Première partie
I - Le bilan - État des lieux - Parole défunte
Introduction
Richesse de la parole
Les raisons du déclin de la parole
- A Fin de l’enseignement de la rhétorique
- B Divorce prononcé entre l’école et la parole
L’enfant devenu adulte ou «Un homme à la mer !»
La dérive éthique : Le discours sur les valeurs
Enfonçons le clou : Le langage infecté ou le politiquement correct
Le discours piégé de la fonction Ressource Humaine
Un effet du politiquement correct : L’entreprise menacée par la déviance sectaire
Le manager en péril ou
«A vous de faire passer les bons messages...»
L’information surabondante
Les supports indigestes
Les grandes messes
Deuxième partie
II - Revenir à la parole – Parole vivante
Prolégomènes : Penser avant de reparler !
Le plan ou la structure
Vertu de l’éloquence
Les vertus du charisme
Comment devenir orateur : Se former
La pédagogie
Le théâtre pour devenir orateur
Les quatre questions à se poser pour accéder à la situation
Retour à la rhétorique
La rhétorique peut-elle être immorale ?
Retrouver la conviction et réinvestir la dialectique
Troisième partie
Réflexions d’hier, d’aujourd’hui et pour longtemps encore
Art et Théâtre
Changement
Communication
Comportement
Conflit, Crise
Connaissance de soi
Convaincre, Persuader, Séduire
Créativité, Imagination et Innovation
Désobéir, Dire Non, Critiquer
Diplôme ou Compétence
L’Entreprise
Evaluation, Process, Reporting
Formation, Éducation, Pédagogie
L’Homme et la Nature humaine
Information, Fond, Forme et Sens
Intuition
Management
Manipulation et Mensonge
Motivation et Réussite
Mots
Paradoxe
La Parole
Philosophie
Le Politiquement Correct
Pouvoir, Autorité
Public et Société
Raison
Réalité et Vérité
Réussir
Savoir
Technologie et Communication
Temps
Valeur
Vie
Annexes
Bibliographie
Première Partie
I - Le bilan – État des lieux – Parole défunte
Introduction
Redonnons sa place entière à la « Parole ».
Celle-ci nous est tellement quotidienne, que nous soyons dans l’émission ou dans l’écoute, que nous en oublions jusqu’à son essence profonde et l’immense champ des variétés d’expression qu’elle recouvre.
Elle est à l’origine de l’homme et la venue de l’écriture, loin de freiner son expansion, a au contraire démultiplié ses domaines d’excellence.
Bien sûr, faire l’éloge de la parole prend aujourd’hui un sens particulier.
A l’heure où « La Communication », nouvelle religion dominante, avec ses dévoiements, ses outrances et ses mensonges, est devenue la nouvelle idole fallacieuse, il convient de retourner aux sources de l’expression verbale et comportementale, de ses spécificités et de ses vertus premières.
A ce propos, l’analyse de Valère Novarina est éclairante sur l’inanité advenue du statut de la communication.
« Médium, médias, communication, information :
Ces mots-là nous trompent;
Tous les médias nous trompent.
Non par ce qu’ils disent, mais par l’image du langage qu’ils nous donnent :
Un enchaînement mécanique avec émetteur, récepteur, marchandise à faire passer, outils pour le dire et chose à transmettre.
Au bout de cet enchaînement, c’est l’homme, c’est le parlant lui-même qui n’a rien dit.
Au bout de la chaîne, il n’y a jamais que le message qui ait parlé. La communication parle toute seule. »
Étymologiquement, communiquer veut dire « mettre en commun ».
La parole n’existe que par le phénomène d’échange.
Avec cette particularité que, par l’échange, la parole se change.
Il y a loin entre ce qui est dit et ce qui est entendu.
La parole, de par cette distorsion, subit un étrange métabolisme où se joue la quête absolue du sens.
Sans récepteur, pas d’émetteur. La parole se joue à plusieurs.
Et lorsque nous parlons à nous-mêmes, nous sommes les deux à la fois.
La parole est ainsi le lieu privilégié de l’assemblée des hommes, de la cité et donc du vivre ensemble.
C’est une démarche de ressaisissement qu’il serait bon d’entreprendre.
Se ressaisir de la parole, c’est à dire faire revivre la possibilité de l’entendre à nouveau.
Et l’urgence est là, car le bruit a remplacé le son et la communication s’est substituée à l’expression.
Or, ce qui est le propre de l’homme, sa nécessité pour ainsi dire, c’est d’avoir pris la parole pour dire ce qu’il est, décrire le monde et s’y inscrire pour se donner les conditions de le transformer.
Par essence, la parole est transformation.
En cela elle est une métaphore de la pierre philosophale.
Le plomb changé en or et réciproquement.
Le vrai et le faux en même temps.
Dans la cité d’aujourd’hui, « la Parole multi-canal à message unique » qui, à vrai dire révèle une absence de pensée, prend diverses formes pour sculpter le vide dans le néant et déclare s’affranchir de la fonction naturelle du langage qui est de signifier.
La parole ne disant plus rien, elle infecte la capacité d’écoute.
L’oreille est polluée.
L’écoute est à reconquérir.
Et si l’on rajoute à cette déroute la communication numérique, virtuelle par essence, la boucle est bouclée.
« Les nouvelles technologies de l’information, au prétexte qu’elles permettent d’être là où l’on n’est pas, peuvent devenir le meilleur moyen de ne pas être là où l’on est » Frère Samuel
Dés lors, c’est à un dramatique retour en arrière de civilisation que nous assistons.
Nous sommes les témoins attristés de cette proclamation de l’inepte comme culture officielle avec son « Parler politiquement correct ».
Circulez, il n’y a plus rien à comprendre.
Il vous suffit d’admirer les bienfaits de l’avatar d’une pensée virtuelle mâchée sur mesure.
Avant, nous nous devions de tendre à penser juste et produire une réflexion individuelle, maintenant il nous est enjoint de « Bien Penser, c’est à dire comme tout le monde ».
Et pour prouver que nous pensons bien, il faut surtout aux oreilles de tous : « Bien Parler ».
Le niveau de censure ne fait qu’augmenter à mesure de l’affadissement des esprits et le débat aujourd’hui ne s’envisage qu’avec des « gens bien ».
Les médias illustrent malheureusement à la perfection cette déchéance de l’indépendance d’esprit et malheur aux journalistes intègres qui donnent la parole à tous.
Les petits camarades se chargent immédiatement de leurs taper sur les doigts.
(Voir Patrick Cohen, figure emblématique de la bien-pensance, reprocher à Frédéric Taddeï d’inviter des gens pas comme il faut … )
Dès lors, mon propos tente un déchiffrement des perversions de la parole afin de s’en dégager au mieux et de redécouvrir les vertus premières de l’art d’exprimer si bien énoncées par Boileau :
« Ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. »
C’est aussi une démarche citoyenne, donc politique au sens propre.
C’est la cité des hommes qui est interpellée dans son devenir.
2 - Richesse de la parole
Combien est remarquable la richesse des termes qui célèbrent les modalités d’expression de la parole ! La finesse le dispute à la nuance et c’est toujours dans un désir de précision et de clarté que se déclinent les subtilités de la langue.
L’énumération qui suit peut paraître fastidieuse mais comment supprimer une seule expression sans prendre le risque de mutiler une tonalité de la communication.
Parole historique
Parole osée
Parole libre
Paroles insensées,
Paroles magiques
Paroles hachées
Paroles violentes
Paroles attribuées
Parole de Dieu
Parole d’honneur
Paroles de bienvenue
Paroles assommantes
Paroles assourdissantes
Paroles blessantes
Ma parole !
Parole qui échappe
Parole qui froisse
Parole qui indispose
Parole désobligeante
Parole surprenante
Parole offensante
Bonne parole
Belles paroles
Dernières paroles
Porte-parole
Homme de parole
Temps de parole
Déluge de paroles
Sens des paroles
Moulin à paroles
Attaque en paroles
Sur parole
Il ne lui manque que la parole
Joindre le geste à la parole
Accorder la parole à quelqu’un
Accueillir des paroles
Adresser la parole à quelqu’un
S’exercer à la parole
Arracher une parole à quelqu’un
Assommer quelqu’un de paroles.
Avoir la parole facile
Boire les paroles de quelqu’un
Céder la parole à quelqu’un
Citer des paroles
Colporter la parole
Composer ses paroles
Crédibiliser des paroles
Se gargariser de certaines paroles
Se griser de ses propres paroles
S’enivrer de paroles
Consigner la parole
Couper la parole
Crédibiliser des paroles
Critiquer les paroles
Croire sur parole
Déformer les paroles
Dégager sa parole
Demander la parole
Dénaturer les paroles
Désavouer les paroles
Donner sa parole
Douter de la parole
Encourager quelqu’un de la parole et du geste
Endormir quelqu’un avec des paroles mielleuses
Engager sa parole
Enjôler quelqu’un par de belles paroles
Exciter quelqu’un par des paroles
Faire rentrer les paroles dans la gorge
Interpréter des paroles
Manquer de parole
Ménager ses paroles
Mesurer ses paroles.
Mettre des paroles à profit
Minimiser la parole
Modérer ses paroles
N’avoir qu’une parole
Nuancer des paroles
Obtenir la parole
Payer quelqu’un en paroles
Perdre la parole
Peser ses paroles
Porter la bonne parole
Prêcher la bonne parole
Prendre la parole en public
Prêter la parole à un objet
Prodiguer de bonnes paroles
Rapporter les paroles de quelqu’un
Réciter des paroles
Refuser la parole
Rendre sa parole
Répéter des paroles
Reprendre la parole
Respecter sa parole
Retirer la parole à quelqu’un
Retirer sa parole
Savourer les paroles de quelqu’un
Se délecter de certaines paroles
Séduire par la parole
S’entraîner à prendre la parole
S’étourdir de parole
La parole est donc bien notre véritable colonne vertébrale, celle autour de laquelle se charpente nos personnalités en fonction de l’usage que nous en faisons.
Il existe différentes approches pour cerner son essence et son fonctionnement, telles que la linguistique, la phonétique, la rhétorique, la dialectique, la sémantique et d’autres encore… mais aucune de celles-ci ne tente de figer l’homme dans un étiquetage comportemental ainsi que le font par exemple la graphologie, la morphopsychologie, la typologie selon Jung, le MBTI avec ses indicateurs Typologiques et Myers Briggs avec ses 16 types de personnalité et combien d’autres encore dont le sérieux le dispute à l’instrumentalisation.
Mais rien pour la parole en tant que telle. Et tant mieux.
Pourtant elle mérite d’être observée et les enseignements qui en découlent sont riches de révélations.
Encore faut-il avoir le souci d’écouter, d’observer et de faire surgir l’intui-tion.
Cela prend du temps, celui-là même qu’on ne cesse de vouloir nous retirer au nom de l’efficacité. D’ailleurs, la façon dont on modélise la première prise de contact des nouvelles générations avec leur langue maternelle et son apprentissage est éloquente.
C’est précisément l’élément temporel qui a présidé au choix de la méthode globale.
En un rien de temps, l’enfant peut faire illusion sur sa capacité à lire.
Reste aux adultes de faire semblant de croire que l’enfant comprend ce qu’il lit.
Mais peu importe, l’évaluation sera là pour valider la réussite apparente de l’opération.
Aujourd’hui la méthode globale a disparu officiellement au profit de la méthode dite « semi globale » ou « mixte » ce qui en d’autres termes signifie : « On ne change pas complètement une équipe qui perd ! » La méthode syllabique, également appelée « méthode synthétique », repose sur les propriétés phonétiques de notre alphabet.
La méthode dite « syllabique » est mal nommée : elle est en réalité « alphabétique » puisque la base est la lettre ou le graphème (non la syllabe).
Déjà pratiquée dans la Grèce antique, elle consiste à partir des éléments les plus simples : les lettres et les sons. Une fois que ceux-ci sont maîtrisés, l’enfant apprend à les composer en syllabes puis en mots. C’est le fameux « B - A, BA » (où les lettres B et A donnent la syllabe BA).
Que signifie cette méthode, sinon que l’enfant comprend ce qu’il lit et en devient comme le coauteur.
Le son et le signe s’assimilent par connivence et le son fait sens.
On pourra voir ici l’éternel combat entre les anciens et les modernes.
Il n’en n’est rien. C’est seulement le constat que la méthode globale va plus vite et que la méthode syllabique va plus loin.
C’est la constante d’une société qui croit avoir un combat à livrer avec le temps.
Combat perdu d’avance comme dit le poète :
« Le temps s’en va, le temps s’en va, madame,
Las ! Le temps, non, mais nous nous en allons,
Et tôt serons étendus sous la lame. »Pierre de Ronsard
3 - Les raisons du déclin de la parole
A - Fin de l’enseignement de la rhétorique
Le dernier tiers du XIXe siècle a été marqué par l’extinction de l’enseigne-ment rhétorique en France, symbolisée par la suppression de la classe de rhétorique dans les années 1880. L’école de la IIIe République supprime presque entièrement le « discours » et promeut la dissertation, qui devient vite dans les écoles l’exercice roi.
L’attaque des Romantiques aboutira, par le débat politique, à la suppression en 1885 par Jules Ferry de la rhétorique dans les programmes d’en seignement.
La pensée positiviste, qui voit dans l’écriture scientifique le seul type de discours permettant d’accéder à la vérité absolue, rejette la rhétorique comme l’art du mensonge institué, notamment dans l’enseignement.
A la différence de la rhétorique ancienne, celle qui est enseignée aujourd’hui n’entend plus fournir des techniques, mais revendique une analyse scientifique, car elle veut mettre en lumière les règles générales de la production des messages. Il ne s’agit plus de former des rhéteurs mais de réfléchir sur les rhéteurs et le discours, sur les rôles du locuteur et de l’interlocuteur. Il s’agit d’une période riche en conceptions et théories, parfois très personnelles, voire uniquement le fait d’un auteur. Par ailleurs, un ensemble de sciences éclairent le discours sur l’art oratoire, qui s’enrichit des apports de la linguistique, de la psychologie ou encore des mathématiques.
Le site :ecolederhetorique.comprécise utilement la situation :
Une objection de taille contre la rhétorique est qu’elle a trop souvent permis l’emprise d’une élite sur la société. C’est ce qui explique la réaction du rapport Parent qui jugea que l’enseignement de la rhétorique ne convenait plus à une société ouverte, fondée sur l’égalité des chances. La libéralisation de l’éducation, objectif fort louable et qui a réussi dans une certaine mesure, passait donc par sa suppression. On fit son procès et la rhétorique tua la rhétorique. Or celle-ci ne se réduit pas à une simple habileté logique qui donne un pouvoir sur les autres et elle peut s’enseigner à tous. Vers 1960, plusieurs universitaires, tel Chaïm Perelman, lui ont redonné ses lettres de noblesse, en réaction aux propagandes totalitaires du nazisme et du stalinisme. La réussite de Perelman a été de mettre en évidence les règles de la persuasion qui gouvernent le rapport avec un auditoire quelconque, qu’il soit composé d’une ou de plusieurs personnes.
Notre monde quotidien ne comporte pas de certitudes scientifiques, la vérité est rarement évidente, et cependant il nous faut sans cesse prendre des déci--sions, ce qui ne signifie pas irrationalité ou chaos. Le domaine de la rhétorique, c’est l’espace qui est laissé à la créativité humaine. Elle peut être cela parce qu’en démocratie, avec le développement des assemblées de toutes sortes, qui naissent dès que des humains désirent prendre des décisions en commun, les vieilles règles s’appliquent : il faut savoir comment convaincre et conduire une argumentation, dans un contexte où il n’est pas possible d’uti-liser une démonstration de type logico-mathématique. Que l’on pense par exemple à l’Institut du Nouveau Monde, créé par Michel Venne, dont l’un des objectifs est d’élaborer des méthodes de délibération et de participation civique pour les jeunes, lors d’activités comme l’Université du Nouveau Monde ou les forums de discussions sur Internet. En outre, les médias véhiculent sans cesse de nouvelles informations, une multitude d’opinions qui réclament une prise de position, des questions de société qui demandent réflexion avant d’opter pour la solution que l’on estime la meilleure. Toutefois devant un tel foisonnement d’informations, souvent contradictoires, devant la puissance des médias, il s’ensuit que souvent ce n’est pas nous qui changeons d’opinions, mais les opinions qui se transforment en nous, sans même que nous en prenions conscience. Or, la rhétorique est un art éprouvé qui consiste en la formation d’esprits critiques et avertis. Elle apprend aussi à se défier des fausses logiques, ce qui est tout simplement apprendre à penser.
Bien sûr, comme tout art humain, elle peut être utilisée de manière immorale. Cependant, argumenter est à la base du commerce humain. Puisque l’on n’échappe pas à persuader sauf par la violence, apprenons à bien persuader. À l’école, pourrait s’y intégrer une dimension éthique. Il n’est pas si facile d’affronter par soi-même l’épreuve du dialogue et de la réfutation. Mais cela peut se faire à condition que ceux qui y participent soient égaux. Si on ne peut plus contester les arguments de l’autre parce qu’il s’arroge un rôle exorbitant, alors le dialogue n’est plus possible. Il ne reste plus qu’idéologie et langue de bois. La liberté est au cœur de ce type de rhétorique, il appartient à chacun de créer ce climat de liberté et de s’ouvrir aux objections possibles des autres. Apprendre ensemble à persuader, c’est-à-dire à s’entendre sur des règles à observer, sur les fautes à ne pas commettre, sur les moyens à ne pas employer sous peine d’être disqualifié, comme une sorte de jeu. Le jeu civilisé du dialogue qui a une fonction médiatique entre la fonction persuasive et les valeurs humaines de respect d’autrui, de liberté de pensée, d’indépendance du jugement et de tolérance. Qui cherche à convaincre renonce à la violence et à l’autoritarisme, puisque les divergences sont inévitables. Les moyens utilisés par la rhétorique sont aussi d’ordre affectif, raison et sentiment étant inséparables. Car pour persuader, il faut être capable de comprendre l’autre, ses sentiments, ses émotions, sinon la persuasion reste sans effet. Elle peut de ce fait participer à la construction d’une communauté.
La rhétorique est avant tout un art de penser, de découvrir des idées, de rechercher ensemble des solutions. C’est pourquoi se pose la question de l’intégration de cette formation dans le cadre des programmes scolaires. L’his-toire, les lettres, la philosophie et d’autres matières sont des champs où elle pourrait s’inscrire. Ce pourrait être une occasion de faire sauter le cloisonnement des savoirs qui favorise un cloisonnement des esprits et de développer l’intelligence des relations. La pédagogie elle-même pourrait en être transformée. Car une formation à la rhétorique serait stérile si elle n’était étroitement associée à la transmission d’une culture qui permette à chacun de se façonner une formation générale. Au cours des siècles, elle s’est toujours appuyée sur la construction d’une mémoire, au sens d’une intégration intelligente de ces propositions sur le monde et sur l’existence que fournissent la littérature, la philosophie ou l’histoire, une mémoire créatrice qui est une condition préalable à toute pensée inventive. Bref, il ne s’agit pas de béatifier la rhétorique mais de rendre compte de l’avantage que peut retirer une société démocratique à enseigner, à tous les niveaux de son système d’éducation, cet art de faire valoir la parole, toute parole qui vient du cœur de nos semblables.
B - Divorce prononcé entre l’école et la parole
L’école, c’est bien là que tout a commencé et que, pour la première fois, nous avons rencontré cette expérience de parler en public.
Rappelez vous…
Vous avez 8 ou 9 ans, c’est le lundi matin, le fameux lundi matin de la récitation…
Quelle est la première chose que vous entendez ?
« Bien ! Qui vais-je interroger ? »
L’instituteur ouvre le cahier de présence. Le doigt glisse sur les noms … A ce moment, s’il avait relevé la tête, il aurait vu ses vingt-cinq élèves en train de disparaître dans leur casier…
Et puis le doigt s’arrête sur une ligne … Delphine !
Delphine a les tripes complètement nouées.
A ce moment précis, ce sont les vingt-quatre autres élèves qui se sentent provisoirement épargnés.
Delphine se lève.
Elle parcourt l’espace qui la sépare de son pupitre jusqu’à l’estrade où se trouve le grand tableau noir.
Elle est maintenant de dos mais va devoir se retourner et affronter le regard de ses camarades qui, en ce moment, ont tout du monstre dont parlait Louis Jouvet, désignant le public.
Ca y est, elle se retourne … Ils sont là !
Aussitôt les mains se joignent, les doigts tricotent.
Le déhanché survient.
Une jambe monte sur l’autre.
Les mains sont maintenant à la hauteur du diaphragme.
Apnée respiratoire.
Les joues s’empourprent.
Les sourcils montent très haut.
Les yeux sont exorbités.
Et là … mutisme absolu, aucun mot ne sort.
Cela a peut-être été vous, ou bien l’un ou l’autre de vos camarades …
C’est à ce moment précis que Delphine va entendre, venant de son professeur, des mots innocents, des mots qui n’ont l’air de rien et qui vont complètement la déchiqueter.
« Eh bien … Delphine … on t’écoute … »
Ce « Eh bien, Delphine … » est comme une lame de rasoir qui l’écorche vive! Puis vient le scoop :
« Eh bien … Delphine … tu es drôlement timide ! »
Elle est contente, elle ne le savait pas.
Et maintenant cela devient une marque indélébile.
Delphine est timide et c’est une condamnation définitive.
Et puis comme décidément, rien ne sort, voici la proposition du professeur :
« Bon, Delphine, puisque tes camarades t’impressionnent, tu vas te retourner, tu vas regarder le tableau, comme ça, tu ne les verras plus, cela va te calmer. »
Et voilà, le tour est joué, ça fonctionne : Delphine, de dos, débite toute sa récitation d’un trait et va se rasseoir, accompagnée d’un « 17, tu vois, ça c’est bien passé, finalement ! »
Ce simple exemple pour nous rappeler que nous sommes tous issus d’un système scolaire qui se consacre presque exclusivement à l’écrit et délaisse l’oral.
On nous a inculqué la grammaire de l’écrit.





























