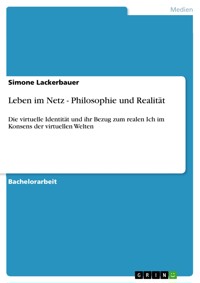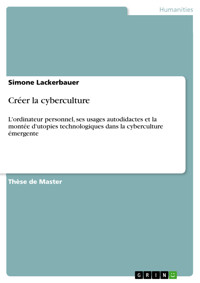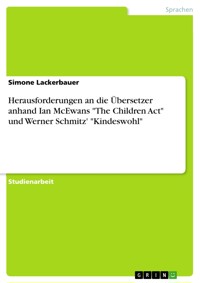18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Französisch
Travail d'étude de l’année 2012 dans le domaine Médias / Communication - Communication interculturelle, note: 18/20, Université Panthéon-Assas, Paris II (Institut français de presse), cours: Cours méthodologique : « Politiques et institutions culturelles », langue: français, résumé: A l’ère numérique du XXIe siècle avec son progrès d’innovations numériques en pleine accélération, sa pléthore d’outils technologiques et des usages détournés multiples, le « hacker » suscite des remous parmi les acteurs politiques et les médias. En principe, la figure du hacker fait partie de la cyberculture contemporaine et est attribué des rôles multiples. Le pirate informatique qui télécharge de la musique et viole les droits d’auteur semble avoir le même statut que les informateurs de WikiLeaks, ou les usagers d’armes virtuelles à l’ère du « cyberterrorisme » : ils sont des hackers, des membres d’une communauté invisible et malveillante, disposant d’un ensemble de programmes pour endommager la société. Mais qu’est-ce qu’un hacker véritablement ? Déjà l’origine du mot « hacker » pose problème et la traduction s’avère complexe : il n’existe pas de véritable traduction, ni en français, ni en allemand. Encore complexifié par le langage technique des hackers et par la préférence des acteurs de rester dans l’ombre, la communauté des hackers est peu connue en dehors du domaine de l’informatique. Autour de cette notion, on peut se demander les questions suivantes : d’où vient la notion du « hacker » et pourquoi est-ce qu’il n’y a pas de définition homogène de ce phénomène ? Quelle est la complexité derrière la perception des hackers par eux-mêmes et par des tiers ? Quelles sont les conséquences d’un affrontement de la réalité virtuelle des hackers à la vie réelle de la société ? Dans le cadre de ce travail limité, le contexte de ces questions sera expliqué pour montrer pourquoi une définition et une représentation homogène du hacker ne sont plus possibles.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Sommaire
Introduction
I. La figure du hacker entre contreculture et cyberculture
1. Qu’est-ce qu’un hacker ?
2. Les codes de la communauté des hackers
3. Le regard extérieur : une conception binaire du hacker
II. Les affrontements du réel et du virtuel
1. Les jeux de visibilité : les hackers et les médias
2. Les limites du virtuel : les hackers face à la société
3. La perte de l’innocence : les hackers confrontés à la realpolitik
Conclusion
Annexes
I. Un glossaire de la terminologie des hackers
II. Le design de la visibilité : un essai de typologie du web 2.0
III. « The Conscience of a Hacker »,« A Cyberspace Independence Declaration »
Sources et références bibliographiques
Table de matières
==Phrack Inc.=="<"/span>
Volume One, Issue 7, Phile 3 of 10
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-="<"/span>
The following was written shortly after my arrest...
\/\The Conscience of a Hacker/\/
by
+++The Mentor+++
Written on January 8, 1986
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-="<"/span>
Another one got caught today, it's all over the papers. "TeenagerArrested in Computer Crime Scandal", "Hacker Arrested after Bank Tampering"... Damn kids. They're all alike. But did you, in your three-piece psychology and 1950's technobrain,ever take a look behind the eyes of the hacker? Did you ever wonder whatIntroduction
A l’ère numérique du XXIe siècle avec son progrès d’innovations numériques en pleine accélération, sa pléthore d’outils technologiques et des usages détournés multiples, le « hacker » suscite des remous parmi les acteurs politiques et les médias. En principe, la figure du hacker fait partie de la cyberculture[1] contemporaine et est attribué des rôles multiples. Le pirate informatique qui télécharge de la musique et viole les droits d’auteur semble avoir le même statut que les informateurs de WikiLeaks, ou les usagers d’armes virtuelles[2] à l’ère du « cyberterrorisme » : ils sont des hackers, des membres d’une communauté invisible et malveillante, disposant d’un ensemble de programmes pour endommager la société.
Mais qu’est-ce qu’un hacker véritablement ? Déjà l’origine du mot « hacker » pose problème et la traduction s’avère complexe : il n’existe pas de véritable traduction, ni en français, ni en allemand. Encore complexifié par le langage technique des hackers et par la préférence des acteurs de rester dans l’ombre, la communauté des hackers est peu connue en dehors du domaine de l’informatique. Autour de cette notion, on peut se demander les questions suivantes : d’où vient la notion du « hacker » et pourquoi est-ce qu’il n’y a pas de définition homogène de ce phénomène ? Quelle est la complexité derrière la perception des hackers par eux-mêmes et par des tiers ? Quelles sont les conséquences d’un affrontement de la réalité virtuelle des hackers à la vie réelle de la société ? Dans le cadre de ce travail limité, le contexte de ces questions sera expliqué pour montrer pourquoi une définition et une représentation homogène du hacker ne sont plus possibles.
Dans la première partie, on s’interrogera sur l’émergence de la figure du hacker en expliquant que cette évolution est liée à plusieurs développements : de l’un côté, il y a le contexte historique de guerre avec un progrès d’innovation technologique accéléré qui aboutit au développement de l’informatique. De l’autre côté, il y a une évolution progressive de la cyberculture d’où émerge une perception plus personnelle de l’ordinateur avec des usages détournés. On voit se constituer ici une communauté des hackers qui adopte ses propres règles dans le cyberespace. Le hacking aujourd’hui a pris plusieurs formes inédites et cet ensemble de facteurs nous aboutit à constater qu’il n’existe pas une définition univoque du hacker et de sa position dans la vie numérique.
Dans la deuxième partie, on partira du principe que le hacker lui-même contribue à cette perception différenciée. Par la suite, on aboutira à l’observation de ce qui se passe aux lieux de confrontation des visions des hackers et du monde réel. On verra certains enjeux connectés au sein de cette opposition : l’image qu’ont les hackers de soi et de leur place dans la société ne correspond pas à la réalité. Dans cette disparité, on pourra appréhender la complexité derrière la perception des hackers, qui demande une réflexion plus détaillée : face aux médias, on verra les jeux de visibilité des hackers entre l’ombre et la transparence. Se présentera puis la fin possible de l’imaginaire virtuel dans sa confrontation à la société. Dernièrement, on tentera à donner des points de départ pour la confrontation des hackers à la realpolitik.
Le corpus pour ce travail s’appuie d’abord sur les écrits des hackers : leurs « manifestes » et leurs magazines, notamment pendant les années 1980 et 1990. La deuxième échelle est celle des tiers « spécialistes » qui ont écrit sur le phénomène des hackers – et qui sont eux-mêmes soit des hackers, soit des chercheurs dans le domaine de la sociologie dés médias ou de l’innovation, ou bien dans l’informatique. Troisièmement, on s’adosse à des théories de la sociologie des médias et de l’innovation, sur certains exemples du cyberdroit, de la géopolitique et de l’histoire culturelle.
La problématique du corpus constitué se montre dans deux aspects : la littérature sur les hackers ou les pirates informatiques dans les sciences sociales ou le droit est souvent dépassée et n’intègre pas les aspects récents comme les mouvements militants[3]. Le deuxième problème se pose dans l’application de certains termes qui n’ont pas la même connotation en anglais qu’en français : par exemple, le mot français « pirate » ne signifie pas la même chose que le mot anglais « hacker » et le « code » anglais ne partage pas la même connotation que son équivalent français. Par rapport aux sources du côté des hackers, il est également nécessaire de garder une certaine prudence : il n’est ni possible de prouver le degré de vérité ni le degré d’exagération d’une information sans une analyse plus profonde. Troisièmement, dans le cadre de ce travail, la présentation du hacker se repose avant tout sur le modèle américain, même s’ils existent en France et en Allemagne des communautés similaires.
En résumé, ce travail se veut une première approche pour montrer que la problématique des hackers dans la vie numérique est liée à plusieurs facteurs : dans un premier temps, elle est liée aux hackers eux-mêmes avec leurs valeurs et à la perception différenciée des hackers par des tiers. Dans un deuxième temps, elle se montre aussi dans la relation ambigüe et parfois dissonante des hackers avec la réalité.