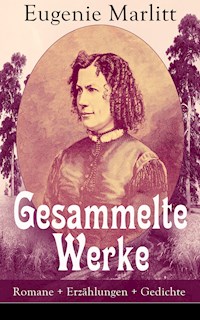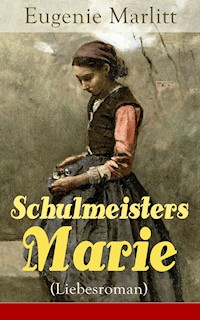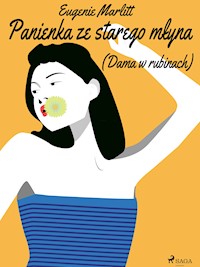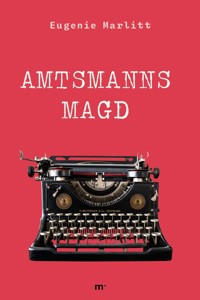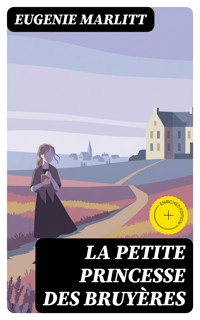
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DigiCat
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans "La petite princesse des bruyères", Eugenie Marlitt explore les thèmes de l'amour, de la lutte sociale et des différences de classe à travers l'histoire d'une jeune fille, orpheline, élevée dans les bruyères d'une région rurale allemande. Son style, riche en dialogues et en descriptions vivantes, évoque une atmosphère à la fois romantique et mélancolique, typique du courant littéraire du 19ème siècle. Marlitt place son récit dans un cadre naturel pittoresque qui renforce les émotions et les luttes des personnages, tout en interrogeant les normes sociales de son époque, ce qui en fait une œuvre emblématique du genre du roman populaire et de la littérature féminine de son temps. Eugenie Marlitt, de son vrai nom, entre dans la littérature après avoir connu des difficultés personnelles, notamment la perte de ses parents et des tensions au sein de sa première vie conjugale. Ces expériences, couplées à son intérêt pour les questions sociales, nourrissent son écriture. Elle s'applique à dépeindre la condition féminine et les contraintes que la société impose, offrant à ses héroïnes des arcs narratifs qui résonnent avec ses propres luttes. Je recommande chaleureusement "La petite princesse des bruyères" aux lecteurs intéressés par une exploration poignante de l'amour et de la résilience humaine dans un contexte de lutte sociale. Ce livre, à la fois accessible et riche en réflexions, saura séduire ceux qui apprécient les récits poignants, tout en offrant des pistes de réflexion sur les relations humaines et l'impact des classes sociales. Dans cette édition enrichie, nous avons soigneusement créé une valeur ajoutée pour votre expérience de lecture : - Des Citations mémorables soigneusement sélectionnées soulignent des moments de pure virtuosité littéraire. - Des notes de bas de page interactives clarifient les références inhabituelles, les allusions historiques et les expressions archaïques pour une lecture plus aisée et mieux informée.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
La petite princesse des bruyères
Table des matières
La petite princesse des bruyères
«Alors donne-moi ta main et baise-moi sur le front.» (Page 53.)
I.
Le petit cours d’eau qui coule au travers de la bruyère n’est point de ceux qui font parler d’eux et arrivent à une renommée éclatante. Ses bouillonnements n’ont pas une voix bruyante, et ne s’élèvent jamais aux mugissements des fiers torrents, lesquels, trop semblables aux hommes, mesurent leur fierté aux maux qu’ils commettent, et en ont d’autant plus qu’ils ont causé plus de malheurs. Ses eaux paisibles traversent un pays plat entre des bords peu élevés, plantés d’aulnes et de saules; mais ces arbres semblent s’être entendus à demi-mot, et se sont si bien unis, si bien rapprochés et confondus, que le ciel lui-même paraît devoir ignorer l’existence de cette petite artère représentant le pouls de la bruyère ignorée.
Cette bruyère mérite d’être contemplée durant les jours d’été, lorsque la chaleur atteint son point le plus intense. Sans doute elle n’élève pas jusqu’au ciel un front altier, couronné de cimes qui défient toutes les altitudes, ou bien de rhododendrons aux couleurs éclatantes. Elle ne porte pas même, avec une humilité hypocrite, s’alliant fort bien à la vanité féroce, un lourd diadème de granit fait de pointes de rochers qui déchirent ce qui passe à leur portée. Elle n’a pas la brillante ceinture d’acier que lui ferait un puissant cours d’eau l’enserrant dans ses replis. Mais l’érica fleurit sur ce sol à perte de vue. Ses petites clochettes lilas et rougeâtres étendent sur les douces ondulations de la terre un splendide manteau royal, aux teintes harmonieusement fondues, et parsemé d’essaims d’abeilles aux ailes poudrées d’or. Plus loin s’étale la plaine sablonneuse, privée d’humus, mais qui contient pour la modeste bruyère un principe nutritif suffisant: elle y puise la vie et la vigueur. Au delà, une longue raie sombre coupe brusquement les teintes rougeâtres d’ébène veiné qui ont été revêtues par la plaine: c’est la forêt immense, profonde, aux arbres majestueux. Seulement, pour la traverser, on y marche de longues heures sous les rangées de colonnes au feuillage touffu, qui s’élancent vers le ciel en y portant les nids des pinsons et des fauvettes. Parfois, au travers du taillis, on aperçoit les yeux purs et profonds des créatures que l’homme appelle sauvages, parce que, étant lui-même bien sauvage, il les a réduites à l’état de gibier toujours traqué, et auquel on n’accorde de trêve qu’afin de pouvoir continuer indéfiniment la tuerie. Et quand enfin les grands arbres ont pour successeurs des arbres plus petits, quand ceux-ci sont remplacés par les taillis sous lesquels Dieu a répandu avec profusion la fraise embaumée, qui représente la friandise des enfants pauvres, et leur est accordée par la nature sans qu’ils aient la peine de la cultiver, parce qu’ils n’en auraient pas le loisir, on aperçoit au loin des prairies bien aménagées et le tapis d’or pâle que les champs de blé étendent sur la terre. Alors, en dépit de ces marques de richesse et de bonne culture, quoique l’on voie de cette place le clocher d’une petite église, au toit recouvert d’ardoises, entouré d’un village dont les maisons semblent en bon état, on ne peut s’empêcher de sourire à la pensée du mépris qu’inspire à tous ces travailleurs «la pauvre bruyère inculte qui gît là-bas dans les sables».
Le petit ruisseau dont l’existence a été révélée au commencement de ce récit entoure l’une des landes les plus pauvres et les plus désertes qui se puissent concevoir. Il court longtemps en ligne parallèle à la forêt, et ce n’est qu’après de nombreux et laborieux détours qu’une inclination, sans doute invincible, le rapproche de la forêt. Il parvient, dans l’un de ses efforts, à former un petit bassin en miniature, dans lequel l’eau coule lentement. On ne sait où l’air finit, où l’eau commence, tant les cailloux sont blancs et l’eau tranquille. Ce petit bassin divise un bosquet d’aulnes. Un bouleau se dresse tout près de là, pareil à un radieux enfant de la mythologie qui secoue éternellement des rayons argentés.
C’était dans les derniers jours du mois de juin[1q].
Au milieu de l’eau fraîche de ce bassin se trouvait une paire de petits pieds bruns appartenant à une petite fille; deux mains tout aussi petites, tout aussi brunes, tenaient soigneusement les plis d’une robe faite en grossière laine grise, et soutenaient cette robe à la hauteur des genoux, tandis que l’avant-corps se penchait curieusement comme pour interroger la naïade mystérieuse ou pour causer avec elle. Par le fait, le miroir du bassin, ainsi consulté, renvoyait l’image d’une taille chétive, d’épaules étroites, recouvertes de toile blanche, et d’un visage très brun et très jeune. Si l’on jugeait d’après les apparences, il semblait très indifférent aux deux yeux qui plongeaient curieusement leur regard dans le fond du bassin d’appartenir à un visage modelé selon le type grec, ou déformé selon le type hun. Ici, sur ce petit coin solitaire de la grande bruyère, il n’y avait pas de règles concernant la beauté féminine, et point d’occasion de comparaison. En plein air, à la lumière non falsifiée du soleil, en pleine nature, en un mot, rien n’est beau que ce qui est naturel, rien n’est absolument laid de ce qui se montre sans artifice.
Des cheveux coupés assez courts flottaient librement, découvrant le front et couvrant la nuque de leur masse d’un noir bleu, dont la teinte était en tout pareille à celle de l’aile du corbeau. Une chaînette en verroterie rouge, dont les perles semblaient être autant de gouttelettes de sang, garnissait le cou, dont les tons bruns, aidés de la couleur du collier, faisaient ressortir puissamment la chemise de grossière toile blanche qui couvrait le buste de la petite fille... Mais tout à coup cette image se troubla, et, comme dans les contes de fées, l’apparition s’évanouit.
Un large morceau de ciel bleu remplissait la brèche du bosquet, et, tout en communiquant à l’eau du bassin une teinte d’acier, servait de fond ou de repoussoir à l’image de la petite fille. Des nuages avaient passé sur ce ciel bleu et s’étaient mirés dans le bassin en y étendant brusquement un voile. Des forces contraires avaient engagé une lutte, et l’horizon prenait un bain de pourpre. Les taillis et les troncs des grands arbres s’enfonçaient seuls dans une teinte d’autant plus sombre que le ciel devenait plus éclatant, et les branches basses semblaient autant de stalactites noires qui dessinaient leurs silhouettes sur un fond fait de flammes. C’était une nouvelle transformation littéralement féerique, mais qui fit éclater une terreur intense. La petite fille, penchée sur le bassin, y aperçut deux yeux démesurément ouverts, et leur expression empruntait à ces étranges oppositions d’ombre et de flamme un caractère tout à fait surnaturel.
Les pieds bruns n’appartenaient pas à une héroïne. D’un bond sauvage, la petite fille atteignait la rive.... puis elle prit la fuite avec la vélocité qui aurait été déployée par une jeune Indienne aux pieds ailés. Là-bas, au-dessus de la bruyère, le soleil se couchait dans un océan de feu. Un nuage rouge remplissait la brèche du bosquet d’aulnes... Telle était, hélas! la véritable explication du phénomène espéré, — et appréhendé. — Il n’y avait pas eu de phénomène; mais ces yeux, ces deux yeux si grands ou si agrandis, si effrayants ou bien si effrayés? Eh bien, cela aussi s’expliquait... Mais on n’avait jamais vu un lièvre courir avec la rapidité qne je venais de déployer, ni une petite fille prendre peur d’elle-même et se sauver devant son propre regard.
Bientôt j’eus honte de moi-même devant les deux témoins, — mes meilleurs amis, — qui avaient assisté à cette marque de défaillance et de lâcheté.
Ma bonne Mieke[1], — la plus belle vache noire à taches rousses qui ait jamais hanté la bruyère, — n’avait nullement partagé mon émotion. Il est vrai que, des deux témoins de ma frayeur, c’était celui que je redoutais le moins, reconnaissant qu’elle représentait la partie la moins intelligente de mon public. Elle demeurait impassible sous le bouleau, et arrachait et mâchait le bon herbage qui formait une bande étroite sur ce terrain humide. Elle leva un moment sa longue tête étroite, puis se remit à satisfaire son insatiable appétit en broutant à droite et à gauche, — sans préférence, — les pousses grasses dont elle était entourée. Elle avait fixé sur moi, seulement pendant la durée d’une seconde, son regard bêtement surpris.
Spitz, au contraire, qui s’était indolemment étendu à l’ombre du bosquet, prit la chose du côté tragique. Il se dressa tout à coup, et aboya furieusement contre l’eau, absolument comme s’il eût soupçonné le ruisseau d’être un ennemi courant sur mes talons. Il n’y avait pas à douter du sentiment qui l’agitait: sa voix, tour à tour retentissante et étouffée, témoignait de la colère et de la terreur qui luttaient en lui. Cela était vraiment trop comique, et me mit tout à coup en gaieté. Je revins vers le bassin, et sautai dans l’eau en riant, brisant ainsi en mille éclats le miroir qui m’avait causé une si vive frayeur.
Mais il y avait un troisième témoin que Spitz ni moi n’avions pas encore remarqué. Seulement, celui-ci était l’un de ceux dont l’opinion me préoccupait le moins.
«Hé bien, hé bien?...» dit-il tout à coup, «que fait donc ma petite princesse par ici?»
Cette interrogation m’était adressée par une voix enrouée, qui ressemblait à un grognement tel qu’il pouvait passer par des lèvres serrées, toujours occupées à retenir le tuyau d’une pipe, laquelle semblait cimentée entre les dents du fumeur, qu’elle ne quittait jamais.
«Ah! c’est toi, Heinz?»
Je n’éprouvais pas de confusion en face de celui-ci; il se sauvait lui-même avec la vélocité du lièvre dès que les choses ne lui paraissaient pas régulières, comme il le disait. Personne n’eût pu croire à cette pusillanimité en contemplant ce vieillard robuste.
C’était Heinz, l’éleveur d’abeilles. Son corps massif reposait sur une paire de pieds gigantesques, qui ébranlaient le sol quand il se mettait en mouvement. Son front atteignait des branches qui, eu égard à ma stature, me semblaient toucher le ciel, et son dos incommensurable bornait si complètement la vue du côté de la bruyère, que celle-ci semblait masquée par une muraille de granit subitement élevée entre le monde extérieur et ma petite personne.
Ce géant jouait invariablement des talons devant tout ce qui lui paraissait tenir au surnaturel, et pour lui rien ici-bas n’était naturel. Un drap blanc suspendu dans l’obscurité le mettait en fuite, — et cela me causait une certaine satisfaction. — Je prenais plaisir à inventer pour lui mille contes fantastiques, et je les lui faisais en me pénétrant si bien de mon sujet, que j’arrivais à m’inspirer à moi-même une terreur panique. Nous nous entendions à merveille dès qu’il s’agissait d’avoir peur, et nous étions de bons camarades d’effroi.
«Je viens de piétiner sur une paire d’yeux, Heinz,» lui dis-je. Et j’appliquai quelques derniers coups de talon sur le lit du bassin, de telle sorte que les gouttelettes d’eau jaillirent jusque sur la redingote de mon vieil ami. Je n’ai jamais su, ni alors ni depuis, quelle pouvait être la couleur de cette redingote, plus fantastique encore que mes contes. Ce devait être une couleur éclectique, dans laquelle bien des teintes se confondaient en se heurtant.
«Sais-tu,» poursuivis-je, «qu’il se passe là dedans d’étranges choses?»
Et j’aurais eu un plaisir presque égal en voyant mon assertion démentie, — ou confirmée; — mais la première hypothèse n’était guère admissible pour qui connaissait l’éleveur d’abeilles.
Il eut pourtant un mouvement d’incrédulité.
«Oh!...» fit-il d’un ton méditatif. «En plein jour?
— Qu’importe à la reine des eaux le grand jour quand elle est en colère?...» Et j’eus un mouvement de triomphe en m’apercevant que son incrédulité allait en s’affaiblissant tandis qu’il examinait l’eau avec crainte et méfiance.
«Comment! tu ne me crois pas, Heinz? Ah! j’aurais bien voulu qu’elle te regardât comme elle vient de me regarder... avec un air méchant... si méchant!»
Heinz n’en demandait pas tant pour être convaincu. Il ôta gravement sa pipe, cracha vivement, et s’écria avec un accent de triomphe en dirigeant vers moi le tuyau de la pipe:
«Ne te l’ai-je pas toujours dit? Ai-je jamais cessé de le répéter? Mais je ne le ferai jamais plus. — En ce qui me concerne, je réponds que les gens et les choses de là dedans peuvent être bien tranquilles. Je n’y mettrai plus la main... N’ayez pas peur!»
Je m’étais prise à mon propre piège, et le succès de ma narration, tout en flattant mon amour-propre d’auteur, me plongea cependant dans la consternation.
Le petit ruisseau qui vagabondait au travers de la bruyère était plus riche que les fleuves orgueilleux baignant les palais des hommes et les capitales célèbres. Il roulait des perles... en nombre restreint, il est vrai, et peu faites pour servir d’ornement aux diadèmes, ou même pour être portées en bague. Mais que savais-je alors? Mon ignorance était pour moi une source inépuisable d’illusions, de rêves. J’aimais ces petites choses brillantes, qui s’étalaient dans leur rondeur mobile sur la paume de ma main. Je pouvais employer des heures entières pour explorer l’eau et y chercher des coquillages. Je les apportais à Heinz, qui savait les ouvrir. — Son procédé était un secret qu’il ne m’avait pas confié. — Et voici qu’il allait me refuser ses bons offices parce que ma fable lui avait fait supposer que la puissance mystérieuse baptisée par moi «la reine des eaux» était irritée contre nous et s’apprêtait à nous poursuivre, comme on fait un procès à deux fripons.
«Allons, allons, Heinz,» lui dis-je, «ce n’était qu’une sotte plaisanterie... Ne te laisse pas tourner en ridicule en ajoutant foi à tous mes contes.»
Et je me penchai sur l’eau, qui, remise du mouvement que je lui avait imprimé, commençait à recouvrer sa limpidité avec sa tranquillité.
«Vois toi-même. Qu’est-ce qui regarde là dedans? Rien, absolument rien d’autre que mes propres yeux. Pourquoi sont-ils donc ouverts d’une façon surnaturelle, dis, Heinz? Je voudrais savoir seulement cela... Les yeux de Mlle Streit ne sont pas comme ceux-ci, ni ceux d’Isabelle non plus.
— Ni ceux d’Isabelle non plus,» répéta Heinz comme un écho complaisant. «Et pourtant,» fit-il, abandonnant ce rôle d’écho pour rentrer en possession de son individualité, «pourtant, les yeux d’Isabelle sont perçants, petite princesse, bien perçants! »
Tandis que je lui révélais que je l’avais pris pour dupe, Heinz m’avait menacée de son poing massif, mais en accompagnant ce geste terrible d’un sourire rassurant, dont je n’avais que faire, du reste, sachant fort bien qu’il n’était pas au pouvoir de Heinz de n’être pas bon. Puis, après avoir prononcé ces derniers mots en leur donnant l’accent grave et recueilli d’une sentence, il serra les lèvres avec un air méditatif, fronça et releva jusqu’à son couvre-chef une paire de sourcils que j’avais eu parfois l’irrévérence de comparer à une double brosse, et passa la main dans les touffes de cheveux durs et jaunâtres qui garnissaient ses tempes, et qui semblaient s’allumer sous les rayons du soleil couchant.
Il chassa devant lui un formidable nuage de fumée, et je m’élançai sur la rive près de lui. Mieke s’était soulevée, et venait brouter familièrement quelques tiges de chiendent à demi écrasées par les pieds formidables de notre ami Heinz.
«Voyons,» me dit-il en riant, «explique-moi comment sont faits ces yeux si perçants.
— Oh! je t’en prie, laissons cela. Il y a beaucoup de choses dont il ne faut pas plaisanter,» lui répondis-je en imitant du mieux que je le pouvais sa mine grave et son ton sentencieux.
Mieke avait fait un repas excellent. Entre ses deux longues cornes se trouvait une couronne de roses et de feuilles de bouleau. Elle portait cette parure avec tant de majestueuse aisance, tant de grâce massive, qu’on eût pu croire qu’elle l’avait de naissance. Une chaîne faite de fleurettes enfilées couvrait son poitrail, et il n’était pas jusqu’à la pointe de sa queue qui ne fût ornée d’un bouquet de bruyères. Rien n’était plus divertissant, — du moins à mes yeux, — que de voir ce bouquet mis en mouvement, et venant frapper le dos de Mieke avec un bruit strident dès qu’une mouche venait y faire une station trop prolongée.
«Elle a ses atours de fête et les porte admirablement,» dis-je, «mais tu ne comprends pas cela. Allons, essaye de deviner, Heinz: Mieke a pris sa grande parure et l’on a fait des gâteaux à la maison. Devines-tu?»
Je touchais là au point faible du géant mon ami. Heinz n’avait jamais été capable, je ne dirai pas de remonter des effets aux causes, — l’analyse n’était aucunement son affaire, et il ne savait pas du tout le chemin qui conduit du concret à l’abstrait, — mais encore de faire le plus léger effort pour comprendre les choses les plus simples. Quand il se trouvait interpellé de la sorte et mis en demeure de deviner, même ce qui sautait aux yeux, Heinz restait interdit devant moi, incapable de suivre le moindre raisonnement, en un mot, aussi étranger à tout travail d’esprit que pourrait l’être un enfant de deux ans. Dans ces circonstances, j’avais la coutume de venir à son secours plus ou moins généreusement, selon mon caprice du moment.
«Tête obtuse!» m’écriai-je, «tu ne veux donc pas m’adresser tes félicitations? Mais je ne t’en tiendrai pas quitte... Cher, excellent Heinz, c’est aujourd’hui l’anniversaire du jour de ma naissance.»
Une expression de joie émue passa sur le bon et épais visage de mon compagnon. Il me tendit sa grande main ouverte, et j’y plaçai la mienne en y frappant de tout cœur.
«Et quel âge ma petite princesse a-t-elle conquis aujourd’hui?» ajouta-t-il, trouvant sans doute que cette question était la conséquence naturelle du compliment qu’il venait de m’adresser.
Je me mis à rire. «Tu ne le sais pas? Tu l’as encore oublié ? Voyons, essaye de comprendre: qu’est-ce qui vient après seize?
— Dix-sept... quoi! Dix-sept ans? Ce n’est pas vrai, — ce n’est pas possible... Une toute petite fille comme cela! — Ce n’est pas vrai!»
Et, comme pour ajouter beaucoup de poids à cette protestation, il leva ses deux mains vers le ciel.
Cette incrédulité si enracinée, si profonde, me causa une vive indignation. Et pourtant mon vieil ami, qui lorsqu’il avait vingt ans était déjà en possession de la stature qui le mettait en rivalité avec les chênes élancés de la forêt, avait peut-être le droit de se montrer incrédule et quelque raison de s’exprimer ainsi. Depuis trois ans seulement, mon oreille arrivait à la place où l’on sentait battre le cœur vigoureux d’Heinz, et depuis cette époque je n’avais pas gagné une ligne; j’avais été et je demeurais une petite créature destinée à trotter au travers de la vie sur les pieds d’un enfant. Cette apparence brouillait encore les idées déjà très confuses que mon vieux compagnon entretenait relativement à la réalité des choses, et le confirmait dans cette opinion, vaguement conçue, que les années, en s’écoulant, n’ajoutaient rien à mon âge.
Je le tançai vertement, mais il se déroba à la réprimande par cette manœuvre diplomatique, innée même chez les plus jeunes enfants: il changea de thème, et, au lieu de répondre aux reproches que je lui adressais, il me dit tout bas, en désignant un lieu du bout de son pouce et par-dessus son épaule: «On déterre le vieux roi.»
Je bondis aussitôt en dehors du bosquet.
Il me fallut tout d’abord protéger de mes deux mains mes yeux éblouis par l’éclat d’un soleil couchant, baigné dans un océan pourpre. Ses rayons enflammés perçaient, comme autant de flèches lancées par des dieux, la ligne de nuages légers qui confinait dans l’horizon lointain à la forêt... Là tous les héros des temps fabuleux chevauchaient au travers de la grande bruyère, et leurs éperons étincelaient sous les flammes du soleil.
Là on ne voyait pas encore fleurir la bruyère, l’herbe s’étendait sur la prairie comme une couverture soigneusement tendue; seulement la prairie avait respiré, comme je l’affirmais quand j’étais une petite enfant, c’est-à-dire que son sein s’était soulevé çà et là pour marquer cinq sépultures, l’une de beaucoup plus importante que les quatre autres. L’histoire, m’aurait enseigné que cinq chefs des Huns[2] dormaient là leur dernier sommeil, mais la tradition et la légende, beaucoup plus séduisantes, m’avaient appris que ces tombeaux étaient ceux de géants contemporains et acteurs des temps merveilleux. Ceux qui étaient placés sous ces petites collines avaient été des géants dont le pas ébranlait la terre et la faisait gémir, tandis que du poing ils fendaient les rochers et les pulvérisaient. Sur le dos du plus grand tumulus, — il faut bien, quoi que j’en aie, que je désigne ces sépultures par leur nom historique, — avait poussé un genévrier. Un oiseau avait-il laissé tomber au hasard une graine qui avait germé là, ou bien était-ce un caprice humain qui avait voulu ombrager la tombe de ce grand chef? On ne savait, mais le fait est que les vieux arbre avait vécu, quoique chétif, malingre et contrarié dans son développement par les rigueurs de l’hiver et les tourbillons de neige, dont il supportait seul les assauts, sans que les campagnards, partageant sa lutte, en diminuassent les périls. Il s’élevait là, fier de son isolement, de son indépendance, comme un être qui ne peut compter que sur soi pour protéger son existence.
«Le vieux roi est enterré là, car l’arbre est venu à cette place, et il s’y trouve aussi des fleurs jaunes, tandis qu’il n’y en a pas sur les autres tombes,» avais-je dit à Heinz quand j’étais enfant et que je passais avec lui près du tumulus. Et je lui racontais que là, où s’élevait le genévrier, reposait un vieux roi à la tête cerclée d’or, à la barbe blanche énorme, étendu sur une couverture pourpre qui lui servait de linceul. La solitude la plus complète faisait le guet près du mystérieux sommeil du géant inconnu, mais entrevu, grâce à nos rêves. Les oiseaux quittaient la forêt pour faire une petite excursion en s’invitant à une collation composée de baies de genévrier. Les papillons brillants, aux ailes bleues, étaient mes confidents; eux aussi, ils étaient «du secret», et même ils en savaient peut-être plus que moi. Il m’était arrivé de rester là de longues heures, toujours courtes à mon gré, couchée sur le dos, la tête appuyée sur mes mains croisées, sondant le ciel du regard, mais le reportant aussi sur les peuplades de fourmis affairées qui entraient si aisément sous terre et revenaient au grand jour, après avoir vu tout ce qui se passait là-dessous et s’être, sans nul doute, promenées sur la couverture pourpre. Je les enviais et me sentais saisie de nostalgie pour les temps passés, en même temps que de curiosité ardente pour toutes les merveilles inconnues, mais pressenties.
Jusqu’à l’heure présente, j’avais considéré le grand tumulus comme mon jardin particulier, ma forêt, ma propriété privée, en un mot. Dierkhof, ma patrie, était situé dans la bruyère proprement dite; un sentier à peine battu le reliait au monde extérieur, en partant de la forêt, et laissait au loin le tumulus, comme s’il eût éprouvé une certaine appréhension de ce voisinage encore redoutable. Jamais, si loin que pussent remonter mes souvenirs, un pied humain étranger n’avait laissé sa trace dans ces environs... Robinson, dans son île, n’était pas plus solitaire que mon vieux roi dans sa tombe... Et voici que j’apercevais tout à coup une troupe composée d’individus inconnus. Ils enlevaient de grands blocs de terre aux flancs du tumulus, demeuré intact jusqu’ici au travers des siècles. J’apercevais distinctement la pioche levée, dessinant sur le ciel enflammé une fine ligne noire, et quand je la voyais retomber, j’éprouvais l’angoisse indescriptible que j’aurais ressentie si ce fer avait fait son œuvre dans la chair d’un corps aimé et vivant. Il ne faut pas que cette impression soit taxée d’exagération: nul ne mesure l’intensité des sentiments de l’enfance, parce que chacun perd brin à brin, avec l’acuité de ces sensations, la mémoire de leurs effets. Avoir été enfant est le lot de tout le monde; se souvenir de ce que l’on ressentait quand on était enfant, garder dans sa fraîcheur et sa puissance la connaissance des tempêtes dont on a été le récipient, — si je puis m’exprimer de la sorte, — est le privilège d’un très petit nombre, et il est permis de le revendiquer sans vanité comme sans orgueil, parce qu’il n’affirme et né comporte aucune faculté exceptionnelle.
Sans me rendre compte de ce que j’éprouvais, pas plus que de la scène énigmatique à laquelle j’assistais, et poussée seulement par ce besoin instinctif de mettre fin à une souffrance intolérable, je pris ma course en ligne droite, à la façon des oiseaux. Mon chien Spitz me tint fidèlement compagnie en galopant à mes côtés, et lorsque j’arrivai, à bout d’haleine et de forces, au but qui m’attirait, je trouvai près de moi le vieux Heinz, nullement essoufflé, mais ayant fait tranquillement ses enjambées de sept lieues.
Ce fut seulement à cet instant que je me sentis envahie par la confusion qui s’empare toujours de l’enfant devant toute chose inconnue, devant tout visage étranger. Je reculai quelque peu, et saisis le pan de la redingote de Heinz. J’acquérais de la sorte la conscience d’un appui et d’une protection.
II.
Trois hommes,— trois messieurs, devrais-je dire, si j’avais connu à cette époque les nuances du langage civilisé, — se tenaient immobiles sur le tumulus[3] et demeuraient dans une attente silencieuse, tandis que plusieurs ouvriers creusaient le terrain et le. déblayaient à mesure que le travail s’avançait, aux aboiements furieux de Spitz, qui avait, sans nul doute, à l’endroit de ma propriété, des idées aussi erronées et aussi arrêtées que les miennes propres. Les étrangers se tournèrent un instant de notre côté ; l’un d’entre eux, le plus jeune en apparence, leva sa canne contre le chien, qui faisait mine de passer du discours à l’action, et d’engager une lutte avec ceux qu’à mon instar il considérait comme d’impudents usurpateurs. Puis il arrêta un froid regard sur Heinz et sur moi, laissa retomber avec insolence son bâton déjà levé, et nous tourna derechef le dos.
On creusait sous l’arbre. Le genévrier, arraché du sol, gisait au loin, et ceci m’apparut tout d’abord comme une insigne profanation, qui me causa une profonde douleur. Hélas! la réalité était entrée en lutte avec le rêve, et, selon son implacable coutume, l’écrasait du premier coup. J’avais tant souhaité savoir!... Et voici qu’au moment où je pouvais apprendre, je reculais d’appréhension: c’est que la vérité, je commençais à le comprendre, allait tuer le songe[2q].
A la place où s’élevait naguère le genévrier, on voyait une grande ouverture béante, entourée d’amas de terre glaise et de sable jaunâtre, retenant encore des fragments de racines qui représentaient à mes yeux autant de veines du pauvre arbre inhumainement tranchées.
«Nous devons avoir atteint la pierre,» dit l’un des trois messieurs, en écoutant le son rendu par la pioche des ouvriers.
On déblaya incontinent ce côté du tumulus, et l’on mit en évidence un énorme quartier de granit brut.
Les trois messieurs s’écartèrent quelque peu, tandis que les ouvriers s’attaquaient au bloc de granit pour le déplacer. Heinz, au contraire, fit un pas en avant. Les travailleurs ne faisaient pas, selon lui, leur besogne d’une façon satisfaisante. La jambe droite étendue, il levait et abaissait en cadence ses poings formidables, et pendant qu’il se livrait à cet exercice platonique, sa pipe chômait si peu que je n’aperçus plus les têtes des étrangers, voilées par un nuage bleu. Cela produisit un effet d’une nature si particulière que je ne pourrai jamais l’oublier.
Le jeune homme derrière lequel se tenait mon vieux compagnon s’élança en avant comme si on lui eût asséné un coup aussi violent qu’imprévu. Il se retourna aussitôt pour toiser avec autant de surprise que de dédain ce fumeur malencontreux. Après avoir attaché sur Heinz un long regard, qui en disait plus que les plus longs discours, il prit dans sa poche un mouchoir très fin, et le secoua autour de lui avec une suprême expression de dégoût, comme pour purifier l’atmosphère qui l’entourait, et pour chasser tous les miasmes qui avaient eu l’inconcevable inconvenance de l’environner.
Heinz enleva silencieusement le corps du délit à ses lèvres, qui le quittaient à regret, et laissa sa bonne pipe pendre à son côté. Il était littéralement ahuri. Jamais encore le tabac qu’il fumait n’avait produit un semblable effet sur qui que ce soit. J’éprouvai un sentiment d’une autre nature, qui participait de l’humiliation et de la colère, et éveillait en moi l’injuste mais naturelle notion représentée par la peine du talion: «Dédain pour dédain,» voilà ce que mon sang bruissait dans mes oreilles... et je n’eus plus d’autre désir que celui de m’éloigner bien vite de cette compagnie qui se permettait de mépriser mon ami... Mais, précisément à ce moment, le bloc chancela sur sa base, et fut écarté de la place qu’il devait, selon toute probabilité, occuper éternellement.
Cet événement dissipa toutes mes velléités de retraite et me cloua à ma place.
Tout d’abord je ne pus rien entrevoir, car les trois messieurs se penchèrent avidement sur l’ouverture... D’ailleurs, et même en dehors de cet empêchement, il m’eût été impossible de discerner quoi que ce fût. Le sang se précipitait dans mes veines et faisait battre fiévreusement mes artères. Je détournai même les yeux, tant il me semblait vraisemblable de voir se passer quelque scène miraculeuse dont je n’aurais pas la force de supporter le spectacle.
«Sapristi!... ce serait seulement ça?...» s’écria Heinz, qui, en dépit de ses habitudes silencieuses, ne put réprimer cette marque de désappointement.
Je regardai bien vite, et il me sembla alors que toutes les lumières et toutes les couleurs de la vaste bruyère s’étaient subitement éteintes, tandis que les papillons bleus perdaient leurs ailes, et les oiseaux oubliaient leur langage mélodieux, fin ou animé, dont j’avais toujours espéré découvrir la signification mystérieuse... C’était la réalité émergeant, froide, triomphante et laide, de ce sépulcre hanté par mes rêves et mes visions. Le soleil tombait à l’horizon, et dans l’ouverture béante il n’y avait pas de vieux roi au diadème d’or, à la grande barbe d’argent, reposant sur une couverture pourpre. Il n’y avait rien qu’un caveau vide.
Les étrangers ne semblèrent nullement déçus. Tout au contraire, ils parurent trouver que les choses devaient se présenter sous cet aspect. L’un d’entre eux, qui portait sur son nez des lunettes et sur son dos une longue boîte de fer-blanc, descendit dans le caveau, et le jeune homme le suivit, tandis que leur troisième compagnon, grand et mince, examinait soigneusement la partie intérieure du bloc de granit. Je ne pouvais voir son visage, parce qu’il me tournait le dos; mais, à en juger d’après les apparences, il me parut âgé : en effet, ses mouvements étaient lents, et la bande de cheveux court coupés qui dépassait son chapeau de quelques lignes seulement avait une teinte grise déterminée.
«Cette pierre a été travaillée,» dit-il d’une voix brève, tandis que sa main en interrogeait la superficie.
«Les piliers aussi!...» cria une voix s’élevant des profondeurs du tumulus. «Et quel magnifique toit de granit nous avons au-dessus de nous! un bloc erratique véritablement gigantesque!»
Le jeune homme apparut à l’ouverture. Il dut se baisser profondément, et ce mouvement fit tomber son chapeau. Jusqu’ici j’avais vu peu d’hommes, et seulement Heinz, le vieux pasteur du plus proche village, distant de deux heures au moins, puis quelques individus osseux, massifs, parlant aussi peu que leur bétail, et cultivant leur propre sol, qui ne leur rendait pas l’équivalent de leur travail et n’en pouvait mais Je ne savais donc ce qu’était la beauté masculine, n’ayant jamais eu l’occasion de me former un jugement à l’aide de la comparaison. Pourtant il y avait à Dierkhof un portrait de Charlemagne, lequel m’avait toujours paru trop beau pour représenter une réalité, et que j’attribuais à une fantaisie du peintre, inventant ce que la nature ne pouvait lui offrir. Je pensai à ce portrait quand je vis surgir des profondeurs de ce gouffre obscur un front large, pur, et d’autant plus blanc que les boucles brunes dont il était environné lui fournissaient une brusque opposition de teintes. La tête, rejetée en arrière par un mouvement énergique, semblait reposer sur ces belles masses de cheveux sombres et pourtant brillantes.
Le jeune homme tenait un grand vase de grès jaunâtre.
«Doucement, Monsieur Claudius, doucement,» s’écriait le monsieur aux lunettes, qui tenait lui-même plusieurs objets de forme bizarre; «il faut y mettre beaucoup de précaution; ces urnes sont extrêmement fragiles au premier moment, mais l’air les durcit promptement.»
Cet effet ne devait pas se produire. Dès que l’urne fut posée sur le bloc de granit, elle se fendit, un nuage de cendre s’en échappa, et l’on vit rouler dans toutes les directions des restes d’ossements.
L’individu aux lunettes poussa un cri de désespoir et de regret. Il releva ses lunettes sur son front, toucha délicatement, avec mille tendres précautions, les fragments épars sur le sol, puis il examina la fêlure de l’urne.
«Ah bah! le dommage n’est pas bien grand, Monsieur le professeur. Il y a là-dessous encore six urnes au moins, et de tous points pareilles à celle-ci.»
Le visage du professeur se contracta péniblement.
«Voilà un langage que je dois assimiler poliment,» fit le professeur avec effort, «à une profanation.»
Le jeune homme se mit à rire, et c’était, en vérité, un rire merveilleusement gai et gracieux. Il s’en rendit maître très rapidement, et son visage redevint sérieux.
«Je suis par le fait seulement un profane, mais un profane passionné,» dit-il en cherchant à s’excuser. «Cette dernière qualité me vaudra peut-être un peu d’indulgence, et vous excuserez un novice qui prend par-ci par-là le mors aux dents, ne se laisse pas guider par le frein de la science, et galope un peu au hasard a travers l’espace... Je tenais surtout à me renseigner au sujet de la construction intérieure de cette antique sépulture, et... Ah! que cela est beau!...» s’écria-t-il en s’interrompant brusquement et saisissant l’un des objets que le savant venait d’étaler sur le granit,
Selon toute apparence, il n’avait prêté aucune attention au plaidoyer du jeune homme. Plongé dans une méditation profonde et même laborieuse, il examinait en silence un petit ustensile que tour à tour il exposait à la lumière des derniers rayons du soleil, ou rapprochait pensivement des yeux.
«Hum! hum!...» murmura-t-il, «c’est un travail fait en une sorte de filigrane d’argent... Hum! hum!
— De l’argent dans une tombe antérieure à l’histoire de la Germanie, Monsieur le professeur?...» fit le jeune homme avec une nuance d’ironie. «Voyez ce beau morceau de bronze!»
C’était un poignard ou bien un couteau qu’il avait saisi parmi les objets rapportés par le professeur. Il joua avec cette arme comme s’il s’en fût servi pour frapper un ennemi, puis il la soupesa sur la pointe de ses doigts en souriant. «Un poing germain n’aurait pas su employer cette arme délicate,» ajouta-t-il, «il l’eût broyée en la touchant... Pas plus que les barbares de cette contrée n’auraient eu assez de talent pour exécuter la jolie parure en argent que vous examinez... Selon toute vraisemblance, le docteur de Sassen a raison lorsqu’il désigne ces prétendues tombes des Hun[4]s comme autant de sépultures phéniciennes.»
M. de Sassen! le docteur de Sassen! Je tressaillis vivement. Celui qui venait de parler ne m’avait-il pas désignée du doigt, et tous les regards ne s’étaient-ils pas fixés sur ma pauvre petite personne épouvantée? Tous ces regards! Oh! j’aurais voulu être engloutie au sein de la terre. Comme j’étais... comme je suis restée enfant! Nul ne m’accordait la moindre attention et ne semblait s’apercevoir de mon existence... Je pus m’en convaincre, et j’allais respirer, lorsque mes yeux tombèrent sur Heintz, le maladroit ami qui se trouvait près de moi. Il me contemplait avec commisération, et s’écria de sa voix retentissante et profonde:
«Hé, ma petite princesse! ces gens-là parlent de....
— Tais-toi, Heinz,» lui dis-je avec colère, — pour la première fois de ma vie, — et je frappai du pied avec violence pour la première fois de ma vie.
Il parut pétrifié, et me contempla longtemps sans se rendre compte du motif qui lui avait valu une si dure rebuffade, puis il détourna la vue avec repentir et confusion, se disant sans nul doute qu’étant réprimandé, il avait dû commettre quelque faute, et croyant plus aisément à sa culpabilité, même énigmatique pour lui, qu’à mon injustice et à ma dureté. Les ouvriers étaient devenus attentifs. Ils semblaient s’apercevoir seulement en ce moment qu’il y avait là, près d’eux, non pas un buisson d’épines ou quelque autre chose du même genre, mais une petite fille craintive. Ils examinaient avec une curiosité souriante. J’aurais souhaité me sauver en courant; mais un sentiment indéfinissable me retenait à ma place, et me faisait à la fois désirer et craindre d’entendre encore parler du personnage dont on venait de prononcer le nom.
Je me calmai en découvrant que la malencontreuse exclamation de Heinz n’avait pas attiré l’attention des trois messieurs. L’origine «phénicienne» attribuée à ces objets trouvés dans le tumulus avait allumé des charbons ardents dans l’âme du professeur à lunettes. Il était, suivant toute apparence, opposé à cette doctrine historique, et défendait son opinion avec des arguments passionnés et verbeux, dont le jeune homme suivait patiemment la déduction.
Le monsieur aux cheveux gris ne semblait accorder aucune attention à ce débat scientifique. Il se promenait tranquillement dans un rayon circonscrit. Puis il examina longtemps la tombe du Hun, et enfin gravit le monticule pour contempler la vaste plaine.
Les flammes du couchant s’étaient peu à peu éteintes, et l’horizon se noyait dans une nappe d’encre violette. Seul un nuage étroit gardait encore la réverbération du soleil, et s’étendait au-dessus du tumulus comme un bras indicateur. Le décor et les accessoires d’un drame appartenant au passé bien lointain s’ensevelissaient graduellement dans une obscurité toujours plus intense, et le ciel éternel dressait majestueusement sa coupole d’un bleu sombre au-dessus des hommes déjà réduits en cendres et des vivants réservés au même sort. La pâle lune entrait en scène et se dorait à mesure qu’elle semblait s’élever.
L’individu qui se tenait sur le monticule tira sa montre.
«Il est temps de partir,» dit-il à ses compagnons. «Il nous faut au moins une heure pour rejoindre la voiture.
— Hélas! oui, mon oncle!...» répondit le jeune homme sur un mode plaintif. «Une heure, une grande heure interminable. Je voudrais bien avoir cette maudite bruyère derrière moi,» poursuivit-il en jetant un regard de commisération sur ses petits pieds finement chaussés. Le professeur, en entendant cette plainte frivole, haussa les épaules en proférant un «eh!» méprisant.
«Sommes-nous vraiment obligés de revenir par cet exécrable chemin, aussi ennuyeux qu’impraticable?...» reprit le jeune homme.
Le professeur haussa les épaules, et répondit froidement:
«Je n’en connais pas de meilleur.»
Son interlocuteur promena sur la plaine un regard de sombre mécontentement. Puis, d’une voix sonore et particulièrement harmonieuse, il récita deux vers naïfs qui me parurent très beaux:
La paix s’étend sur la bruyère, qui repose Sous les rayons d’un soleil ami.
«Quel pathos!» ajouta le jeune homme. «Je ne comprends pas que la poésie puisse germer sur ce sol si pauvre, et dont l’aspect seul suffirait pour glacer l’inspiration dans mon cerveau et paralyser mon imagination. Êtes-vous sincère, Monsieur le professeur, dans votre tendresse pour ce coin de terre déshérité ? Expliquez-moi ce que je ne puis comprendre... Montrez-moi autre chose que cette bruyère, et encore de la bruyère, abominable vision uniformément brune. Pas même un chant d’oiseau! La vie semble suspendue, et l’on aura beau dire, c’est la vie qui est la vraie poésie! Vous aurez beau dire, Monsieur le professeur, votre bruyère est l’enfant déshérité et repoussé de Dieu.»
Le professeur ne répondit pas un seul mot. Il conduisit seulement le jeune homme à quelques pas plus loin, vers l’endroit où la croupe du monticule s’abaissait pour se réunir au sol. saisit son interlocuteur par les épaules, et l’obligea à regarder au loin vers le sud, par-dessus le monticule éventré.
Là se trouvait Dierkhof. Son toit lourd et solide, parsemé d’autant de touffes de bruyères que d’ardoises, s’élevait entre quatre chênes robustes. Des nuages épais s’élevaient au-dessus des cheminées du vieux toit, et s’évaporaient, lentement absorbés par l’air du soir. Ils encadraient une cigogne vêtue de blanc et de noir, debout sur une seule patte, et plongée en de graves méditations, dont témoignait son bec pourpre pensivement penché sur son sein. Il y avait juste assez de clarté dans le crépuscule pour que l’on pût distinguer des nuances de verdure sombre, et une légère lueur au-dessus du jardin, lequel semblait, par un privilège particulier, avoir retenu plus longtemps que ses alentours la lumière du soleil mourant... L’on voyait même Mieke, laquelle, bien repue et probablement lasse d’attendre mon retour, avait jugé à propos de se mettre en route sans guide et sans protection pour regagner son domicile. La porte cochère était largement ouverte, et pourtant l’animal restait indolemment immobile devant ce seuil si aisé à franchir. Était-ce seulement une sotte irrésolution qui la retenait? N’avait-elle pas plutôt conscience du rôle important qu’elle remplissait en complétant et animant le paysage trop morne?
«Eh bien!...» fit le professeur d’un ton triomphant, «qu’en dites-vous? Que vous semble de cette immobilité, belle précisément de son uniformité et de sa solitude? L’Océan aussi est uniforme et dépourvu de la vie que vous réclamez à grands cris. Cela s’oppose-t-il à ce qu’il soit une source d’inspirations pour les poètes? Revenez ici dans un mois, alors que la bruyère en fleur roule sous le moindre souffle du vent des flots de pourpre: alors son aspect est féerique. Plus tard encore, elle se transforme, et semble couverte d’or en fusion ayant la couleur du miel, et alors «cet enfant déshérité de Dieu» a revêtu une parure digne des enfants royaux. Quelques-uns des petits ruisseaux traversant la bruyère, — en voilà un qui court affairé par là, — contiennent des perles.
— Oui, des milliards de perles liquides qui vont alimenter les rivières et les fleuves pour regagner la mer,» répondit le jeune homme en riant.
Le professeur secoua la tête avec impatience. Je l’aimais depuis un instant, ce vieux savant, en dépit de son visage desséché, de ses mots inconnus et de la grande vilaine boîte de fer-blanc qu’il portait sur son dos. Il plaidait pour ma bruyère bien-aimée, et, en quelques mots simples et exacts, il venait de me révéler à moi-même toutes les beautés que je connaissais, dont je jouissais, mais que je n’aurais pu analyser jusqu’à ce jour. Quant à ce jeune railleur au sourire méprisant et moqueur, dont chaque parole excitait en moi un mouvement de colère, il devait être châtié. Je ne sais pas encore aujourd’hui où je puisai le courage dont je me sentis subitement animée; mais le fait est que je me trouvai tout à coup à ses côtés, lui tendant silencieusement ma main qui contenait cinq perles.
J’éprouvai à cet instant la tentation que j’aurais ressentie si, en place du sol de ma bruyère, j’avais eu sous mes pieds des charbons ardents. Mes lèvres tremblaient, tandis qu’un sentiment d’angoisse et de confusion m’étreignait le cœur. Mes yeux s’attachaient obstinément au sol, et tout à coup la nuit se fit en moi. Tout le monde m’entourait: le monsieur qui avait quitté le sommet du monticule, les ouvriers, enfin la réunion tout entière vint se grouper autour de moi. Aussi la chaussure gigantesque de Heinz ne resta-t-elle pas en arrière. En s’attachant à la terre, mes regards apercevaient les pieds de mon protecteur, qui m’avait fidèlement suivie.
«Ah! ah! voyez, Monsieur Claudius, cette enfant vient porter témoignage contre vous et confondre votre incrédulité... Bravo, petite fille!...» s’écria le professeur surpris et charmé. «L’incrédulité est une vilaine plante. Il faut la déraciner partout où elle pousse, mais principalement dans les jeunes cœurs, car, là, elle étouffe tous les bons germes et réduit le sol à la stérilité. »
Le jeune homme ne répondit pas un mot. Peut-être était-il stupéfait de l’audace déployée par cette petite fille, qui, vêtue d’une chemise grossière et d’un pauvre jupon de laine, était venue se placer à ses côtés. Languissamment et, autant que je pus le conjecturer, à contre-cœur, il étendit vers moi ses doigts d’ivoire aux ongles rosés et brillants. La confusion que j’éprouvais déjà prit la proportion d’un tourment insoutenable: près de cette belle main élégante et bien soignée, ma propre main m’apparut avec la teinte du café brûlé... Je la retirai involontairement, et me sentis fort disposée à jeter mes perles au loin.
«En effet... ces perles ne sont pas percées,» dit le jeune homme en faisant rouler deux de ces petites boules dans le creux de sa main.
«Leur forme et leur couleur laissent sans doute beaucoup à désirer... Elles sont grises et fort irrégulières,» reprit le professeur. «Ce n’est rien de plus que des perles de fort peu de valeur. Nonobstant leurs imperfections, ces perles n’en constituent pas moins l’apparition d’un fait intéressant.
— J’aimerais beaucoup à les conserver,» dit le jeune homme d’un ton poli et avec l’accent de la prière.
«Prenez-les,» répondis-je brusquement sans le regarder. Ce laconisme m’était imposé par la force des choses. En effet, si l’on eût voulu prêter l’oreille un peu attentivement, on eût entendu les battements tumultueux de mon cœur de lièvre.
Il prit soigneusement les autres perles qui se trouvaient encore dans ma main, et je vis le monsieur au chapeau brun, qui se tenait en face de moi, tirer de sa poche un petit sac dans lequel on entendait une sorte de cliquetis.
«Voici pour vous, mon enfant,» dit-il en mettant dans ma main cinq grandes pièces rondes et brillantes.
Lui, je pouvais le regarder. Mes yeux, en se levant, aperçurent le large bord d’un chapeau qui couvrait la moitié de son visage. Après ce chapeau venaient de grandes lunettes bleues qui projetaient sur ses joues un reflet livide.
«Qu’est-ce que cela?...» dis-je, car, en dépit de ma sauvagerie et de mon effroi, j’étais émerveillée de la forme qu’avaient ces pièces inconnues.
«Qu’est-ce que cela?...» répéta l’étranger frappé de surprise. «Ne savez-vous pas ce qu’est l’argent? N’avez-vous jamais vu d’écus?
— Non, Monsieur, elle ne sait pas ce qu’est l’argent et n’en a jamais vu ni manié,» répondit Heinz en intervenant dans la conversation avec une sollicitude quasi paternelle. «La vieille dame ne permet pas qu’il y ait de l’argent à la maison; quand elle en trouve, elle le jette sans pitié dans le ruisseau.
— Comment!... Et qu’est donc cette bizarre vieille dame?» s’écrièrent les trois étrangers presque à la fois.
«Hé ! c’est la grand’mère de la petite princesse.»
Le jeune homme se mit à rire.
«De cette petite princesse?» fit-il en me désignant.
Je laissai tomber les pièces d’argent et me sauvai. Méchant, méchant Heinz! Mais aussi pourquoi lui avais-je conté l’histoire d’une princesse fine et délicate, la Princesse des fèves, et pourquoi avais-je permis que depuis ce jour il m’appelât la petite princesse? Ce rapprochement s’était fait tout naturellement dans son esprit, parce qu’il trouvait que rien n’était plus délicat et plus mignon que la petite fille aux pieds légers, vagabondant à ses côtés au travers de la bruyère.
Je me mis à courir de toutes mes forces, coupant l’espace en ligne droite afin de rejoindre plus tôt le gîte. Le rire ironique du jeune homme me chassait comme l’aurait pu faire un sirocco pestiféré, et la rapidité de ma course se décuplait quand ma pensée entrevoyait confusément que je pourrais peut-être oublier la raillerie et le mépris dès que je serais abritée sous le vieux toit de Dierkhof.
Isabelle se tenait devant la porte cochère, et m’attendait avec impatience: Mieke était rentrée sans moi. Mon regard s’attacha, du plus loin que cela fut possible, sur cette silhouette qui se dessinait en contours fortement accusés sur le fond crépusculaire du soir... Combien j’aimais cette tête blonde! Sa chevelure avait exactement la teinte jaune paille qui se voyait encore aux tempes de Heinz, et, comme le front avait revêtu les mêmes tons d’ambre, il n’était pas possible de discerner à quelques pas la ligne de démarcation limitant la chevelure. Son nez était puissant, monumental, tout comme celui de son frère Heinz. Son sang frais et pur déposait sur ses pommettes une sorte de vernis brillant et rosé. Mais là s’arrêtait la ressemblance. Elle avait des yeux perçants qui frappaient son frère d’une crainte respectueuse, et plus je m’approchais, plus son regard, — que je connaissais bien, — me donnait à penser.
«Es-tu devenue folle, Éléonore?» s’écria-t-elle avec le vigoureux laconisme qui faisait partie de sa nature.
Elle était en colère, fort en colère, autant du moins que permettait de le discerner l’incroyable domination qu’elle exerçait sur elle-même, et qui lui permettait de maîtriser en toute circonstance et à toute heure les mouvements de son âme... Mais je jugeais de la situation par un symptôme à moi bien connu: elle m’appelait de mon prénom. Or ce fait se produisait seulement dans ses plus violents moments d’emportement.
Après avoir prononcé ce petit nombre de mots, elle se tut, et dirigea vers moi un regard à la fois impérieux et interrogateur. J’étais accoutumée à la comprendre, même et surtout quand elle ne parlait pas. Aussi son regard glissa-t-elle aussitôt sur ma personne et s’arrêta aux extrémités: mes pieds étaient nus.
«Ah! Isabelle, mes souliers et mes bas sont restés près du ruisseau,» dis-je avec abattement.
«Démence!... Les aller chercher de suite!»
Elle rebroussa chemin et se dirigea vers la cuisine, disposée en garde-manger, sans avoir cependant été complètement dépouillée de ses anciennes attributions. Isabelle faisait cuire du lard, que l’on entendait grésiller tandis que dans la grande marmite, remplie de pommes de terre, montaient de grosses bulles d’eau.
Ainsi le souper allait être prêt. Il me fallait faire grande diligence pour me trouver à mon poste dans ce bref délai. Pourtant nulle considération n’aurait pu me décider à repasser le seuil de la porte cochère. Si je quittais la maison par la porte du fond, j’étais cachée et protégée par les bâtiments de Dierkhof, et pouvais atteindre le ruisseau sans courir le risque de rencontrer les étrangers et d’être vue par eux.
III.
Je me dirigeai vers cette porte, située entre la maison et le battoir[5], et s’ouvrant en pleins champs sur un espace que l’on désignait par les mots de cour plantée[6]. Mais Isabelle vint me barrer le chemin en levant l’index par un geste d’interdiction.
«Tu ne peux sortir par là, ta grand’mère y est,» me dit-elle d’une voix contenue[3q].
La porte était ouverte, et j’aperçus en effet ma grand’mère levant et baissant avec énergie le bras de la pompe... Ce spectacle n’avait rien de surprenant pour moi, car j’y assistais quotidiennement.
Ma grand’mère était une femme de haute stature, fortement charpentée, et dont le visage, depuis la chevelure jusqu’à son cou puissant, était toujours, et en toute saison, uniformément pourpre. Ce teint se joignant à des traits fortement accusés, à une taille élevée en même temps que massive, à une démarche procédant toujours par enjambées prodigieuses, aux mouvements énergiques de ses bras musculeux, composait une apparition effrayante, sauvage, et tout au moins bizarre, même pour ceux qui vivaient près d’elle. Aujourd’hui encore, quand je me représente cet ensemble, je ne puis, en dépit de ses yeux noirs et de son profil oriental, m’empêcher d’évoquer du même coup l’image des femmes cimbres[7], vêtues de peaux de bête, la hache de combat à la main, s’élançant dans la mêlée humaine en poussant de féroces clameurs, et prenant part à la tuerie.
Elle penchait la tête de façon à recevoir le jet vigoureux de la pompe. L’eau ruisselait sur son visage, sur son cou, et serpentait sur les fortes et épaisses nattes de cheveux gris qui tombaient jusque dans l’auge de la fontaine. Même en plein hiver, et quand il gelait à pierre fendre, elle ne manquait jamais de se livrer à cette ablution, qui semblait être aussi indispensable à son existence que l’air à ses poumons. Aujourd’hui cependant la teinte de son visage me parut plus surprenante que jamais. Même sous ces flots d’eau froide, la teinte pourpre persistait, et même, me semblait-il, s’accusait davantage et brunissait. Quand ce corps puissant se redressa, quand elle dressa fortement sa tête en la rejetant sur la nuque, et que, dans la plénitude de la jouissance, elle respira bruyamment plusieurs fois, il me sembla que ses lèvres étaient violacées, et que, plus que jamais, leur contraste avec ses fortes dents blanches s’accusait vivement.
Je regardai Isabelle. Elle aussi contemplait cette scène, et paraissait, — contre son habitude, — complètement absorbée par ce spectacle. Ses yeux bleus aux teintes métalliques, à l’expression dure et sévère, reflétaient, chose étrange, une vague et mélancolique inquiétude.
«Qu’a donc ma grand’mère?» demandai-je avec anxiété.
«Rien, — le temps est lourd, orageux aujourd’hui.» Il lui était visiblement désagréable d’avoir laissé surprendre ce regard d’inquiète commisération.
«N’y a-t-il donc aucun remède, Isabelle, contre cette terrible disposition qui lui porte le sang à la tête?
— Elle ne veut d’aucun remède, — tu le sais. — Hier soir, elle m’a jeté au nez le bain de pieds que j’avais préparé pour elle. Va-t’en, enfant, va chercher tes effets.»
Elle retourna à la cuisine, et je sortis de la maison par une autre porte. Je me dirigeai en courant vers le ruisseau, qui était séparé de la maison par une trentaine de pas à peine, et cherchai à me glisser au travers des taillis qui couvraient ses rives. Cette entreprise n’était pas aussi aisée qu’on pourrait le croire: toute cette végétation grandissait et s’étendait à sa guise sans être jamais refrénée, taillée ou dirigée par la main humaine. Mais je poursuivis ma route en dépit des difficultés de l’entreprise, car si les branches flexibles cinglaient mon visage, mes mains et mes pieds nus, leur densité me protégeait contre tout regard étranger. J’avais à peine fait quelques pas sous leur abri, que j’eus tout lieu de m’en féliciter doublement: en ligne diagonale, au travers de la bruyère, je voyais venir les trois étrangers, Heinz en tête, se dirigeant vers le ruisseau. J’espérai cependant atteindre avant eux la petite baie où j’avais déposé ma chaussure. Mon attente fut trompée: beaucoup d’obstacles avaient retardé ma marche, et je dus me résigner à me pelotonner à terre sous la protection des taillis.
Il m’était aisé de deviner le mobile qui les conduisait là. Heinz leur signalait l’étroite bande de gazon qui s’étendait près des rives du ruisseau. Cela différait, et beaucoup, de l’âpre et dur tapis que la bruyère étendait sur le sol. C’était une surface voloutée, élastique, telle qu’on l’aurait préparée pour des pieds privilégiés. Les étrangers vinrent tout près de moi et frôlèrent en passant les branches des arbres derrière lesquels je m’abritais. Tout à coup ils s’arrêtèrent.
«Ha! ha!» dit le jeune homme, qui avait atteint le pied du bouleau, «ceci est, si je ne me trompe, le cabinet de toilette de la princesse des bruyères.»
Ces mots suspendirent ma respiration... Je me penchai en avant, j’écartai les branches avec la prudence qu’une jeune sauvage eût apportée à cet espionnage, et j’aperçus le railleur ramassant un soulier. En dépit de mon inexpérience et de mon ignorance pour tout ce qui concernait les choses du monde, je savais fort bien en quelle tenue un soulier féminin doit s’offrir aux regards. Je savais des contes dans lesquelles de petites pantoufles en velours rouge, brodées de petites paillettes d’or ou d’argent, jouent un rôle considérable. Le papier fin sur lequel étaient imprimés ces récits merveilleux me semblait encore trop grossier pour servir de semelle à cette chaussure idéale et éthérée. L’informe soulier que l’on venait de relever était taillé dans le plus épais de tous les cuirs. — O Isabelle impitoyable!... Le bois lui-même ne te semblait pas suffisamment solide pour revêtir mes pieds toujours agités.
Le matin même, ces souliers tout neufs avaient été déposés devant mon lit en compagnie d’une roide paire de bas tricotés par Isabelle elle-même avec une laine dure et rêche... C’était son orgueilleux présent d’anniversaire, et j’en avais été tout à fait heureuse. Un plus ample examen avait encore augmenté ma satisfaction, car le cordonnier, rempli de prévoyance, avait rangé sur une semelle épaisse comme son gros doigt un bataillon de clous à tête brillante... lesquels me semblaient à l’heure présente scintiller de lueurs ennemies et déplaisantes.
«Ah!... quelle enfant! La voilà qui a oublié ses souliers... des souliers tout neufs encore!» s’écria Heinz en branlant la tête. «Ce sera drôle d’entendre Isabelle,» ajouta-t-il d’un ton anxieux et alarmé.
«A qui donc appartient l’enfant que nous avons vue vers le tumulus?» demanda de sa voix douce et pénétrante le vieux monsieur à cheveux gris.
«A Dierkhof, Monsieur, à la maison de Dierkhof.
— Oui... fort bien... Mais je vous demande comment elle s’appelle.»
Heinz déplaça quelque peu son couvre-chef de façon à pouvoir gratter son oreille, mouvement qui annonçait chez lui une extrême perplexité... Je sentais naître et venir sa réponse diplomatique... Il n’avait pas oublié ma colère et la vivacité avec laquelle je lui avais imposé silence quelques moments auparavant... Et quand il voulait bien mettre en mouvement son épaisse cervelle, Heinz était plus fin qu’on ne le croyait communément.
«Comment on l’appelle?...» fit-il d’un air encore plus niais que de coutume. «Hé ? mais, Isabelle l’appelle l’enfant, et moi...
— La petite princesse,» dit le jeune homme, affectant un ton aussi grave et aussi simple que celui de mon rusé Heinz. Il jouait avec mon soulier comme je l’avais vu jouer avec le couteau phénicien et le soupeser du bout des doigts. Mais il affectait cette fois d’employer toutes ses forces à soutenir un poids énorme, et ce jeu, humiliant pour moi, me semblait-il, s’accentuait encore grâce à l’expression moqueuse de ce beau visage.
«Ah!...» fit-il, «les dames de la bruyère tiennent à faire des impressions profondes... à laisser des traces ineffaçables...» Et, s’adressant au vieux monsieur, il ajouta: «Je voudrais bien que Charlotte vît cette chaussure idéalement légère, mon oncle... J’ai bien envie de lui porter cet objet à titre d’échantillon du costume des naturels de la bruyère.
— Point de folies, Dagobert!» répondit le vieux monsieur d’un ton sévère. Heinz venait de faire entendre un cri d’effroi.
«Non! non! Monsieur,» dit-il avec anxiété, «cela ne se peut. Mon Dieu! que dirait Isabelle? Des souliers tout neufs.
— Brrr... vous m’inspirez une terreur peut-être salutaire. Cette Isabelle doit être le dragon qui garde votre princesse aux pieds nus.»
Et le jeune homme, riant de tout son cœur de cet incident, laissa tomber le gros soulier. Il frappa les mains l’une contre l’autre pour faire disparaître la poussière qui s’était attachée à ses gants; puis, saluant Heinz, les étrangers s’éloignèrent, tandis que mon vieux camarade emballait joyeusement cette chaussure malencontreuse dans les vastes poches de sa redingote. Il découvrit aussi les bas suspendus à un arbre, les prit en secouant la tête d’un air mécontent, les envoya rejoindre dans ses poches leurs compagnons naturels, et se dirigea en grande hâte vers Dierkhof.