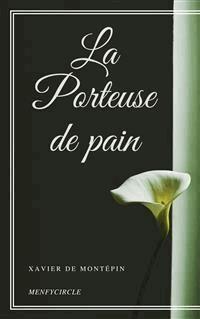
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Xavier de Montépin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Jeanne Fortier, gardienne dans une usine de Maison-Alfort, mère de Georges et Julie, vient de perdre son mari mécanicien. Elle repousse les avances du contremaître Jacques Garaud. Pour la conquérir, il lui écrit pour annoncer qu'il va faire fortune. En fait, il veut voler à l'ingénieur Jules Labroue son invention. Il incendie l'usine, tue Labroue qui l'a surpris, menace Jeanne, s'arrange pour lui faire endosser la culpabilité du crime, puis s'enfuit en Amérique sous le nom de Paul Harmant. Il passe pour mort. Jeanne est condamnée et perd la raison. Quand la vue d'un incendie réveille sa mémoire, elle n'a qu'une idée, s'évader pour retrouver ses enfants. Hospitalisée à Bicêtre, puis prisonnière à Clermont, elle s'enfuit déguisée en religieuse et se rend à Paris où elle sera porteuse de pain sous l'identité de Lise Perrin...Attention, sortez les mouchoirs!... Voici du beau, du grand mélo, un archétype du genre. Rassurez-vous, tout se terminera bien pour Jeanne et ses enfants...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
La Porteuse de pain
Xavier de Montépin
Xavier Henri Aymon Perrin, comte de Montépin, né à Apremont (Haute-Saône) le 10 mars 1823 et mort à Paris le 30 avril 1902, est un romancier populaire français. Il repose au cimetière ancien (cimetière communal de l'Ouest) 6e division, de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine à côté de la tombe de sa femme Louise Lesueur et de celle de Caroline Lesueur. Auteur de romans-feuilletons et de drames populaires, il s'illustra dans le feuilleton. Il est notamment l'auteur de l'un des best-sellers du xixe siècle, La Porteuse de pain, paru de 1884 à 1889, qui a été adaptée successivement au théâtre, au cinéma et à la télévision. Le Médecin des pauvres, paru en feuilleton de janvier à mai 1861 dans le journal illustré Les Veillées parisiennes, fut un plagiat d'un roman historique de Louis Jousserandot, un avocat républicain. Jousserandot et Montépin s'assignèrent mutuellement en justice. Le procès eut lieu en janvier 1863. Les deux plaignants furent renvoyés dos à dos et condamnés tous deux aux dépens. Mais la défaite fut bien du côté de Jousserandot, l'ancien proscrit républicain qui avait bien peu de chances de gagner face au riche et célèbre Xavier de Montépin, adulé des lecteurs et politiquement proche du pouvoir impérial en place. Les Filles de plâtre, paru en 1855, fit également scandale et valut à Montépin une condamnation à trois mois d'emprisonnement et 500 francs d'amende en 1856. Xavier de Montépin utilisait un ou des nègres, comme beaucoup des auteurs à succès de son époque qui produisaient du roman-feuilleton « au kilomètre ». Le nom de l'un d'eux—Maurice Jogand—est connu.
Partie 1 L’INCENDIAIRE
Chapitre1
Au moment où commence notre récit, c’est-à-dire le 3 septembre de l’année 1861, à trois heures du soir, une femme de vingt-six ans à peu près suivait la route conduisant de Maisons-Alfort à Alfortville. Cette femme, simplement vêtue de deuil, était de taille moyenne, bien faite, d’une beauté attrayante.
Des cheveux d’un blond fauve s’enroulaient en grosses torsades sur sa tête nue. Dans son visage d’une pâleur mate, brillaient de grands yeux aux prunelles d’un bleu sombre. La bouche était petite ; les lèvres bien dessinées, d’un rouge cerise mûre, s’entrouvraient sur des dents éblouissantes.
De la main droite, elle tenait un bidon de fer-blanc à anse mobile ; de la main gauche, elle serrait la menotte rose d’un bébé de trois ans environ qui marchait à pas lents en tirant derrière lui, par une ficelle, un petit cheval de bois et de carton.
Une saccade détruisit l’équilibre du jouet qui tomba sur le côté. La jeune femme fit halte aussitôt.
« Voyons, Georges, dit-elle lentement à l’enfant d’une voix douce et caressante, prends ton joujou, mon chéri, et porte-le.
– Oui, petite maman. »
Le bébé obéissant saisit son dada par la tête, le mit sous son bras, et tous deux continuèrent leur chemin. Ils atteignirent bientôt les premières maisons d’Alfortville. La jeune femme entra dans une petite boutique d’épicerie. Une forte commère sortit aussitôt d’une pièce voisine.
« Tiens, c’est vous, m’ame Fortier ! dit-elle, bonjour, m’ame Fortier… Qu’est-ce qu’il faut vous servir ?…
– Du pétrole, s’il vous plaît…
– Du pétrole !… encore ! Mais bon dieu, qu’est-ce que vous en faites ? Vous en avez déjà pris hier.
– Mon gamin a renversé le bidon en jouant…
– C’est donc ça ! Combien qu’il vous en faut ?
– Quatre litres, afin de ne pas revenir si souvent. »
L’épicière se mit en devoir de mesurer le liquide demandé.
« C’est dangereux tout de même, ces moutards ! Savez-vous que votre gosse, en renversant le bidon, pouvait incendier l’usine ? Il aurait suffi pour ça d’une allumette. Un malheur arrive vite !…
– Aussi je l’ai joliment grondé, quoiqu’il ne l’ait point fait par malice. Il a bien promis qu’il ne recommencerait plus.
– Et vous plaisez-vous dans votre emploi, m’ame Fortier ? Vous devez gagner autant qu’à la couture…
– Bien sûr que oui, et pourtant, si je n’économisais pas sur toutes choses… Songez donc… deux enfants !
– Votre dernière, la petite Lucie, est en nourrice ?
– Oui, dans la Bourgogne, à Joigny.
– Ça vous coûte cher ?
– C’est trente francs par mois qu’il faut prendre sur mes gages… Ah ! mon pauvre mari me manque bien !…
– Je vous crois, m’ame Fortier.
– Il était si bon… si honnête… si courageux ! il m’aimait tant !… Je peux bien dire que la machine qui l’a tué en éclatant a tué en même temps mon bonheur… »
Mme Fortier passa sa main sur ses yeux.
« Faut pas pleurer, ma fille, reprit la marchande. Il y en a qui sont encore plus à plaindre que vous ne l’êtes. Le patron s’est bien conduit avec vous, car enfin je me suis laissé dire que, sans une distraction de votre cher homme, la machine n’aurait pas éclaté… Est-ce vrai ?
– Hélas ! oui, c’est vrai…
– On lui a fait un bel enterrement au pauvre Fortier. Vous avez eu une collecte des ouvriers de l’usine, et le patron s’y est inscrit pour cent francs… Enfin il vous a installée dans la fabrique comme gardienne, et ça n’est guère une place de femme…
– Certes, M. Labroue a été bon, très bon, murmura tristement la jeune veuve. On prétend qu’il est dur, sa conduite avec moi prouve le contraire, mais enfin c’est dans sa maison que mon mari a été tué !… Si ce n’avait été pour mes enfants, je n’aurais jamais accepté un emploi qui me force à vivre dans l’endroit où le sang de mon pauvre Pierre a coulé.
– Il faut se faire une raison, ma fille. Vous êtes jeune… vous êtes jolie… très jolie même ! Vous verrez qu’un jour un bon garçon vous demandera de l’épouser, et vous ne lui répondrez pas non…
– Oh ! quant à cela, jamais ! s’écria Jeanne Fortier.
– À votre âge on ne reste pas veuve éternellement…
– Cela se voit, je le sais bien. Moi, j’ai d’autres idées ; si seulement j’avais devant moi quelque argent, deux ou trois billets de mille francs.
– Qu’est-ce que vous feriez ?
– Ce que je ferais ? Mais à quoi bon penser à cela ? Je n’aurai jamais d’argent dans les mains. Je resterai à l’usine tant que je pourrai pour mes enfants. J’espérerai en l’avenir.
– C’est ça, l’espérance donne du courage. Voici votre pétrole. Si vous m’en croyez, vous enfermerez le bidon.
– Ah ! soyez tranquille, j’ai trop peur du feu ! »
La jeune femme sortit de l’épicerie après avoir payé. Le petit Georges jouait devant. La mère l’appela. L’enfant mit sous son bras son cheval de carton et vint la rejoindre. Debout sur le seuil du magasin, l’épicière la regardait s’éloigner.
« Une brave et digne femme tout de même, murmurait-elle. Ah ! le fait est que son mari doit lui manquer, car je la crois ambitieuse. Elle ne m’a point expliqué ses idées, mais elle en a, c’est positif. Il lui faudrait deux ou trois billets de mille francs pour essayer n’importe quoi… Mazette ! comme elle y va ! »… Les quelques paroles échangées entre les deux femmes résumaient de façon très nette la situation de Jeanne Fortier. La jeune veuve, nous le savons, avait vingt-six ans. Bonne ouvrière, experte aux travaux de couture, elle avait épousé à vingt-deux ans un brave garçon, Pierre Fortier, mécanicien dans l’usine de M. Jules Labroue. Le mécanicien était mort, quelques mois auparavant, à la suite de l’explosion d’une machine, explosion causée par son imprudence ou plutôt par une distraction d’un instant chèrement payée.
M. Labroue, voulant assurer l’avenir de la veuve et des orphelins, avait offert à Jeanne la place de gardienne-concierge de l’usine. Jeanne avait accepté avec reconnaissance parce qu’elle trouvait le moyen d’élever ses enfants. Mais, elle souffrait dans l’usine où tout lui rappelait la fin tragique du mari qu’elle pleurait. Mais s’éloigner était impossible. Il s’agissait de vivre. Or, aucun travail de couture n’aurait pu lui fournir de ressources équivalentes à celles qui résultaient de sa position à l’usine.
L’épicière de Maisons-Alfort croyait Jeanne ambitieuse. Elle se trompait. Si la jeune veuve souhaitait quelques billets de mille francs, c’était dans l’unique dessein de créer un petit commerce et d’augmenter, à force de travail, le bien-être de ses chers enfants.
En regagnant l’usine, Jeanne songeait à ces choses. Elle marchait tristement, sans rien entendre, sans rien voir. Soudain elle tressaillit. Une voix, derrière elle, venait de prononcer son nom. Son front se plissa, son visage s’assombrit mais elle ne tourna point la tête et marcha plus vite.
« Attendez-moi, madame Fortier, reprit la voix. Je retourne à l’usine. Nous ferons route ensemble. »
Georges s’était retourné, et reconnaissant celui qui parlait il s’arrêta, malgré les efforts de sa mère pour l’entraîner.
« Petite maman, dit-il, c’est mon bon ami Garaud… »
Le personnage que Georges venait de nommer Garaud rejoignit la mère et l’enfant. Jeanne, très agitée, faisait sur elle-même un violent effort pour cacher son trouble. Le nouveau venu prit Georges dans ses bras, le souleva, et l’embrassa sur les deux joues en lui disant :
« Bonjour, bébé ! »
Puis, le remettant à terre, il poursuivit, non sans amertume :
« Savez-vous, madame Fortier, qu’on jurerait que je vous fais peur ! Pourquoi ça ? Vous m’aviez bien entendu tout à l’heure, et au lieu de m’attendre vous avez hâté le pas.
Qu’est-ce que je vous ai fait ?… »
Jeanne répondit, avec un embarras manifeste :
« Je ne vous avais pas entendu, et je me dépêchais pour rentrer à la fabrique, car j’ai donné ma loge à garder, et je suis fautive.
– Est-ce vrai que vous ne m’aviez pas entendu ?
– Puisque je vous le dis.
– Ce n’est point une raison pour que je le croie. Vous évitez toujours de vous trouver auprès de moi. Vous savez pourtant que je suis très heureux, quand je puis échanger avec vous quelques paroles.
– Monsieur Jacques, dit vivement la jeune femme, ne recommencez pas à me parler comme vous l’avez fait plusieurs fois ! Cela me cause beaucoup de peine.
– Et moi, Jeanne ! La froideur de votre accueil, votre air de défiance avec moi me font cruellement souffrir. Je vous aime de toutes mes forces ! Je vous adore !
– Vous voyez bien, interrompit la jeune veuve, vous voyez bien que j’avais raison de hâter le pas pour ne pas vous entendre.
– Est-ce que je puis me taire quand je suis près de vous et que mon unique pensée, c’est vous ? Jeanne, je vous aime ! Il faut vous habituer à me l’entendre répéter.
– Et sans cesse, je vous dirai, moi, je vous répéterai que votre amour est une folie ! répliqua la jeune veuve.
– Une folie ! Pourquoi ?
– Je ne me remarierai jamais, j’en suis sûre.
– Et moi je suis sûr du contraire. Vous êtes jeune, vous êtes jolie. Est-ce que vous pouvez passer dans le veuvage, dans la solitude, le reste de vos jours ?
– Monsieur Garaud, taisez-vous, je vous en prie…
– Pourquoi me taire ? je dis la vérité !
– Vous devriez vous souvenir que cinq mois à peine se sont écoulés depuis la mort de mon pauvre Pierre, votre ami.
– Certes, je n’oublie pas ! Mais est-ce outrager sa mémoire que de vous aimer, puisque sa mort vous a rendue libre ? Est-ce l’outrager que de vous dire : « Jeanne, les enfants de Pierre, qui fut mon ami, seront les miens ! » Voyons, raisonnons. M. Labroue vous a nommée concierge de l’usine. Ça vous permet de vivoter à peu près, mais c’est tout au plus si avec vos deux enfants vous parvenez à joindre les deux bouts. Moi je gagne quinze francs par jour. Quatre cent cinquante francs par mois… Ça serait pour vous et pour les petits, le bien-être, car vous êtes aussi économe que travailleuse !… et puis j’ai de grande idées… Nous pourrions devenir riches ! Qui sait si un jour ou l’autre je ne serai point patron à mon tour ?… Alors il y aurait moyen de faire quelque chose pour les enfants. Vous seriez une heureuse femme, Jeanne, et une heureuse mère ! Je vous en prie, ne me refusez pas. Je vous aime à en devenir fou ! Je vous veux. Je vous aurai. »
Jeanne s’arrêta et regarda son interlocuteur bien en face.
« Écoutez-moi, Garaud, dit-elle d’une voix que l’émotion rendait presque indistincte. Voici la quatrième fois que, sous des formes différentes, vous me parlez de votre amour et de vos espérances. Je vous crois sincère.
– Sincère ! ah ! oui, je le suis. Je vous le jure !
– Laissez-moi achever, reprit la femme. Je ne mets point en doute vos bonnes intentions, mais je ne puis que vous faire aujourd’hui, pour la quatrième fois, la même réponse : je veux rester veuve. Je ne me remarierai jamais. J’ai trop aimé Pierre pour en aimer un autre. Mon cœur était à lui, il l’a emporté avec lui. »
Le contremaître fit un geste de désespoir. Deux grosses larmes coulèrent sur ses joues.
« Et cependant, dit-il d’une voix étranglée, je vous adore. Ah ! madame Fortier, vous me faites beaucoup souffrir. »
Ces larmes d’un homme produisirent sur Jeanne une pénible impression.
« Je vous cause de la peine en vous disant la vérité, répliqua-t-elle d’un ton plus doux. Mais ma conscience me commande la franchise ! Ne pensez plus à moi.
– Est-ce que je pourrais ! s’écria le contremaître.
– On peut tout ce qu’on veut. À partir d’aujourd’hui, je vous le demande, je vous en conjure, pour mes enfants, ne me répétez plus des choses que je ne veux pas entendre.
– Ainsi, vous me fermez l’avenir ?
– Je le dois.
– Jeanne, reprit Jacques d’un ton farouche, en saisissant violemment la main de Mme Fortier, peut-être me dédaignez-vous parce que je suis un simple ouvrier, n’ayant pour fortune que mon salaire, mais si je devenais riche, très riche ? M’accepteriez-vous, alors ?
– Ne me parlez pas ainsi, balbutia la jeune femme. Vous me faites peur.
– Refuseriez-vous la richesse pour vous, pour vos enfants ?
– Taisez-vous !
– Eh bien, non, je ne me tairai point ! Vous ne comprenez pas, vous n’avez jamais compris comment je vous aime ! Je vous adore depuis cinq ans ! depuis le premier jour où je vous ai vue, et d’heure en heure, cette passion a grandi. Tant que Pierre a vécu, j’ai gardé le silence. Il m’appelait son ami ; sa femme était sacrée pour moi. Il est mort, vous êtres libre. Votre destinée est de m’appartenir tôt ou tard. Ne luttez point contre elle et je ferai de vous la plus heureuse des femmes. »
Et, élevant jusqu’à la hauteur de son visage la main qu’il tenait toujours, il la pressa contre ses lèvres avec une sorte de furie. Jeanne se dégagea. Tandis que s’échangeaient les répliques de ce dialogue, le petit Georges, après avoir joué sur la route, commençait à trouver le temps d’arrêt un peu prolongé.
« Maman, fit-il, allons-nous-en. Viens-nous-en, ami Jacques. »
Et il prit la main du contremaître. Celui-ci et Jeanne se remirent en marche. Jacques était sombre.
« Donnez-moi ce bidon, dit-il tout à coup, que je le porte…
– Non, merci, nous voici presque arrivés, d’ailleurs ça n’est pas lourd, quatre litres de pétrole… »
Le contremaître ne put réprimer un mouvement de surprise :
« Vous vous éclairez donc au pétrole ?
– Oui, c’est moins cher, et vous savez que je dois avoir de la lumière toute la nuit dans la loge.
– Sans doute, mais c’est dangereux et M. Labroue serait mécontent s’il apprenait que vous faites cette économie. Il ne veut pas qu’une goutte d’huile minérale entre dans l’usine.
– Je l’ignorais, fit Jeanne avec un étonnement mêlé d’inquiétude.
– Eh bien, prenez garde au patron. Il se fâcherait.
– Dès demain je brûlerai de l’huile ordinaire. »
On était arrivé près de l’usine. La porte était close. Jeanne s’avança pour frapper.
« Un dernier mot, lui dit Jacques.
– Lequel ?
– Ne me fixez aucune époque, mais permettez-moi l’espoir. Vous me le permettez, n’est-ce pas ?
– Non, Jacques.
– Quoi, pas même cela ! » s’écria le contremaître.
La jeune femme fut épouvantée du brusque changement qui venait de s’opérer dans la physionomie de son interlocuteur. Elle se hâta vers la porte. Jacques lui barra le passage.
« Ne me désespérez pas ! » murmura-t-il, les dents serrées.
Jeanne, voulant se débarrasser du contremaître qui lui faisait vraiment peur, répondit :
« Eh bien, plus tard, nous verrons. »
Le visage de Jacques se détendit.
« Ah ! fit-il en poussant un soupir d’allégement, voilà une bonne parole ! J’en avais grand besoin. Merci ! »
Jeanne avait frappé. La porte s’ouvrit. La jeune veuve franchit le seuil avec son fils. Jacques vint ensuite et referma la porte derrière lui. Une femme sortit de la loge et dit :
« Vous voilà de retour, je retourne à l’atelier.
– Allez, Victoire, et merci de votre complaisance. »
Jeanne ouvrit la porte d’une resserre voisine, et sur une des tablettes qui s’y trouvaient plaça son bidon en disant :
« Le gamin ne pourra pas le renverser en s’amusant.
– Prenez bien garde au feu ! fit observer Jacques, les bâtiments sont légers. Partout des cloisons en voliges. Il suffirait d’une étincelle pour que ça flambe.
– N’ayez crainte, monsieur Garaud », répéta Jeanne. Jacques lui tendit la main et, comme elle semblait hésiter à la prendre, il balbutia :
« Est-ce que vous m’en voulez ?
– Non certainement ; mais je vous en prie…
– Oh ! je ne vous dirai plus rien de ce qu’il vous déplaît d’entendre, reprit-il ; seulement n’oubliez point que vous m’avez donné une parole d’espoir. L’espérance me rendra fort ! Un jour je viendrai vous dire : « Ce n’est plus seulement ma tendresse que je vous apporte : c’est encore la fortune pour vous… pour vos enfants… » Ce jour-là, consentirez-vous à vous appeler madame Garaud ?
– Pour mes enfants peut-être, balbutia Jeanne avec émotion.
– Je n’en demande pas plus, je suis content, donnez-moi la main.
– La voici. »
Jacques serra cette main dans la sienne et s’éloigna.
Chapitre2
Garaud était un homme de trente ans environ ; ce qu’on appelle dans le langage populaire un beau gars : un solide gaillard bien bâti. Son regard exprimait l’intelligence, mais non la franchise. Sa lèvre inférieure épaisse dénotait un tempérament sensuel et des passions violentes.
C’était un ouvrier mécanicien de premier ordre, et de plus, très exact, très consciencieux dans son travail. M. Labroue avait voulu se l’attacher sérieusement. Depuis six ans il appartenait à l’usine en qualité de contremaître.
Jacques connaissait ses dispositions naturelles, ses aptitudes et souvent, pour les développer plus encore, il consacrait une partie de ses nuits à l’étude de livres spéciaux. Des rêves d’ambition fiévreuse le hantaient.
Il avait un tempérament de jouisseur, une nature avide de satisfactions matérielles. Il voulait être riche à tout prix…
Nous soulignons à dessein ces trois mots.
En disant à Jeanne qu’il l’aimait, qu’il voulait la prendre pour femme, il ne mentait point ; il éprouvait très réellement à l’endroit de la veuve de Pierre Fortier une passion sincère et violente. Les dernières paroles de Jeanne avaient fait naître dans son âme une sensation de joie inouïe.
Elle s’apprivoise ! murmurait-il. Au lieu de répondre « Non » comme toujours, elle a répondu « peut-être ? » Suis-je assez bête d’aimer ça ! C’est la première fois que ça m’arrive. Elle me rend fou ! Il faut qu’elle soit à moi. Je ne peux pas vivre sans elle. Mais je sens que pour l’obtenir il faut être riche. Je n’ai produit d’impression sur elle qu’en lui parlant de fortune pour ses enfants. Comment m’enrichir vite ? Ah ! si j’avais dans la tête une bonne invention de mécanique, et dans ma poche des billets de mille pour l’exécuter, ce serait vite fait !
Tout en monologuant ainsi, Jacques se dirigeait vers le cabinet du propriétaire de l’usine, M. Jules Labroue. Ce cabinet se trouvait dans un pavillon voisin des bureaux de la comptabilité et de la caisse, et touchait aux ateliers des modèles. Le pavillon lui-même s’accolait aux ateliers de fabrication.
Le patron était extrêmement rigoureux pour tout ce qui concernait le bon ordre de sa maison. On ne discutait point à l’usine ; l’obéissance passive s’imposait ; il fallait céder ou partir.
Le patron avait son logement à l’usine même, au premier étage du pavillon. La porte du cabinet était placée juste en face du guichet de la caisse dont un simple couloir la séparait. Au fond de ce couloir un escalier conduisait à l’appartement de M. Labroue. Jacques frappa discrètement à la porte. Le caissier, entendant du bruit, leva la plaque de cuivre mobile qui fermait le guichet.
« Inutile de frapper, dit-il, le patron est sorti.
– Voudrez-vous, monsieur Ricoux, le prévenir que je suis de retour.
– Suffit, Jacques. La commission sera faite. »
Le contremaître se rendit aux ateliers où il inspecta le travail, et donna divers ordres. Dans la salle des ajusteurs il alla droit à l’étau d’un ouvrier âgé de cinquante et un ans.
« Vincent, lui dit-il, j’ai rencontré votre fils, et…
– Est-ce qu’il vous a dit que ma femme est plus malade ? interrompit l’ajusteur, devenu blanc comme un linge.
– Non, mais il recommande que vous ne vous attardiez point en sortant de l’atelier…
– Monsieur Jacques, reprit l’ouvrier tremblant de tout son corps, pour que le garçon vous ait arrêté, pour qu’il me recommande de ne pas m’attarder, moi qui ne m’attarde jamais, il faut que sa mère soit très mal… Monsieur Jacques, donnez-moi la permission d’aller jusqu’à la maison, ça me tranquillisera.
– Vous savez, mon pauvre Vincent, qu’il m’est impossible de prendre cela sur moi, répliqua le contremaître. Vous connaissez le règlement. Dès qu’on est entré dans l’usine, on ne peut plus en sortir qu’au coup de cloche.
– Une fois n’est pas coutume, et en demandant au patron…
– M. Labroue est absent.
– Ah ! pas de chance ! » fit l’ouvrier d’un ton désolé.
Jacques sortit de la salle des ajusteurs. Quand le contremaître eut disparu, l’ouvrier dépouilla vivement son tablier de travail, et, se dissimulant derrière les établis, quitta l’atelier sans qu’on fît attention à lui. Il traversa la grande cour en longeant les murailles et il arriva près de la porte de l’usine. Là, il donna deux petits coups dans le vitrage de la loge.
« M’ame Fortier, tirez-moi le cordon, s’il vous plaît, dit-il.
– Vous avez la permission de sortir ? demanda Jeanne.
– Non, mais le contremaître vient de rentrer, il m’a dit que mon garçon lui avait touché deux mots relativement à ma femme, qui est malade. Je crains que son état n’ait empiré. Pour me rassurer, je veux courir jusque chez nous…
– Mais, monsieur Vincent, je ne peux pas vous laisser sortir sans autorisation. Vous savez que la règle est formelle.
– Eh ! je me fiche pas mal de la règle ! répliqua l’ouvrier presque avec colère. Je veux aller voir ma femme… et j’irai.
– N’insistez pas, Vincent, je vous en prie ! Si le patron savait que je vous ai laissé sortir, je serais réprimandée.
– Le patron est absent, répondit l’ajusteur.
– Demandez une permission au contremaître.
– Je l’ai fait. Il me l’a refusée. Alors je la prends, tant pis ! Je cours à la maison et, si tout va bien, je rapplique ici au pas accéléré. Voyons, m’ame Fortier, prouvez que vous avez bon cœur. Ouvrez-moi la porte. Je ne dirai pas que je suis sorti, et en rentrant je retournerai à mon étau. On ne se sera seulement point aperçu de mon absence. Si on sait que je suis sorti, je dirai que vous n’étiez point dans votre loge, que j’y suis entré, que j’ai tiré le cordon moi-même. Le temps s’écoule, m’ame Fortier. Laissez-moi allez voir ma femme…
– Je risque ma place, fit-elle, mais je n’ai pas le courage de vous refuser. »
En même temps, elle tira le cordon.
« Merci ! merci », cria l’ouvrier en s’élançant dehors.
« J’ai peut-être eu tort, pensait la jeune femme, mais les règlements sont trop rigoureux. Il avait les larmes dans les yeux, ce pauvre Vincent ! »
Jacques Garaud, après avoir donné un coup d’œil rapide aux diverses salles, était revenu à l’atelier de l’ajustage où il voulait surveiller les pièces d’un moteur à air comprimé qui devait être livré le lendemain. Il s’approcha de l’ouvrier chargé du montage.
« Vous avancez ? lui demanda-t-il.
– Oui, monsieur Garaud, je n’attends plus que le collier qu’apprête Vincent. Quand je l’aurai, il ne me faudra pas plus d’une demi-heure pour tout mettre en place. »
Jacques se dirigea vers l’étau de Vincent. La place de l’ajusteur était vide. Sur l’étau à côté du collier, se voyait le tablier de travail. Le contremaître fronça les sourcils.
« Où est Vincent ? demanda-t-il à un ouvrier voisin.
– Je ne sais pas, monsieur Jacques, répondit l’homme. Quand vous l’avez quitté, je l’ai vu prendre sa casquette et filer. »
Jacques fit un geste de colère.
S’approchant alors d’un autre établi, il dit à l’ouvrier qui y travaillait :
« François, cessez ce que vous faites et achevez vivement ce collier. Il faut que ce soit fini dans une heure. »
Le contremaître sortit de l’atelier et se dirigea vers la loge de Jeanne. La jeune femme, à travers le vitrage de la fenêtre, le vit traverser la cour et venir de son côté.
« Il se sera aperçu de la disparition de Vincent, pensa-t-elle ; il va m’adresser des reproches, bien sûr. »
Et Jeanne, un peu inquiète, éprouva quelque regret de s’être laissée apitoyer… Jacques ouvrit la loge.
« M’ame Fortier, dit-il d’une voix rude, vous avez ouvert la porte à un homme de l’usine ?
– Moi… monsieur Jacques… balbutia la veuve.
– Oh ! inutile de nier, interrompit le contremaître. Vincent m’a demandé l’autorisation d’aller jusque chez lui. Je la lui ai refusée, comme c’était mon devoir ; il est venu vous trouver et vous avez été plus faible que moi…
– Eh bien, oui, c’est vrai, dit Jeanne, le pauvre homme pleurait ; il m’a suppliée… J’ai cédé…
– Vous saviez pourtant qu’en agissant ainsi vous étiez coupable ; et savez-vous quelle sera pour lui la conséquence de votre faiblesse ?… À partir de ce moment, il ne fait plus partie du personnel de l’usine, et quand il se présentera, je vous défends de lui ouvrir. Vincent a interrompu un travail qu’il fallait achever dans le plus bref délai. Je suis responsable. Je dois rendre compte au patron de ce qui se passe dans les ateliers. Je l’avertirai.
– Mais, s’écria la jeune femme avec effroi, tout va retomber sur moi, alors !…
– Mon devoir est de dire la vérité.
– Non, monsieur Jacques, vous ne serez pas dur à ce point pour ce pauvre Vincent. Ce n’est point ma cause que je plaide auprès de vous, c’est la sienne. En se figurant sa femme plus malade, en danger de mort, il a perdu la tête ; il va rentrer, le patron est absent, vous seul saurez qu’une infraction au règlement a été commise. Vincent est un honnête homme. En perdant son travail, il se trouverait dans la misère. Vous ne direz rien à M. Labroue, n’est-ce pas ? Vous êtes bon, vous aurez pitié de lui…
– Mon bon ami, dit tout à coup le petit Georges qui s’accrochait à la jupe de sa mère, ne fais pas de chagrin à maman… »
Le contremaître subissait un violent combat intérieur. Une émotion profonde se lisait sur son visage.
« Je ne veux pas que vous puissiez me reprocher d’avoir repoussé votre demande ! s’écria-t-il enfin. Pour l’amour de vous, Jeanne, je pardonnerai à Vincent. »
En ce moment, un coup de sonnette retentit dans la loge.
« C’est lui qui revient sans doute », fit la jeune femme…
Elle tira le cordon en s’avançant jusqu’au seuil, suivie de Jacques, pour voir l’arrivant. Le nouveau venu n’était pas Vincent, mais le propriétaire de l’usine, M. Jules Labroue. Il marcha droit au contremaître.
« Est-ce vous, Jacques, lui demanda-t-il d’un ton sec, qui avez permis à Vincent de quitter l’atelier ? Ne point répondre à une question si nettement formulée était impossible.
« Non, monsieur, dit le contremaître.
– Alors Vincent a quitté l’atelier sans vous prévenir ?
– Oui, monsieur. Et je suis venu ici demander à Mme Fortier si elle l’avait vu sortir. »
M. Labroue se tourna vers Jeanne et l’interrogea du regard.
« Je l’ai vu sortir, en effet… murmura la femme.
– Ainsi vous lui avez ouvert ? »
Jeanne dit un signe de tête affirmatif.
« Vous connaissiez cependant le règlement, madame Fortier, reprit le patron. Quel prétexte a-t-il mis en avant pour motiver sa sortie ? »
Ce fut Jacques qui répondit :
« Il s’est figuré que l’état de sa ménagère, qui est malade, empirait, et il a voulu la voir…
– Je l’admets… Tout au moins pouvait-il attendre mon retour pour me demander l’autorisation de quitter momentanément l’atelier, et j’aurais accueilli sans hésiter une requête basée sur un aussi sérieux motif, mais je veux que mes ordres soient respectés. »
M. Labroue, s’adressant à Jeanne, ajouta :
« Quand Vincent se présentera, vous ne le laisserez point rentrer et vous lui direz de venir demain pour le règlement de son compte. Je regrette que cette mesure de rigueur tombe sur lui, car c’était un bon ouvrier, mais il faut un exemple. Venez, Garaud… »
Le contremaître suivit M. Labroue qui se dirigeait vers son cabinet.
Chapitre3
L’ingénieur Jules Labroue était un homme de quarante-cinq ans. La bonté formait le fond de sa nature, ce qui ne l’empêchait point d’être à cheval sur la discipline. Élève de l’École polytechnique, il conduisait son usine militairement.
Ne possédant qu’une très médiocre fortune, il avait épousé à trente-deux ans une femme assez riche pour lui permettre de donner suite aux projets qui le hantaient depuis sa première jeunesse. Il portait mille inventions dans son cerveau toujours en travail. Grâce à la dot de sa femme, il passa du domaine de la théorie dans celui de la pratique. Il put faire construire l’usine qu’il dirigeait à Alfortville. Il n’avait pas encore mis d’argent de côté, mais la maison prenait de jour en jour plus d’extension et le fonds de roulement devait se doubler et même se quadrupler à bref délai, car l’inventeur travaillait sans relâche.
Cinq ans auparavant, Jules Labroue avait perdu sa jeune femme, morte en mettant au monde un garçon. Cette mort prématurée frappa douloureusement l’ingénieur. Blessé au cœur il devint acariâtre. Il ne retrouvait quelque chose de son ancienne douceur de caractère qu’auprès de son petit garçon Lucien.
Lucien était élevé chez la sœur de son père, veuve et retirée dans un village du Blaisois. Chaque mois Jules Labroue quittait l’usine pendant quarante-huit heures afin d’aller embrasser son fils qu’il adorait. Pour Lucien seul, il ambitionnait de réaliser une grande fortune.
… On arriva au pavillon où se trouvaient les bureaux et la caisse. M. Labroue s’arrêta devant le guichet, tira de sa poche un portefeuille dans lequel il prit des papiers qu’il posa sur la tablette de cuivre, et dit au caissier :
« Monsieur Ricoux, voici deux traites de la maison Baumann : vous en passerez écriture et vous les joindrez au bordereau que vous m’apporterez tout à l’heure et qu’il faudra envoyer demain à la Banque… »
L’ingénieur ouvrit la porte de son cabinet, entra, et fit signe à Jacques d’entrer avec lui. Il s’assit à son bureau.
« Avez-vous visité, chez M. Montreux, la machine que nous avons mise en place il y a quinze jours ? demanda-t-il à Jacques.
– Oui, monsieur… Il faudra une journée d’ouvrier pour quelques petites réparations d’ajustage. Un bon ajusteur est nécessaire… je pensais à Vincent, mais…
– Mais, interrompit d’un ton sec M. Labroue, Vincent ne fait plus partie des ateliers. Vous savez que je ne reviens jamais sur ce que j’ai dit. Vous tancerez vertement le contremaître de son atelier. Il aurait dû surveiller ses hommes mieux qu’il ne l’a fait. Vous ne pouvez être partout à la fois, mais vous devez vous faire craindre assez pour qu’on ne se croie pas tout permis quand vous avez le dos tourné. J’ai confiance en vous, je vous délègue mon autorité ; ne l’oubliez pas ! Vous manquez de sévérité. Je vois des choses qui m’irritent. Savez-vous qu’une ouvrière a quitté son travail pour venir garder la loge pendant une absence de Mme Fortier ?
– Je le sais, mais c’est une ouvrière qui est à ses pièces.
– Peu m’importe ! il est d’un mauvais exemple qu’on quitte l’atelier, Mme Fortier doit savoir en outre qu’il lui est défendu de s’éloigner de l’usine pendant les heures de travail. J’ai eu tort de lui donner cette place de gardienne. Je n’ai point réfléchi qu’une jeune femme ne pourrait remplacer un gardien. Pour une surveillance active de jour et de nuit, un homme est indispensable. Jeanne Fortier ne gardera pas sa position ici. »
Jacques tressaillit en entendant ces mots.
En ce moment le caissier entra dans le cabinet et dit :
« Voici le bordereau pour la Banque, monsieur. »
M. Labroue d’un coup d’œil évalua le total du bordereau.
« Cent vingt-sept mille francs, dit-il.
– Oui, monsieur… »
Jacques Garaud écoutait. L’ingénieur endossa les traites, signa le bordereau et reprit :
« Vous enverrez cela demain à la Banque ; après demain on ira toucher.
– Ce sera fait, monsieur.
– Vous avez relevé les échéances pour le 10 ?
– Oui, monsieur.
– Quel est l’écart entre les sommes payées et les sommes à recevoir ?
– Soixante-trois mille francs à votre actif, monsieur.
– Très bien. »
M. Ricoux se retira. Jacques était resté debout, la casquette à la main. M. Labroue quitta son bureau, vint à la grande table chargée de dessins et d’épures, et dit :
« Ou je me trompe beaucoup, Jacques Garaud, ou j’ai trouvé quelque chose de merveilleux… une fortune !…
– Une fortune ! répéta Jacques Garaud, tandis qu’une lueur de cupidité s’allumait dans ses yeux.
– Oui, répondit l’ingénieur. Une application nouvelle du moins ; le perfectionnement d’un système suisse que vous devez connaître. J’ai besoin d’en causer avec vous, Jacques, vous m’inspirez la plus grande confiance et la plus grande estime. Outre que vous savez à fond votre métier, vous êtes chercheur et de bon conseil. J’ai besoin de vous pour mener à bien une dernière invention. Vous étiez dans une fabrique en Suisse avant d’entrer chez moi, m’avez-vous dit ?…
– Oui, monsieur.
– Vous vous êtes occupé certainement des machines à guillocher qu’on exécute pour l’Amérique ?…
– Oui, monsieur. Mais je me permettrai de vous faire observer que la machine à guillocher a dit son dernier mot…
– Pour les machines à guillocher les surfaces planes, oui.
– Il est impossible de faire des tours capables de guillocher des surfaces arrondies.
– Croyez-vous ?
– Je le crois d’autant mieux que j’ai tout particulièrement étudié le système.
– Difficile, oui… impossible, non… C’est une machine à guillocher les contours que j’ai inventée. »
Le contremaître ouvrit de grands yeux et fit un geste de surprise.
« Si vous ne vous illusionnez pas, monsieur, dit-il ensuite, vous gagnerez des millions ! On s’arrachera cette mécanique introuvable…
– Je l’ai trouvée, mais, je vous le répète, j’ai besoin de m’entendre avec vous sur diverses applications de mon système. Je pense comme vous que, si la réussite est complète, je réaliserai pour mon fils une grosse fortune. C’est surtout en pensant à lui, à son avenir, que je travaille avec tant de courage, mais je ne veux pas être égoïste ; je vais vous confier mes plans. Nous les étudierons ensemble et, si vous n’y trouvez rien à reprendre ou à modifier, vous vous mettrez à l’œuvre pour la construction, en ayant soin de tenir secrète une découverte qu’une seule indiscrétion permettrait peut-être de me voler.
– Ah ! monsieur, s’écria Jacques, vous pouvez compter sur moi, vous le savez bien.
– Je le sais et c’est pour cela que je fais de vous, à partir d’aujourd’hui, un collaborateur associé. Sur les bénéfices de la machine à guillocher que nous allons construire, je vous donnerai quinze pour cent. »
Le feu de la convoitise s’alluma dans les yeux du contremaître.
« Quinze pour cent ! répéta-t-il.
– Oui, et je porterai cette somme à vingt pour cent après un chiffre de trois cent mille francs de bénéfices nets. Du reste, nous signerons un petit traité. Venez voir mon plan. »
M. Labroue ouvrit le coffre-fort qui se trouvait de l’autre côté de la fenêtre. Il y prit une cassette qu’il plaça sur la table du milieu et, après l’avoir ouverte à l’aide d’une clef microscopique suspendue à sa chaîne de montre, il en tira des papiers qu’il déroula et qu’il étala sur le tapis de drap vert.
L’ingénieur entama alors des explications en termes techniques dans lesquelles nous nous garderons bien de le suivre.
« C’est admirable, monsieur ! s’écria Jacques Garaud quand l’ingénieur eut achevé. C’est la réalisation de l’impossible.
– Vous croyez alors la réussite probable ?
– Je la regarde comme certaine.
– Eh bien, ma part de collaboration est faite. La vôtre commence. Mettez-vous à l’œuvre.
– Je m’y mettrai après avoir étudié à tête reposée tous les détails afin de faire construire les modèles à forger ou à fondre.
– Chaque jour vous viendrez dans mon cabinet, et pendant deux ou trois heures je vous donnerai ces plans. Je n’ose les laisser sortir d’ici. Nulle précaution n’est inutile.
– Je viendrai là, dit le contremaître, sous vos yeux faire mes dessins de modèles, et si de petites modifications me paraissent nécessaires, je vous les signalerai.
– C’est convenu, nous travaillerons ensemble, Jacques.
– Monsieur, je vous remercie de toute mon âme et ma reconnaissance vous est à tout jamais acquise.
– Je n’en doute pas. Maintenant que vous voilà pour ainsi dire mon associé, il faut que vous redoubliez d’activité, de zèle, et que vous vous montriez sévère dans les ateliers.
– Dois-je toujours préparer le compte de Vincent ?
– Oui, je persiste à faire un exemple. Veuillez, en sortant dire au garçon de bureau de m’envoyer Mme Fortier.
– Oui, monsieur. »
Jacques se retira. Le garçon de bureau n’était pas rentré.
Le contremaître alla lui-même à la loge de Jeanne.
« Madame Fortier, lui dit-il, le patron vous demande. »
La jeune femme se mit à trembler.
« Il vous a parlé de moi, n’est-ce pas ? balbutia-t-elle.
– Oui. Il va vous gronder sérieusement. Vous le connaissez, il a bon cœur, mais il est parfois brutal. Laissez-le dire sans lui répondre. Quoiqu’il arrive, songez que vous avez en moi un ami absolument dévoué.
– Advienne que pourra ! répliqua la jeune veuve. J’ai la conscience tranquille. Mais qui gardera ma loge ?
– Fermez tout bonnement la porte. Votre absence ne sera pas longue. Moi, je retourne aux ateliers. »
Jacques semblait préoccupé. Il traversa les ateliers et entra dans une pièce, spécialement affectée à son usage. Là, il se laissa tomber sur une chaise.
« Certes, murmurait-il, le patron ne se trompe pas ! C’est une fortune ! Ce que je cherchais, il l’a trouvé ! Si cette invention m’appartenait, ce ne serait pas cent, deux cent, trois cent mille francs que je gagnerais, mais des millions ! Oui, des millions. Mais il faudrait de l’argent pour louer des ateliers, pour les outiller, pour faire construire. Et je n’ai rien ! »
Après un silence Jacques poursuivit, en serrant les poings :
« Ah ! la tentation est forte ! Quinze pour cent… vingt pour cent… qu’est-ce cela, quand je pourrais avoir tout ! Je serais riche alors et Jeanne ne refuserait plus de m’entendre ! Le patron est irrité contre elle. Je voudrais qu’il la rudoie, qu’il la chasse ! Elle se trouverait sur le pavé, sans ressources pour elle et pour ses deux enfants. Il lui faudrait bien venir à moi !… »
Jeanne Fortier, en proie à un trouble facile à comprendre, avait franchi le seuil du pavillon où se trouvait le cabinet de M. Labroue. Elle frappa d’une main tremblante.
« Entrez », cria M. Labroue. La jeune femme entra et d’une voix étranglée balbutia :
« Vous m’avez fait demander, monsieur ?
– Oui, madame, répondit l’ingénieur d’un ton rude. J’ai besoin de savoir pourquoi vous vous êtes absentée de l’usine, cet après-midi, confiant à une ouvrière la garde de votre loge, ce qui est absolument contraire à la règle établie.
– Monsieur, répliqua Jeanne, si j’ai cru pouvoir quitter ma loge, c’était pour les besoins de l’usine. J’allais acheter le combustible nécessaire à l’entretien des lampes de nuit.
– Soit ! Mais rien ne vous empêchait d’attendre la fermeture des ateliers pour faire cette emplette. De plus, votre faiblesse à l’endroit de Vincent prouve qu’il est impossible de compter sur vous. Encore une fois, madame, je me suis fourvoyé en faisant de vous la gardienne de l’usine. »
Jeanne avait les yeux pleins de larmes.
« Je n’ai pas sollicité cet emploi, monsieur, fit-elle avec dignité, vous avez cru devoir me l’offrir pour m’aider à vivre après la mort de mon pauvre mari tué à votre service. J’ai accepté en vous bénissant, car je n’avais que la misère en perspective. Mais vous m’adressez de durs reproches et j’ai conscience de ne les point mériter.
– Quoi ! prétendez-vous n’avoir point désobéi aux règlements ?
– J’ai prié une femme qui travaille à ses pièces de me remplacer. Le temps que cette femme a perdu lui appartenait.
– Vous déplacez la question ! répliqua l’ingénieur irrité de se voir tenir tête. C’est à vous seule qu’a été confiée la garde de l’usine. Mais passons ! Vous avez laissé sortir un ouvrier sans autorisation.
– C’est vrai, monsieur, j’ai été faible devant les prières de Vincent, j’ai cédé, j’ai désobéi, mais vous savez pourquoi, monsieur ; à moins d’avoir un cœur de pierre, tout le monde à ma place aurait agi comme j’ai agi.
– Nous ne sommes guère faits pour vivre ensemble, madame Fortier, dit l’ingénieur après un silence, et je le regrette. Cependant vous êtes digne d’intérêt… »
En ce moment le caissier Ricoux entra dans le cabinet pour soumettre au patron des pièces de comptabilité. La vérification opérée, le caissier reprit ses pièces. Il allait sortir, mais ses yeux tombèrent sur la jeune veuve, et il dit :
– Puisque Mme Fortier est là, ayez donc la bonté, monsieur, de lui apprendre qu’il lui est absolument défendu d’introduire du pétrole dans l’usine pour son usage particulier. »
M. Labroue bondit.
« Du pétrole ! s’écria-t-il, du pétrole ici !
– Oui, monsieur, répondit le caissier, Mme Fortier se sert d’une lampe à huile minérale. J’ai senti hier, auprès de sa loge, l’odeur du pétrole renversé.
– Prétendez-vous ignorer, madame, que ceci constitue une désobéissance formelle au règlement ? demanda l’ingénieur.
– Je l’ignorais, monsieur.
– C’est impossible !
– Je ne mens jamais. À quoi me servirait d’ailleurs un mensonge ? Je vois bien que la mesure est comble.
– Et vous ne vous trompez point, madame, répliqua M. Labroue. À la fin du mois vous quitterez l’usine.
– Ainsi, balbutia Jeanne qu’étouffaient les sanglots, vous me chassez !… Mon mari est mort dans votre maison, tué pour votre service, à son poste, comme un soldat. Que vous importe ! Vous me chassez ! Que deviendrai-je ? que deviendront mes petits enfants ? Peu vous importe encore ! Ah ! tenez, monsieur, prenez garde, cela ne vous portera pas bonheur !… »
M. Labroue regarda Jeanne fixement.
« Qu’est-ce à dire ? demanda-t-il.
– Malheureuse ! s’écria le caissier. C’est une menace !
– Non, monsieur, répondit Jeanne qui sanglotait, je ne menace pas, je ne menace personne, j’accepte le malheur qui, coup sur coup, me frappe, et je garde pour moi mon chagrin… Je suis fautive, j’en dois porter la peine. Je partirai, monsieur, je m’en irai dans huit jours. Veuillez vous procurer quelqu’un qui me remplace. »
M. Labroue, malgré sa rudesse, se sentait très ému.
« Vous vous trompez absolument, ma pauvre enfant, fit-il avec douceur, je ne vous chasse pas… Je m’aperçois que j’ai eu tort de mettre une femme à un poste où de toute nécessité il faut un homme… et vous devez le comprendre.
– Il fallait y penser d’abord, monsieur.
– Sans doute, mais mon vif désir de vous être utile m’a empêché de réfléchir. Restez jusqu’à la fin du mois. D’ici là je vous aurai trouvé une place mieux en rapport avec votre caractère et vos aptitudes.
– Non… non… monsieur, dans huit jours, je partirai. Aussi bien, cette maison était un enfer pour moi. Il me semblait y marcher dans du sang, au milieu de mes souvenirs lugubres. C’est une maison maudite, où mon pauvre mari a trouvé la mort, et où je n’ai trouvé, moi, que des chagrins. »
Et la jeune femme s’élança hors du cabinet.
« Pauvre femme ! dit l’ingénieur. Je suis désolé vraiment de ce qui arrive. J’ai ravivé toutes ses douleurs. Certes, elle n’agissait point avec des intentions mauvaises, mais enfin rien ne se passait correctement. Je ne sais où j’avais la tête en lui donnant cette place.
– Vous n’écoutiez que votre bon cœur, monsieur, répliqua le caissier d’un ton patelin.
– Je lui trouverai une place auprès de ma sœur. Cela pourra s’arranger sans doute.
– Ah ! monsieur, reprit le caissier, prenez garde de trop suivre votre premier mouvement. Cette femme vous a menacé.
– Était-ce bien une menace ?
– Positivement. Cette Jeanne Fortier me fait l’effet de partager sa haine entre vous et la maison. Prenez garde, monsieur…
– Allons, Ricoux, vous exagérez ! Vous voyez les choses trop en noir ! Cette pauvre femme est veuve et mère de famille ! Je dois faire quelque chose pour elle. Si je ne puis la placer auprès de ma sœur, je lui remettrai une somme assez ronde pour lui permettre de vivre en attendant du travail. »
Puis, changeant de conversation, M. Labroue ajouta :
« Vous avez établi votre balance ?
– Oui, monsieur, la voici », répondit Ricoux.
Et il tendit à l’ingénieur une feuille de papier sur laquelle étaient tracés des chiffres.
« Sept mille cent vingt-trois francs trente centimes…
– Oui, monsieur. Je vais vous les apporter.
– Quelle singulière manie est la vôtre ! mon cher Ricoux. Je suis le caissier de mon caissier ! Pourquoi ne gardez-vous pas l’argent dans votre coffre-fort ?
– J’ai déjà eu l’honneur de vous le dire, monsieur, la responsabilité m’épouvante. Ne couchant pas à l’usine, je ne veux répondre de rien.
– Apportez donc les fonds. »
Ricoux alla chercher la somme de sept mille cent vingt-trois francs trente centimes, et la remit à M. Labroue qui la serra dans sa caisse particulière, ainsi qu’il le faisait tous les soirs. On entendit la sonnerie de cloche, annonçant la fermeture des ateliers. Le caissier souhaita le bonsoir à son patron et se retira. Le garçon de bureau vint prendre les ordres.
« Vous pouvez partir, je n’en ai pas à vous donner ce soir, David », lui fit l’ingénieur.
David quitta le cabinet, prit son chapeau dans le couloir et traversa pour gagner la porte de sortie.
Le départ des ouvriers s’achevait. Le garçon de bureau, au lieu de sortir de la cour, s’arrêta sur le seuil de la loge.
« Eh bien, quoi, petit Georges, cria-t-il, on ne vient donc pas dire bonsoir à son camarade, aujourd’hui ? »
L’enfant apparut.
« Qué que t’as ? reprit David, t’as les yeux rouges, mon mignon. Pourquoi tu pleures ?
– Maman a du chagrin… fit le petit Georges.
– Du chagrin ? » répéta le garçon de bureau.
Il avança sa tête dans l’encadrement de la porte et demanda :
« Quoi c’est-il donc qui se passe, m’ame Fortier ? »
Jeanne sanglotait.
« Ah ! mon pauvre David, balbutia Jeanne en essayant d’étouffer ses sanglots, je suis malheureuse… On me chasse…
– On vous chasse d’ici, vous ! s’écria le garçon de bureau atterré par cette nouvelle, c’est pas possible. Et pourquoi ?… Qu’est-ce qu’on a donc à vous reprocher ? »
Jeanne raconta brièvement les motifs du mécontentement de l’ingénieur.
« Ah ! reprit David après avoir écouté, présentement la chose ne m’étonne plus. Mais ça s’arrangera. Vous connaissez le particulier, vif comme la poudre, mais au fond il n’y a pas de plus brave homme que lui. Il ne peut pas vous renvoyer, vous la veuve de Pierre Fortier.
– Je m’en irai. Dans huit jours j’aurai quitté l’usine ! Mais je l’ai dit à M. Labroue, ça ne lui portera point bonheur !
– Tout ça, c’est des paroles, m’ame Fortier. Ça se rabibochera, vous verrez, et vous resterez avec nous… Au revoir, m’ame Fortier… Bonsoir petiot. »
David tendit les bras à Georges, lui donna deux gros baisers et sortit. Jeanne attendit pour fermer la porte que les feuilles de présence lui eussent été apportées. Dix minutes s’écoulèrent, puis Jacques Garaud parut.
« Voici les feuilles, dit-il. Rien de nouveau ? »
Le petit Georges lui saisit la main, et répondit :
« Nous avons bien du chagrin, mon ami Jacques. Nous partons de l’usine… »
Le contremaître tressaillit.
« Vous partez de l’usine ! » s’écria-t-il.
Jeanne fit un signe de tête affirmatif.
« Ainsi, ce que je redoutais est arrivé ! Le patron vous a fait des reproches… il s’est mis en colère, et…
– Et il m’a chassée ! acheva Mme Fortier.
– Vous l’avez irrité, certainement.
– Je me suis révoltée contre ses reproches qui pouvaient être formulés moins durement. Dans huit jours, je quitterai l’usine.
– Et où irez-vous, dans huit jours ? Que ferez-vous ?
– Où j’irai ? Je ne sais pas… Ce que je ferai ? Je travaillerai… pour gagner mon pain et celui de mes enfants.
– Voyons, Jeanne, il ne faut point aggraver par votre faute une situation déjà bien difficile. Le patron peut revenir sur cette détermination prise dans un premier mouvement.
– Je veux partir.
– Et moi, Jeanne, je ne vous verrai plus !
– Cela vaudra mieux. Souvenez-vous de ce que je vous disais tantôt. En ne me voyant plus, vous m’oublierez.
– Souvenez-vous de ce que je vous ai répondu : Mon amour, c’est ma vie ! Voyons, Jeanne, point de coup de tête ! Demain je parlerai au patron, je le supplierai de vous conserver ici.
– Monsieur Garaud, je vous défends de faire cela.
– Mais c’est la misère qui vous attend ! Jeanne, vous connaissez mes sentiments pour vous. Je vous répète ce soir ce que je vous disais ce matin ! Je vous aime… aimez-moi… vivons ensemble… »
La jeune femme indignée se redressa.
« Vivre avec vous ! s’écria-t-elle. Être votre maîtresse !… Pour me faire une proposition semblable, il faut que vous me méprisiez bien !
– Je vous jure que le lendemain du jour où les dix premiers mois de votre veuvage seront finis, vous deviendrez ma femme. »
Puis il poursuivit avec passion :
« Jeanne… chère Jeanne… réfléchissez… Ce que je vous propose, c’est la vie, c’est le bonheur pour des petits êtres que vous aimez, et que j’aimerai, moi, de toutes mes forces. Si vous me repoussez, ce sera pour eux comme pour vous la misère… La misère noire. On sait ce que rapporte le travail d’une femme. Jamais vous ne pourrez gagner assez pour donner aux petits la nourriture et les vêtements dont ils ont besoin.
– Ah ! tentateur ! Vous assombrissez ce tableau pour m’épouvanter… pour me décourager…
– Je vous dis la vérité telle qu’elle est. Mais je vous sauverai malgré vous ! Vous serez ma femme…
– Mon Dieu… mon Dieu… fit Jeanne avec une sorte d’affolement. Il ne se taira pas, et il ne partira pas !
– Je veux vous prouver ma tendresse par mon obéissance. Je pars. Mais pour m’occuper de vous… »
Et Jacques Garaud quitta la jeune femme qu’il laissait en proie à une agitation terrible. Ces paroles confuses s’échappaient de ses lèvres :
« Il a raison… il n’a que trop raison. Pour ces pauvres petits, pour moi, c’est la misère. Comment pourrais-je, avec le travail de mes mains, payer les mois de nourrice de Lucie ? Comment élèverais-je Georges ? Ah ! la situation est effroyable. Jacques m’offre la paix… la tranquillité… l’aisance… Mais pour cela il faudrait trahir le serment que j’ai fait à Pierre à son lit de mort. Ce serait odieux… ce serait lâche !… Non… Non… »
Jeanne, puisant dans sa volonté une force surhumaine, se leva, essuya ses larmes et sortit de la loge. Elle ferma la porte de la cour comme cela lui était recommandé, puis elle alla faire une ronde dans les ateliers déserts, visita les écuries, où le cocher donnait à ses chevaux le repas du soir, et revint chez elle.
M. Labroue se présentait pour sortir. Elle lui ouvrit la porte sans prononcer une parole et rentra. Georges jouait dans un coin de la chambre avec son éternel cheval de carton et avec une boîte de soldats de plomb. Le cocher sortit à son tour. Jeanne resta seule dans la fabrique.
Chapitre4
Depuis la mort de sa femme, l’ingénieur avait supprimé tout train de maison. Il prenait pension dans un restaurant. Vers onze heures du soir il rentrait et travaillait souvent pendant deux ou trois heures. Le matin, il se levait presque au point du jour, travaillait encore et allait faire une première visite aux ateliers.
Le cocher, pas plus que le caissier et le contremaître principal, ne couchait à l’usine. L’écurie, contenant trois chevaux, se trouvait isolée des autres bâtiments. Jeanne, la nuit, habitait donc seule l’usine en même temps que l’ingénieur. Il avait donné l’ordre à Mme Fortier de ne jamais l’attendre lorsqu’il était dehors, une clef de la petite porte lui permettant de rentrer sans réveiller la gardienne. Outre la porte cochère et la poterne donnant sur la route, il existait une troisième issue, voisine du pavillon habité par M. Labroue et accédant à un chemin de traverse conduisant à Maisons-Alfort. L’ingénieur sortait et entrait assez fréquemment par cette issue.
Le lendemain, la vie active reprit dans l’usine. Jacques Garaud, en passant, dit très brièvement bonjour à Jeanne. Une extrême préoccupation se voyait sur sa figure ; il alla droit aux ateliers. Vincent n’avait point reparu depuis la veille. Sa femme était au plus bas et il ne pouvait songer à s’éloigner.
Au moment où sonnèrent neuf heures, Jacques se rendit au cabinet de M. Labroue et il commença à étudier sérieusement avec lui le projet de la machine à guillocher. La journée s’écoula.
Jeanne avait fait son travail quotidien sans adresser la parole à qui que ce fût. Le soir, quelques ouvriers, sachant ce qui s’était passé la veille, voulurent adresser des consolations à la veuve de leur camarade. Mme Fortier les arrêta dès les premiers mots.
« Inutile de parler de cela ! leur dit-elle en jouant l’indifférence. Ce qui est fait est fait, et je n’en mourrai pas, allez !… »
Jacques, en partant, lui serra la main silencieusement. Sa préoccupation semblait avoir encore augmenté depuis le matin.
Le contremaître avait son domicile assez loin de l’usine. Il habitait une petite chambre dans une maison d’Alfortville. Il lui fallait vingt-cinq minutes pour s’y rendre ; il prenait ses repas chez un marchand de vin où se réunissaient le soir un grand nombre des ouvriers de la fabrique. Ce soir-là, Jacques ne parut pas à son restaurant.
Quand Jacques rentra chez lui, minuit sonnait. Il se coucha, mais ne put fermer l’œil. Le lendemain, lorsqu’il arriva à l’usine, ses regards brillaient d’un feu sombre. Il fit halte à la porte de la loge. Jeanne s’avança vers lui.
« Qu’avez-vous donc, monsieur Garaud ? lui demanda-t-elle, frappée du grand changement qui s’était fait en lui depuis le jour précédent.
– Rien… rien… m’ame Fortier, balbutia-t-il d’un ton singulier. J’aurais voulu vous dire… Mais non… Je vais à l’atelier.
– Quel air étrange ! » pensa la jeune veuve.
Jacques Garaud fit son service habituel. Comme la veille il se rendit à neuf heures précises au bureau de M. Labroue, et poursuivit avec lui des études relatives à l’invention nouvelle. À onze heures, le contremaître sortit pour aller déjeuner, mais pas plus à l’aller qu’au retour il n’adressa la parole à Jeanne en passant devant sa loge. Dans l’après-midi il retourna trouver l’ingénieur.
« Jacques, dit-il au contremaître, vous pouvez commencer les dessins pour le moulage. Moi je termine une lettre pressée… »
Garaud se mit au travail. Sa main tremblait. Ses yeux n’avaient plus leur netteté de perception habituelle. Le caissier Ricoux entra dans le cabinet.
« On arrive de la Banque, monsieur… fit-il.
– Eh bien, demanda l’ingénieur, on a encaissé ?…
– Oui, monsieur, et je vous apporte le montant du bordereau…
– Revenez un peu plus tard, je vous prie… »
Le caissier sortit. Jacques, présent à cette conversation, avait tressailli en entendant ces mots :
« Je vous apporte le montant du bordereau. »
Puis il s’était courbé de nouveau sur son travail. Un quart d’heure s’écoula. On entendit frapper.
« Entrez ! » cria l’ingénieur avec impatience. Jeanne parut sur le seuil.
« Monsieur, dit-elle, c’est une dépêche…
– Merci… » répondit M. Labroue en prenant le télégramme.
Mme Fortier sortit. L’ingénieur déchira l’enveloppe, parcourut du regard la feuille qu’elle contenait, et devint très pâle.
« Lucien malade ! s’écria-t-il. En danger peut-être !… »
Puis, s’adressant au contremaître, il poursuivit :
« Je reçois une dépêche de ma sœur. Je vais partir à l’instant même, rassemblez les dessins et les plans et donnez-les-moi. Je les enfermerai dans le coffre-fort.
– Oui, monsieur, tout de suite », répliqua le contremaître.
Et il se mit en devoir de rassembler les papiers. M. Labroue fit retentir un coup de cloche dans la cour, puis appela le caissier.
« Mon cher Ricoux, lui dit le patron, un télégramme réclame ma présence auprès de mon enfant malade. Faites votre caisse. Gardez les sommes qui vous seront utiles, et remettez-moi le reste.
– Je vais me hâter, monsieur. »
Ricoux sortit. Le coup de cloche appelait Jeanne Fortier.
« Donnez l’ordre au cocher d’atteler le coupé vivement, je vous prie, lui dit M. Labroue. Vous reviendrez ensuite me parler. »
Jeanne reparut au bout de quelques minutes. Jacques était toujours là, le caissier rendait ses comptes.
« Je garde cinq mille francs, disait-il ; j’espère bien n’avoir pas besoin d’ouvrir la caisse avant votre retour.
– Peut-être… répliqua l’ingénieur. Ne m’attendez que dans deux jours au plus tôt… C’est aujourd’hui mercredi. En admettant que je ne sois pas retenu par la maladie de Lucien, je ne serai ici que samedi dans la matinée. Combien m’apportez-vous ?
– Aux 127 000 francs du bordereau touché à la Banque, je joins les recettes de la journée, 11 027 francs sur lesquels je garde 5 000 francs. Total : 133 027 francs. Donc, avec ce que vous avez en caisse, cela fera 190 953 francs 70 centimes… Assurez-vous-en, monsieur.
– Je n’ai pas le temps de vérifier. »
Et l’ingénieur enferma dans son coffre-fort les sommes que lui remettait le caissier. Jacques et Jeanne attendaient. Mme Fortier regardait le contremaître et trouvait à son visage une expression qu’elle ne lui connaissait pas avant ce jour.
Jacques s’avança vers M. Labroue.
« Voici les dessins et les plans, monsieur », dit-il.
M. Labroue les prit et les plaça dans le coffret, puis il plaça le coffret lui-même dans la caisse.
« À mon retour, fit-il, nous continuerons ce travail. »
L’ingénieur se tourna vers Jeanne et poursuivit :
« Madame Fortier, je vous recommande de ne pas vous départir, ne fût-ce qu’une minute, de la surveillance qui vous incombe. À mon retour je m’occuperai de vous. Soyez certaine que je ne vous laisserai point sans emploi. Oubliez ce qui s’est passé entre nous, comme je l’oublie moi-même. »
Jeanne, étonnée de cette bienveillance inattendue restait muette. Le caissier Ricoux l’examinait avec attention…
« Mauvaise nature ! murmura-t-il. Cette femme déteste le patron… elle voulait se venger en lui faisant du mal… »
M. Labroue continua :
« Préparez-moi, je vous prie, une valise contenant un peu de linge. Joignez-y un pardessus et une couverture. »
Mme Fortier sortit du cabinet. En la voyant s’éloigner, l’ingénieur dit au caissier et au contremaître :
« Elle m’en veut beaucoup, la pauvre créature… Elle ne comprend pas que le poste occupé par elle ici n’est nullement son affaire… Je sais bien que j’ai été un peu cassant, un peu brutal même… Je lui ferai oublier cela… Je vais m’occuper d’elle… »
M. Labroue donna ensuite ses dernières instructions à Ricoux et à Jacques.
Cinq minutes plus tard, la voiture se dirigeait vers la gare d’Orléans, emportant l’ingénieur. Jeanne, le contremaître et le caissier assistaient à son départ.
« Je vous recommande de fermer les portes avec soin, madame Fortier, dit le caissier. Mon avis est que le patron vous laisse légèrement une bien grosse responsabilité !
– Soyez sans inquiétude, monsieur, répondit Jeanne, ma surveillance ne sera point en défaut. »
À l’heure de la sortie, le contremaître vint apporter les feuilles de présence pour le lendemain.
« Bonsoir, Jeanne ! dit-il. Bonne nuit !… »
Il allait sortir. Cette fois, ce fut Mme Fortier qui l’arrêta.
« Que vouliez-vous me dire ce matin ? » demanda-t-elle.
Jacques tressaillit visiblement et répondit :
« Je voulais vous dire bien des choses…
– Eh bien, dites-les…
– Non… j’ai réfléchi… pas encore… je n’ose pas. Mais si je ne vous parle point, je vous écrirai, c’est plus facile. »
Jeanne trouva les paroles du contremaître non moins étranges que sa physionomie.
« Vous me faites presque peur ! murmura-t-elle.
– Ne me demandez rien… quant à présent du moins… et répondez à une question qu’il faut que je vous adresse…
– Une question ? répéta Jeanne. Laquelle ?
– Avez-vous sérieusement pensé à ce que je vous disais hier relativement à votre situation ? reprit le contremaître.
– Oui, j’y ai pensé…
– Et consentez-vous à ce que je vous proposais…
– Quand vous m’aurez appris ce que vous ne voulez pas, ce que vous n’osez pas m’apprendre aujourd’hui.
– Eh bien, demain notre sort à tous deux sera fixé… fixé…
– Demain ? Pourquoi demain ?
– Ne m’interrogez point. Demain arrivera vite, et en quelques heures il se passe bien des choses. »
Puis Jacques Garaud partit brusquement ; il alla dîner à l’endroit où il prenait ses repas, resta chez le marchand de vin jusqu’à dix heures du soir, jouant aux cartes de l’air le plus calme avec quelques camarades auxquels il souhaita une bonne nuit en les quittant.
Aussitôt qu’il fut seul, son visage redevint sombre comme il était depuis deux jours. Au lieu de se rendre chez lui, Jacques s’engagea dans un sentier traversant la plaine entre Alfortville et Alfort. Bientôt il se trouva dans les terres labourées. Il allait vite, et prêtant l’oreille afin de s’assurer que personne ne marchait derrière lui ou ne venait à sa rencontre. Soudain il s’arrêta. Une muraille se dressait en face de lui. C’était celle de l’usine de M. Labroue. Il la côtoya jusqu’à la petite porte bâtarde voisine du pavillon habité par l’ingénieur.
« C’est par là qu’il faut entrer… » murmura-t-il en se baissant vers la serrure qu’il examina avec attention.
Tirant ensuite de sa poche une boîte de fer-blanc, il l’ouvrit. Cette boîte renfermait un morceau de cire à modeler avec lequel il prit l’empreinte de la serrure. Cela fait, il se dirigea vers Alfortville par le chemin qu’il avait suivi pour venir.
À cette heure précise, M. Labroue descendait du train-poste qui s’arrêtait à Blois. Sa sœur, Mme Bertin, habitait au village où elle vivait d’une façon fort modeste depuis la mort de son mari. Ce village, nommé Saint-Gervais, se trouvait sur la route de Bracieux, à trois kilomètres de Blois.
M. Labroue traversa le pont et s’engagea sur la route de Saint-Gervais. Il était haletant. La dépêche expédiée par Mme Bertin remplissait son cœur paternel de douloureuses angoisses.
Le village de Saint-Gervais, bâti sur le flanc d’un coteau, lui apparut bientôt. Il était une heure du matin. La cloche qu’il agita résonna d’une façon bruyante. L’ingénieur attendit.
Au bout de quelques secondes une fenêtre s’ouvrit.
« Qui est là ? demanda une voix de femme.
– Moi, chère sœur… répondit M. Labroue. Comment va Lucien ?
– Dieu soit béni. Tout danger a disparu… répliqua Mme Bertin. Attends ! je vais t’ouvrir. »
La porte de la cour tourna sur ses gonds. Le frère et la sœur tombèrent dans les bras l’un de l’autre.
« Ta dépêche m’a fait du mal ! s’écria M. Labroue en franchissant le seuil de la maison.
– Eh ! j’ai eu bien peur moi-même ! répondit Mme Bertin. Le médecin redoutait une angine couenneuse…
– Pauvre mignon !… C’est presque toujours mortel.
– C’est pour cela que mon épouvante était si grande, mais le médecin a déclaré ce soir que tout péril avait disparu. Lucien a encore la fièvre, mais il va beaucoup mieux.
– Je voudrais le voir.
– Viens… il est dans ma chambre… »
M. Labroue gravit derrière sa sœur l’escalier accédant à la chambre où Lucien reposait dans son petit lit de fer. Le visage de l’enfant était pourpre ; de grosses gouttes de sueur collaient à ses tempes les boucles de ses cheveux blonds. M. Labroue le contempla pendant quelques secondes.
« Pauvre cher mignon !… » répéta-t-il.
Et il effleura de ses lèvres le front de l’enfant.
« Ne restons point ici, je t’en prie, dit Mme Bertin. Nous le réveillerions et c’est ce qu’il ne faut pas. »
Le frère et la sœur descendirent au rez-de-chaussée.
« As-tu besoin de quelque chose ? demanda la bonne dame.
– De rien, absolument.
– Eh bien, alors, va te reposer. Tu sais que ta chambre est toujours prête. Demain, ou plutôt ce matin, nous causerons. »
Le lendemain matin, le docteur constata du premier coup d’œil l’état satisfaisant de l’enfant. Rassuré d’une façon complète, l’ingénieur manifesta son intention de partir dans l’après-midi.
« Je prendrai ce soir l’express de Paris, dit-il à sa sœur. Je serai à neuf heures à Paris, et à Alfortville une heure et demi après.
– Eh bien, demanda Mme Bertin, as-tu du nouveau dans ton usine ? Es-tu satisfait ? »
M. Labroue eut un sourire aux lèvres.
« Si je suis satisfait ? Je suis en train de m’enrichir.
– Une nouvelle invention, sans doute ?
– Oui, une trouvaille qui aura mis, d’ici à quatre ans, deux ou trois millions dans ma caisse.
– Ne t’illusionnes-tu pas un peu ?
– L’illusion est impossible. Il s’agit d’une machine à guillocher non seulement les surfaces planes mais encore les contours. Les Américains me paieront cette machine ce que je voudrais…
– À moins que quelqu’un n’arrive avant toi ! Qu’une indiscrétion soit commise… et on vole ton idée.
– Sois sans crainte, je fais beaucoup moi-même, et je suis bien secondé par ceux qui m’entourent. Je crois t’avoir déjà parlé de mon contremaître Jacques Garaud. Il est intelligent, actif, et je trouve sa collaboration si précieuse que je vais l’associer aux bénéfices que donnera la machine à guillocher…
– Tu lui as confié le secret de ton invention ?
– Il le fallait bien. D’ailleurs je connais l’homme…
– Tant mieux. Et cette pauvre femme, cette jeune mère de famille dont le mari a été tué par une explosion ? Elle est toujours employée dans ton usine, je suppose ?
– Je suis obligé de me séparer d’elle.
– Tu la renvoies ! fit Mme Bertin avec surprise.
– Bien malgré moi… J’y suis forcé.
– Je comprends mal cela. La mort de son mari, tué à ton service, t’a créé vis-à-vis d’elle des devoirs impérieux.
– Je connais ces devoirs et ne compte point m’y soustraire. Jeanne Fortier est une brave et honnête créature, mais elle n’a pas ce qu’il faut pour remplir un emploi de surveillance, où l’énergie d’un homme est indispensable.
– Tu aurais dû y penser avant de l’employer.
– Elle a manqué et laissé manquer aux règlements de la maison, cela est d’un mauvais exemple et ne peut être toléré.
– Enfin, que va devenir cette pauvre créature ?
– C’est au point de vue de son avenir que je voulais te parler d’elle… Depuis longtemps, j’insiste auprès de toi pour qu’au lieu d’une femme de ménage tu prennes une domestique à demeure ; tu m’as toujours refusé.
– Je me trouve servie d’une façon très suffisante.





























