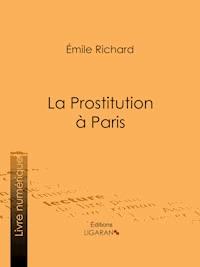
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "Chaque année, à l'occasion de la discussion du budget de la Préfecture de police, le Conseil municipal s'est prononcé sur l'impérieuse nécessité de modifier radicalement les moyens employés pour pallier, dans la mesure du possible, aux désastreuses conséquences du développement de la prostitution à Paris."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’étude de la réglementation actuelle de la prostitution à Paris et des réformes qu’il convient d’y apporter, en se plaçant sur le terrain de l’hygiène publique, m’a été confiée en 1886 par mes collègues du Conseil municipal.
La commission sanitaire, en même temps qu’elle me nommait son rapporteur, décidait qu’elle procéderait à une enquête sur place au Dispensaire de la Préfecture de police, à la prison de Saint-Lazare et aux hôpitaux de Lourcine et du Midi.
Après quatre années consacrées à un examen approfondi de cette question, j’ai eu l’honneur de présenter au Conseil municipal, au nom de la commission sanitaire un rapport sur la réorganisation du service sanitaire relatif à la prostitution.
Ce rapport déposé le 18 mars dernier forme la base du travail que je présente aujourd’hui au public.
Examiner au point de vue de la santé publique quelles sont les conséquences de la réglementation actuelle de la prostitution et de l’organisation présente du service des Mœurs ;
Rechercher quelles réformes pourraient être apportées à cet état de choses, en s’inspirant des principes de liberté et d’humanité, trop souvent méconnus par une administration, plus soucieuse de donner satisfaction aux préjugés courants, que de garantir les véritables intérêts de l’hygiène matérielle et morale de la population parisienne ;
Proposer un ensemble de résolutions pratiques servant de sanction aux longues et remarquables études auxquelles, depuis une douzaine d’années, le Conseil municipal a procédé sur cette question de la prostitution, qui préoccupe à un si légitime degré la population parisienne.
C’est de ces idées que j’ai cherché à m’inspirer dans ce travail.
ÉMILE RICHARD.
Avril 1890.
Chaque année, à l’occasion de la discussion du budget de la Préfecture de police, le Conseil municipal s’est prononcé sur l’impérieuse nécessité de modifier radicalement les moyens employés pour pallier, dans la mesure du possible, aux désastreuses conséquences du développement de la prostitution à Paris.
Ces moyens sont de deux ordres : moyens administratifs ; moyens médicaux et hygiéniques.
Je ne m’occuperai des premiers qu’autant qu’ils m’apparaîtraient, sinon comme des dangers, au moins comme de très insuffisantes garanties pour la santé publique. Les inconvénients qu’ils présentent à d’autres points de vue, à celui de la liberté des personnes par exemple, n’ont pas à faire l’objet de cette étude. Ils ont d’ailleurs été maintes fois exposés, de la façon la plus complète, particulièrement par M. Sigismond Lacroix et M. Yves Guyot.
Non pas que j’estime que l’autorité publique doive rester absolument désarmée en face d’un péril hygiénique et social aussi réel, que celui qui résulte de l’exercice quotidien d’une profession insalubre entre toutes. Je pense au contraire que la liberté absolue de la prostitution, telle qu’elle a été réclamée par quelques publicistes dupes d’une trop généreuse illusion, offrirait des inconvénients tels, que ceux-là même qui en auraient été les promoteurs ne tarderaient pas à réclamer le retour à une réglementation d’autant plus excessive, qu’on aurait été plus loin dans la voie contraire.
Mais les pouvoirs que je réclamerai pour l’autorité municipale, qui à mon avis doit avoir la charge exclusive de tout ce qui concerne l’hygiène publique, j’entends qu’elle les tienne, non d’une extension abusive d’antiques édits, et d’ordonnances depuis longtemps implicitement abrogées, mais de textes de lois, nets, précis, n’offrant aucune prise à l’arbitraire ni à l’équivoque, et devenant aussi bien une garantie pour les malheureuses que la misère ou le manque d’éducation ont jetées sur le pavé, que pour la société elle-même.
Ces mesures devraient d’ailleurs, dans ma pensée, s’appliquer non seulement aux prostituées susceptibles de devenir les instruments de diffusion de maladies contagieuses, mais n’être qu’une partie de cette législation générale d’hygiène, que la science moderne réclame, et qui comporte aussi bien les précautions obligatoires à imposer aux personnes, que les dispositions à prendre à l’égard des immeubles ou des usines qui constituent des centres de diffusion de germes infectieux.
Les moyens hygiéniques et médicaux, seront étudiés aussi complètement que possible dans ce travail.
Parmi ces moyens, j’indiquerai, en me réservant d’en apprécier ultérieurement la valeur respective, les visites sanitaires imposées aux prostituées, l’ouverture de dispensaires gratuits où les médicaments internes et externes seraient gratuitement distribués, la création de nouveaux hôpitaux spéciaux ou l’ouverture de services spéciaux aux maladies vénériennes dans les hôpitaux généraux, la substitution de l’internement dans un hospice à l’emprisonnement, l’obligation pour les sociétés mutuelles, les grandes compagnies d’accorder aux vénériens les secours médicaux et pharmaceutiques qui leur sont actuellement refusés par les règlements, enfin l’assimilation des mineures débauchées aux enfants moralement abandonnés.
Des propositions portant sur chacun de ces points ont été à maintes reprises faites au Conseil municipal. Je les examinerai successivement, à mesure que le cours de cette étude m’y amènera.
Mais, avant d’aborder ce sujet, il me paraît logique de rechercher tout d’abord quelle est réellement, pour la santé publique à Paris, l’étendue du danger que peut lui faire courir la diffusion des maladies vénériennes et spécialement de la syphilis.
Les éléments d’une statistique, même approximative, des affections connues sous le nom générique de « maladies vénériennes » offrent de telles difficultés à être réunis, qu’on peut considérer comme presque impossible son établissement. Les seuls renseignements exacts qu’on puisse obtenir sont : le nombre des malades traités dans les hôpitaux spéciaux de Paris, et celui des consultations externes dans les mêmes établissements, auxquels on peut ajouter le chiffre des filles reconnues malades et envoyées en traitement, à l’infirmerie de Saint-Lazare, par le Dispensaire de salubrité.
Pour les autres hôpitaux généraux, bien qu’un certain nombre de vénériens y soient admis chaque année, ce n’est qu’à titre de pure tolérance, et le plus souvent la nature de l’affection dont ils sont atteints n’est même pas indiquée sur les feuilles de statistique adressées à l’Administration. M. le docteur Bourneville en a donné la raison à la Commission spéciale de la police des mœurs : l’Administration refuse tout secours aux malades, à leur sortie de l’hôpital, s’il est constaté sur leurs pancartes qu’ils sont atteints de maladies vénériennes. Le fait n’a pas été contesté et ne pouvait l’être. De là, l’obligation pour les internes qui, obéissant à un sentiment d’humanité ou au désir de conserver dans leur service des sujets d’étude intéressants, de remplacer sur les pancartes la mention de l’affection dont sont atteints les malades par une désignation inexacte.
La même incertitude règne quant aux consultations externes des hôpitaux généraux, où cependant se rendent chaque année un nombre considérable de vénériens, sur lequel les statistiques hospitalières sont muettes.
Mais ces causes d’ignorance ne sont rien à côté de celles qui résultent des préjugés encore dominants dans une grande partie de la population, en ce qui concerne les affections vénériennes. Nulle part les dissimulations ne sont aussi fréquentes. Beaucoup de gens n’osent même pas, lorsqu’ils en sont atteints, s’adresser à leur médecin habituel et vont réclamer les soins, soit d’un spécialiste plus ou moins autorisé, soit de pharmaciens qui ne craignent point d’assumer la responsabilité d’un traitement tout à fait empirique, et le plus souvent illusoire, de maladies qui peuvent avoir les plus graves conséquences dans l’avenir.
Comment, dans de semblables conditions, espérer obtenir le chiffre, même très relatif, du nombre des vénériens traités à domicile ? Il serait téméraire de l’essayer et si plus loin je mentionne, sur quelques-uns de ces points obscurs, l’opinion émise par certains auteurs, ce ne sera évidemment qu’à titre de simples probabilités.
Mais si la statistique est impuissante à fournir un résultat, quant au chiffre absolu des vénériens, il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit des mouvements d’augmentation ou de diminution qui peuvent se produire dans leur nombre.
Or, c’est justement là ce qu’il importe de rechercher et de connaître. Et ici j’ai des éléments plus que suffisants d’information, et dans les travaux des éminents praticiens qui se sont occupés de cette grave question, et dans les statistiques fournies par l’administration de l’Assistance publique.
Il est en effet hors de conteste que si la clientèle des hôpitaux spéciaux – Midi, Lourcine, Saint-Louis – où viennent affluer les vénériens, augmente ou diminue, non seulement pendant une année, mais pendant une période plus ou moins longue, on peut logiquement en conclure que cette diminution ou cette augmentation correspond à un mouvement semblable dans la totalité de la population vénérienne de Paris.
D’autant que, dans les observations auxquelles j’aurai par la suite à me reporter, la base de comparaison est, non seulement le nombre des malades entrés et traités dans ces hôpitaux, nombre nécessairement limité à celui des lits, et par conséquent peu susceptible de variations d’une certaine amplitude, mais surtout celui des consultations externes. C’est ce qu’a fait très justement remarquer, dans une de ses leçons, M. le Dr Charles Mauriac :
« On m’objectera peut-être, écrit-il, que le chiffre des consultations dans un hôpital ne peut pas donner la mesure exacte de la diminution ou de l’augmentation des maladies ; qu’il y a d’autres éléments dont il faudrait tenir compte. Sans doute que si on pouvait supputer aussi la clientèle civile, on aurait une base plus large de statistique, et par conséquent des résultats plus probants. Mais ces résultats resteraient toujours les mêmes, et ne seraient certainement pas modifiés dans une grande mesure. Est-ce que quand les hôpitaux affectés aux maladies communes regorgent de malades, il n’y en a pas également un grand nombre dans la pratique civile ? D’un autre côté, si on vous disait : Dans tel hôpital ou dans tous les hôpitaux de Paris, le nombre des consultants, depuis cinq ans, a plus que doublé, et cette augmentation, loin de diminuer, s’accroît tous les ans, qu’en concluriez-vous ? C’est que l’état sanitaire d’une partie ou de la totalité de la ville est devenu mauvais, qu’il a été vicié d’une façon permanente, et qu’un pareil état de choses n’est pas resté confiné dans une classe restreinte de la population, mais s’est généralisé et a étendu son action partout, de bas en haut, sur tout le monde, peut-être à des degrés inégaux, mais assez cependant pour qu’on puisse dire : toute la ville est devenue malsaine. »
Si l’on ajoute que les chiffres que j’ai pu recueillir concernent non seulement l’hôpital du Midi, mais aussi également Lourcine et Saint-Louis, c’est-à-dire l’ensemble des établissements hospitaliers, où sont régulièrement admis les vénériens, on conviendra que la base de statistique ainsi constituée est suffisamment large pour donner une mesure très rapprochée d’une absolue exactitude des mouvements des affections vénériennes à Paris.
D’autant, qu’en ce qui touche plus spécialement l’objet de ce rapport, c’est-à-dire la relation entre le régime actuel de la prostitution et la diffusion de ces affections, il convient de remarquer que les malades qui sont admis soit aux consultations, soit dans les salles de ces trois hôpitaux, appartiennent justement aux couches sociales parmi lesquelles la prostitution exerce au plus haut degré ses désastreux effets. La clientèle habituelle des filles réellement dangereuses au point de vue sanitaire se compose en effet pour la presque totalité – abstraction faite des militaires – d’ouvriers, de commis, de petits employés, d’individus jeunes et de modeste condition, qui, n’ayant pas les moyens de s’adresser aux maîtres de la science lorsqu’ils sont atteints de maladies spéciales, viennent leur demander leurs soins dans les établissements hospitaliers où ils les dispensent gratuitement au public.
Les observations recueillies dans ces hôpitaux ont donc une autorité considérable, et ont été le premier objet de nos études.
De 1872 à 1888, le nombre des malades atteints d’affections vénériennes (syphilis, chancres simples, blennorrhagie) entrés dans les trois hôpitaux du Midi, de Lourcine et de Saint-Louis, a été de 118 233, se divisant comme suit :
Syphylitiques : 60 438.
Autres vénériens : 57 795, soit une moyenne annuelle de 3 555 syphilitiques et de 3 399 autres vénériens.
Durant la même période, le nombre des consultations externes à l’hôpital du Midi s’est élevé à 440 658, soit une moyenne annuelle de 25 921.
À l’hôpital de Lourcine, le nombre des consultations externes a été de 54 973, soit une moyenne annuelle de 3 233.
Pour l’hôpital Saint-Louis, le chiffre des consultations externes donné par l’Administration est un chiffre global qui comprend des affections de toute nature. Cet établissement est en effet un hôpital général, dont certains services sont spécialement affectés aux maladies de la peau, et d’autres aux affections vénériennes. Néanmoins, des renseignements particuliers que j’ai pu recueillir, il résulte que la moyenne annuelle des consultations externes données à des vénériens dans cet hôpital est de 20 000 au minimum.
Le chiffre moyen des admissions de vénériens dans les trois hôpitaux de Paris, où ils sont régulièrement admis, est donc, pour une période de 17 années, de 6 954 et le chiffre des consultations externes données aux malades de cette catégorie, de 49 154, ce qui, à raison de trois consultations par malade, proportion généralement admise par les médecins de ces hôpitaux, représente 16 385 vénériens, soit au total 23 339 ou en chiffre rond 23 000.
Mais il s’en faut que nous ayons là le nombre total des vénériens qui viennent demander des soins aux médecins de nos hôpitaux. Si, comme je l’ai dit déjà, ils ne peuvent guère s’introduire que par une tacite complicité dans les hôpitaux généraux, si, comme l’affirme M. Peyron, ils n’y sont admis « que dans une proportion relativement minime, et le plus souvent parce que ces malades sont en même temps atteints d’une autre affection », il n’en résulte pas moins qu’il y a en permanence une centaine de syphilitiques répartis dans les salles de ces établissements. C’était du moins le chiffre donné, en 1883, à la Commission spéciale de la police des mœurs, par M. Brelet, secrétaire général de l’Assistance publique.
Or, la durée du séjour des syphilitiques à l’hôpital n’excédant guère deux mois, c’est donc environ 600 vénériens qu’il convient d’ajouter au total qui précède. Et encore n’est-il pas question ici des malades, atteints de blennorrhagie compliquée, d’orchites simples ou doubles, d’ulcérations du col, de métrites, de vaginites, etc., que nous avons tous bien souvent rencontrés dans les services des hôpitaux généraux.
Viennent ensuite les consultations externes des mêmes établissements. Là, tous les malades indistinctement sont admis, examinés, et reçoivent les mêmes soins. Le docteur Léon Le Fort, qui s’est beaucoup occupé de ces questions, a calculé que, sur le nombre total des malades secourus chaque année dans les hôpitaux généraux de Paris, 3. 3 pour 100 sont atteints de maladies vénériennes et il en évalue le nombre à environ 14 000.
Il faut encore ajouter à ces chiffres celui des malades envoyés par le Dispensaire de salubrité à Saint-Lazare. Pour les dix dernières années (1879-1888), le nombre des filles soumises ou insoumises reconnues atteintes de maladies contagieuses et dirigées sur l’infirmerie de cette prison a été de 15 939, soit par an 1 594.
Reste la clientèle de ville, celle qui, suivant ses moyens de fortune, s’adresse, soit à des hommes de l’art, instruits et expérimentés, soit, en bien plus grand nombre, aux pharmaciens ou aux spécialistes de bas étage, dont les réclames remplissent les colonnes des journaux, envahissent les murs de la ville, sollicitant partout, par l’attrait menteur du bon marché ou de la commodité des heures de consultations, les jeunes gens qui cachent, comme une flétrissure, une maladie que le préjugé public stigmatise encore trop souvent de l’épithète de « honteuse ». De ceux-la, il est matériellement et radicalement impossible de connaître le nombre. Mais il est évidemment considérable, si l’on en juge par le chiffre d’industriels qui vivent de l’exploitation des affections vénériennes. D’après Lecour, on peut considérer que le chiffre des vénériens admis aux hôpitaux ne représente guère que le cinquième environ de ceux qui sont traités à domicile par les médecins ou bien qui s’adressent à des pharmaciens ou à des empiriques. On arriverait ainsi à un nombre annuel de 47 500.
Ce chiffre, obtenu empiriquement, est très probablement au-dessous de la vérité.
En tout cas, si on l’ajoute aux nombres ci-dessus donnés, des malades secourus dans les hôpitaux, on arrive à un total de vénériens qui dépasse 85 000.
On voit que l’étendue du mal est assez grande pour qu’on s’y arrête et qu’on prenne des mesures pour l’enrayer, d’autant plus que, loin de diminuer depuis quinze ans, il s’est au contraire accru dans une proportion considérable.
En 1875, dans la troisième de ses belles leçons de l’hôpital du Midi, M. le docteur Charles Mauriac concluait ainsi :
« Le nombre des maladies vénériennes dans la ville de Paris a considérablement diminué depuis 1870-1871. Après avoir atteint son minimum en 1871, il s’est relevé en 1872, pour suivre depuis cette époque une progression toujours décroissante. »
Cette diminution n’a malheureusement pas continué bien longtemps. Dès 1876-1877 un mouvement en sens inverse s’est produit, et l’atténuation constatée par M. Charles Mauriac a bien vite cédé la place à une augmentation continue des entrées de vénériens dans les hôpitaux spéciaux, et surtout à un accroissement véritablement inquiétant du nombre des consultants.
Cette augmentation a atteint son plus haut point en 1882. À partir de 1883, une période de décroissance sensible a pu être observée. Elle a continué jusqu’en 1887. L’année 1888 semble être la première d’une nouvelle période croissante.
Les deux tableaux suivants, dressés sur les renseignements statistiques fournis par le service de l’Assistance publique, le démontrent surabondamment :
A.– Nombre des entrées dans les hôpitaux du Midi, de Lourcine et de Saint-Louis (1872 à 1888 inclus).
S. Syphilitiques. – A.V. Autres vénériens.
B.– Consultations externes dans les hôpitaux du Midi, de Lourcine et de Saint-Louis (1872 à 1888 inclus).
Si l’on consulte le tableau A, on voit que le nombre des vénériens, entrés dans les trois hôpitaux du Midi, de Lourcine et de Saint-Louis, qui avait diminué de 8,16 pour 100 de 1872 à 1876, a augmenté de 49,34 pour 100 de 1877 à 1882, pour s’abaisser de nouveau de 12,82 p. 100 de 1883 à 1887.
Le tableau B montre les oscillations des consultations externes dans les mêmes hôpitaux. Mais ici, il convient d’établir les comparaisons par hôpital, car, pour les raisons que nous avons précédemment indiquées, les consultations de l’hôpital Saint-Louis, mentionnées seulement pour montrer l’identité du mouvement d’augmentation dans les trois hôpitaux, ne sauraient servir de base à un calcul quelque peu précis, toutes les affections générales ou locales y étant inscrites en bloc. Au Midi et à Lourcine, nous n’avons, au contraire, affaire qu’à des vénériens.
Or, dans le premier de ces hôpitaux, je constate qu’à une diminution de 22,03 pour 100 pendant la première période (1872-1876), succède une augmentation de 125,04 pour 100 pour la seconde (1877-1882), suivie d’une diminution de 39,02 pour 100 pendant la troisième (1883-1887).
À Lourcine les mouvements sont les suivants : diminution de 21,24 pour 100 de 1872 à 1876 ; augmentation de 238,73 pour 100 de 1877 à 1882 ; diminution de 26,38 pour 100 de 1883 à 1887.
L’accroissement constaté pour l’hôpital Saint-Louis, qui, suivant tous les renseignements que j’ai pu recueillir, a porté presque exclusivement sur les maladies vénériennes, correspond à une augmentation d’au moins 6 000 consultants de 1876 à 1882.
En présence de tels résultats constatés pour les mêmes périodes d’années, dans les trois hôpitaux où sont secourus les vénériens, il n’est pas possible de nier la réalité de ces oscillations, dont nous aurons plus tard à rechercher les causes probables.
Il m’est donc, dès à présent, permis d’affirmer, à la suite des syphyliographes les plus éminents, et particulièrement de MM. Mauriac, Martineau, Alfred Fournier, qu’à une diminution sensible, mais très limitée en somme, de la contagion vénérienne dans Paris, a succédé pendant six ans une augmentation énorme, qui s’est atténuée pendant les cinq années suivantes, et que le nombre des vénériens qui s’était accru dans une proportion considérable, reste encore beaucoup au-dessus de ce qu’il était il y a treize ans.
Il reste à examiner dans quelle proportion se sont accrues chacune des trois espèces comprises sous le nom commun de maladies vénériennes : la syphilis, la blennorrhagie et le chancre simple.
1° SYPHILIS.– Si l’on s’en rapportait uniquement aux indications fournies par le tableau A (malades traités dans les hôpitaux), on en conclurait que le nombre des individus atteints de syphilis, n’a varié que dans une proportion très restreinte pendant la période 1876-1882. La comparaison entre les admissions à l’hôpital du Midi pendant les quatre années 1872-1875, qui constituent la première période de décroissance, et les quatre années 1878-1881, qui ont fourni les chiffres les plus élevés de la période croissante, donnent en effet un excédent annuel de 42 cas seulement pour la seconde sur la première, c’est-à-dire une quantité presque négligeable. À Lourcine, la proportion est sensiblement plus considérable. La comparaison des deux périodes nous donne un excédent de 135 cas par année, chiffre notable, surtout si on le compare à celui des lits de cet établissement.
Mais le nombre des admissions, tout en fournissant des indications qu’il convient de recueillir, est une base absolument insuffisante d’études. Les chiffres des consultations seuls sont des éléments de statistique d’une réelle importance, et malheureusement l’Assistance publique donne les chiffres en bloc, sans établir de catégories parmi les malades qui y ont été admis.
Il me faut donc m’en référer à l’autorité des médecins des hôpitaux spéciaux, qui ont été mieux que qui que ce soit à même de se rendre un compte exact des mouvements des maladies syphilitiques pendant la période d’années que nous venons d’examiner.
M. le docteur Charles Mauriac a très soigneusement noté les observations de la presque totalité des malades qui se sont présentés à sa consultation en 1879 et 1880. Pour les affections syphilitiques, il donne les chiffres de 1 641 pour 1879 et de 1 727 pour 1880. L’augmentation est à peu près la même que pour les admissions. Martineau a fait des remarques semblables à Lourcine, et il déclare que le nombre des syphilitiques s’est sensiblement accru de 1877 à 1881, mais sans donner de chiffres. M. le docteur Léon Colin, médecin inspecteur général des armées, arrive aux mêmes conclusions à la suite d’observations prises dans les hôpitaux militaires.
Un autre document intéressant à consulter, à ce point de vue spécial, c’est le tableau suivant, établi grâce aux travaux du service de Statistique municipale de Paris, tableau qui donne le chiffre des morts de syphilis de 1872 à 1888 :
C.– Nombre des décès de syphilis par âges (1872-1888).
Ici encore, j’ai évidemment des chiffres bien au-dessous de la vérité, l’indication des causes de décès résultant des déclarations recueillies soit des familles, soit des médecins de l’état-civil. Mais le mouvement qu’ils indiquent est identique à celui donné par les précédents tableaux. On voit, en effet, le nombre des décès, qui était resté presque constant de 1872 à 1876 (124, minimum ; 148, maximum), s’élever rapidement à partir de 1877 pour doubler presque (285) en 1882 et 1883. C’est au moins une coïncidence remarquable.
Néanmoins, je me donnerai garde de tirer de ces renseignements des conclusions trop absolues. Leur manque de précision me commande une extrême réserve. Mais il m’est au moins permis d’affirmer que si la syphilis n’a pas fait de progrès inquiétants, elle ne recule pas, quelques mesures qu’aient prises jusqu’à présent les administrations parisiennes pour en diminuer la diffusion.
Il y a là une situation qui mérite d’attirer toute l’attention des hygiénistes et des sociologistes, car la gravité de cette maladie n’est plus à démontrer. Si, depuis une vingtaine d’années, grâce aux travaux des Ricord, des Lancereaux, des Mauriac, des Fournier, elle n’inspire plus l’épouvante qu’elle causait jadis ; si, pendant sa première explosion, elle n’est pas sortie des formes moyennes comme intensité, elle n’en entraîne pas moins les conséquences les plus funestes.
Personne ne contestera, en effet, qu’elle ne soit une des causes les plus fréquentes de cette dépopulation qui préoccupe si justement tous les esprits soucieux de l’avenir de notre pays. Il me suffira de rappeler que Kanowitz affirme « qu’un tiers de tous les enfants nés de parents syphilitiques meurt avant la naissance, et que, parmi ceux qui naissent vivants, 34 % meurent dans les six premiers mois de l’existence. »
M. le docteur Armand Després, qui a fait une étude très complète et très remarquable de cette question, arrive à des conclusions identiques : « On peut arriver approximativement, dit-il, au chiffre de 2 % pour les mort-nés du fait de la syphilis des parents, ou, si l’on préfère, le quart de la totalité des mort-nés. Cela fait un chiffre relativement considérable, 12 000 par an ».
La statistique suivante des syphilitiques admises de 1880 à 1885 dans les services d’accouchement, et des enfants nouveau-nés atteints d’accidents syphilitiques morts à l’hôpital, statistique établie par l’administration de l’Assistance publique sur la demande de la Commission sanitaire, confirme les citations qui précèdent :
Dans un remarquable travail lu à l’Académie de médecine, en mars 1885, M. le docteur Alfred Fournier a du reste montré de la façon la plus saisissante le rôle de la syphilis comme facteur de la dépopulation. Il a établi que, quand un homme syphilitique contracte mariage, il y a beaucoup de chances pour que de ce mariage ne résultent que des avortements ou des enfants mort-nés 200 cas de mariages entre pères syphilitiques et mères saines, observés dans la clientèle de M. Fournier, lui ont fourni 403 grossesses, sur lesquelles 288 enfants survivants contre 115 enfants morts (avortements, mort-nés ou morts dans le premier mois) ; soit 28 morts sur 100, ou plus d’un mort sur 4 naissances.
Les chiffres sont bien plus fâcheux encore dans le cas d’une mère ou d’un couple syphilitique, 44 femmes devenues enceintes au cours d’une syphilis récente, transmise par l’enfant et par l’époux (clientèle privée), ont fourni 44 grossesses ; dans 43 cas, l’enfant est mort : 27 avortements, 6 mort-nés, 8 décès de 1 heure à 15 jours, 2 décès de 45 jours à 7 mois ; un seul enfant a survécu.
Quand la syphilis est moins récente, la mortalité est moindre, mais encore énorme : 100 femmes syphilisées par leurs maris (clientèle privée) ont eu 208 grossesses ; il y a eu 148 enfants morts, soit une mortalité de 71 %.
À l’hôpital, la mortalité est plus grande encore. À Lourcine, M. Alfred Fournier a trouvé, sur 100 grossesses chez de femmes syphilitiques, 86 enfants morts ; à Saint-Louis, 84 sur 100.
En relevant dans un grand nombre d’auteurs tous les faits analogues, cette statistique de tout le monde a donné 491 grossesses avec 109 enfants vivants contre 382 morts, soit 77 enfants morts sur 100. La moyenne des statistiques qui précèdent donne 68 enfants morts sur 100 dans les familles syphilitiques.
« La syphilis, conclut M. Fournier, prend donc une part imposante, considérable, dans la mortalité de l’enfance, et conséquemment elle a sa place parmi les facteurs de la dépopulation.
2° BLENNORRHAGIE ET CHANCRE SIMPLE.– Si l’augmentation de la syphilis de 1876 à 1882 a été relativement faible, il en est tout autrement de celle des deux autres espèces vénériennes. Les moyennes annuelles ont été à l’hôpital du Midi :
Soit une augmentation de 1, 147 cas, ou 52 p. 100. À Lourcine, les moyennes pour les mêmes périodes ont été respectivement de 240, 552 et 355.
La blennorrhagie a été en progression constante depuis 1876. Or cette affection, qui représente à peu près la moitié du nombre des maladies vénériennes secourues dans nos hôpitaux, ne saurait être considérée comme aussi bénigne qu’on le pense communément. Elle peut avoir des suites très sérieuses pour les malades qui n’ont subi qu’un traitement insuffisant, ou même ne se sont pas soignés du tout, ce qui est très fréquent parmi les classes peu instruites de la société. « Les affections blennhorragiques, dit Mauriac, doivent être rangées parmi les plus délicates et les plus difficiles à guérir.
Comme la syphilis, bien qu’à un moindre degré, elles ont leur action funeste sur la fécondité des unions. « Sans entrer dans de grands détails, écrit le docteur Després, nous disons avec Hunter et Ricord qu’une blennorrhagie compliquée d’orchite double rend l’homme presque irrémédiablement stérile ; que la blennorrhagie propagée au col de l’utérus et à la cavité utérine, rend la femme irrémédiablement stérile. »
Ajoutons que, contrairement aux deux autres espèces vénériennes, la blennorrhagie ne tend nullement à diminuer depuis 1882, mais augmente au contraire chaque année. Les deux tableaux suivants le démontrent :
Blennorrhagies simples traitées dans les hôpitaux.
Blennorrhagies compliquées d’orchite.
Il convient de remarquer que le nombre des blennorrhagiques qui sont admis dans les hôpitaux est excessivement faible, par rapport à celui des malades atteints de ces affections qui sont soignés aux consultations externes de ces établissements et surtout en ville.
L’augmentation du chancre simple est encore plus marquée. Cette espèce est celle qui, depuis quinze ans, a présenté les fluctuations les plus considérables et les plus singulières. En 1874-1875, le chancre simple était moins fréquent que le chancre syphilitique, et ne représentait plus que la vingtième partie du nombre total des maladies vénériennes. Depuis cette époque, il a reparu chaque année en nombre plus considérable dans les salles et aux consultations des hôpitaux spéciaux. En 1876, le rapport entre le chancre syphilitique et le chancre mou était de 5,5 à 1. En 1877, il était de 2,33 à 1. En 1878 de 2,7 à 1. En 1879, la proportion se renverse. Le chancre simple devient plus fréquent que le chancre syphilitique. Elle s’accroît encore en 1880, où il forme le dixième environ des maladies vénériennes.
Ajoutons que, malgré ce rapide accroissement en nombre, le chancre simple ne s’est pas aggravé, et que les statistiques de ces dernières années montrent une diminution notable de cette forme vénérienne, qui est d’ailleurs, de l’avis de tous les auteurs, celle qui cède le plus facilement aux mesures d’hygiène générale.
L’étude, très sommaire, à laquelle je me suis livré, quant au nombre et aux mouvements des affections vénériennes à Paris pendant les dix-sept dernières années, suffira, je n’en doute pas, à appeler l’attention sur la nécessité de rechercher, et de trouver, sinon le remède, du moins un palliatif énergique à une situation qui ne laisse pas que d’être très grave, au point de vue de la conservation de la santé publique et de l’accroissement de la population de notre pays.
Le premier point à élucider maintenant, c’est la relation qui peut exister entre ces oscillations des maladies vénériennes, et les changements qui ont pu survenir, soit dans le régime administratif, soit dans toute autre cause d’accroissement ou de diminution de la population à Paris. C’est cette recherche qui fait l’objet du chapitre suivant.





























