
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Third Editions
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
La Saga Red Dead. Vengeance, Honneur et Rédemption permet de comprendre en plusieurs temps le phénomène généré par cette saga de western. Aujourd'hui, elle inspire même certains réalisateurs et scénaristes de films ou de séries, à l'image de Westworld (HBO). Le livre revient sur les coulisses du développement en parallèle de celui du mastodonte GTA, qui a su mettre en place des techniques innovantes pour concevoir des mondes ouverts au réalisme troublant. S'ensuit un décryptage de son scénario et de sa narration, au regard de son pendant cinématographique, et une analyse de ses nombreux thèmes, depuis la moralité variable à l'époque de la conquête de l'Ouest aux piliers du genre western. Le chapitre sur les mondes ouverts permet quant à lui de comprendre en quoi Red Dead est une saga qui se situe bien au-dessus de la mêlée, grâce à une expérience de jeu grandiose, et d'en expliquer l'emprise qu'elle a sur les joueurs. La dernière partie s'applique à décortiquer les rapports entre les personnages, qui font le lien entre les nécessités du gameplay et celles du scénario, pour enfin expliquer en quoi la saga est peut-être une évolution du western que seul le jeu vidéo pouvait offrir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 642
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À Patrick Mariault, mon oncle, parti pendant la finalisation de cet ouvrage. « Blessed are the meek, for they
« Shérif, puis-je vous présenter un bel exemple de gens sophistiqués : “Turkey Creek” Jack Johnson et “Texas Jack” Vermillion. »1
– Doc Holliday, Tombstone
1. « Sheriff, allow me to present a pair of fellow sophisticates : “Turkey Creek” Jack Johnson and “Texas Jack” Vermillion. »
LA SAGA RED DEAD VENGEANCE, HONNEUR ET RÉDEMPTION
PRÉFACE
LA NOTION de frontière est devenue un pan incontournable de notre culture à compter du jour où James Fenimore Cooper a publié sa série de romans Histoires de Bas-de-Cuir1. Elle parvient à cristalliser cet esprit d’aventure que nous tous, êtres humains, avons au plus profond de nous. Lorsque Buffalo Bill et ses premiers spectacles itinérants à propos de l’Ouest Sauvage ont présenté publiquement le souffle épique de ces terres magiques au monde entier, toutes les imaginations se sont enflammées, tous les instincts de conquête de l’indomptable se sont embrasés. Romans, fictions et essais, films, séries télévisées, publicités, pièces de théâtre, spectacles, festivals et reconstitutions, sports de tir monté… Chacune de ces œuvres et attractions a, à sa façon, continué d’alimenter le souffle épique du Far West.
Aujourd’hui, c’est au tour de la saga Red Dead de faire entrer le western dans un nouveau médium : celui du jeu vidéo. Désormais, le joueur peut goûter comme jamais l’excitation et la liberté d’arpenter l’Ouest. Bien qu’il faille parvenir à saupoudrer cette précision historique si délicate d’une bonne dose de poésie, ce savant mélange inspirera le joueur à faire comme bon lui semblera face au défi de la vie et de la mort. Red Dead Redemption ravira tous ceux que les merveilles de l’Ouest sauvage passionnent et fascinent.
Le présent ouvrage de Romain Dasnoy sur cette licence s’impose telle une lecture incontournable pour quiconque est doté d’une âme aventureuse et d’un esprit indomptable.
Peter Sherayko
Peter Sherayko, alias “Texas Jack” Vermillion Caravan West Productions
Historien reconnu, acteur et auteur, Peter Sherayko est célèbre pour son travail sur des films de western tels que Tombstone (1993, George P. Cosmatos) – dans lequel il joue le rôle de “Texas Jack” Vermillion auprès de Wyatt Earp (Kurt Russell) et Doc Holliday (Val Kilmer) –, Bone Tomahawk (S. Craig Zahler, 2015) et des programmes télévisés tels que Wild West Tech, The Truth about Jesse James ou encore Deadwood, série télévisée de HBO pour laquelle il est consultant spécialisé. Sa passion pour l’histoire de l’Old West et le cinéma l’a conduit à créer Caravan West Productions afin d’aider les réalisateurs et producteurs dans leur démarche de retranscription fidèle de l’Ouest américain dans leurs œuvres. Il est également l’auteur de livres passionnants tels que Tombstone : The Guns and Gear (2010) et The Fringe of Hollywood : The Art of Making a Western (2011).
1. Cette série regroupe cinq romans historiques parus entre 1823 et 1841, narrant les aventures du chasseur blanc Natty Bumppo, dit Œil-de-Faucon ou Bas-de-Cuir (pour ne citer que ces deux pseudonymes). Le plus connu de ces ouvrages reste sans doute Le Dernier des Mohicans (1826), dont l’histoire se situe en l’an 1757.
LA SAGA RED DEAD vengeance, honneur et rÉdemption
INTRODUCTION AU SOMMET DU MONT ROCKSTAR
« Tucson, 21 mars. Ce matin au lever du jour, un agent de la Southern Pacific Railroad a trouvé le corps de Franck Stilwell, criblé de balles. Les circonstances de l’affaire sont les suivantes : Stilwell arriva dimanche afin de comparaître devant le Grand Jury pour des faits de braquage de diligence près de Bisbee en novembre dernier. La nuit dernière, le train venu des frontières de l’ouest arriva avec les restes de Morgan Earp (tué dans la nuit du samedi à Tombstone), ainsi que ses trois frères, accompagnés par Sherman McMasters, Doc Holliday et un homme connu sous le nom de Johnson, tous lourdement armés de fusils et de revolvers. Quelques minutes avant que le train ne redémarre, Stilwell et Ike Clanton (frère de William Clanton, qui a été tué à Tombstone par les Earp) arrivèrent à la gare. Ils aperçurent la fratrie Earp marchant sur la plateforme. Stilwell a été vu descendant sur les rails et partant dans la direction où son corps a été retrouvé. Quatre des hommes armés le suivirent. Au moment du départ du train, six coups de feu ont été entendus. Ils atteignirent tous le corps – quatre balles de fusil et deux charges de chevrotine. Les deux jambes furent touchées ainsi que le buste, apparemment à bout portant, comme en témoignent des traces de poudre brûlée sur le manteau et la circonférence des impacts, environ huit centimètres. »
– The Tombstone Epitaph (21 mars 1882).
Au terme d’une confrontation de plusieurs mois avec des hors-la-loi de la région de Tombstone en Arizona, l’U. S. Marshal Wyatt Earp escorte à la gare de Tucson l’un de ses frères aînés, Virgil. Ce dernier ramène le corps de son frère cadet Morgan auprès de leur famille à Colton, en Californie. Accompagné des autres membres de sa fratrie, de Jack « Turkey Creek » Johnson, de Texas Jack Vermillion et de Doc Holliday, Wyatt croise le regard des meurtriers de son frère sur le quai de la gare. S’ensuivra l’une des plus flamboyantes expéditions punitives de l’histoire moderne des États-Unis sur près d’un mois, durant lequel Earp et son « gang » d’adjoints traqueront sans relâche les membres des Cochise County Cowboys. Histoires devenues légendes, les exploits du célèbre marshal sont adaptées au cinéma pour, dès lors, ne plus cesser d’amplifier la teneur des événements tout en portant les émotions à leur paroxysme. Dans le magistral Tombstone (George P. Cosmatos, 1993), Kurt Russell, sous les traits de Wyatt Earp, les yeux injectés de sang et les tempes battant furieusement à chaque syllabe prononcée, interprète l’une des scènes les plus viscérales jamais tournées dans le cinéma américain, certes totalement fictive, mais élevant la notion de vengeance au firmament des thèmes westerniens, et même au-delà : « Les Cowboys, c’est terminé. Tu as compris ? Je vois un foulard rouge, je tue l’homme qui le porte ! Allez, cours, raclure… COURS ! Dis aux autres raclures que la LOI est en marche ! Dis-leur que JE suis en marche… et que la MORT m’accompagne, tu m’entends ? LA MORT M’ACCOMPAGNE ! »1
Malgré la stature véridique et historique des personnalités ayant œuvré lors de la « Conquête de l’Ouest »2, la réalité des faits se noie dans l’image d’Épinal qu’entretiennent la fiction et les mémoires depuis la fin de la guerre d’Indépendance des États-Unis en 1783, marquant le début de l’âge d’or de l’Old West et de la représentation qu’en feront les auteurs et dont le point culminant sera la période succédant à la guerre de Sécession en 1865. Les récits d’alors, provenant de plumes journalistiques ou romancées, exagèrent sans complexes chaque élément constituant cette époque, trouvant de l’héroïsme, de la noblesse et du courage là où il n’y en avait pas, inventant un code d’honneur dans l’agissement de bandes crapuleuses, et du romantisme à des héros souvent plus délinquants que bienfaiteurs ou à des criminels portant parfois l’insigne de la loi. Mais les récits de l’Ouest sauvage3 plaisent. Popularisées dans les dime novels, ancêtres des pulp magazines destinés à la classe populaire américaine d’alors, ces histoires mettent en scène les pionniers des contrées lointaines, les héros de la guerre civile ou encore les fermiers en proie à de terribles épreuves lors de la colonisation des terres reculées. Cette culture renvoie très tôt une image quelque peu déformée de la réalité, mais construit de ce fait la légende de l’Ouest américain, peut-être plus que l’histoire « objective » en elle-même.
En 1903, alors que Wyatt Earp ouvre un saloon à Tonopah, au Nevada, tout en acceptant une place de marshal adjoint, le cinéma américain naissant produit ce qui est considéré comme le premier film de western de l’histoire : The Great Train Robbery (Edwin S. Porter). Du haut de ses étincelantes douze minutes, et malgré le jeu maniéré des comédiens, l’œuvre fait grande impression4. Ainsi, l’une des plus grandes inventions culturelles de l’histoire de notre civilisation coïncide avec la fin de l’âge d’or de l’Old West. Et ce n’est pas un hasard si, installé en Californie depuis 1910, Earp, en vérité tout autant hors-la-loi que représentant de la loi elle-même, commence à fréquenter des tournages de films westerns avec une fonction assez peu documentée de consultant. Il se lie d’amitié avec des stars du moment, comme Tom Mix, et devient proche du jeune John Ford, grand réalisateur de westerns en devenir. Pour le film raté Wild Bill Hickok (Clifford Smith, 1923), l’acteur William S. Hart fait d’ailleurs appel à Earp, qui en profite pour essayer de redorer son blason en incluant son « personnage » dans le film. Car loin d’être le héros populaire décrit au cinéma, l’homme a une réputation, au contraire, plutôt douteuse, que les événements de Tombstone et Tucson ont accentuée. De plus, que vient faire Earp dans la vie de James Butler Hickok ? De toute évidence selon les historiens, ils ne se sont jamais rencontrés. En toute conscience de la formulation malhonnête de la démarche, même une légende avérée comme Wyatt Earp use des ficelles de la fiction pour sublimer son image. D’aucuns seront déçus de l’apprendre, mais le western n’est, en tout état de cause, « que » du cinéma !
En s’influençant mutuellement pendant trois décennies à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, marquant l’extinction de l’Old West (la civilisation l’emportant sur le monde sauvage) et l’avènement du cinéma (et ses prouesses technologiques comme vecteurs de cohésion culturelle), le western et l’histoire de l’Ouest sauvage nourriront dans le cœur et l’esprit des Américains un lien si fort, si indéfectible, qu’il est aujourd’hui difficile de discerner exactement l’univers fictif de son pendant historique. Sur la durée, en plus de cent ans de productions, le cinéma pourrait avoir dépeint plus d’événements « marquants » issus de la conquête de l’Ouest que la réalité n’en compte objectivement. Ainsi, le western ne serait pas seulement un genre, il représente, à lui seul, le cinéma dans son ensemble : une rhétorique, un style, une évocation et une inspiration, comme autant de reflets de la culture américaine5 dans une période cruciale de son développement, à peine détrôné par le film noir et celui de guerre. Il est, et restera, le seul genre majeur et authentique, celui dont découleront tous les autres au fil des décennies, des créateurs et des formats.
Cinquante-cinq ans après la disparition de Wyatt Earp, Diego Angel, un Colombien expatrié aux États-Unis, fonde une société de développement numérique, Angel Studios, basée près de la frontière mexicaine. La mondialisation fait déjà son œuvre au début des années 1990 et la structure prend plusieurs commandes émanant du Japon, travaillant ainsi avec SEGA, Nintendo et Capcom. Angel Studios finit par signer ses titres pour le compte de Rockstar Games, un éditeur du groupe Take-Two Interactive, déjà célèbre pour sa franchise de jeux de gangsters Grand Theft Auto et qui se portera acquéreur du studio pour le renommer Rockstar San Diego. Parmi les titres qui resteront à l’état de développement, l’un d’eux attire la curiosité des dirigeants de Take-Two. Ce qui deviendra Red Dead Revolver en 2004 est, à l’origine, un tactical shooter relativement classique, que son créateur, Yoshiki Okamoto, déjà auteur d’un jeu d’arcade dans l’univers de l’Ouest américain6, veut transformer en véritable expérience western. Quoi de mieux que de confier une telle création à une équipe bercée depuis l’enfance par la culture ouest-américaine ? D’une œuvre somme toute assez simple et jouant considérablement avec les stéréotypes, Rockstar Games ne s’imagine alors peut-être pas l’extraordinaire potentiel que renferme la vengeance glaciale de Red Harlow, qui dispose déjà d’un sixième sens lui permettant de maîtriser son sang-froid et de vaincre ses ennemis dans des duels à mort au rythme de ses pulsations cardiaques. Au-delà du gameplay déjà inventif, Red Dead Revolver, cumulant certes les lieux communs pour parfaire son univers, fait toutefois la part belle aux nobles thèmes westerniens, se payant même le luxe de porter les valeurs du personnage principal bien plus loin que ne l’était, par exemple, l’audacieux inconnu de Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars, Sergio Leone, 1964) – avec de faux airs de Clint Eastwood, évidemment.
La grande épopée historique souhaitée par Take-Two développe finalement ses arômes avec l’ambitieux Red Dead Redemption en 2010. L’histoire de John Marston, l’une des plus impressionnantes expéditions mémorielles pour un jeu vidéo, va bien au-delà de la simple transposition d’un genre, quand bien même ses similitudes avec des films comme 3 : 10 to Yuma (James Mangold, 2007) paraissent évidentes. En effet, il n’invente pas le concept de l’open world, mais offre, peut-être bien plus que The Elder Scrolls7 ou de nombreux MMORPG8 aux mondes persistants, la quintessence même des notions d’exploration par nécessité historique, de découverte par nécessité narrative et de contemplation par nécessité artistique. Considéré comme l’un des jeux vidéo les plus coûteux de l’histoire9, vendu à plus de quatorze millions d’exemplaires dans le monde et bénéficiant d’un monde ouvert salué par l’industrie, il propose une idéologie alternative à celle de son grand frère Grand Theft Auto, tout en gardant l’essentiel de son ADN. Et si le jeu de gangsters est entièrement conçu par son studio originel Rockstar North en Écosse, le schisme opéré par Take-Two et son univers « American Frontier » en rupture totale avec l’urbanisme chaotique de Los Angeles ne fait qu’accentuer l’opposition entre l’Ouest et l’Est, le Nouveau Monde et le Vieux Continent, en étant entièrement développé par Rockstar San Diego, studio enraciné dans la culture western10. Ainsi, plus que jamais, l’Old West reste et restera une appartenance, une idéologie, voire un patrimoine profondément ancré là où l’histoire se sera déroulée, et là où le cinéma l’aura transfiguré.
L’avènement de sa suite en 2018 est aussi celui de tous les exploits – ou presque. Vendu à quelque vingt-quatre millions d’exemplaires en moins de six mois, elle se hisse parmi les vingt jeux les plus vendus de l’Histoire11, disposant d’un monde ouvert fourmillant de détails d’un niveau de précision rarement atteint. Red Dead Redemption 2 conduit à une réflexion sur la nature de la narration historiquement linéaire au cinéma et une cohérence environnementale transcendée par un réalisme au perfectionnisme prodigieux. Mais surtout, dans la peau de John Marston ou d’Arthur Morgan, déambulant à leur guise dans les grands espaces, se livrant à des activités de pêche ou de chasse aux trésors, s’opposant aux gangs de la région ou observant la vie sauvage d’une beauté parfois étourdissante, le joueur prend enfin la mesure de la complexité de l’univers dans lequel il évolue, faisant écho à l’Old West le plus authentique qui soit. Avec l’œuvre de Rockstar, le jeu vidéo serait-il devenu l’évolution parfaite du western ? Celle où l’expérience et le libre-arbitre priment sur l’histoire, à un point tel qu’il en devient, à son tour, une inspiration majeure pour les cinéastes d’aujourd’hui12 ?
La complexité de la série Red Dead – son histoire, ses rouages, son identité –, liée à celle bien plus immense encore de la culture dans laquelle elle s’inscrit, rend difficile son décryptage au sein d’un tel ouvrage. C’est pourquoi cette démarche devait s’accompagner d’un véritable engagement dans l’univers du western et la vision portée par les développeurs. Comme un passage de témoin bien plus important que sa simple fonction symbolique de prime abord, nous sommes heureux d’ouvrir ces pages avec une préface de Peter Sherayko. Grande figure de l’Ouest américain actuel, conseiller et acteur sur des œuvres de fiction comme Tombstone, Deadwood (David Milch, 2004-2006) ou Bone Tomahawk (S. Craig Zahler, 2015), il est également un historien reconnu et travaille aussi bien pour la préservation de sa culture que pour la pérennisation des codes du western dans le cinéma d’aujourd’hui. Il nous fait l’honneur d’introduire cet hommage ambitieux à la série de Rockstar Games que nous souhaitons aussi exemplaire que complet.
Et ce voyage ne pourrait pas mieux commencer sans l’évocation lointaine de L’Homme sans nom, archétype irrévérencieux et éternel d’un genre devenu immortel : « J’ai le sentiment que ça va vraiment être une bonne et longue bataille. »13
L’auteur : Romain Dasnoy
Fondateur de Wayô Records et d’Overlook Events, spécialisé dans le cinéma et le jeu vidéo, concepteur et producteur des concerts officiels Dragon Ball, Saint Seiya, Tribute to John Williams ou encore TV Series Live, il est également à l’origine des performances scéniques en Europe de Joe Hisaishi, Danny Elfman ou encore Final Fantasy. Passionné par le rapport qu’entretiennent la narration et la musique, il conçoit lui-même ses événements musicaux, écrit dans la presse spécialisée depuis le début des années 2000 et produit la première chronique entièrement dédiée à la musique de jeu vidéo sur une grande radio nationale (France Musique). Il signe L’Histoire de Final Fantasy VI en 2017 aux Éditions Pix’n Love, Le Guide des compositeurs de musique de film en 2017 et Le Guide des séries de science-fiction en 2019 chez Ynnis Éditions, tout en écrivant des nouvelles de science-fiction publiées chez Rivière Blanche.
1. « The Cowboys are finished, you understand me ? I see a red sash, I kill the man wearin’ it ! So run, you cur… Run ! Tell all the other curs the LAW’S coming ! You tell ‘em I’M coming… and HELL’S coming with me, you hear ? HELL’S COMING WITH ME ! » (Traduction reposant sur la version française du film).
2. Période s’étendant du XVIIe siècle au XXe siècle nommée « American Frontier » dans sa langue originale, évoquant plutôt les notions géographique et historique des terres aux « confins » de la civilisation, plus que la simple idée de « conquête ».
3. À l’époque, les termes utilisés sont Wild West, Old West ou Far West. Le terme western n’apparaît que bien plus tard pour désigner le genre au cinéma.
4. Le plan final du film – un cowboy dégainant et tirant face caméra –, ainsi qu’un extrait de la fusillade dans les bois sont repris en introduction du film Tombstone de 1993.
5. Par « culture américaine », nous prenons ici son sens large historique : jusqu’au Compromis de 1850, le Mexique occupait une large place de l’ouest des États-Unis actuels ; le Texas, la Californie, l’Arizona, le Nevada, l’Utah et le Nouveau-Mexique restent, encore de nos jours, très empreints de ce mélange de cultures.
6. Gun. Smoke (ガンスモーク), Capcom, 1985.
7. Série de jeux de rôle du développeur Bethesda Softworks, souvent considérée comme l’arché-type des jeux vidéo en monde ouvert.
8. « Massively Multiplayer Online Role-Playing Game » (jeu de rôle en ligne massivement multijoueur).
9. Entre 80 et 100 millions de dollars, selon les estimations du New York Times (2010), pour plus de huit cents employés sur près de cinq ans de développement.
10. Les différents studios du groupe finiront par œuvrer main dans la main à l’orée de Grand Theft Auto V en 2013 et Red Dead Redemption 2 en 2018.
11. Sources diverses et rapport fiscal de Take-Two Interactive (mai 2019).
12. Dans une interview donnée à Wired en 2019, Jonathan Nolan explicite sa fascination pour des jeux comme Skyrim (Bethesda Softworks, 2011) et Red Dead Redemption 2, lui servant à créer l’univers de la série Westworld (HBO, 2016 – en production).
13. « I have a feeling it’s really gonna be a good, long battle. » (Clint Eastwood – Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo / Le Bon, la Brute et le Truand, Sergio Leone, 1966).
« – Dans quelle direction allez-vous, Révérend ?
– Eh bien, ce n’est pas très clair dans mon esprit.
– Vous avez trois possibilités.
– Ah bon ?
– Le nord, le sud ou l’est.
– Et qu’est-il arrivé à l’ouest ?
– Nous nous y rendons. »1
– Buck et le Pasteur (Buck and the Preacher / Buck et son complice, Sidney Poitier, 1972)
1. « — Which way are you ridin’, Preacher ?
— Well, that’s not exactly settled in my mind yet.
— Well, you got three possibilities.
— Oh ?
— North, South or East.
— What happened to West ?
— We’re going West. »
LA SAGA RED DEAD VENGEANCE, HONNEUR ET RÉDEMPTION
LA GENÈSE DE RED DEAD
DMA DESIGN
Les fondations d’un état d’esprit
Lorsque DMA Design, petit studio de développement écossais ayant connu le succès avec sa série Lemmings, sort le controversé Grand Theft Auto en 1997, l’industrie ne mesure pas encore les répercussions d’une révolution qui l’agite depuis quelques années. Certes, le jeu de gangsters est un carton plein un peu partout dans le monde, mais sa réputation sulfureuse le précède et dynamise anormalement ses ventes. À sa sortie, l’accueil réservé par la presse est toutefois singulièrement glacial. Au-delà de l’apologie du crime dont on l’accuse de façon plus ou moins arbitraire, GTA est pointé du doigt pour ses graphismes d’un autre temps, son gameplay hasardeux et limité, ainsi que la pauvreté de ses missions partageant le même mécanisme consistant à rallier deux points de la carte en suivant un indicateur visuel. En tout état de cause, il n’est qu’une version à peine améliorée d’APB2, pourtant de dix ans son aîné. Alors que la 3D devient la norme sur les ordinateurs et la génération de consoles du moment3, Grand Theft Auto détonne en effet magistralement. On l’oppose à des titres bien plus impressionnants en termes de rendu, comme Quarantine et sa suite4, offrant déjà des joutes véhiculées et armées dans des villes entièrement modélisées en trois dimensions. La liberté accordée au joueur, quant à elle, est jugée limitée, dans ce qui semble être un monde ouvert en réalité très fermé et où règne paradoxalement le sentiment de huis clos d’une cité sans issue à la Dark City5. Pour couronner le tout, des syndicats de policiers de plusieurs pays d’Europe demandent le retrait du jeu de la vente, allant jusqu’à interpeller la classe politique.
Mais la magie opère. De façon consciencieuse et sans que cela soit réellement voulu par ses développeurs, GTA transforme tous ses prétendus défauts en atouts majeurs. Ses graphismes simples rendent effectivement possible une vaste zone de jeu, donnant à la fois une impression de gigantisme, mais également une sensation de vitesse sans équivalent avec la simple idée de garder la caméra centrée sur le véhicule. Si les missions ne sont pas très variées, le fait de pouvoir changer de voiture à tout moment, alternant à cette occasion l’une des sept stations de radio aléatoires, rend l’expérience étrangement enivrante. La dimension sandbox du jeu s’installe alors de façon pernicieuse, amenant les joueurs à cumuler le plus grand nombre de piétons écrasés et à échapper le plus longtemps possible à la horde de policiers les traquant sans relâche. En grattant la surface de ce petit titre sans prétention, mais diablement malin sur le plan marketing, un univers de créativité irrévérencieux se dévoile et procure à ses joueurs un plaisir pas toujours coupable. Le mot est lâché. Grand Theft Auto est fun. Moche, mal animé et à la jouabilité sommaire, mais fun. Comme l’était Lemmings. Et en brisant les barrières de la morale dictée par ses défenseurs autoproclamés, les développeurs de DMA Design seront à l’origine du plus grand plébiscite commercial de toute l’histoire du jeu vidéo moderne.
Au milieu des années 1980, Mike Dailly, Steve Hammond, David Jones et Russell Kay, quatre copains de la ville de Dundee (Écosse), évoluent au sein d’un club de leur collège, le Kingsway Amateur Computer Club. Ses membres se passionnent pour l’informatique et le jeu vidéo, alors balbutiant. Il est permis, et même nécessaire dans de nombreux cas, de programmer soi-même le code BASIC et ses dérivés, propres à chaque constructeur. Grâce aux revues spécialisées, les plus courageux entrent patiemment des centaines, des milliers de lignes de code pour faire tourner des jeux ou démos amateurs. Il ne faut évidemment pas se tromper ! Mais la copie mène à l’apprentissage et les erreurs à la réflexion, conduisant rapidement à la création de variations, comme changer la nature d’une action ou l’affichage d’un élément. Très vite, les « enthousiastes » de cette technologie vont jusqu’à créer leurs propres jeux – en réalité, le plus souvent de simples séquences à s’échanger et qui mènent les apprentis programmeurs à rivaliser d’ingéniosité. La demoscene devient une véritable école pour les joueurs de l’époque, et certains prennent très au sérieux cette activité encore mal perçue. Alors plus âgé que les autres, David Jones travaille dans l’usine de fabrication et d’assemblage d’ordinateurs Timex Sinclair, mais en est licencié pour des raisons économiques. Qu’à cela ne tienne : avec ses indemnités, il se paie la Rolls-Royce des machines de l’époque, le flamboyant Amiga 1000, quand ses camarades n’en sont encore qu’à la génération répandue des ZX Spectrum et Commodore 64. Ensemble, ils s’émerveillent devant les nouvelles possibilités quasi infinies pour l’époque, offertes par cet hardware flambant neuf de la société Commodore et des logiciels tels que Deluxe Paint. Rapidement, le bande développe ses talents et se lance dans la programmation d’un shoot ‘em up horizontal, intitulé Menace et conçu par David Jones. Le titre s’inspire largement des nombreux jeux du genre, dont Salamander de l’éditeur Konami. Ils proposent Menace à un éditeur assez dynamique, Hewson Consultants, mais Jones décline finalement l’offre, considérant que la sortie ne serait pas en phase avec son ambition. En se tournant vers le naissant Psygnosis, il signe un accord, et le titre est publié en 1988, inaugurant ainsi la création de la société DMA Design. L’année suivante, le jeune studio accouche d’un nouveau shoot ‘em up, Bloody Money, comptabilisant deux fois plus de ventes que son prédécesseur6. Les développeurs imaginent alors un nouveau titre, Walker, mettant en scène un robot bipède inspiré de l’AT-ST de Star Wars7. Pour la conception du jeu, Mike Dailly fait des tests sur Deluxe Paint et réalise une animation de sprite humanoïde très simple, nécessitant le moins de place possible, idéalement dans un cadre de 8x8 pixels. Gary Timmons, le nouvel artiste de la maison, lui apporte son aide et ensemble ils perfectionnent l’animation en 8x10 pixels et imaginent la base du petit personnage dans des situations où il se retrouve écrasé, mâché, explosé ou encore projeté au loin. Face à ces essais hilarants, Russell Kay s’écrie alors8 : « Il y a un jeu là-dedans ! » et trouvera même un nom pour ces êtres ainsi malmenés.
À peine nés, les lemmings sont déjà de facétieuses créatures et un accord est rapidement trouvé avec Psygnosis qui trouve le concept génial. L’équipe se démène et chacun y va de son design, créant ainsi une compétition en interne pour trouver le moyen le plus amusant de résoudre les niveaux. Basé à Liverpool en Angleterre, l’éditeur participe également de son côté à la construction du jeu et de ses mécanismes en faxant ses idées et ses impressions sur les démos envoyées par DMA Design. Le principe de Lemmings est, en apparence, simple et à la portée de tous. Il s’agit de guider un groupe d’animaux bipèdes anthropomorphes qui se déplacent et agissent à l’unisson. S’il y a un ravin, tous tomberont dedans, se contentant de suivre un leader qui, lui, ignore les obstacles. Il chutera dans un précipice, sautera sur une bombe et rebroussera chemin face à un mur. Au joueur de trouver la ou l’une des formules permettant au plus grand nombre de lemmings d’atteindre la sortie sains et saufs. Pour cela, plusieurs actions offriront aux créatures le moyen de trouver leur chemin, comme creuser le sol pour atteindre une autre galerie, ouvrir un parapluie pour ralentir une chute fatale, se faire exploser pour ouvrir une brèche dans un mur, ou faire la circulation pour ordonner aux autres de partir dans la direction opposée. Évidemment, une action aura un sens, voire un double sens, et pendant qu’elle se réalisera, les autres lemmings continueront de marcher, parfois vers une mort certaine. La complexité sous-jacente du gameplay fait mouche, de même que la compréhension et la prise en main, toutes deux immédiates. Certes, Lemmings n’est pas très beau, son animation est sommaire et sa jouabilité réduite à sa plus simple formulation, mais le jeu est incroyablement… fun. Cela vous rappelle quelque chose ?
Sorti entre 1991 et 1992 sur toutes les machines de l’époque, consoles et ordinateurs confondus, le titre de DMA Design crève l’écran. À son lancement, Psygnosis enregistre 55 000 ventes en l’espace d’une seule journée, autorisant le développement de nombreuses suites à succès. Entre-temps, l’équipe produit quelques titres qui font parler d’eux, comme l’excellent Walker, avec quelques années de retard, ou encore le maussade Unirally, qui aurait pu connaître un meilleur destin si le studio Pixar n’avait pas intenté – et gagné – un procès pour plagiat9, obligeant Nintendo à retirer le jeu de la vente. La série Lemmings jouit, elle, d’un succès toujours plus franc. Mais au milieu des années 1990, l’équipe commence à craquer, et la direction décide d’arrêter le développement de sa poule aux œufs d’or. David Jones s’en explique au magazine anglais Next Generation en avril 1997 : « Après Lemmings, on avait besoin d’un break pour un certain temps. Trois années infernales. » Il est alors temps de développer de nouvelles idées et ils misent sur la 3DO de Panasonic. Jones poursuit dans la même interview : « On a probablement perdu trois mois pour ça. On a acheté le kit de développement et on a commencé à réfléchir à des jeux. Mais heureusement, Nintendo nous a approchés pour collaborer sur l’Ultra 64, comme on l’appelait à l’époque. » Cette première collaboration porte le nom de Body Harvest et met en scène un soldat pouvant voyager dans le temps, le tout rythmé par un gameplay plongé dans un monde de violence et d’action. DMA Design expérimente alors de grosses difficultés de compréhension avec le géant japonais, qui sont autant de problèmes rhétoriques – Nintendo ayant un rapport très codifié à la violence – que linguistiques. Finalement, le jeu est lâché en cours de route par le constructeur, mais sera édité par Gremlin Interactive et Midway Games, sans connaître pour autant de diffusion au Japon. Premier jeu en 3D pour les développeurs de Lemmings, Body Harvest ne convainc pas les joueurs malgré un accueil de la presse favorable. La société continue néanmoins sur sa lancée avec des jeux aux graphismes en accord avec la nouvelle génération de machines, comme Space Station Silicon Valley (1998) et Wild Metal Country (1999). Mais c’est bien un petit jeu en 2D et sans prétention de prime abord qui attirera les regards du monde entier sur le studio basé à Dundee. Grand Theft Auto sera, à bien des égards, l’un des titres les plus fondamentaux de la décennie 1990.
2. APB pour « All Points Bulletin » (Atari Games, 1987). Jeu mettant en scène une voiture de police vue de haut, devant parcourir la ville pour donner des amendes à divers contrevenants. Le titre est repris en 2010 avec APB : All Points Bulletin, par le créateur de Grand Theft Auto, David Jones, pour sa société Realtime Worlds.
3. La Saturn de SEGA et la PlayStation de Sony sortent en 1994 et leurs premiers jeux sont souvent exclusivement en 3D précalculée ou temps réel.
4. GameTek, 1994 et 1995.
5. Alex Proyas, 1998.
6. 40 000 exemplaires au total.
7. « All Terrain Scout Transport », introduit en 1980 dans The Empire Stikes Back (Irvin Kershner).
8. « There’s a game in that ! », citation provenant de http://www.javalemmings.com/DMA/DMA1_1.html
9. Le court-métrage d’animation Red’s Dream (John Lasseter, 1987) met en scène un clown et son monocycle. Le jeu de DMA Design est effectivement un parcours acrobatique en monocycle, mais il n’a rien à voir avec le film en images de synthèse.
GRAND THEFT AUTO
Vision dérangeante des États-Unis
Le développement de Grand Theft Auto débute en 1995 sous le nom de Race ‘n’ Chase, sur la base d’un projet porté par Steve Hammond. Il s’agit au départ d’incarner des bandits comme des policiers, alternant les missions dans les deux camps, mais l’équipe à la conception supprime finalement la partie dédiée aux autorités, estimant que respecter le Code de la route dans des parties de chasse n’a pas réellement de sens du point de vue du joueur. Assumer le fait de vouloir écraser des piétons ainsi que perpétrer d’autres crimes tout en gagnant des points est, pour l’époque, quelque peu révolutionnaire. L’idée originelle va même jusqu’à envisager une ville entièrement modélisée en 3D isométrique, permettant des effets de rotation modernes lors de l’exploration de celle-ci. Mais diverses raisons techniques et budgétaires conduisent le studio à revoir l’ambition du titre qui doit avant tout proposer différentes villes vastes et vivantes, posant un certain nombre de problèmes d’affichage et d’interaction. Mike Dailly imagine alors un moteur relativement simple, mais d’une efficacité redoutable : le point de vue se fera en plongée parfaite sur l’avatar – ou le véhicule le transportant – avec une caméra fixée sur le centre de l’écran, offrant un effet de perspective en mouvement, dite parallaxe, pour les immeubles. En zoomant sur le sol lors des ralentissements et dézoomant lors des accélérations, la sensation de vitesse s’en trouve décuplée et particulièrement enivrante pour le joueur. Les sprites en 2D ne souffrent d’aucun souci de perspective et sont même multipliés pour créer cette sensation de densité qui aurait été, au cœur des années 1990, difficile à reproduire dans un jeu entièrement en 3D. Avec sa volonté de proposer aux joueurs la possibilité d’un « monde ouvert », même si le terme n’est pas encore utilisé, DMA Design réalise son souhait de créer une sorte d’Elite10 dans l’urbanisme moderne.
Mais le développement du jeu se poursuit de manière empirique et l’équipe se heurte à de nombreux obstacles, que cela soit au niveau de la jouabilité ou à celui du comportement de l’intelligence artificielle, conduisant le titre presque à son annulation pure et simple. Nommé directeur créatif chez DMA Design, l’ancien journaliste Gary Penn, reconverti dans le jeu vidéo – il a notamment travaillé sur Frontier : Elite II11 – se souvient auprès de Gamasutra en 2011 : « […] Il y avait des gens de l’équipe qui essayaient constamment de corriger les choses. Le cœur du jeu était fondamentalement défectueux. La police se comportait vraiment mal, la façon dont ça fonctionnait était simplement absurde. […] Un jour, et je pense que c’était un bug, la police est soudainement devenue cinglée et agressive. Ils essayaient de nous rouler dessus. Leur routine s’est déréglée je pense, et ça a été un super moment car finalement, c’est devenu quelque chose qui fonctionnait, genre “ Mon Dieu ! La police pète un câble, ils essaient de m’écraser !” On l’a un peu peaufiné, mais on l’a laissé, car c’était super marrant. Tout à coup, le jeu est devenu plus construit et ce n’était plus ennuyeux, avec la police qui tente de vous liquider. Ils sont après vous et ils cherchent à vous éjecter hors de cette putain de route. Tout le monde disait : “ Hey ! Mais c’est super cool. On tient quelque chose, ça fonctionne !” Ce n’était pas à propos des missions, que nous avons toujours considérées comme étant un autre bazar, mais plutôt du jeu en général, le fait de rendre possible la réalisation de plein de trucs à côté. »
Grand Theft Auto gagne l’attention du monde. Polémique certes, mais se jouant avec brio des notions de gameplay, de fun, de monde ouvert et même de sandbox – concept encore balbutiant et pourtant déjà si présent dans de nombreux jeux au cœur des années 1990. Malgré un succès d’estime très éloigné des cartons de jeux Triple-A de l’époque, le titre de DMA Design agite surtout les esprits entreprenants de l’industrie vidéoludique. Il se passe quelque chose, certains l’ont désormais bien compris et ils ne lâcheront plus ce petit titre venu d’Écosse.
Lorsque GTA sort en 1997, l’industrie vidéoludique traverse une période de profonds changements. Suite à la récession économique du début des années 1990 et à la crise touchant l’Europe en 1993, le secteur du jeu vidéo peine et divise son chiffre d’affaires mondial par deux. Mais la PlayStation révolutionne le milieu, et la fin de la décennie sera propice à plusieurs bouleversements rythmés par de nombreuses acquisitions. Ainsi, DMA Design, s’étant séparé de Psygnosis lors de leur rachat par Sony en 1993 précisément pour préparer l’arrivée de la console, est intégré à Gremlin Interactive en 1997, qui sauve Body Harvest de son naufrage chez Nintendo. L’éditeur anglais s’assure alors une place de choix pour l’exploitation mondiale de Grand Theft Auto qui, coïncidence des calendriers ou non, précède de peu le rachat. Suite à leurs accords de commercialisation, Gremlin est à son tour ingurgité par le Gargantua français du secteur, Bruno Bonnell et sa société Infogrames, en 1999. Ce dernier se hisse gentiment au rang des plus grands groupes mondiaux du jeu vidéo, mais se retrouve en déficit très rapidement puis décline quelques années après12.
En parallèle, un autre géant en devenir, Take-Two Interactive, place également ses pions en acquérant le studio de développement canadien GameTek en 1997. La société flaire déjà un gros potentiel en Grand Theft Auto, qu’il distribue sur le territoire nord-américain en 1998 avec un an de retard, et réussit à se positionner pour la création des extensions des jeux London 1961 et London 1969, alors que DMA Design est occupé sur la production de la suite. Afin de renforcer leur position dominante sur le titre, l’éditeur rachète son alter ego européen, BMG Interactive, filiale d’un énorme groupe allemand qui n’a ni la fibre ni l’envie d’explorer l’univers du jeu vidéo. Rockstar Games naît ainsi d’une ambition affichée, articulant une grande partie de sa rhétorique sur la philosophie développée dans GTA, entre fun et controverse, résumant une définition assumée et libérée de ce que doit être le futur du jeu vidéo. Cette stratégie d’acquisition des développeurs aux titres-clés – et naissants –, couplée à celle de renforcer sa distribution sur les marchés eux aussi déterminants, fera des étincelles. Infogrames leur cède finalement le studio écossais quelques mois après son acquisition, pour une somme, bien qu’élevée, dérisoire au vu de la dépense initiale13. Take-Two, éditeur devenu groupe aux multiples entités partageant la dénomination « Rockstar14 », se frotte les mains : Grand Theft Auto leur appartient désormais totalement, et l’avenir leur donnera plus que raison.
Au rythme des acquisitions, la pression monte chez le développeur écossais, qui finit par se séparer des membres fondateurs Mike Dailly, Steve Hammond et Russell Kay. Depuis quelque temps, Grand Theft Auto 2 est en gestation. La suite est même très attendue par le public, en plus d’être au centre des tractations de Take-Two et de son entité flambant neuve, Rockstar Games. Cette deuxième aventure du jeu de gangsters met les petits plats dans les grands en proposant un film live de plusieurs minutes en guise de trailer promotionnel et intégré en partie dans l’introduction. Fondamentalement, le titre de DMA Design n’est guère différent de son prédécesseur, mais il offre des idées inédites installant quelques strates au gameplay global. Sept gangs se partagent ainsi la ville – deux fois plus grande que celle du premier épisode –, avec des niveaux d’interaction évoluant au fil du jeu, tout en débloquant de nouvelles zones. Au joueur de remplir ses missions au bénéfice des uns ou des autres, tout en gérant les dissensions et diverses animosités entre les mafias locales. La police possède elle-même plusieurs « wanted levels », allant jusqu’à l’intervention de l’armée. Il est possible de suivre plusieurs tâches, mais surtout d’interagir plus franchement avec l’univers, en proposant des activités annexes et en développant ainsi la dimension sandbox du titre. Certes, le jeu est toujours d’un goût graphique douteux, mais l’équipe de développement se défend en prétextant, sur leur site officiel, que leur travail porte essentiellement sur le contenu et l’expérience de jeu, et non sur l’esthétique. Avec de très bonnes ventes et l’adoubement d’une certaine catégorie de gamers, GTA 2 s’installe confortablement tout en imposant sa marque de fabrique dans le paysage vidéoludique. Mais déjà, la PlayStation 2 pointe le bout de son nez, et le passage à la 3D devient une affaire urgente – ce qui permettrait, par ailleurs, de capter un public encore plus large, avide de graphismes et de gameplay innovants et immersifs.
Au cours de l’année 2000, l’équipe de DMA Design compte plusieurs dizaines d’employés et déménage dans la capitale écossaise, Édimbourg – le dernier fondateur de la société, David Jones, quitte définitivement le navire pour créer Rage Games et Realtime Worlds. Le lancement de la production du troisième opus du jeu de gangsters se fait dans un cadre particulier, sous la direction du producteur Leslie Benzies, développeur dans la société depuis 1995 et un des grands instigateurs de la série depuis ses débuts. Le passage de la 2D à la 3D est alors un challenge aussi bien technique que scénaristique. Il confie à IGN en 2001 : « Lorsque nous avons mis à plat les idées pour Grand Theft Auto 3 en tant que DMA et Rockstar, tout a naturellement évolué à partir des premiers jeux qui avaient installé de nouveaux niveaux de liberté en termes d’interactivité et de non-linéarité. Le défi et l’objectif, avec ce titre, étaient de prendre toute la liberté et la diversité des titres 2D vus de haut, et de les amener vers un monde vivant en 3D, tout en réfléchissant pleinement aux implications qu’allait entraîner ce changement esthétique. »
En 2001, le jeu est présenté à l’E3, mais le monde retient son souffle face au tonitruant State of Emergency, développé par VIS Entertainment (studio basé à Dundee en Écosse sous la houlette d’anciens collaborateurs de DMA Design) et distribué par Rockstar Games. Titre d’action se déroulant dans des décors urbains modernes et léchés, cet adversaire qui n’en a pas l’air détourne l’attention avec son gameplay explosif où l’on s’amuse dès les premières minutes. En comparaison, les premiers aperçus du nouvel opus de GTA ne convainquent pas tout de suite ; pire, avec son introduction assez lente et sa dimension très cinématographique, il passerait presque pour la caution intellectuelle du salon américain ! D’un jeu de gangsters au fun addictif immédiat, les professionnels voient arriver un titre conventionnel, certes en 3D, mais pas nécessairement plus attractif que la concurrence. Le paradigme initial semble même altéré par l’exigence d’adopter de nouvelles technologies changeant non seulement sa perception esthétique profonde, mais également le sens de son gameplay. Entre storytelling et open world, l’équilibre apparaît précaire et les développeurs ne peuvent que modifier la rhétorique globale du titre, car si le monde est en réalité de taille à peu près égale à son prédécesseur, le rendu réaliste des graphismes offre moins de dédales de rues et d’avenues, et amoindrit la sensation de perdition. Quid de la « simulation de crimes » irrévérencieuse des débuts ? Celle-ci reste intacte, quoique écraser en série les piétons soit plus difficile du fait de la « perte » visible de population qu’a subie l’univers. Pour autant, la communication s’assouplit légèrement chez DMA Design. Le studio tente de faire bonne figure face aux polémiques passées. Dans le même entretien accordé à IGN, Leslie Benzies ajoute : « La violence a toujours été bridée par l’humour… Ces jeux n’ont pas vocation à être pris sérieusement, et leur approche, nous l’espérons, rend le principe assez clair. […] Il y a beaucoup de façons de tuer des gens dans le jeu, en les frappant, en leur tirant dessus, en les faisant exploser, etc. Mais c’est vraiment aux joueurs de le découvrir par eux-mêmes. Le but principal est d’avoir affaire à d’autres criminels, pas à des innocents qui passaient par là. Vous n’êtes jamais récompensé avec la violence gratuite. » Écraser des piétons était pourtant devenu un sport national chez certains joueurs, car cela permettait de récolter des points lors des deux premiers titres…
De retour à Liberty City, la ville aux accents new-yorkais du premier GTA, les joueurs découvrent un jeu tout à coup bien plus réaliste que la majorité des titres d’alors. Un soin particulier a été porté à l’histoire et, nouveauté, à une brochette de personnages assez travaillés, héros ou antihéros, antagonistes ou seconds rôles, venant crédibiliser l’ambition quasi hollywoodienne des créateurs. Et l’écart est d’autant plus grand avec les précédents jeux en 2D, que pour rendre la nouvelle esthétique 3D intelligible, une quantité importante d’idées bouleversant profondément la nature de la série sont concrétisées – la transformation graphique ne doit surtout pas être gratuite et s’accompagner de fonctionnalités allant dans le sens de la révolution voulue. Dan Houser, ancien de BMG Interactive ayant intégré Rockstar Games et directeur créatif du groupe qui sera notamment à l’origine de Red Dead Redemption15, témoigne à IGN en 2011 : « Cela a créé de nombreux problèmes auxquels nous n’avions pas pensé. Vous aviez tous ces personnages qui déambulaient dans les rues et ils avaient besoin de parler. Vous deviez alors définir tout un système pour ça et trouver un moyen de le faire quand – ce qui semblait totalement fou – vous deviez en même temps enregistrer 8 000 lignes de dialogues. […] Nous nous sommes dit que nous allions produire des scènes cinématiques en pré-rendu. Mais ce serait bizarre, il y aurait des temps de chargement assez lourds et ça n’aurait pas du tout la même tête que le jeu. Alors, comment faire ces scènes ? La motion capture pouvait le faire, mais on ne l’avait jamais effectuée auparavant. On a donc dû trouver un moyen de le réaliser… Mais par où devions-nous commencer ? Pouvions-nous le streamer depuis le disque ? Cela marcherait-il ? C’étaient des choses comme ça, qui sont aujourd’hui très standard. GTA III a été le premier, ou l’un des tout premiers, à le faire. »
Le moteur utilisé est alors celui de Criterion Games, RenderWare. Il servira de base aux épisodes à venir, Vice City en 2002 et San Andreas en 2004, avant de passer à un outil développé en interne. La nouvelle identité de la série est immédiatement acquise par les gamers, qui plébiscitent ce troisième opus comme jamais. Un monde ouvert entièrement modélisé en 3D, disposant d’un bon équilibre entre storytelling et activités annexes, avec une vaste zone de jeu à parcourir, à explorer et contenant de plus en plus d’éléments cachés venant étoffer le gameplay et l’histoire. En 2005, San Andreas devient le jeu le plus vendu sur PlayStation 2 et culminera parmi les titres les plus rentables de l’histoire16. Ce modèle, grande réussite de DMA Design (renommé Rockstar North en 2002) en moins de six ans de développement de la série, servira de base pour le moins solide à une version historique de Grand Theft Auto, reposant sur l’Old West américain, mais dont l’histoire de la création nous ramène quelques années en arrière et sur un tout autre continent…
10. David Braben et Ian Bell, 1984. Jeu de stratégie et de combat dans l’espace, considéré comme un des plus innovants de tous les temps, utilisant un algorithme et des formules de nombres aléatoires pour générer un espace gigantesque avec des milliers de planètes à explorer.
11. Frontier Developments, 1993.
12. La boulimie d’Infogrames se matérialise par les rachats spectaculaires d’Ocean Software, d’Ozisoft ou d’Eden Games, ainsi que les immenses GT Interactive (avec ses dizaines de millions de dettes) et Hasbro Interactive. Le navire chavire au début des années 2000. S’ensuit une profonde restructuration qui conduira à la forme connue aujourd’hui sous le nom d’Atari SA.
13. Infogrames achète Gremlin Interactive pour 40 millions de dollars en 1999, incluant DMA Design, et revend ce dernier à Take-Two Interactive la même année pour « seulement » 11 millions de dollars.
14. Take-Two se présente désormais comme un groupe comportant deux éditeurs majeurs : Rockstar Games et 2K, eux-mêmes gérant une myriade de studios de développement. Le canadien GameTek deviendra par exemple Rockstar Toronto.
15. Son frère, Sam Houser, également ancien de BMG Interactive, est alors nommé président de Rockstar Games, à New York.
16. Aujourd’hui, il est toujours classé devant son successeur Grand Theft Auto IV.
UN GENRE INCONTOURNABLE
Red Dead Revolver. Histoire d’un sauvetage
Bien avant d’être renommée « Rockstar San Diego » durant l’impressionnante expansion de Take-Two Interactive et vingt ans avant la sortie de Red Dead Revolver, la société Angel Studios, fondée par un Colombien expatrié dans la grande ville californienne située à la frontière du Mexique, n’a, de prime abord, rien à voir avec la culture européenne et en particulier celle de DMA Design, studio œuvrant depuis les lointains lowlands d’Écosse. Dans le sillage des activités économiques et technologiques de la Silicon Valley, œuvrant plus au nord dans la zone urbaine de San Francisco, le jeune studio débute dès 1984 en se spécialisant dans l’imagerie de synthèse. La philosophie de Diego Angel, créateur de l’entité ayant étudié à Chicago, est de fonctionner à l’instinct, choisissant les projets au feeling et abandonnant aussitôt une voie pour une autre. Il suit sa bonne étoile dans un monde fait de possibilités et où les plus audacieux ont souvent le dernier mot. La démarche paie et la structure s’agrandit au fil des années en réalisant des vidéos commerciales, des présentations d’entreprises ou de l’imagerie synthétique pour le monde médical. Au début des années 1990, le studio conçoit les séquences en CGI du film Le Cobaye (The Lawnmower Man, Brett Leonard, 1992). Si le long métrage n’est pas une franche réussite, la prouesse technique est bien là, en plus de mettre en scène un monde de réalité virtuelle à la Tron (Steven Lisberger, 1982), chose encore incomprise des spectateurs de l’époque. La même année, Angel Studios se distingue également avec le clip psychédélique de Peter Gabriel, Kiss That Frog, qui remporte le prix des meilleurs effets spéciaux aux MTV Video Music Awards (1994). Mais c’est surtout l’industrie de l’informatique, et par extension du jeu vidéo, qui rattrape l’homme d’affaires. Diego Angel signe un contrat avec la société Silicon Graphics, géant du secteur à l’époque. Ensemble, les deux structures développent des démos spectaculaires pour vanter les mérites du matériel de Silicon Graphics, faisant office de référence dans le domaine de l’infographie et du traitement vidéo chez les professionnels industriels. En 1993, c’est leur processeur Reality Coprocessor qui équipe la flambant neuve – et ambitieuse – Nintendo 64 du constructeur japonais éponyme. À ce moment-là, Genyo Takeda17 se dit impressionné par le travail d’Angel Studios et, puisque les outils de Silicon Graphics sont familiers à ces derniers, il leur demande naturellement d’intégrer, en 1995, la Dream Team18 des développeurs de la future Ultra 64… dont fera également partie DMA Design. La société californienne a alors déjà acquis une popularité mondiale pour sa maîtrise des environnements, certes encore balbutiants, en trois dimensions temps réel ; une consécration honorifique et surtout aussi rare que précieuse à l’époque.
Alors qu’il officie déjà avec SEGA sur quelques titres, tels que Ecco : The Tides of Time (1994) sur SEGA CD et Mr. Bones (1996) sur Saturn, le studio de San Diego se lance dans la réalisation de deux jeux de base-ball (sport national au Japon également très populaire aux États-Unis) pour le compte de Nintendo, sous licence officielle de la Major League Baseball et empruntant le nom d’une star de l’époque, Ken Griffey Jr. Le projet déterminant est cependant soumis par un éditeur tiers de la console de Nintendo, le géant japonais Capcom et sa célèbre franchise Resident Evil19. La suite du jeu à succès, mettant en scène des militaires dans un manoir de la ville de Raccoon City infesté de zombies, sort en 1998 sur PlayStation et contient un total de 1 400 mégaoctets de données, répartis sur deux disques. La mission confiée à Angel Studios est de réaliser le portage sur la console de Nintendo dont les cartouches possèdent une capacité de stockage n’excédant pas… 64 mégaoctets ! Néanmoins, le défi est relevé en moins de deux ans, une dizaine de personnes ayant œuvré dessus à plein temps, redéfinissant les contours techniques et artistiques du jeu, en accentuant la compression des scènes cinématiques et en révisant les durées via des coupes – ce qui a pour avantage de rendre paradoxalement le jeu plus dynamique. Cette version « amoindrie » techniquement se révèle, selon les joueurs, parfois supérieure à l’originale sur PlayStation, notamment grâce au système d’anti-aliasing de Nintendo, évitant le crénelage des textures propres à la console de Sony. Resident Evil 2 sur Nintendo 64 se paie même le luxe d’avoir une jouabilité peaufinée, quelques bonus in game et, cerise sur le gâteau, une musique améliorée en élevant la fréquence d’échantillonnage des sons et en adoptant la technologie Dolby Surround. Un coup de maître pour Diego Angel et ses équipes, qui confirment leur parfaite maîtrise des outils de technologie, tout en flattant particulièrement la console de Nintendo que d’aucuns prétendent supérieure en tout point à sa rivale, malgré ses capacités techniques moindres.
Pendant ce temps, Take-Two Interactive observe, tapi dans l’ombre, le manège de cette mondialisation collaborative auquel se prêtent les différents acteurs du marché, et rachète DMA Design à Infogrames la même année que la sortie du portage de Resident Evil 2 sur Nintendo 64, en 1999. Une année qui voit aussi, pour le développeur californien, la publication d’un jeu de course dans un monde ouvert et urbain tout en trois dimensions : Midtown Madness permet aux joueurs de se balader où ils le souhaitent, tout en ayant la possibilité de foncer sur les piétons et de renverser du mobilier urbain – par inadvertance, bien entendu ! Deux ans avant le premier opus 3D de Grand Theft Auto, la prestation de Diego Angel et de ses équipes fait grand bruit, et le jeu va même jusqu’à animer les temps de pause des développeurs de GTA en Écosse. Mais le studio est à nouveau happé par une nouvelle demande émanant de Capcom, formulée par Yoshiki Okamoto, game designer chevronné ayant débuté chez Konami en 1982. Ce développeur émérite a fait les beaux jours des jeux de tir sur bornes d’arcade, les shoot ‘em up, extrêmement populaires au Japon, se succédant de façon frénétique dans les salles dédiées et dont les légendaires difficultés augmentent au même rythme que les impressionnantes aptitudes des gamers passionnés du genre. En 1985, Okamoto s’était distingué en réalisant, a priori tout seul20, un shooter vertical nommé Gun. Smoke, sur le thème du western. Si les différents éléments y étaient, depuis la musique jusqu’aux décors, le titre de Capcom n’en restait pas moins un représentant assez classique dans son genre, ne se démarquant pas spécialement de ses pendants futuristes avec leurs vaisseaux spatiaux. Au début des années 2000, le rapprochement avec Angel Studios voit la collaboration s’engager sur une idée très classique, prenant comme base de réflexion la nécessité d’aborder la 3D pour un jeu de tir pas spécialement différemment d’un shooter 2D au scrolling vertical ou horizontal, mais offrant une immersion inédite dans un univers plutôt américain, qui, par définition, charmerait les joueurs japonais pour son exotisme comme les joueurs occidentaux par affinité culturelle. Le document de présentation du jeu chez Capcom décrit l’idée en quelques lignes : « S.W.A.T. est un shooter d’action spécialement conçu pour aborder le plein potentiel de la PlayStation 2. Ce jeu utilise une technologie innovante avec un design très détaillé pour donner vie au monde mortel et excitant de l’Ouest sauvage. […] Dans S.W.A.T., vous prenez le contrôle d’une large variété de personnages dynamiques pour combattre des ennemis hauts en couleur avec pistolets, couteaux, dynamite et autres armes de l’Ouest. La technologie novatrice d’Angel Studios donnera aux personnages plus d’expressivité et la possibilité d’aller partout à travers des terrains accidentés, dans le but d’interagir avec pratiquement n’importe quoi, tabouret ou bouteille de whisky, ou tout autre objet de l’environnement western. » Ainsi, Spaghetti Western Action Team, de son prodigieux titre complet, serait-il une suite spirituelle, en 3D et aux interactions évidemment en phase avec l’ère du temps, de Gun. Smoke ? Au départ, S.W.A.T. n’a pourtant rien d’un western et s’éloigne même beaucoup de l’idée du shooter d’élite solitaire évoluant sur une carte envahie d’ennemis. Le premier prototype met en scène sept membres des forces tactiques aux aptitudes et équipements complémentaires évoluant dans un building à libérer. Il est doté d’un gameplay permettant de passer de l’un à l’autre, grâce à un effet de split de l’écran de jeu pour plus de dynamisme en temps réel. Cependant, le concept évolue sous l’impulsion d’Okamoto, qui transpose l’action sur une île, lors d’un carnaval pris d’assaut par des robots tueurs. Finalement, la troupe d’élite de S.W.A.T. ne délogera ni des terroristes dans un immeuble ni des robots au large de l’océan, mais basculera dans le thème westernien avant que l’idée d’un groupe de soldats ne passe définitivement à la trappe, pour ne garder que ce qui fait l’essence du genre depuis des décennies, avec son héros solitaire, rescapé des shoot ‘em up où le joueur n’incarnait qu’un avatar seul contre tous. Cette illumination, Okamoto, en bon passionné de cinéma américain qu’il est, l’a en voyant le film Blindman, le justicier aveugle (Ferdinando Baldi, 1971), authentique western spaghetti avec Tony Anthony et Ringo Starr. Et quoi de plus logique que de confier cette nouvelle transposition du concept à un studio de développement ayant ses quartiers à l’endroit même où l’Histoire a créé le western ?
Le développement débute en 2000 et le titre porte déjà toutes les spécificités d’un jeu d’arcade, sans grande place accordée à l’histoire ou aux moments calmes, l’ensemble étant exclusivement centré sur les missions de tir, avec des bizarreries et caricatures bien éloignées de l’idée que l’on se ferait du western. En effet, le héros dispose d’armes farfelues, parfois ultra puissantes et anachroniques ; le design semble souvent se situer à la croisée de plusieurs influences fantaisistes et certaines vidéos du développement de l’époque montrent des aptitudes physiques improbables comme un extrait où l’avatar vole et abat des ennemis en plein ciel. Ainsi, la première approche se retrouve plutôt à mi-chemin entre Panzer Dragoon (SEGA, 1995) et Tenchu (Acquire, 1998) selon le designer Dominic Craig21, deux franchises qui souffrent en plus à cette époque d’un problème de jouabilité aussi bien occasionné par, d’une part, le manque d’expérience des développeurs comme des joueurs dans des environnements 3D, ou de moteurs encore claudicants, et, d’autre part, par la volonté de toujours chercher à renouveler l’expérience de gameplay. Par ailleurs, le concept et l’influence sont bien trop japonais pour être solubles dans un thème comme le western, même si le héros est une copie carbone de Clint Eastwood dans L’Homme des hautes plaines (High Plains Drifter, Clint Eastwood, 1973). Le développement s’engage ainsi dans une très lente descente aux enfers et s’enlise dans d’incessants va-et-vient entre les équipes américaine et japonaise. Le représentant de Capcom, le célèbre Akira Yasuda (designer sur Street Fighter II
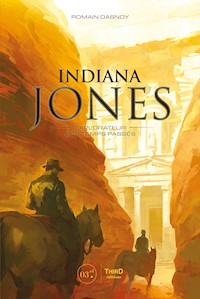













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














