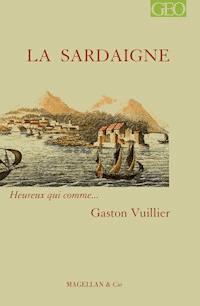
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Heureux qui comme…
- Sprache: Französisch
Partager les émotions des premiers écrivains-voyageurs et retrouver les racines d’un monde intemporel.
Gaston Vuillier (1845-1915) a abandonné sa carrière de fonctionnaire pour se faire dessinateur. Sa réputation grandit vite et il devient un des collaborateurs réguliers et « complet » (dessins et textes) de la revue en vogue Le Tour du monde. Amoureux des splendeurs de la Méditerranée, il ne pouvait manquer de débarquer en Sardaigne et de faire un commentaire élogieux sur l’authenticité préservée de l’île et de ses habitants.
Récit publié dans Le Tour du monde en 1891.
EXTRAIT
Après cette nuit de tempête, une clarté d’aube trembla timidement à l’horizon, le ciel froid se colora lentement de rose pâle, et des silhouettes de montagnes s’élevèrent devant nous. C’était la Sardaigne, que les Pélasges avaient désignée du nom grec d’Ichnusa à cause de sa forme de sandale. Vers la droite courait la longue bande rocheuse qui forme l’île d’Asinara, tandis qu’à l’arrière les monts Corses noyaient dans des vapeurs lointaines leurs cimes neigeuses.
A PROPOS DE LA COLLECTION
Heureux qui comme… est une collection phare pour les Editions Magellan, avec 10 000 exemplaires vendus chaque année.
Publiée en partenariat avec le magazine Géo depuis 2004, elle compte aujourd’hui 92 titres disponibles, et pour bon nombre d’entre eux une deuxième, troisième ou quatrième édition.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Gaston Vuillier, dessinateur, voyageur et ethnographe est né en 1845. Il travailla pour Le Tour du monde, grande revue illustrée du XIXe siècle. Son ouvrage La Sardaigne témoigne de son amour pour les pays méditerranés.D
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’ÎLE DE LA STABILITÉ
Présenté par Marc Wiltz
Ballotée par l’Histoire, la Sardaigne a joué un rôle capital dans l’unification de l’Italie, proclamée officiellement par son roi Victor Emmanuel II le 17 mars 1861. Celui-ci sera le premier roi d’Italie jusqu’à son décès en 1878, après que Cavour ait négocié le soutien militaire de Napoléon III contre l’Autriche, en échange de Nice et de la Savoie…
Auparavant, la Sardaigne aura subi le joug de tous les empires de Méditerranée, sans pour autant perdre son identité : les marchands phéniciens, restés sur le littoral, lui apportent l’apiculture, l’extraction de l’huile d’olive, et développent les cités portuaires ; les Libyens du roi Sardus tentent sans succès de conquérir l’intérieur de l’île ; les Carthaginois s’installent sur les côtes, stimulent l’agriculture céréalière et transforment leur conquête en véritable base militaire, mais les parties montagneuses de l’île leur restent inaccessibles ; Rome succède à Carthage après les guerres puniques, conquiert à son tour l’île dans sa totalité hors les montagnes de la Barbagia, et la couvre de routes et de monuments jusqu’à la chute de l’Empire ; Les Vandales, d’origine germanique, y passent eux aussi, balayés peu après par les Byzantins qui convertissent les populations au christianisme ; les envahisseurs arabes restent quelques années, avant que Pise et Gênes ne prennent la suite avec le soutien moral du pape ; le royaume d’Aragon entre en scène à son tour et le catalan devient la langue officielle de Sardaigne ; territoire de Charles Quint, l’île connaît la domination autrichienne, puis une tentative vite avortée des Français en 1793… Après toutes ces péripéties marquées par la convoitise que suscite la position stratégique de l’île au cœur des routes maritimes de la Méditerranée, l’intégration à l’Italie naissante peut alors commencer !
À l’heure où Gaston Vuillier se rend sur place pour son reportage, la situation n’a pas beaucoup changée. La Sardaigne est toujours une terre rude, plus rurale que citadine, tournée vers la mer mais très ancrée dans son terroir, et les mœurs des populations civiles restent traditionnelles. Elle ne bénéficie pas de l’essor économique du nord de ce nouveau pays et reste enchâssée dans ses coutumes. Aux yeux du dessinateur auquel Hachette s’est attaché au point de lui confier également l’écriture de ses sujets, c’est là le plus grand charme de cette île immense. Tout y est intact. La vérité humaine, avec ses codes d’honneur qui font les brigands et les légendes de sang, éclate avec force. Vuillier travaille depuis 1888 pour la revue à succès Le Tour du monde. Après son premier reportage approfondi en
Andorre, puis un autre aux Baléares, la Sardaigne représente pour lui une attraction géographique significative et peut-être le vrai tournant de son parcours. Le voyageur écrit à la première personne, il décrit et dessine ce qu’il voit : paysages et monuments, personnages et modes de vie, légendes et rencontres. Dans son texte personnel, il inclut avec art et entrain le meilleur des choses à voir dans le pays traversé. Il est incontestablement le touriste, précurseur de ceux du XXe siècle, mais surtout il s’efforce de rendre compte pour d’autres touristes. Il propose sans insister un modèle à suivre pour les futurs voyageurs. Dans la foulée, il poursuivra son étonnant parcours vers les îles de la Méditerranée : Baléares, Corse, Sardaigne, Sicile, Malte… Il publie chaque reportage dans Le Tour du monde, qu’il réunit en 1893 dans un ouvrage global : Les îles oubliées. Les Baléares, la Corse et la Sardaigne. Il découvre dans ce monde des îles autonomes de la Méditerranée les premisses d’une ethnologie des traditions populaires, dont la Sardaigne est l’un des creuset les plus authentiques.
Récit publié dans la revue Le Tour du Monde, 1891.
LASARDAIGNE
Octobre 1890. Ajaccio est endormi. Minuit vient de sonner à tous les clochers, lorsque le vapeur Comte-Bacciochi, après avoir lentement tourné sur son axe, a pris la direction de Porto Torres, droit au sud, vers la Sardaigne.
La veille, les côtes de la Corse, voilées de sombres nuages, étaient battues par la mer en furie ; le golfe semblait bouleversé. Le matin même, les flots, pris comme d’un subit accès de fureur, avaient envahi les quais.
Après cette violente convulsion, la mer s’était mise à sommeiller, et je l’avais longuement contemplée tandis qu’elle frissonnait doucement, à l’heure où le soleil se couchait, gracieuse, murmurante, caressée par des bandes de mouettes folles, tout au long des plages vermeilles. Maintenant, furtive, alanguie, pleine de chuchotements, de soupirs et comme de baisers confus, elle reflète et berce sur son sein les clartés éparses de la ville, les pâleurs des édifices, les lueurs tremblantes des étoiles du firmament. Je suis au nombre des passagers qui, sur le pont du navire, rêvent silencieux devant cette mer enchanteresse s’épanouissant, en quelque sorte, dans sa mystérieuse beauté.
Le Comte-Bacciochi s’en va dans une atmosphère capiteuse, sur des flots qu’on dirait électrisés, pareil à ces navires légendaires qui, guidés par les antiques constellations, ont vogué sur des mers idéales, vers les rivages inconnus que des explorateurs fabuleux ont vus fleurir devant leurs yeux émerveillés.
« Quelle traversée superbe nous allons avoir !, s’écria tout à coup une voix forte interrompant brusquement nos rêveries.
– Je vous répondrai dans une heure, lorsque nous doublerons le cabo di Muro », avait répliqué aussitôt le commandant, d’un ton narquois, en jetant un rapide coup d’œil vers le ciel. Et il était monté vivement sur la dunette, enveloppé de fourrures comme un boyard.
« Le commandant plaisante, dis-je à M. Mariani, un récent ami de Corse dont j’avais reconnu la voix.
– Non, me dit-il, le commandant est un vrai loup de mer, sa réponse ne présage rien de bon ; il va passer la nuit sur la dunette, c’est l’indice d’un gros temps. Du reste, voyez », ajouta-t-il.
Je suivis son regard…
La lune venait de dresser son disque difforme et dardait comme un grand œil sanglant à travers des nuages blafards. Les nuages montaient sur l’horizon, semblables à d’épaisses fumées qui se seraient élevées de quelque volcan sous-marin, et couraient ensuite, déchirés, dans l’espace, avec une vitesse prodigieuse.
« Adieu les doux rêves, l’espoir d’une nuit pure, me dis-je, les lueurs d’Ajaccio se voilent déjà, le phare des Sanguinaires pâlit, le ciel devient plus sombre, et le pont désert. »
Nous allons quelque temps ainsi vers l’horizon noir, puis le vent se lève et commence à siffler dans la nuit, tandis que les crêtes des vagues passent avec une éblouissante rapidité de chaque côté du navire. La houle augmente…
Lorsque nous doublons le cap Muro, les éclairs déchirent les nues, la foudre gronde, le vent hurle, le bateau a des sonorités étranges, la mer est comme en folie. Le commandant ne s’est pas trompé…
Les passagers avaient depuis longtemps abandonné le pont. J’étais demeuré seul, retenu des deux mains à la rampe de l’entrée des cabines, les yeux vers l’arrière. Les dernières clartés du phare des Sanguinaires avaient disparu, la silhouette du cap s’était évanouie dans les noirceurs du ciel. J’écoutais la musique infernale de l’ouragan, ses clameurs, ses grondements, le sourd halètement de la machine, les craquements de la membrure ; je voyais la fantastique chevauchée des vagues aux croupes blanchissantes, les nuées flottant comme de grands crêpes déchirés, tandis que là-haut, dans la mâture confuse, la sombre silhouette du commandant s’élevait grandie, à la lueur des éclairs, comme une vision.
Dans l’horreur et l’épouvante de cette nuit, au milieu des rauques imprécations des airs et des flots, sur ce pont désert, je songeais… je songeais avec émoi à cette île latine que j’allais parcourir et dont l’abord était pour moi singulièrement tragique.
Je la savais presque inconnue en Europe, peu connue en Italie même. Ne dirait-on pas que les voyageurs l’ont toujours évitée ? En traversant la Méditerranée, on a pu, parfois, l’apercevoir étalant les lignes infinies de ses mornes côtes et les ondulations graves de ses monts.
La Sardaigne me hantait alors comme une sorte de pays maudit, exhalant des fièvres redoutables, peuplé d’hommes équivoques. Les réminiscences classiques m’apportaient les paroles peu rassurantes de Cicéron à son frère : « Cura, mi frater, ut valeas et quamvis sit hiem Sardiniam istam esse cogites »1. Et ce vers d’un poète : « Sed tristis caelo ac multia vitiata palude »2.
J’avais lu dans le brillant ouvrage de mon ami Onésime Reclus, La Terre à vol d’oiseau3, que les Romains avaient fait de cette île une Cayenne pour leurs déportés, sachant bien que la fosse y était creusée d’avance : « Tu trouveras la Sardaigne à Tivoli même ! » écrivait le poète, c’est-à-dire : « Quoi que tu fasses, tu mourras !… »
Après cette nuit de tempête, une clarté d’aube trembla timidement à l’horizon, le ciel froid se colora lentement de rose pâle, et des silhouettes de montagnes s’élevèrent devant nous. C’était la Sardaigne, que les Pélasges avaient désignée du nom grec d’Ichnusa à cause de sa forme de sandale. Vers la droite courait la longue bande rocheuse qui forme l’île d’Asinara, tandis qu’à l’arrière les monts Corses noyaient dans des vapeurs lointaines leurs cimes neigeuses.
Porto Torres… ! Le premier village sarde est sous nos yeux. Triste et pauvre village aux maisons basses, où l’on voit errer des enfants hâves ; son port ressemble à une mare. De grands souvenirs peuplent pourtant ses murailles silencieuses et planent sur les monuments ruinés des races diverses qui l’emplirent de grandeur. Les Espagnols, à des époques glorieuses, y élevèrent des tours au front crénelé, qui n’ont cessé de se refléter fièrement dans les eaux du port. Le Palais du roi barbare, Palazzo del re barbaro, antique temple de la Fortune, construit par les Romains, montre à travers les raquettes des cactus ses masses écroulées. La basilique de San Gavino, antérieure à l’an 1000, remaniée en 1210 par un seigneur du Logudoro, couronne un monticule.
Par-delà les maisons, derrière ces monuments des âges écoulés, des terrains aux lignes grandes et sévères ondulent jusqu’au loin. Et, tandis qu’à bord se font les manœuvres d’arrivée, je considère cette terre qui s’étale sous un ciel tourmenté, couverte de ruines, et comme toute pâle et grelottante de misère et de malaria.
Le vent d’ouest souffle avec force, les flots venus du large agitent cette rade sans abri ; au pied des fières tours d’Aragon, des balancelles peintes de couleurs vives s’entre-choquent et gémissent.
« Vous avez une fâcheuse impression de la Sardaigne, me dit M. Mariani en me tapant amicalement sur l’épaule. Je comprends, continua-til, qu’après une nuit pareille, et en présence de Porto Torres, vous soyez attristé ; mais n’ayez point d’inquiétudes, d’agréables surprises vous sont réservées pour le cours de votre voyage. »
Et, prenant mon bras, il m’entraîna dans le salon, où il m’offrit à déjeuner. Là je rencontrai M. Morati, vice-consul de France à Sassari, et notre nouveau consul à Cagliari rejoignant son poste, passager nocturne qui n’avait pas mis les pieds hors de sa cabine depuis l’embarquement.
Au cours d’un joyeux repas, mes impressions fâcheuses se dissipent, puis, comme le soleil luit, je descends à terre et parcours le village.
Porto Torres, qui semble se remettre à vivre un peu aujourd’hui, après un long sommeil qui le prit à la fin du Moyen Âge, fut, sous le nom de Turris Lybisonnis, une grande cité, capitale romaine du nord de la Sardaigne. Les statues mutilées, les divinités de marbre retrouvées dans la boue des marécages, les mosaïques précieuses, les colonnes, les chapiteaux, les armes, les médailles aux effigies rares que heurtent fréquemment le soc de la charrue ou la pioche du fossoyeur, établiraient son antique splendeur, si les ruines éparses du palais et d’aqueducs, si le pont magnifique qui traverse l’ancien flumen Turritanum, n’en témoignaient hautement.
Le vice-consul de Sassari me suivit dans mon pèlerinage à travers ces ruines d’une grandeur passée, au milieu des herbes et des pierres, dans les chemins défoncés par la tempête de la nuit, le long des vestiges d’une voie romaine. Je m’arrêtais sans cesse pour considérer les cavaliers sardes qui passaient, pleins d’allure, le capotu4 sur la tête, le profil sévère sur le ciel, les cheveux d’un noir d’ébène flottants, la barbe sauvage. Le consul, habitué à voir ces hommes qu’il coudoyait chaque jour, n’était point frappé de leur grand caractère, et mon enthousiasme le surprenait beaucoup.
Le pont romain traverse l’embouchure du fleuve ; ses piliers formés de blocs de porphyre s’enfoncent dans les eaux mortes. La nappe d’eau sommeille au milieu des hautes herbes sans un frisson, sans un murmure, reflétant comme un miroir immobile et noir les arceaux et les piliers du pont romain.
Ah ! plus tard je ne les rencontrai qu’avec terreur ces eaux des fleuves sardes qui distillent des poisons et se glissent silencieuses, perfides, avec des ondulations de couleuvres… Mais il était trop tard pour les fuir : la malaria m’avait déjà pénétré !
La basilique de San Gavino, aujourd’hui simple église paroissiale de village, était à la fin du xve siècle un puissant archevêché. Devant ses murailles, déjà au VIIIe siècle, des rois, des prélats entourés des magnats de Torres, avaient à diverses reprises célébré une grande victoire remportée sur les Sarrasins. Pendant les cérémonies pompeuses, les dépouilles et les armures des infidèles étaient amoncelées sur les marches extérieures, devant le portail. À l’intérieur, trois nefs pisanes y sont séparées par de nombreuses colonnes de styles différents en marbre, en granit et en porphyre. Ces colonnes, dont plusieurs proviennent des ruines du temple de la Fortune, supportent les poutres de la toiture, qui sont en bois de genévrier. L’une d’elles offre la particularité de se maintenir toujours humide, et le peuple prête à cette circonstance un caractère merveilleux.
La crypte abrite les ossements de trois martyrs : San Proto, San Giannario, et enfin San Gavino. Ce dernier est le saint le plus vénéré du nord de la Sardaigne.
Il est des jours où, en dehors de l’activité relative occasionnée par l’arrivée des vapeurs, le triste Porto Torres s’anime soudain et se met en fête. Les habitants des flancs dénudés du Limbara, dans l’âpre Gallura, de villages accroupis le long de quelque ruisseau fangeux, de mystérieux nuraghi5, de cratères de volcans éteints, toute la population du Logudoro enfin arrive en chevauchées éclatantes aux costumes superbes. C’est alors, parmi les ruines, devant l’immense golfe d’azur, sous le ciel transparent, comme une subite floraison d’une richesse inouïe. Ces assemblées ont lieu le second jour de la Pentecôte, où se célèbre la messe de San Gavino.
Beaucoup de pèlerins accourent dans le seul but de faire à genoux le tour de chaque colonne en les baisant dévôtement et de se prosterner devant la statue équestre du saint. La légende rapporte que San Gavino, après avoir arraché une de ces colonnes du fond de la mer, la posa ensuite toute droite sur l’arçon de sa selle et l’apporta fièrement ainsi dans la basilique.
Les fêtes terminées, les pèlerins, au moment de quitter Porto Torres, prennent leurs femmes en croupe et s’élancent dans la mer. Lorsque les flots ont atteint le poitrail de leurs chevaux, ils se retirent et se mettent en voyage pour regagner leurs demeures, souvent très éloignées. Les eaux du golfe opèrent ce jour-là des miracles, car elles ont été sanctifiées dans les temps reculés par le sang des martyrs qui y furent précipités. Les cavaliers sont persuadés qu’après cette baignade leurs cheveux seront préservés des maladies.
La ville de Sassari a un droit de propriété sur la sainte basilique mais la municipalité doit, sous peine de déchéance de son privilège, se rendre tous les ans à Porto Torres, le jour de la San Gavino, et y manger en cœur une… cuisse de veau ! On voit donc ce jourlà arriver les membres de la municipalité en grand costume d’apparat, précédés des massiers. Le cortège s’avance gravement : le chanoine vicaire de Porto Torres le reçoit et présente au sindaco6 les clefs de l’église sur un plateau. Celui-ci les prend dans sa main pour faire acte de propriété, et les restitue aussitôt au chanoine en le priant d’avoir soin du bien appartenant à la ville de Sassari et confié à sa garde. Étrange basilique qui, depuis des temps très anciens, soutient la foi des gens du Logudoro, éveille un mysticisme rare, abrite des superstitions bizarres et voit se perpétuer de cruelles mortifications !
Des pèlerins de Sassari s’y rendaient régulièrement encore et, dans le mystère des murailles épaisses, dans la sombre nuit de la crypte, se flagellaient jusqu’à éclabousser de sang les parois, en chantant lugubrement le Miserere…
Tandis que j’allais foulant aux pieds les ruines des palais, pensif devant les vestiges d’une grandeur évanouie, m’attardant auprès de la basilique vénérée, l’heure de quitter Porto Torres était venue.
La durée du trajet jusqu’à Sassari n’est que de trois quarts d’heure en chemin de fer, mais la société amicale au milieu de laquelle je me trouvais le fit paraître encore plus court. Du reste, le paysage est peu intéressant. On traverse une vaste solitude inculte où se penche quelque nuraghi ruiné, où s’affaissent les restes d’un aqueduc romain. De loin en loin seulement, un pâtre solitaire profile sa silhouette, tandis que des troupeaux de chèvres noires semblent ronger silencieusement le sol maigre et désert.
L’arbre frissonnant qui égaye les yeux de sa verdure et anime la solitude de son ombre mouvante n’existe pas ici.
Contre la. voie passe un Sarde a cheval, triste et fier, les yeux vers les nuages errants. Il porte sa femme en croupe ; une besace pend de chaque côté de la monture. Il s’en va.
Aux approches de Sassari, l’opuntia et le figuier se montrent, puis les hauteurs se couvrent de forêts, les cultures nuancent la terre, la ville apparaît. Le soir vient de bonne heure en cette saison ; le vent est tombé, des fumées bleuâtres s’élèvent à travers les maisons et montent toutes droites vers le ciel, quelques rayons du couchant rougissent le sommet des édifices, et un croissant de lune se pose comme un pâle diadème sur le front de la cité.
Dès l’arrivée, M. Mariani nous entraîne dans sa demeure, et nous terminons cette journée fort gaiement par un repas où se mêlent les vins de France et les vins sardes. J’avoue que si nos crus sont renommés pour leur finesse et leur arôme, les vins de Sardaigne possèdent une chaleur et un bouquet rares.
Lorsque j’avais songé à entreprendre ce voyage, j’avais vu dans ma pensée des villes misérables, sombres, abandonnées, une population farouche.
À Sassari, j’étais agréablement déçu.
Sassari, la charmante, sorte de deuxième capitale de la Sardaigne, est une ville agréable et policée. Sa situation est ravissante. Assise, toute blanche, sur le penchant d’une colline, entourée d’une immense ceinture de forêts frissonnantes qui ondulent aux caresses des brises, elle paraît se pencher vers la mer, et contempler l’immensité. Mais ce n’est point son aspect seul qui charme : Sassari dort sous un beau ciel, l’urbanité de ses habitants est proverbiale, les paysages gracieux et verdoyants abondent dans ses environs.
Les gens de Sassari se distinguent par les usages et par le langage. Aussi disent-ils avec une nuance de mépris, en parlant des autres habitants de l’île : « Ce sont des Sardes », c’est-à-dire des barbares. Eux sont exclusivement Sassarese.
Cette ville a cependant conservé un caractère particulièrement étrange en dehors des grandes voies et des places publiques aux magasins luxueux, dans une série de ruelles étroites, vrai dédale éclairé d’un jour blafard. Là, des cavaliers encapuchonnés de noir, le poing sur la hanche, le calumet aux dents, le fusil en travers de la selle et la femme en croupe, passent crânement, faisant retentir le pavé du sabot de leurs chevaux. Il faut souvent se réfugier sous les portes pour leur livrer passage.
Dans ces ruelles, les boutiques sont basses, sombres, les demeures tristes. Par la porte ouverte, on aperçoit, dans l’obscurité et le mystère qu’elles gardent même en plein jour, les lueurs des veilleuses agonisant devant de pâles madones. D’habitude, les gens se meuvent comme des ombres confuses dans ces logis mystiques d’où s’exhalent comme des bouffées de tristesse, de misère et de résignation.
Certaines façades contrastent d’une façon singulière avec l’intérieur ténébreux de la demeure. Souvent un drapeau rouge y flotte, portant en lettres noires le mot : vino. Les gens du peuple s’arrêtent et boivent, les ménagères viennent s’y approvisionner. La plupart du temps, les denrées ou objets mis en vente dans l’intérieur sont représentés par des échantillons suspendus au linteau de la porte. Il est réjouissant de considérer ces étalages composés de choses inattendues : des ficelles laissent se balancer sur vos têtes un morceau de charbon, une tomate, une chandelle, des figues sèches, des macaronis, des pains, des pommes, des flacons d’huile et de vin, quelquefois les deux ensemble dans la même bouteille. Sur le seuil même et dans l’intérieur sont des amas de magnifiques pommes cirées au joli vert tendre qu’on appelle melappio. Des salles basses en sont pleines. Dans la rue, leur odeur suave vous suit ; elles sont avec raison fort estimées.
Cette ville est vraiment intéressante par ses antithèses. Avec ses édifices, ses palais, ses institutions, ses magasins, elle est en pleine voie moderne, tandis qu’une grande partie de la population qui se meut ou circule dans ses rues a conservé les coutumes des ancêtres, l’allure un peu farouche d’autrefois. Devant les boutiques luxueuses les individus vêtus de haillons passent ou s’arrêtent. Le haillon est ici un ornement, presque une coquetterie. J’ai vu à Sassari un enfant qui aurait pu se draper dans les plis du manteau absent dont parle Théophile Gautier dans son Voyage en Espagne.
Ce qui frappe aussi dans cette ville, c’est l’activité et le travail. La foule y est grouillante, gaie ; chacun vaque lestement à ses affaires. Les cafés (ils sont rares) sont très peu fréquentés, même par les officiers de la garnison.
Le lendemain de mon arrivée, le soir venu, comme le ciel sans rayons pâlissait la terre de ce bleu crépusculaire particulier qui baigne avant la nuit les villes blanches des pays méridionaux, je m’en allai errer par la ville. De par les ruelles des pauvres quartiers c’était à ce moment comme un fourmillement d’étincelles. Des gerbes de feu d’artifice illuminaient chaque porte, le vent en apportait au loin les flammèches qui flottaient, se balançaient, ou piquaient droit en étoiles filantes. C’étaient les ménagères qui allumaient le charbon de leurs fourneaux, en plein air, pour préparer le repas du soir. On les voyait en silhouettes sombres se pencher vers les brasiers et souffler de toutes leurs forces, rouges d’efforts et des reflets du feu, qu’elles éventaient aussi avec des sortes de paillassons de forme ronde. D’autres avaient laissé au vent le soin d’attiser leur feu. Puis peu a peu les fourneaux réintégraient les logis, et les rues devenaient obscures. Ce spectacle se renouvelle chaque soir, car les maisons sont privées de cheminées.
Les églises à Sassari sont nombreuses et en général assez peu intéressantes. La cathédrale, à la façade surchargée peut-être d’ornements, est cependant d’une grande richesse d’aspect. Cette profusion de sculptures sur une pierre d’une belle couleur dorée produit des effets magiques aux rayons du soleil. Certains jours, sous les feux du couchant, j’ai vu les hautes corniches flamber comme un métal ardent.





























