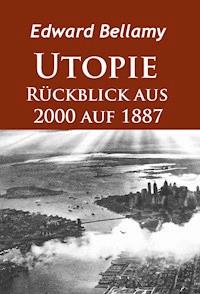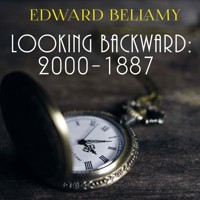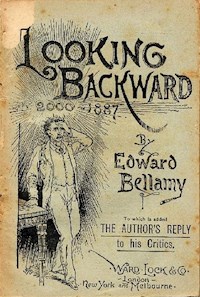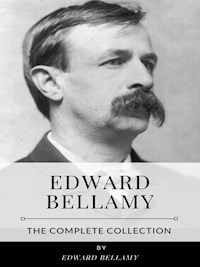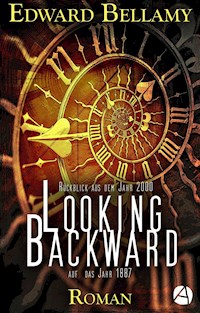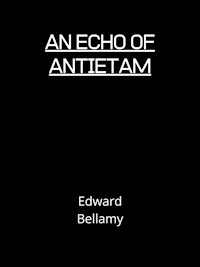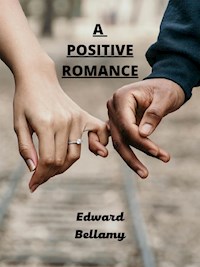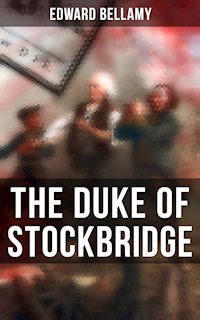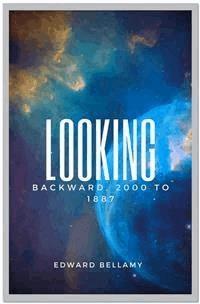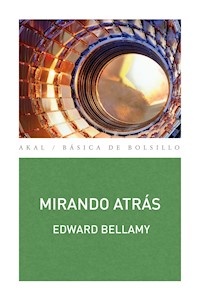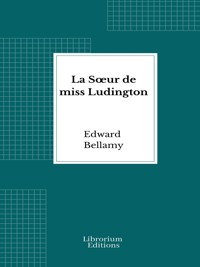
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Le bonheur, dans certaines existences, se trouve presque également réparti du berceau à la tombe. Pour d’autres, au contraire, il fait brusquement irruption, illuminant une période particulière et laissant dans l’ombre tout le reste. Durant ces heures ou ces années bénies, il nous enveloppe, il est dans l’air que nous respirons, et nous jouissons de la vie au lieu de la subir. Les hommes atteignent d’ordinaire ce point culminant dans l’âge viril ou dans l’âge mûr, quand, par exemple, le succès a enfin couronné une carrière difficile, mais le bonheur des femmes s’épanouit plutôt avec leur jeunesse. Ceci est vrai surtout pour celles qui sont restées filles et dont la vie devient, à mesure que les années passent, plus solitaire, plus dénuée d’intérêt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Edward Bellamy
LA SŒUR DE MISS LUDINGTON
traducteur :
R. Issant
© 2025 Librorium Editions
ISBN : 9782385749507
I
Le bonheur, dans certaines existences, se trouve presque également réparti du berceau à la tombe. Pour d’autres, au contraire, il fait brusquement irruption, illuminant une période particulière et laissant dans l’ombre tout le reste. Durant ces heures ou ces années bénies, il nous enveloppe, il est dans l’air que nous respirons, et nous jouissons de la vie au lieu de la subir. Les hommes atteignent d’ordinaire ce point culminant dans l’âge viril ou dans l’âge mûr, quand, par exemple, le succès a enfin couronné une carrière difficile, mais le bonheur des femmes s’épanouit plutôt avec leur jeunesse. Ceci est vrai surtout pour celles qui sont restées filles et dont la vie devient, à mesure que les années passent, plus solitaire, plus dénuée d’intérêt.
À vingt-cinq ans Ida Ludington constata, pour sa part, que le bonheur avait fui sans retour, ne laissant après lui qu’un pâle souvenir. Dès lors elle n’était plus jeune et ce fait, déjà triste, avait été encore aggravé par des circonstances tout spécialement douloureuses.
Les Ludington représentaient la plus ancienne famille de Hilton, un rustique petit village situé parmi les collines du Massachusetts. Ils n’étaient pas riches, mais à leur aise, et la population, composée tout entière de cultivateurs, considérait en eux les notables du pays. L’enfance de miss Ludington fut choyée à l’excès ; jeune fille, on l’appelait la belle Ida, on l’entourait d’hommages, on faisait d’elle le centre et l’arbitre de la vie sociale à Hilton ; puis, en plein triomphe, elle tomba gravement malade ; la mort semblait imminente et, de fait, la belle Ida mourut ; la ravissante fille qui s’était couchée sur ce lit de douleur ne se releva pas ; une femme flétrie, défigurée guérit à sa place.
Les ravages de la maladie n’avaient laissé aucun vestige de sa beauté, disparue sans retour. La luxuriante chevelure était tombée ; le peu qui en repoussa fut toujours clairsemé, d’une couleur indécise en outre ; les lèvres naguère colorées d’un si vif incarnat s’étaient amincies et avaient perdu leur dessin charmant, leur couleur ; le teint, tant de fois comparé à des pétales de rose, était criblé de taches et de coutures ; ses amis eux-mêmes ne pouvaient la reconnaître et rien ne venait tempérer pour elle l’amertume d’une perte irréparable.
La disparition de la jeunesse est toujours une pénible épreuve, mais d’ordinaire elle se produit graduellement, de telle sorte qu’on s’en aperçoit à peine. Miss Ludington, au contraire, devint vieille sans transition ; elle se pleura, elle se garda un deuil obstiné ; tant que dura sa longue convalescence, elle ne quitta pas des yeux une miniature qui la représentait à dix-sept ans, souriant comme elle ne devait plus jamais sourire. C’était tout ce qui restait d’elle, la photographie n’étant pas encore à la mode à cette époque, – vers la fin de la troisième décade du siècle actuel.
Au reflet insensible de ce qu’elle avait été, la pauvre Ida ne cessait d’adresser des paroles de tendresse incohérentes entrecoupées de sanglots. Vainement ses compagnes venaient-elles essayer de la distraire ; elle écoutait avec une patiente indifférence leur babil bien intentionné sur les menues nouvelles locales, puis, aussitôt qu’elle le pouvait sans impolitesse, se hâtait de ramener la conversation aux heureux jours qui avaient précédé sa maladie. Sur ce sujet elle ne tarissait pas, mais il était impossible de l’intéresser si peu que ce fut au présent.
Elle avait enfermé dans un médaillon la précieuse miniature qu’elle portait constamment sur son cœur. Les personnes qui lui rendaient visite ne pouvaient rien faire qui l’enchantât davantage que de demander à voir ce portrait. Lorsqu’elles l’admiraient avec l’enthousiasme souhaité, son pauvre visage défiguré prenait une expression de bonheur intense et elle disait avec émotion : – N’était-elle pas belle ? Le peintre ne l’avait point flattée ! – exprimant ainsi, d’une façon presque pathétique, qu’aucun retour sur elle-même ne se mêlait à sa pitié pour la belle morte. Il lui semblait parler d’un être infiniment cher que la destinée lui avait ravi, voilà tout. Comment aurait-elle pu se faire la moindre illusion, quand, regardant d’abord un miroir, elle reportait ensuite ses yeux sur la miniature. Quel contraste effrayant !
Oui, la pauvre Ida était bien morte, mais certains morts tiennent dans notre pensée beaucoup plus de place que les vivants. Depuis le jour où elle s’était levée du lit de souffrance, témoin de sa lamentable transformation, miss Ludington n’avait pu se décider à reprendre les jolies robes de couleurs brillantes, ornées de rubans, de broderies et de dentelles, dont elle se parait coquettement autrefois ; elle les avait pliées avec soin et embaumées dans de la lavande, puis mises sous clef comme on fait pour les reliques des défunts, car dorénavant elle ne devait plus porter que du noir.
Sa convalescence dura trois ou quatre ans, et elle resta ensuite singulièrement délicate ; de plus en plus elle devint étrangère aux plaisirs et aux intérêts d’autrui. Les filles de son âge se mariaient et n’avaient dans le monde plein de devoirs nouveaux où elles étaient appelées à vivre, rien de commun avec elle. La société, en se réorganisant, l’avait laissée en arrière. Ses anciennes amies représentaient le présent, elle personnifiait le passé ; peu lui importait en somme : si elle n’était rien à ces gens qui la traitaient, dans son deuil, de maniaque et d’égoïste, ils lui étaient bien moins encore. Quant au monde proprement dit, il lui était devenu odieux à cause de l’impression que devait y produire sa laideur. Miss Ludington se repliait sur elle-même, comme une sensitive, recherchait la solitude et couvrait d’un voile épais son visage méconnaissable lorsqu’elle allait à l’église, le seul lieu où elle ne se sentit pas déplacée.
Fille unique, la malheureuse avait perdu sa mère depuis longtemps ; son père mourut sur ces entrefaites et elle n’eut plus à s’occuper de qui que ce fût. Ses rêveries rétrospectives ne prirent sur elle que plus d’empire. Le seul bien dont elle fit grand cas était la somme de souvenirs qui lui restait de sa première jeunesse. Elle craignait toujours d’en avoir gaspillé ou perdu quelques-uns, et se désolait en songeant qu’elle avait des coffres-forts pour y serrer son argent, des verrous et des clefs pour enfermer son linge et son argenterie, mais qu’aucun moyen au monde ne pouvait préserver d’un oubli lent, inévitable, le trésor de ses réminiscences. Seule avec une vieille servante, miss Ludington habitait la maison paternelle, exclusivement soucieuse, nous le répétons, d’y maintenir toutes choses à la même place qu’autrefois, ne dérangeant même pas un meuble afin que rien ne fût changé au cadre qui avait vu fleurir la beauté d’Ida.
Si elle avait pu assurer la même immutabilité au village de Hilton tout entier ! Mais ceci était impossible. La main du progrès bouleversait ce site pastoral, qui se transformait à vue d’œil en un gros bourg manufacturier. Le chemin de fer y passa ; des magasins, des maisons neuves bordèrent les rues méthodiquement alignées. Miss Ludington, à qui chaque pierre était précieuse, avait beau chercher en se promenant tel arbre, tel coin de prairie qui jouait un rôle dans sa mémoire, elle trouvait à la place une cheminée de briques ou un terrain à vendre. Imaginez l’impression que ressentirait un poète en voyant des usines se dresser sur le site qu’occupait jadis un bois sacré. Eh bien, son indignation serait faible, comparée aux sentiments de douleur et de rage qu’éprouvait miss Ludington. Et cependant ses voisins, tous possédés de la fureur d’améliorer, disaient d’un air de complaisance : – On ne reconnaîtrait pas Hilton ! – Hélas ! non, pas plus qu’on ne reconnaissait Ida ! Celle-ci, navrée de voir effacé pour la seconde fois un passé qui était toute sa vie, finit par se défendre le spectacle de cette profanation et ne sortit plus de chez elle.
Soudain, un événement qu’elle-même fut obligée d’appeler heureux, vint l’arracher à son tombeau anticipé. Un parent éloigné, fort riche, lui légua toute sa fortune ; elle avait alors de trente à trente-cinq ans.
Miss Ludington n’avait pas de besoins ; ses dépenses annuelles n’excédaient guère quelques centaines de dollars ; pourtant aucun prodigue, dans toute la force des passions impatientes de se satisfaire, n’accueillit jamais un héritage avec plus de transports que cette vieille fille économe. Elle devint souriante, animée ; elle ne garda plus le coin du feu ; elle sortit beaucoup, marchant d’un pas rapide et résolu, regardant, non plus d’un air désespéré, mais avec une expression indicible de malice et de triomphe, les maçons, les peintres, les abatteurs de bois, occupés autant que jamais à leur besogne maudite. Une idée lumineuse lui était venue qui la consolait enfin. Des arpenteurs furent convoqués ; elle leur fit lever le plan exact de l’unique rue qui formait l’ancien village, puis miss Ludington eut de longs conciliabules avec un architecte qui lui présenta des devis, des projets. L’année d’après elle quittait Hilton, le laissant à la merci des vandales, pour n’y plus revenir ; mais ce fut vers un autre Hilton qu’elle dirigea ses pas.
La fortune qui était sienne désormais n’avait de prix à ses yeux que parce qu’elle lui permettait de réaliser à l’improviste une chimère dont elle s’était bercée, sans espoir, depuis qu’avait commencé la transformation du village.
Parmi les terres qui lui appartenaient, il y avait une grande ferme sur Long-Island, à quelques milles de Brooklyn. Là, elle fit reconstruire en fac-similé le Hilton de son enfance, et d’abord la maison paternelle avec tout ce qui l’entourait jadis ; peu de chose, en somme : la rue bordée de deux rangs d’érables et une trentaine de bâtisses achevées à l’extérieur seulement. On ne donna la dernière main qu’à l’école, au petit temple et à la demeure des Ludington, de sorte que cette curieuse création ne fut pas beaucoup plus importante que les fantaisies architecturales qui encombrent certains jardins d’Italie, par exemple. Les meubles, les tentures de sa maison du Massachusetts avaient étaient transportés par miss Ludington dans son nouveau gîte de Long-Island, exactement calqué sur l’ancien ; une fois installée, la vieille fille eut donc l’impression d’être chez elle qu’elle n’avait pas éprouvée à ce degré depuis dix ans. Certes le village ainsi restitué demeurait vide, mais pour elle il n’était pas plus vide que ne l’avait été l’autre Hilton, alors que ses compagnons de classe devenaient des pères et mères de famille. Ces personnages respectables ne représentaient nullement les camarades qu’Ida chérissait autrefois et, sans se brouiller avec eux, elle leur en avait voulu de gêner par leur présence des souvenirs qui lui étaient doux.
Naturellement ses nouveaux voisins de Long-Island la croyaient folle, d’une folie paisible et inoffensive. Elle s’en souciait peu, les seuls voisins dont elle fit quelque cas étant les figures nuageuses dont son imagination peuplait l’ex-village arraché à l’oubli. Souvent il lui semblait les voir sourire d’un air de gratitude aux fenêtres des maisonnettes qu’elle leur avait rendues ; car c’était son plaisir de croire que ses vieux amis, morts depuis des années, savaient retrouver le chemin de ce Hilton ressuscité. Tandis qu’elle souffrait des changements de toute sorte, ils avaient dû en souffrir davantage : les vivants se refont, à la rigueur, de nouvelles habitudes, mais les morts ne peuvent être qu’errants et désolés si Dieu leur permet de visiter la terre. Or miss Ludington croyait à cette permission. Le sentiment de faire du bien à de pauvres créatures vivantes n’eût pu la laisser aussi satisfaite d’elle-même que celui de rendre un gîte à ces fantômes déshérités. Toute cette évocation, d’ailleurs, n’avait d’autre but que de former un arrière-plan à la figure capitale toujours présente dans sa pensée ; ce nouveau Hilton n’était que le mausolée de la jeunesse qu’elle adorait, le temple d’une idole : Ida Ludington.
Au-dessus de la cheminée, dans la chambre principale, elle avait suspendu un portrait à l’huile qu’un peintre en renom avait fait d’après la petite miniature pâlie à laquelle il ne ressemblait peut-être pas très exactement, quoique miss Ludington se gardât d’en convenir. Grâce au prestige d’une exécution savante, cette jeune fille aux épaules nues, aux épais cheveux d’or flottant sur une robe blanche, lui paraissait au contraire rappeler sa chérie beaucoup mieux encore que la première image ; c’étaient bien les mêmes yeux d’un violet tendre et profond, le même buste virginal qu’on aurait cru sculpté dans le marbre. Combien brillante, combien pleine, avait été la vie de cette adorable fille ! Combien plus réelle que celle de la personnalité morne et fanée qui depuis si longtemps n’avait reçu d’autre lumière que celle qui jaillissait de ce jeune visage ! Et pourtant tout cet éclat s’était évanoui comme une vapeur et ses éléments ne pouvaient pas plus se combiner de nouveau que ne le pourraient les nuances insaisissables de l’aube d’hier. À cause de cela, miss Ludington, qui entourait d’immortelles les portraits de son père et de sa mère, avait encadré le sien d’un crêpe noir. C’est qu’elle ne pleurait pas sans espoir ses parents ; elle savait qu’elle les retrouverait dans un autre monde, tandis que sa jeunesse était irrévocablement morte ; aucun Messie n’en avait jamais promis la résurrection.
II
La solitude dans laquelle s’était confinée miss Ludington lui était devenue si chère qu’elle ne se résigna que très difficilement à accepter, quelques années plus tard, la tutelle du fils d’une cousine pauvre qui venait de mourir en le lui léguant. Elle aurait largement pourvu à tous ses besoins si elle avait su à qui le confier, mais force lui fut de laisser un enfant envahir son intérieur.
Paul de Riemer avait deux ans quand il arriva chez miss Ludington. C’était un beau petit garçon doux et caressant, aux yeux noirs pensifs et profonds. En entrant dans le salon, il tendit spontanément les bras vers le portrait d’Ida et se mit à lui parler dans son langage indécis. Ce mouvement devait lui gagner aussitôt l’affection de sa tutrice.
Puis, à mesure que le baby grandit, toutes ses questions furent d’abord sur « la belle dame du tableau » ; il était content lorsque sa tante, aunty, comme il l’appelait familièrement, lui racontait des histoires vraies dont Ida était l’héroïne. Pendant leurs promenades à travers le village, les souvenirs de sa jeunesse, réveillés par les lieux et les objets qui l’entouraient, suggéraient à miss Ludington de nouveaux récits. Elle ne se lassait jamais de conter, il ne se lassait jamais de l’entendre, et c’était chose surprenante de voir comme la sympathie naïve de l’enfant consolait la vieille fille. Elle parlait à la troisième personne, car il eût été difficile de faire comprendre à Paul, sans l’étonner et sans l’attrister, quel rapport il y avait entre cette jeune dame, qu’il nommait Ida, et sa vieille tante. Qu’avaient-elles de commun, en effet, sauf leur nom ? Et il y avait si longtemps que miss Ludington s’était entendu appeler ainsi qu’elle ne pensait plus que ce nom lui appartînt.
Un jour Paul, qui avait alors huit ans, se trouvait seul dans le salon. Après avoir longuement contemplé le portrait, il trouva moyen de se hisser sur la cheminée. Il posa ses lèvres sur celles de l’image et les baisait tendrement quand miss Ludington entra. Émue jusqu’aux larmes, elle le saisit entre ses bras et le couvrit elle-même de baisers dont la véhémence lui fit peur.
Un ou deux ans plus tard, Paul annonça qu’il épouserait Ida quand il serait grand ; alors sa tante dut lui expliquer qu’elle était morte. Il en éprouva un tel chagrin, qu’on ne parvint que très difficilement à le consoler.
Le jeune garçon, ne dépassant jamais les limites de ce village factice et n’ayant d’autre société que celle de miss Ludington, subit presque autant qu’elle-même l’influence de la belle créature qui était l’âme de cette solitude. La jeunesse et la beauté d’Ida attiraient son cœur d’enfant, et sa présence mystérieuse lui tenait compagnie. Quand il alla au collège, quand il se trouva dans un autre milieu, il était trop tard pour rompre la trame de ses premiers rêves.
Bien loin d’oublier, Paul, à mesure qu’il grandissait, se laissait captiver davantage. Enthousiaste et rêveur, il fit du portrait d’Ida un divin idéal qui attirait vers lui, comme le soleil pompe les brumes du matin, tout ce qui dans son jeune cœur était sentiment et passion. Rien ne put l’empêcher de tomber éperdument amoureux, pas même l’entière vérité déclarée par miss Ludington. Quoiqu’il fût certain maintenant qu’Ida n’existait plus nulle part, ni dans le ciel ni sur la terre, le culte qu’il lui avait voué subsistait quand même.
« C’était ma destinée de l’aimer, disait-il. Si je n’avais jamais vu son portrait, j’aurais continué toute ma vie à la chercher, sans savoir qu’elle était morte et en me désolant de ne point la trouver. »
Miss Ludington venait de dépasser la soixantaine quand Paul, à vingt-deux ans, termina ses études. Elle avait naturellement supposé qu’en frayant avec des camarades et en voyant d’autres femmes, il guérirait de cet amour romanesque. Le résultat trompa son attente. Au lieu de diminuer, sa passion chimérique prenait, d’année en année, plus d’empire sur lui.
Cette passion qui ressemblait à de la folie ne l’empêchait pas, d’ailleurs, de se livrer au travail avec beaucoup d’ardeur et de sérieux. Ayant conquis ses grades universitaires, il devait aller rejoindre miss Ludington. Celle-ci fut donc fort désappointée de ne pas le voir arriver à l’heure où elle l’attendait, après le dernier examen, et de recevoir à sa place une lettre. Pour quelle raison lui envoyait-il, le jour même de son retour ces nombreux feuillets couverts d’une écriture fine et serrée ?
Paul apprenait à sa tante qu’il avait accepté l’invitation d’un ami et qu’il ne reviendrait que deux jours plus tard.
« Mais ce n’est qu’un prétexte, ajoutait-il, le vrai motif de ce retard, c’est que je désire que vous ayez un peu de temps pour méditer le contenu de ma lettre ; ce que j’ai à vous dire vous semblera bien bizarre au premier abord. J’ai essayé d’y faire allusion pendant les dernières vacances… Je n’ai réussi qu’à vous intriguer et je n’étais pas encore préparé à une explication. Je ne sais quelle timidité m’en empêchait. Peut-être aussi avais-je peur de voir ma pensée prendre un corps, de vous la présenter maladroitement et de vous effrayer par son étrangeté avant que vous eussiez eu le temps d’en examiner le côté absolument raisonnable. Maintenant que je reviens vivre auprès de vous, je sens que je ne serais pas capable de dissimuler plus longtemps.
« Vous rappelez-vous que je vous ai demandé une fois si vous n’aviez pas le sentiment de la présence invisible d’Ida ? » Vous avez cru que je perdais la raison.