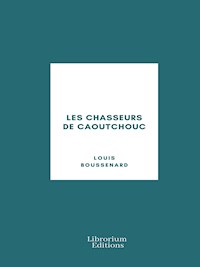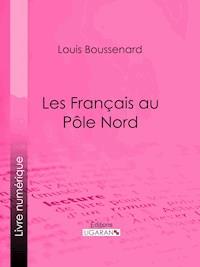0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
C’est là-bas, aux confins de cette Macédoine, terre d’Europe, si proche et pourtant si lointaine... terre inconnue de nous, les gens d’Occident, mystérieuse, belle et malheureuse, une victime suppliciée par deux fléaux terribles, le Turc et l’Albanais.
Macédoine !... une province ?... un royaume ?... une république ?... un État quelconque ?...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Louis Boussenard
La terreur en Macédoine
récit vrai
Edition 1912
© 2021 Librorium Editions
Isbn : 9782383830245
Au lecteur
Il est aujourd’hui des pays qui, depuis des années, sont ravagés par le feu, décimés par le fer et noyés dans le sang.
Et non pas de ces contrées lointaines, encore mystérieuses, où quelque tyran nègre ignorant et féroce, moitié homme et moitié fauve, massacre pour l’immonde joie de tuer.
Non ! ces pays martyrs font partie de notre Europe civilisée, orgueilleuse de ses arts, de ses sciences, de ses découvertes et de ses génies ! J’ai nommé la Bulgarie, la Roumélie, la Macédoine, l’Épire, nations chrétiennes d’Orient que torture à merci le maître musulman.
Et c’est ainsi que des populations honnêtes, laborieuses, inoffensives, sont journellement en proie au vol, au pillage, à l’incendie, au brigandage organisé, à la mort dans les supplices les plus effroyables que puisse inventer la tyrannie la plus atroce et la plus raffinée.
J’ai voulu être l’écrivain de ces souffrances qui passent l’imagination. Et j’éprouve le scrupule bien naturel de vous dire : « Ce récit, documenté avec le plus grand soin et puisé aux sources les plus authentiques, sera toujours conforme à la vérité. Mais, pourtant, cette vérité devra être plutôt atténuée, car il est de ces horreurs que l’on ne peut écrire... »
Je raconterai donc avec tristesse et sincérité les atrocités poignantes dont souffrent les chrétiens d’Orient. Je serai narrateur fidèle et impartial, sans faire intervenir et sans discuter les croyances et sans la moindre préoccupation confessionnelle. Si notre pitié est acquise aux martyrs, c’est parce qu’ils sont avant tout des hommes. Et l’homme qui souffre a droit à notre compassion et à notre respect, quelles que soient son origine, sa nationalité, sa couleur ou sa foi !
C’est pourquoi, aussi, en écrivant ces lignes, je me joins de toute mon âme à ceux qui réclament au nom de l’humanité, pour les martyrs d’Orient, la fin d’une tyrannie qui déshonore un régime et une époque.
L. Boussenard.
Première partie
À feu et à sang
I
En Macédoine. – Fête de famille. – Jeunes époux. – Joie et crainte. – Bonheur précaire. – Marco le Brigand. – Le tchetel. – Le léopard et les douze apôtres. – Oreille coupée. – Pillage, rapine et vol. – Bandit féroce et railleur. – Il faut payer... l’usure de la mâchoire ! – Paroles indignées, mais imprudentes. – Bagarre.
C’est là-bas, aux confins de cette Macédoine, terre d’Europe, si proche et pourtant si lointaine... terre inconnue de nous, les gens d’Occident, mystérieuse, belle et malheureuse, une victime suppliciée par deux fléaux terribles, le Turc et l’Albanais.
Macédoine !... une province ?... un royaume ?... une république ?... un État quelconque ?...
Non ! un souvenir historique, glorieux et stérile ; une abstraction géographique sans unité, sans forme et sans limites. Une sorte de Pologne, qui n’est ni serbe, ni grecque, ni bulgare, et qui est tout cela ; une âme slave et chrétienne à laquelle la conquête veut donner un corps turc et musulman.
Des circonscriptions ottomanes, des gouvernements quelconques découpent l’ancien empire d’Alexandre en vilayets qu’administrent des valis plus ou moins pachas, nommés par le sultan.
Il y a le vilayet de Sélanik avec Salonique pour chef-lieu ; celui de Skodra ou Scutari, chef-lieu Scutari ; celui de Monastir ; celui de Kossovo – Kossovo le Sanglant ! – chef-lieu Prichtina...
C’est un pays de culture et la terre y est féconde. Mais la population y est clairsemée. Elle devrait être énorme, opulente et heureuse...
Certes, partout, dans les villages aperçus de loin en loin, tout blancs sous leurs toitures rouges, c’est le labeur obstiné, c’est l’ardente lutte pour la vie, c’est parfois et pour un moment l’abondance. Mais c’est aussi et toujours l’insécurité, la violence, la terreur !
« Si tu construis une maison à Ipek, dit un proverbe macédonien, ne mets jamais de fenêtres sur la rue ; à Prichtina, tu peux en mettre au premier étage. Mais à Prizrend, avec de bonnes barres de fer, tu peux essayer d’en ouvrir au rez-de-chaussée. »
Il s’agit de villes ayant de quinze à vingt-cinq mille habitants qui, groupés, peuvent se défendre contre les bandits de la montagne.
Quant aux villages ouverts à tous les vents, à tous les intrus, à toutes les convoitises ?... Leur position est effroyable. Écoutez plutôt.
À quelques lieues de Prichtina, le village de Salco est en fête. Et cette fête est d’une surabondance, d’une grandeur et d’une simplicité bibliques.
Nikéa, la fille du maire – mouktar – Grégorio Perticari, épouse Joannès, le fiancé adoré, l’ami si cher de ses jeunes années. Un couple magnifique.
Elle, d’une beauté triomphante, comme son nom venu du grec : Nikê, Victoire. Beauté célèbre qui lui a valu et mérité là-bas le nom de Nikéa la Belle, comme celui de notre ville d’azur et de soleil, Nice la Belle, qui fut aussi Nikê dans l’harmonieuse langue des Hellènes.
Blonde comme les épis, avec des yeux de saphir, noyés de tendresse, une bouche de rose qu’entrouvre l’heureux sourire de ses vingt ans... sourire d’amour, d’espoir, de félicité, et dont l’ineffable caresse ravit le jeune époux.
Lui, brun comme une tzigane, avec des cheveux d’un noir bleuâtre, des yeux de velours, larges, magnétiques, luisants comme des diamants noirs. Une fine moustache cache à peine ses lèvres violemment pourprées ; son menton recourbé, à la romaine, indique l’énergie, cette vertu qui manque aux Slaves ; ses épaules carrées, ses mains courtes, nerveuses, dénotent la vigueur. Avec cela, un regard de flamme, une voix de métal, une âme d’enfant naïf et bon, un cœur loyal et fidèle comme l’acier.
Le père vient de les bénir. L’œil obscurci par une larme attendrie, la voix tremblante, il ajoute :
« Enfants, soyez heureux !
« Les temps sont troublés... le présent est cruel et l’avenir sombre... mais vous avez santé, vigueur, amour, et votre âge est celui de l’espérance...
« Espérez, enfants ! et que rien ne vienne troubler la félicité de ce beau jour.
« Espérez et soyez heureux ! »
Ces paroles du vieillard sont écoutées avec une émotion profonde. Il y a quelques moments d’un silence plein de respect, puis l’orchestre, très simple, prélude, en quelque sorte timidement. Une guzla, un flageolet, un tambourin et une cornemuse, instruments disparates, mais chers aux Slaves du Sud, s’accordent tant bien que mal.
Les jeunes gens, en vestes de drap brun ou écarlate, en longues culottes bouffantes gansées de noir et ceinturées de soie violette, tendent la main aux jeunes filles et les enlacent. Leurs blonds cheveux tordus et nattés avec des sequins d’or, des brimborions d’argent et des grains de corail, charmantes sous leur bonnet grec, les belles filles de Kossovo raffolent de la danse. Aux premières mesures, leurs petits pieds élégamment chaussés de bottines en maroquin rouge trépident et s’agitent en cadence.
Puis les couples partent, s’animent, se grisent de musique et de mouvement, et bientôt tourbillonnent en vertige, infatigablement.
Un peu à l’écart, pressés l’un contre l’autre, les jeunes époux se contemplent, ravis, se parlent doucement à l’oreille et se sourient, extasiés. Ils échangent d’exquises pensées de bonheur intime, se disent à mots entrecoupés la joie de leur cœur, avant de s’élancer au milieu de la cohue vibrante, folle d’allégresse.
« Oui, murmure Nikéa, le père l’a dit, le présent est cruel et l’avenir bien sombre...
« Mais près de toi, ô mon bien-aimé, je ne crains plus rien, car ton amour sera ma sauvegarde et ma force...
– Toujours cette crainte !... toujours ce martyre de la pensée !... Mais, chère âme, ne suis-je pas là désormais pour bannir ces terreurs ?
– Ah ! tu ne sais plus... toi qui reviens de si loin et après si longtemps !...
« Oh ! ce n’est pas un reproche ; mais tu as pu oublier le fléau de notre race, si douce et si aimante, si bonne et si laborieuse !
– Le Turc... l’Albanais !... surtout l’Albanais ! qu’importent désormais ces pillards dans ce grand mouvement qui émancipe aujourd’hui les hommes et les nations ?
« J’estime qu’il est temps de résister à leurs caprices de tyrans, à leurs violences de brutes.
– Non, tu ne sais plus et tu ignores l’état de nos âmes... Sache bien que tu serais seul... que nous serions seuls tous deux à lutter.
« Les autres n’oseraient pas !
– Nous sommes pourtant le nombre et nous avons pour nous la force et le droit.
– Ils n’oseraient pas, te dis-je !
« Songe aux siècles de terreur accumulés sur leurs têtes.
– Que faire, chère âme ?... que faire ?...
– Nous résigner... encore !
« L’impôt est dur... il est injuste... il est écrasant... et pourtant notre labeur saurait y pourvoir... Oui... travailler, se résigner pour être heureux... comme le furent nos pères... malgré l’incessante menace des gens de la montagne.
– Tu le veux ?
– Oh ! non... je t’en prie plutôt... au nom de notre amour et pour notre bonheur si complet, si grand qu’il me fait peur !
– Soit ! je me résignerai aussi, dit-il avec son bon sourire d’homme épris, et quoique la flamme de son regard, semblât, démentir ses paroles.
– Merci ! bien-aimé... oh ! merci !
« Demain... c’est demain seulement qu’ils arrivent pour le tchetel maudit... Viens, la main dans la main, les yeux dans les yeux, nous mêler, à cette belle fête qui est la fête de notre amour. « Forte de ta promesse, je ne crains plus le malheur ! »
Pauvres enfants ! à l’instant même où le présent leur sourit, ce malheur qui menace toujours le paysan de Macédoine s’abat, comme un ouragan dévastateur, sur le village en liesse. Une galopade enragée fait trembler la maison. Des hennissements de chevaux, des fracas de métal s’accompagnent de clameurs humaines.
Le bétail qui somnole dans la grande cour, sous les hangars, un peu partout, s’enfuit effaré. Les buffles noirs vautrés dans la mare s’ébrouent sous une averse de fange ; les moutons se pressent à s’étouffer, dans un coin ; et les petits cochons détalent avec des grouinements exaspérés.
Cependant l’orchestre se tait brusquement.. Les danseurs s’arrêtent, pris d’épouvante, et se précipitent vers les fenêtres. Des clameurs et des gémissements jaillissent de toutes les poitrines. Le père, le vieux Grégorio, lève, désespéré, les bras au ciel. Joannès veut s’élancer vers les intrus.
Nikéa, toute pâle, essaie de le retenir, et gémit d’une voix mourante :
« Oh ! mes pressentiments ! j’étais trop heureuse...
« Que le Dieu tout-puissant nous prenne en pitié et nous protège...
« C’est Marko !... Marko le Brigand !
– Pour vous servir, ma belle enfant !... » répond une voix, railleuse, vibrante, aux éclats de cymbale.
De tous côtés, les danseurs et les danseuses se répandent à travers l’immense cour.. Il en est qui cherchent à s’enfuir, sans savoir où, fous de terreur...
Ce nom terrible qu’accompagne une réputation effroyable a littéralement stupéfié ces malheureux. Yeux éteints, faces pâles, bouches contractées, mains tremblantes, jambes qui se dérobent... ces gens naguère si joyeux semblent des condamnés attendant le coup de la mort.
La voix aux vibrations de cymbale reprend, avec une ironie cinglante :
« Eh bien ! oui... c’est moi, votre excellent ami... votre cher voisin Marko... avec ses douze apôtres !...
« Quoi donc !... notre arrivée vous surprend... vous interloque... vous alarme !...
« Par le diable, mon patron ! nous ne sommes pas des trouble-fête... bien que tu aies oublié de nous inviter, mon vieux Grégorio...
– Seigneur Marko...
C’est très mal, cela !...
– Seigneur...
– Nous sommes pourtant de joyeux compagnons aimant à nous amuser...
– C’est une petite fête de famille, reprend avec effort Grégorio plus épouvanté que jamais.
– Ah çà ! paysan, est-ce que je ne suis pas d’assez haute extraction, moi Marko, bey de Kossovo et pacha de la montagne ?...
– Ce n’est pas... ce que je voulais dire... seigneur... mais je vous attendais seulement demain... jour de Saint-Michel, pour...
– Pour le tchelel, mon impôt... nous savons cela et nous en causerons dans un moment...
« Mais assez d’histoires ! vite à boire... beaucoup à boire... à manger... beaucoup à manger pour mes douze apôtres... ils veulent rattraper le temps perdu... Quant aux chevaux, de la litière jusqu’au ventre... de l’avoine et du maïs plein les auges...
« Et vous, mes braves, pied à terre ! »
L’homme qui parle ainsi en maître et dont l’arrivée sème partout la terreur est un Albanais pur sang. Un bandit, certes, mais un bandit gouailleur, hautain, superbe et formidable.
Vingt-cinq ans à peine, beau comme un demi-dieu de la Grèce païenne et musclé comme un gladiateur antique. Une tête d’une énergie sauvage, avec des yeux gris d’acier, froids et luisants comme des lames de sabre ; un nez à la fière courbure aquiline et cette coupe audacieuse du profil des grands rapaces ; sa chevelure fauve s’ébouriffe en crinière sous le tarbouch à gland noir ; et ses moustaches, fauves aussi, retombent en longues pointes jusqu’à l’arête brutale des mâchoires.
Il porte avec une aisance qui n’est pas sans noblesse un costume éclatant d’une magnificence théâtrale. Veste écarlate soutachée d’or, sur laquelle se croisent deux cartouchières aux étuis bourrés de cartouches ; culotté bouffante et jambières en drap rouge, vaste manteau blanc qui retombe en plis harmonieux, quand il ne s’envole plus au galop éperdu de la chevauchée.
Avec cela, un arsenal. D’abord, en bandoulière, une carabine Martini qui remplace l’immense fusil albanais. Puis, à la selle, un yatagan à la poignée d’or sertie de pierreries. Puis, encore, à la ceinture de soie bleue, une paire de longs revolvers, avec un kandjar et un petit poignard à lame courte et large, de ces lames qui coupent des clous et hachent en scie le meilleur acier anglais..
Il monte un magnifique cheval noir, près duquel s’avance, de son pas silencieux de félin, un lucerdal apprivoisé. C’est un grand léopard des forêts mirdites qui suit son maître comme un chien, semble le comprendre à la parole et lui obéir au geste.
Un terrible compagnon, féroce, intrépide et fidèle.
Les douze apôtres, vêtus également de rouge, avec moins d’opulence, mais aussi formidablement armés, sautent vivement à terre, et laissent la bride sur le cou de leurs chevaux. L’un d’eux porte l’étendard des anciens beys, ou sandjaks, chefs de clans ou de bannières, qui étaient les ancêtres de Marko. C’est le tough, une queue de cheval surmontée d’un croissant d’or et plantée sur une pique.
Les ancêtres de Marko ont été dépossédés par les Turcs. Les chefs de clan indigènes ont été remplacés par des valis, des sandjaks ou des kaïmakans à la solde du sultan. Mais cela est bien égal à Marko qui, parallèlement à la puissance ottomane, conserve et exerce son pouvoir d’ancien seigneur et en abuse avec un sans-gêne et une férocité réellement incroyables.
Le porte-étendard plante le tough devant l’entrée principale en signe de prise de possession. Et nul n’oserait passer outre, même les gendarmes de Sa Majesté le padischah Abdul-Hamid lui-même !
Pendant que le chef parlemente avec le vieux Grégorio, les invités, en habits de fête, s’élancent, empressés, pâles et tremblants, vers les chevaux, les débrident, les bouchonnent, les attachent sous les hangars et leur distribuent, à profusion, la provende.
Le léopard, qui flaire la chair fraîche, fronce le mufle et gronde en sourdine.
« Vite ! s’écrie Marko, un mouton, le plus gras, le plus beau... Hadj n’a pas déjeuné... Il aime les fins morceaux... il serait capable de dévorer une de ces belles filles... et ce serait dommage ! »
On amène un mouton ; le féroce animal, d’un coup de griffe, lui ouvre le ventre et le dévore tout palpitant. Puis, les babines sanglantes, les lèvres plissées en rictus, il perçoit les émanations du troupeau affolé. Il abandonne sa proie, se rue au plus dru et bientôt, ivre de carnage, massacre pour le plaisir de tuer, de se vautrer sur les chairs chaudes...
Attablés, dans la grande salle, parlant fort, mangeant ferme, buvant sec, les apôtres, se font servir par les femmes et les jeunes filles.
Très pâle, mais calme et résolu, Joannès contemple froidement, sans mot dire, les dents serrées, l’orgie. Près de lui s’est blottie Nikéa terrifiée, désespérée, le cœur étreint d’une mortelle angoisse. La carabine entre les jambes, le poignard nu à portée de la main, Marko s’est assis à une table, pendant que, devant lui, Grégorio debout se lamente.
Le bandit a tiré de sa poche une petite planchette longue de trente centimètres, sur laquelle sont découpés au couteau des crans. Puis c’est une cartouche de fusil Martini bouchée par un tampon, de bois remplaçant la balle et, enfin, une mâchoire humaine, un hideux débris de squelette, à laquelle manquent la plupart des dents.
Puis il ajoute froidement, avec une pointe de goguenardise :
« À présent, mon bon, mon cher, mon excellent Grégorio, réglons notre petite affaire.
– Mais, seigneur Marko, répond le vieillard, c’est demain seulement l’échéance... la Saint-Michel...
– Tu te trompes et le calendrier radote.
– Je vous jure... demain...
– Eh bien ! oui, c’est cela... j’y suis et nous sommes d’accord... demain, c’est aujourd’hui !
« Et maintenant, prête une oreille attentive à ce que je vais te dire, car je ne répète jamais un ordre. Va chercher la seconde cartouche et l’autre moitié du tchetel que je t’ai données à la Saint-Georges, quand je suis venu, comme de coutume, t’imposer ma dîme... va et sois prompt. »
Une minute après, le bonhomme revient, tout courant, avec les deux objets. Marko prend la cartouche, reconnaît sur la douille de laiton, le signe arabe qu’il a gravé six mois avant et dit :
« C’est bon. »
Il adapte ensuite la planchette à la sienne et les réunit par le sommet dans l’entaille à angle aigu qui termine la première. Les deux moitiés s’accolent et toutes les encoches coïncident. Cet instrument primitif est, en somme, la taille de nos boulangers, un vestige attardé du moyen âge.
Il y a des encoches pour désigner le nombre de moutons à prélever, d’autres pour les sacs de blé, d’autres encore pour les fûts de vin.
Marko compte gravement :
« Trente moutons... douze fûts de vin... dix-huit sacs de blé... nous verrons tout à l’heure pour le reste... »
Le malheureux paysan se met à gémir :
« Seigneur !... seigneur, prenez-moi en pitié ! Je suis dans une détresse affreuse !...
« Mes champs ravagés par la grêle... mes vignes gelées... et ce damné lucerdal qui vient de massacrer mon dernier troupeau...
« Je n’ai plus de blé !... plus de vin !... plus de moutons, et je suis le plus indigent de tout Kossovo.
– Pauvre ami ! répond avec compassion Marko, je te crois et je te plains de tout mon cœur.
« Mais ne parle pas des moutons... Hadj a mauvais caractère... il croirait à un reproche et il se fâcherait. Je me passerai donc cette année de blé, de vin et de moutons... il faut bien faire quelque chose pour ses fidèles amis quand ils sont dans la peine. »
Stupéfait et surtout inquiet de cette générosité insolite, le vieillard balbutie :
« Ah ! seigneur, que de reconnaissance pour tant de bonté, et comment pourrai-je m’acquitter jamais envers vous ?
Gravement, de son air moitié figue et moitié raisin, le bandit répond :
« D’une façon bien simple : en argent !
– En... ar... en ar... gent !... sanglote le vieillard ; mais... je n’ai pas... une obole... ici...
– Prête l’oreille !... Grégorio... prête l’oreille ! riposte Marko goguenard et menaçant.
– Je suis ruiné !... oui, ruiné...
– C’est entendu ! Mettons cent piastres pour les moutons... Mais... puisque le lucerdal les a massacrés...
– C’est justement pour cela qu’il faut commencer par me les payer.
« Allons !... les cent piastres !...
– Sur mon salut éternel... je suis sans argent.
Marko, qui joue avec son poignard, se précipite d’un bond de tigre sur le vieillard. Avec une rapidité foudroyante il lui saisit l’oreille entre le pouce et l’index, et la tranche d’un seul coup. Le mutilé pousse un hurlement. Le sang ruisselle en nappe. Joannès et Nikéa s’élancent.
Marko jette l’oreille sur la table, l’y cloue d’un coup de poignard et ajoute avec sa bonhomie railleuse et féroce :
– C’est ce que nous appelons prêter l’oreille !... Et cette oreille sera, j’en suis sûr, attentive et docile.
– Grâce pour mon père ! implore en sanglotant Nikéa ; pitié pour lui, seigneur Marko !
– Misérable ! gronde Joannès.
L’Albanais, toujours impassible, pousse un coup de sifflet strident. À ce signal familier, le léopard abandonne sa curée, bondit par la fenêtre, et tombe, en se rasant, devant son maître, avec un grondement de fureur.
Marko continue, riant d’un mauvais rire : « Hadj préfère même, à la chair du mouton, celle de chrétien... il n’aime ni les grands gestes ni les cris... Dans votre intérêt, je vous invite à rester tranquilles, sinon il pourrait vous arriver malheur, car il a la dent dure et la griffe prompte !
Le vieillard étouffe ses plaintes, sa fille tamponne le sang qui ruisselle, pendant que son beau-fils le soutient et le réconforte.
Marko ajoute froidement :
« Nous disons : cent piastres pour les moutons... cent piastres pour le vin... cent piastres pour le blé. »
Le vieillard, anéanti, fait un signe d’assentiment et ajoute d’une voix brisée :
« Tu le veux... tu abuses de ta force... je payerai... mais je ne sais pas où je trouverai cet argent !
– Tu es le mouktar du village... fais comme moi... parle sérieusement à tes administrés... trouve de bons arguments dans le genre des miens...
« Mais continuons : je ne voudrais pas perdre un temps qui, au dire des chrétiens, est de l’argent.. »
Le bandit, à ces mots, débouche les deux cartouches : chacune renferme dix grains de plomb.
« Ces grenailles, dit-il, représentent l’impôt, en argent, car les trois cents piastres, c’est l’impôt en nature... un sequin d’or par grain de plomb, cela me fait dix sequins d’or. Il me les faut !
– Une pareille somme... balbutie Grégorio à un malheureux qui n’a même pas dix piastres !...
– Tu ne m’écoutes plus, mon cher Grégorio... il faudrait me prêter une seconde oreille aussi attentive que la première... Un mot de plus...
– Tue-moi donc tout de suite !
– Ne dis pas de bêtises !... Je suis ton ami et ma générosité me pousse à te faire crédit... un long crédit !... une heure ! une grande heure !... Vois si je suis bon !
« Mais aussi, tu me payeras l’intérêt... les affaires sont les affaires, n’est-ce pas !
« Voyons, mettons, pour l’intérêt, dix autres sequins... C’est donc vingt sequins d’or que tu me verseras dans une heure.
– Filou !... assassin !... bandit !... fils de truie !... Où veux-tu que je vole cette somme énorme ! s’écrie le vieillard exaspéré, perdant soudain toute mesure.
– Silence ! commande Marko avec un sang-froid terrible, et n’oublie pas que les injures se payent à part !
– Encore payer... toujours tondus... toujours écorchés ! L’impôt... les vivres... l’argent... For... et puis quoi encore ?... Notre sang !... Notre vie !
« Je n’ai plus rien et tu ne l’ignores pas... pendant trois longues semaines tu es venu t’installer ici, avec tes brigands et leurs chevaux... vous avez bu, mangé, pillé, ravagé...
– Ton hospitalité fut en effet abondante, généreuse et, pour tout dire, magnifique !
« À tel point que nous nous sommes usé les dents, comme le témoigne cette mâchoire d’un de mes apôtres, mort d’indigestion.
« Tu trouveras donc juste que je te réclame une indemnité pour l’usure de nos précieuses mâchoires1.
– Oh ! tu peux demander... exiger... prendre de force !
– Je demanderai seulement, parce que je suis un homme bien élevé.
« Voyons, trente sequins d’or, est-ce assez ?
– Pourquoi pas cinquante ! s’écrie le vieillard, plus exaspéré que jamais.
– Parce que je sais modérer mes demandes.
« Mais puisque tu offres cinquante, va pour cinquante ! »
Un éclat de rire strident échappe au malheureux, un de ces rires qui confinent à la folie et sont plus douloureux que les sanglots.
Puis il s’écrie d’une voix rauque, toute changée :
« Cause toujours ! va... jette au vent des paroles aussi vaines et inutiles que des feuilles sèches... je n’ai plus rien et je t’échappe... car tu ne réussiras pas plus à tirer de moi une obole qu’à peigner le diable qui n’a pas de cheveux ! »
À ces paroles, un accès d’hilarité folle secoue Marko depuis le gland de son tarbouch jusqu’aux éperons qui ergotent ses talons. Il se tord et s’écrie :
« Impayable ! ce Grégorio est impayable !
« Ma parole ! il ferait pouffer de rire un tas de briques.
« Sois tranquille, mon vieux camarade ; je ne tenterai pas de peigner le diable dont le crâne est comme une pastèque !
« Mais il y a ici de jolies diablesses, toutes roses, toutes blondes, et dont l’abondante chevelure est garnie de sequins... de sequins d’or.
« Je n’y porterai pas une main audacieuse... mais tu vas les prier, en mon nom, de te prêter les pièces d’or de leur coiffure... tu les leur rendras quand tes affaires seront en meilleur état.
« Et surtout fais vite... sois éloquent... car ta seconde oreille et au besoin ton nez ne tiennent qu’à un fil. »
Depuis longtemps déjà Joannès ne se contient qu’avec peine. Seul, sans armes au milieu des bandits qui mangent, boivent et commencent à mener grand bruit, il fait des efforts inouïs pour ne pas éclater, se ruer au milieu de la horde abominable, suivre l’impulsion du sang généreux qui bouillonne dans ses artères, et livrer l’impossible bataille qu’il se sent de force à engager.
En toute autre circonstance, il commettrait ce coup de folie ! Il essayerait d’entraîner ces robustes jeunes gens qui s’évertuent à brosser et à bouchonner les chevaux des brigands !
Mais il a maintenant charge d’âmes et il se contient encore, et à quel prix ! N’est-il pas l’unique protecteur de l’adorable créature qui se blottit, craintive, près de lui, pendant que l’Albanais rapace et féroce continue impassible son hideux marchandage ?
Et puis il veut, dans sa loyauté, espérer en un secours venu du dehors. Comment ! Prichtina est là, tout près... On aperçoit à deux lieues les dômes de ses minarets et les flocons de fumée noire qui s’échappent de la haute cheminée de la minoterie militaire... Il y a une civilisation dans ce chef-lieu de province gouverné par le vali Hatem-Pacha ! Pour appuyer cette civilisation, il y a six mille hommes de troupe, des gendarmes, des fusils, des canons, un général ancien élève de notre école de Saint-Cyr !
Un ordre, un seul mot, et une simple patrouille disperserait comme une bande de moineaux les sacripants de Marko !
Comme pour confirmer cet espoir, hélas ! démenti depuis si longtemps par les faits antérieurs, un galop rapide se fait entendre. Joannès, par une fenêtre, voit arriver un peloton de cavalerie, ottomane commandé par deux officiers. Il reconnaît l’uniforme des gendarmes. Ils sont bien une trentaine..
« Ah ! enfin... c’est la revanche... »
Il va se précipiter vers eux, réclamer du secours...
Devant la maison au pillage, le peloton se met au pas. Officiers et soldats aperçoivent en même temps la bannière de Marko. Et Joannès, écœuré, furieux, entend distinctement le chef dire à son camarade :
« C’est Marko !... il n’y a rien à faire ici pour nous. »
Alors, officiers et soldats portent les armes à l’étendard, et s’éloignent, sachant bien qu’à la prochaine rencontre Marko les récompenseras généreusement, en vrai bandit !
Nikéa n’a pas eu les illusions de son jeune époux. Elle sait que le Turc et l’Albanais s’entendent comme larrons en foire et s’accordent toujours sur le dos du malheureux Slave !
Elle se dresse fièrement devant Marko, arrache les pièces d’or qui oscillent au-dessus de son front, les jette sur la table, et dit avec un mépris écrasant :
« Je te croyais brigand... tu n’es qu’un filou ! »
Marko pâlit, serre les poings, lance à l’imprudente un regard terrible et répond d’une voix sourde :
« Tu vas voir si je suis réellement un brigand ! »
Prises de peur, émues de compassion, les jeunes amies de Nikéa s’approchent à leur tour. Tremblantes, mais indignées, elles arrachent aussi de leur tête les sequins d’or, humbles bijoux séculaires légués par les aïeules !
Elles les lancent dédaigneusement à l’Albanais, et se groupent autour du vieillard, heureuses du sacrifice qui vient de le libérer.
Cependant Grégorio, voyant que Marko demeure en place et ne fait pas mine de s’en aller, lui dit :
« Ces enfants ont généreusement sacrifié pour moi leurs parures...
« Elles se sont dépouillées pour faire ma rançon... vous êtes payé au-delà de vos exigences...
« Je n’ai plus rien, mais nous sommes quittes...
« ... Qu’attendez-vous ?
– Oui, je t’ai tout pris, riposte Marko avec son regard mauvais...
« Eh bien !... je veux le reste...
– Mon Dieu !... que va-t-il me demander encore ? sanglote le vieillard, pressentant quelque chose de plus affreux que tout.
– Ta fille est belle... elle m’a bravé... elle me plaît... je la veux pour épouse !
– Mais... vous raillez, seigneur Marko... puisque, depuis ce matin... ma fille est mariée à Joannès !
– Je suis musulman... je ne reconnais pas le mariage chrétien...
« Du reste, Nikéa la Belle sera heureuse !
« Tu sais nos coutumes... nous professons pour la femme le plus profond respect... la femme, pour nous, est la reine de la maison... l’idole du foyer !
« Mais, tu le sais aussi, nous enlevons la fiancée de notre choix, qui est toujours une étrangère2.
– Je vous le répète, seigneur Marko, c’est impossible... elle est épouse devant Dieu et devant les hommes...
– Ah ! tu refuses... va... je m’en souviendrai !
« Je vais d’abord la rendre veuve... et sur l’heure.
« À moi, mes braves ! »
À ces paroles abominables, les apôtres se lèvent avec un tumulte de vaisselle brisée, d’armes brandies, de jurons. Ils se rangent en un cercle menaçant, hérissé de poignards, et empêchent toute sortie.
Nikéa pousse une clameur déchirante de colère et de terreur :
« Joannès !... mon époux... à l’aide !
« Joannès !... défends-toi !... défends ta femme !... défends notre amour ! »
Chose étrange ! malgré les ardentes supplications de Nikéa, malgré le lucerdal qui veille, malgré Marko qui voit tout, le jeune homme vient de disparaître.
II
Vaine résistance. – Prisonnière. – Tumulte. – Massacre des chevaux. – L’homme à la faux. – Étendard dans la boue. – Un héros. – Mort de trois apôtres. – Joannès ! – Poltrons devenus braves. – Terrible riposte. – Assiégeants et assiégés. – Deux plans. – Léopard messager.
Marko constate l’étrange disparition de Joannès... Il pousse un éclat de rire insultant et s’écrie :
« Il s’est enfui !... le lâche...
« Cela ne m’étonne pas !... un Slave !... c’est poltron comme un lièvre et plus criard qu’une corneille...
– Tu mens ! » riposte, indignée, Nikéa.
Il s’avance pour la saisir et l’entraîner. Son père se jette devant elle et tente vainement de la défendre. D’un terrible coup de poing à la tempe, le bandit le culbute. Le pauvre vieux, assommé, roule sur le sol.
Les apôtres s’esclaffent bruyamment.
« Bien cogné, chef !... un coup de maillet sur la tête d’un bœuf !... ma part de butin qu’il n’en reviendra pas !... si nous mettions le feu à sa culotte ? »
Pâle, échevelée, Nikéa saisit le kandjar passé à la ceinture de Marko, le brandit et s’écrie, menaçante :
« À présent, viens donc me prendre, si tu l’oses ! »
Elle est vraiment superbe d’indignation. Le misérable, qui l’admire ainsi intrépide et résolue, riposte en ricanant :
« Une héroïne !... oui, une héroïne !... elle sera la vraie femme de brigand. »
Se sentant perdue, n’espérant plus rien, préférant à la captivité, à l’outrage, la mort libératrice, elle attaque résolument. Elle lance à la figure de Marko un vigoureux coup de revers. L’Albanais recule. Oh ! d’un seul pas, et cette retraite n’est qu’une feinte. Rompu à toutes les luttes, prévoyant toutes les surprises, il est un trop rude jouteur pour succomber ainsi, d’emblée, surtout devant une femme.
D’un mouvement sec, il rompt les attaches de son grand manteau blanc et le jette, à la volée, sur Nikéa. Le lourd tissu de laine tombe sur la pointe du kandjar. Traversé comme une toile d’araignée, il emprisonne la jeune femme comme sous un filet.
Elle se débat et sanglote, vaincue :
« Lâche !... Lâche !... oh ! je te tuerai. »
Marko triomphant étend de nouveau les mains pour saisir la jeune femme. Ses lèvres se contractent sous un rictus d’ironie, ses yeux flamboient. Il éclate de son rire cinglant comme un coup de cravache et raille :
« Rien ne peut te sauver et tu es ma prisonnière.
« Et maintenant, crie, insulte, menace, mords...
« Je ne crains rien, ni de toi ni de personne au monde !
« ... Et je t’apprivoiserai, comme j’ai dompté mon léopard ! »
Un tumulte épouvantable emplit soudain la cour et interrompt les rodomontades du gredin.
Il y a des fracas et des ruades furieuses qui se mêlent à des souffles époumonnés, rauques et grondants. Puis, de violents soubresauts, des coups sourds, des râles et ces clameurs angoissées, déchirantes, qu’exhalent, sur les champs de bataille, les chevaux à l’agonie.
Les bandits ne se trompent pas sur la nature de ces bruits, malgré leur violence et leur multiplicité. Ils se jettent en furie vers l’entrée unique donnant sur la cour et vocifèrent :
« Les chevaux !... les chevaux !... malheur sur qui touche aux chevaux ! »
Un groupe se presse à l’ouverture étroite, suffisante au passage d’un gredin armé en guerre, avec carabine en bandoulière et arsenal complet à la ceinture. Des épaules s’écrasent, des cous s’allongent, des têtes convulsées par une rage folle apparaissent.
Et quel concert de malédictions !
« Un massacre !... Fils de truie !... bourreau !... écorcheur !... je t’étranglerai avec tes boyaux !... je t’empalerai tout vif !... je te ferai bouillir dans l’huile ! .. »
Un spectacle inouï s’offre à leurs regards navrés. Tous les chevaux mutilés se débattent, le jarret tranché, dans une mare de sang. Tombés sur le côte, incapables de se relever, saignés à blanc, les nobles animaux s’ébrouent, hennissent, ruent de leurs moignons et agonisent, lamentables, pendant que les grands buffles noirs, affolés par la vue et l’odeur du sang, les frappent avec furie du pied et de la corne.
Pâle, tragique, sanglant, un homme se dresse au milieu de ce carnage qu’il symbolise en quelque sorte. Il brandit une faux rouge de la pointe au talon et contemple un moment l’affreuse boucherie qui est son œuvre.
Cet homme, c’est Joannès !
Son regard de flamme se relève, parcourt l’enceinte et se reporte sur ses amis, ses parents, les gens de cette noce interrompue si dramatiquement. Groupés devant un hangar, il les voit grelotter de terreur, n’osant ni avancer ni reculer, et comme figés sur place. Un lamentable troupeau humain paralysé par l’immonde peur et qui oscille, sans volonté, sans dignité.
L’un d’eux balbutie d’une voix éteinte, résumant leurs terreurs et leur passivité :
« Frère !... oh !... qu’as-tu fait... tu as déchaîné... le fléau... le pays sera mis à feu et à sang !... Frère !... les hommes de la montagne viendront en foule... nombreux... affamés et féroces comme des bandes de loups.
« Nos moissons... nos maisons... notre bétail... et nous-mêmes... nos familles... il ne restera rien... Frère !... tu nous as perdus !... Que Dieu nous protège... nous n’avons plus d’espoir qu’en sa pitié ! »
Lui voudrait leur infuser cette intrépidité qui bouillonne dans ses veines, les mener à la bataille, engager à leur tête la lutte ardente, sans merci, qui seule peut les sauver.
Sa terrible besogne l’absorbe. Elle emploie toute sa vigueur, toute son attention. Il n’a pas le temps de leur jeter un mot et ne peut que prêcher d’exemple, en sacrifiant sa vie.
Le voilà près de l’étendard. Le taugh redouté et exécré, toujours debout, comme une menace et une insulte permanentes. Il le crosse d’un coup de pied, l’abat et le roule dans la fange. À ce moment, un premier bandit échappe à la cohue. Il se glisse à travers les membres et les torses tassés, et apparaît. Il voit l’outrage infligé à la bannière de son chef... le sacrilège à l’emblème séculaire. Il s’écrie d’une voix étranglée par la fureur.
« Paysan !... je vais te hacher tout vif ! »
Joannès lève sa terrible faux et riposte :
« Voleur ! je vais te saigner comme un pourceau ! »
Le bandit se présente un peu de biais, le col tendu, la tête penchée, pour mieux voir et s’élancer. Il n’a point le temps de faire un seul pas. Avec une adresse et une vigueur inouïes, Joannès prend juste le moment où il se ramasse pour bondir. La faux, manœuvrée par un bras d’athlète, s’abat de trois quarts, en sifflant, presque sur la nuque.
Il y a un cri... un grognement plutôt, qui s’accompagne d’un éclair rouge... puis un jet de sang gicle, énorme en une coulée de pourpre... et la tête roule à quatre pas du corps, qui tombe en avant, tout flasque.
« Après les chevaux, les hommes ! » crie de sa voix de métal Joannès.
Et les autres, toujours groupés sous le hangar, murmurent de leurs voix gémissantes :
« Il a osé !... oh !... il a osé tuer un de ceux à Marko. »
Un deuxième bandit se présente. La mort de son camarade l’exaspère, mais aussi l’épouvante. Oh ! les temps sont changés ! Quoi !... ces paysans se défendent... ces moutons deviennent enragés. Il hésite une seconde, barre l’entrée, puis allonge vivement les bras pour jeter sa carabine à l’épaule.
Joannès lève de nouveau sa faux.
Dans l’intérieur, on entend les cris étouffés de Nikéa qui se débat sous le manteau dont les plis l’emprisonnent.
« Père !... à moi !... Joannès !... au secours !... Dieu tout-puissant... ne m’abandonnez pas... aux mains de ce brigand... à moi !... mon père... à moi ! mon époux...
« Oh ! je meurs... je meurs... Joannès !... »
Le vieillard reprend lentement connaissance. Il essaye de se relever, glisse, retombe et se cramponne désespérément aux jambes de Marko. Criblé de coups de pied par le bandit qui veut se dégager, le pauvre vieux use ses dernières forces et ne veut pas lâcher prise. Il balbutie d’une voix bredouillante qui s’indigne :
« Il vaut mieux mourir... Ah ! si j’étais jeune... si je pouvais tenir une arme... Le ciel ne nous enverra donc pas un vengeur !... Nous avons été lâches !... lâches !... lâches !... Mais défendez-vous donc, vous les jeunes !... »
Pendant ce temps, les apôtres furieux, ivres, désemparés, vocifèrent, s’agitent, ne sachant plus où porter leurs coups.
Ah ! si les autres voulaient et savaient mettre à profit ce moment de désarroi ! Moment bien court, d’ailleurs, et qui ne dure pas plus d’une minute.
Pour la seconde fois, la faux de Joannès retombe, avec son effroyable bruit de couperet. L’homme qui brandit la carabine pousse un hurlement de bête suppliciée. Sa main droite qui étreint l’arme à la couche est tranchée net, au ras du poignet. Du même coup son épaule gauche est entamée jusqu’à l’os.
Malheureusement, la lame de la faux porte aussi sur le canon d’acier. Le choc est si rude qu’elle vole en éclats, pendant que le bandit pousse des hurlements affreux en agitant ses membres mutilés.
Pour un moment désarmé, Joannès laisse tomber le manche inutile et ramasse la carabine chargée, prêt à faire feu.
Ce mépris de la mort, cette intrépidité commencent à impressionner vivement les paysans. Un seul homme a osé attaquer les apôtres de Marko... ces rapaces formidables auxquels jusqu’à présent rien n’a su résister ! Cet homme vient d’en massacrer deux, et c’est un des leurs !... un Slave comme, eux !
Et Joannès, qui devine leurs pensées, qui sent leurs âmes s’ouvrir à la vaillance, leur crie de sa voix claironnante :
« Défendez-vous !... défendez vos femmes, vos filles... défendez vos demeures... En avant !... mes amis, en avant !
– Il a raison ! répond une voix... c’est bien ce qu’il dit, et c’est beau ce qu’il fait. »
Un homme se détache du groupe apeuré.. Il hésite encore. Un regard de Joannès. l’enhardit, un mot le décide :
« Courage, Michel !... courage... viens !... nous serons les sauveurs... c’est le devoir ! »
En même temps, et avec une vitesse foudroyante, il fait feu sur le troisième assaillant. Frappé en pleine poitrine, l’Albanais s’abat, tué tout raide, sur le coup.
« Voyez !... mais voyez donc comme c’est facile ! hurle Joannès enthousiasmé. Les douze apôtres... l’effroi du pays, ne sont plus que neuf !... Armez-vous !... mes frères, armez-vous, en avant ! et mort aux Albanais ! »
Il jette sa carabine vide. Michel la rattrape au vol et lui passe celle de l’homme décapité.
Cinq ou six canons bronzés s’allongent, en faisceau, par l’ouverture, prêts à cracher les balles. Joannès, aussi avisé que brave, sent qu’il va être canardé. Il s’écrie :
« Ouvre l’œil, Michel, et fais comme moi.
– Ça va bien ! » dit Michel, un gros père tranquille trapu et solide, qui pour ses débuts est superbe.
D’un bond, Joannès se jette derrière le corps d’un cheval, s’aplatit, se tasse, arrive à se rendre invisible et attend. Michel s’abrite comme lui, fouille les cartouchières et lui passe les munitions. Brusquement, les autres s’enhardissent. La contagion de cette intrépidité les gagne. Et puis, ils finissent par comprendre que cette passivité de bêtes à l’abattoir sera leur perte irrémédiable. L’un d’eux résume brièvement leur pensée :
« Puisque nous sommes condamnés... puisque rien ne peut plus nous sauver... mourir pour mourir... eh bien ! mieux vaut périr en luttant »
Un autre ajoute, rageant à froid :
« Ah ! pourquoi avons-nous attendu si longtemps !... »
Et tous crient à pleine poitrine :
« Vive Joannès !... et en avant !... à mort les brigands !... à mort !...
C’est une véritable clameur de vengeance, au souvenir des tyrannies passées, des tortures endurées depuis si longtemps. C’est aussi une clameur de revanche, d’espoir et de délivrance !
Ils empoignent au hasard les fourches et les faux. Ceux qui n’en trouvent pas s’arment de pioches, de bâtons ! Pour un instant Joannès doit les contenir, sous peine de les faire massacrer par les armes à tir rapide. Et puis, il y a les femmes et les jeunes filles enfermées la plupart avec les bandits.
Après un premier moment d’une fureur épouvantable, Marko s’est ressaisi. Il envisage froidement la position et la juge grave.
D’abord, la perte des chevaux est pire qu’un échec, c’est pour le moment un véritable désastre. Elle lui enlève cette mobilité qui fait sa plus grande force. En outre il vient de perdre trois hommes ! Enfin, chose plus grave encore : pour la première fois depuis des temps immémoriaux, les paysans, ces humbles vassaux des hommes de la montagne, ces malheureux serfs taillables à merci, se permettent de résister.
C’est là un fait stupéfiant qui porte une sérieuse atteinte au prestige de ces Albanais indomptés que les Turcs n’ont jamais pu entamer. Pour une fois il est pris au dépourvu. Mais, aussi, qui diable eût songé à cela ! Très calme en apparence, il n’en éprouve pas moins une colère terrible et médite d’épouvantables représailles.
À la rigueur, il pourrait se tirer de ce mauvais pas. Il suffirait de se précipiter en masse sur les assaillants, et de faire une trouée au milieu d’eux. Mais ce serait la fuite, la mort du prestige, la fin de cette crainte séculaire qui fait des paysans la chose des hommes de la montagne. Donc, il faut que Marko parte vainqueur, bannière flottante, et en laissant derrière lui un exemple dont le pays se souvienne un demi-siècle.
Il faut donc attendre, se tenir sur la défensive et repousser, s’il y a lieu, l’assaut. Et puis, rira bien qui rira le dernier !
Marko a son plan. Un diabolique sourire contracte sa figure pendant qu’il dit à ses hommes :
« Nous allons subir un siège ! et la chose ne sera pas banale. Mais, soyez tranquilles, camarades... les morts seront vengés... oh ! terriblement, et nous serons toujours les rois de la montagne, les maîtres de la plaine. »
Aveuglés par la colère, aussi téméraires qu’ils ont été pusillanimes, les paysans se ruent contre la maison. Ils poussent des cris de fureur et brandissent leur armes primitives.
« À mort les Albanais !... à mort les voleurs !... à mort les assassins !... vengeance !... vengeance !... à mort !
– Feu ! » commande Marko en épaulant son martini.
Dix coups de carabine éclatent. Une fumée intense emplit la salle. Les bandits ont tiré de l’intérieur pour ne pas se découvrir. Les femmes affolées gémissent et sanglotent. Dans la cour où l’ouragan de plomb a passé, des corps s’abattent, culbutés en plein élan.
Qui le croirait ? Loin de briser la fougue des assaillants, cette foudroyante riposte ne fait que les exciter. « Le sang appelle le sang ! » hurle Michel jusqu’alors impassible et froid comme un homme de pierre.
Ils vont se faire massacrer follement, sans profit pour la cause sacrée qu’ils défendent. Il faut, pour les arrêter, tout le sang-froid de Joannès et toute la confiance qu’il inspire.
Il les entraîne vers le hangar, où les balles ne peuvent les atteindre, et, là leur parle rapidement à voix. basse. Il a également un plan qu’il expose en quelques mots très clairs, et ses paroles sont acclamées.
« Oui ! tu as raison, Joannès !... tu es le chef !... commande... nous t’obéirons jusqu’à la mort !
– Le temps presse, mes amis... hardi !... à l’ouvrage !... hardi !... ouvrons le conduit par le puits... le travail sera plus facile... À moi de donner le premier coup de pioche.
– Non ! pas toi !... interrompit Michel.
« Tu es la pensée qui dirige... tu dois veiller... donner des ordres... À nous la tâche !
– Bien rude, cette tâche !...
– Bast ! douze ou quinze heures... et ce sera la délivrance de nos filles et de nos compagnes... le châtiment des bandits... et l’affranchissement du pays.
– Bien parlé, Michel, et à l’ouvrage ! »
Pendant ce temps, Marko prépare, lui aussi, l’exécution de son projet. Étrange et de tous points original, ce projet.
Il retire son tarbouch, sa coiffure turque, en feutre écarlate et l’aplatit sur la table. Cela fait, il arrache le poignard qui cloue à une des planches l’oreille du pauvre Grégorio. Avec la lame qui coupe comme un rasoir, il incise une bande circulaire, et large d’environ deux doigts. Il possède ainsi une sorte de collier un peu élastique et très résistant.
Il remet sur sa chevelure fauve la calotte ainsi diminuée d’un dixième et appelle :
« Hadj ! »
Le léopard, qui somnole, repu, les yeux mi-clos, au milieu de la bagarre, entend son nom, proféré comme un sifflement guttural de serpent en fureur. Il s’étire, s’approche et pose sa tête énorme sur les genoux de son maître. Marko lui gratte la nuque, en signe de caresse, et doucement lui passe au col cette singulière cravate. Puis, de sa voix éclatante, il lui crie ce mot :
« Mathisévo !... Mathisévo !... tu entends bien : Mathisévo ! »
Comme s’il comprenait la signification de ces quatre syllabes articulées et scandées par son maître, le léopard rugit, agite sa queue et piétine sur place. Marko lui indique du doigt la fenêtre et répète une dernière fois : « Mathisévo !... »
Puis il pousse un coup de sifflet strident suivi d’un clappement de langue. Le lucerdal se ramasse sur ses jarrets, puis d’un seul bond s’élance jusqu’au milieu de la cour. D’un second élan il franchit l’amas navrant formé par les cadavres de chevaux...
Un coup de carabine retentit, accompagné d’un grognement. C’est Joannès qui a fait feu. Le léopard bondit une troisième fois et disparaît.
Alors, Marko sourit avec son ironie cruelle, darde autour de lui le regard terrible de ses yeux gris et dit lentement :
« Ce rustre l’a manqué !
« Dans douze ou quinze heures, ils seront ici !... et alors, j’aurai ma revanche...
« Une revanche que je veux atroce ! »
III
La sape. – Dans le puits. – Sous la maison.. – Bruits de chevaux. – L’écroulement. – Trop tard ! – Le lucerdal. – Massacre. – Joannès et Marko.– Hadj !... à moi. – Lâche ! – Férocité. – Les pendus. – Atroce mutilation d’un vieillard. – Débris humains. – Effroyable menace.
Le plan de Joannès est très simple. Il consiste à creuser un conduit souterrain, jusque sous la grande salle où se tiennent Marko et ses hommes, les bourreaux et leurs victimes. Un travail de sape.
L’exécution ne semble pas difficile. Mais aura-t-on le temps ? Talonnés par l’angoisse, voulant à tout prix délivrer les chères captives et massacrer les bandits, les paysans commencent avec une ardeur fiévreuse.
Joannès a dit :
« Le puits... creusons par le puits. »
C’est un trou circulaire, très large, mesurant près de trois mètres de diamètre, situé sous le hangar, dans un coin, et revêtu intérieurement d’une maçonnerie grossière, en pierre sèche. Sa profondeur est d’environ huit mètres. Pour tirer l’eau, une corde de chanvre passée sur une poulie de fer attachée à une solive du hangar. À chaque extrémité de la corde, un grand seau de bois.
Pour mener à bien l’entreprise, il faut travailler en silence, ne pas attirer l’attention des brigands et veiller à ce qu’ils demeurent enfermés.
« Je veillerai, dit Joannès, et malheur au premier qui allonge seulement le museau.
« Et toi, Michel, sais-tu manier une carabine ?
– Pas trop mal, tu verras !
– Bon ! à nous deux, nous composons l’infanterie.
« Panitza, tu seras le chef des pionniers. »
Un beau garçon d’une vingtaine d’années, trapu, musclé, les yeux vifs, et francs, s’avance et répond :
« C’est bien, Joannès, j’accepte d’être le chef.
« Comme chef, à moi de travailler le premier. »
Il prend un pic, arrive au puits, et s’installe dans un des seaux, pendant que deux camarades retiennent le cordage.
« Attention ! laissez aller... en douceur... halte. »
À trois mètres de l’ouverture, le sapeur improvisé s’arrête. Avec la pointe de son pic il fait tomber les pierres qui dégringolent avec des plouf ! sinistres.
Vivement il creuse dans la paroi. En peu de temps il a pratiqué une excavation en forme de niche. Il quitte le seau, prend pied dans cette niche, l’amorce du futur conduit, et pioche sans relâche.
Les débris tombent en masse dans l’eau profonde qui rejaillit avec bruit. Joannès quitte un moment sa faction, s’approche du puits et demande à demi-voix :
« Quel sol ?... pierres ?... tuf ?... terre ?...
– Du sable ! répond joyeusement Panitza ; ça se coupe comme du beurre.
– Oui ! mais gare aux éboulements..
– Il faut soutenir les terres en boisant avec des portes, des planches, des douves de tonneaux, des fonds de charrettes... avec tout le bois disponible.
– Entendu ! quand tu seras fatigué, un autre prendra ta place. »
Ainsi commencé, le travail se continue avec une sorte d’acharnement farouche et silencieux. Les débris tombent toujours au fond du puits qui lentement se comble au fur et à mesure que le conduit avance.
Déjà plusieurs hommes y peuvent mener ensemble ce rude labeur. Les uns enlèvent le sable avec des pelles, les autres l’emportent jusqu’au puits dans des couffes, d’autres enfin installent tant bien que mal, à la diable, les planches et les madriers.
Pendant ce temps, les heures s’écoulent, pleines d’angoisse. Pas de nouvelles de l’intérieur. C’est comme si l’on était à vingt lieues de l’énorme salle où Marko et ses bandits attendent, avec leur impassibilité de félins à l’affût.
Le léopard n’a point reparu. Les prisonnières, en apparence résignées, observent un silence douloureux, plein de dignité. Nikéa désarmée n’essaye plus de lutter. Assise près de son père, elle prodigue au vieillard des soins affectueux, le console à voix basse et l’exhorte à la patience.
On s’observe à la dérobée des deux côtés. Nul ne soupçonne ce qui se passe chez l’adversaire, mais on sent que la situation, trop tendue, est près de se dénouer et qu’il va se passer quelque chose de terrible.
... Le boyau de sape est creusé. Affamés, courbaturés, mourant de soif, les intrépides pionniers n’ont pas pris une minute de repos. Le conduit souterrain se poursuit, jusque sous la grande salle qui renfermerait facilement deux cents personnes.
Chose extraordinaire, ils ont travaillé avec tant de précaution que pas un bruit suspect n’est venu donner l’éveil aux bandits. Ils ont ensuite excavé circulairement le centre du plancher. Des piliers, au nombre de six, maintiennent le boisage qui supporte ce plancher.
Ces piliers de bois, dressés en arc-boutants, sont reliés entre eux par des cordes. Ces cordes sont en outre attachées au câble servant jadis à monter l’eau dans les seaux.
Maintenant, les débris retirés de la mine ont comblé le puits jusqu’au boyau transversal. Une petite échelle dressée contre la paroi permet de communiquer facilement avec le dehors.
« Tout est prêt, dit Panitza qui remonte informer Joannès du succès de l’opération.
– C’est bien ! pas de temps à perdre, répond le jeune homme ; empoignez le câble et attendez mon signal. »
Ils sont environ vingt-cinq pouvant travailler utilement. Joannès descend dans le puits, saisit l’extrémité libre du cordage qui sort du boyau. Il aperçoit, à la lueur d’une chandelle, ses camarades arc-boutés, comme des marins parés à haler sur une aussière.
« Vous y êtes ?... » dit-il à demi-voix.
Il va crier l’ordre libérateur, provoquer l’écroulement à pic d’une portion du plancher, tenter le suprême et périlleux effort de délivrance.
Quatorze heures d’un labeur écrasant se sont écoulées.
Un bruit de tonnerre lui coupe la parole et remplit d’effroi son âme jusqu’alors inaccessible à la crainte. Ce bruit arrive aux oreilles des travailleurs à travers les couches de la terre. Il s’amplifie, grandit encore et se précise.