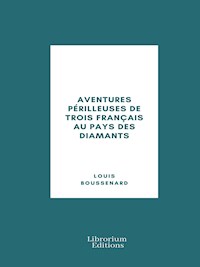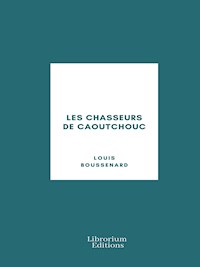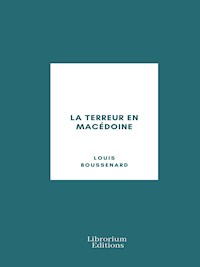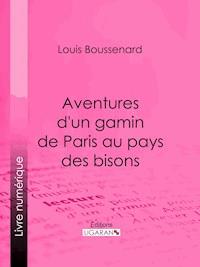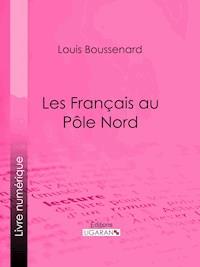
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le congrès géographique international, tenu à Londres en 1886, avait rassemblé, dans la capitale du Royaume-Uni, nombre d'illustrations et de notabilités scientifiques. De tous les points de vue du monde civilisé, les délégués étaient accourus à l'invitation de sir Henry C. Rawlinson, major général des armées de Sa Majesté la Reine et président du congrès."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Congrès international. – Entre géographes. – À propos des explorations polaires. – Russe, Anglais, Allemand et Français. – Grands voyais et grands voyageurs. – Un patriote. – Défi. – Lutte pacifique. – Pour la patrie !
Le congrès géographique international, tenu à Londres en 1886, avait rassemblé, dans la capitale du Royaume-Uni, nombre d’illustrations et de notabilités scientifiques.
De tous les points du monde civilisé, les délégués étaient accourus à l’invitation de sir Henry C. Rawlinson, major général des armées de Sa Majesté la Reine et président du congrès.
Et déjà, depuis près de deux semaines, vieux messieurs à lunettes, sédentaires endurcis, qui, du fond de leur cabinet franchissent monts et forêts, enjambent latitudes et longitudes, gèlent au cercle polaire ou cuisent sous l’équateur, mais par procuration et sans quitter le bienheureux fauteuil… officiers de marine, vaillants, discrets et corrects… professeurs érudits comme des dictionnaires… négociants et armateurs pour qui la géographie n’est pas seulement une science abstraite… et enfin explorateurs bronzés, fiévreux, anémiques encore, mal à l’aise sous le frac noir qui a remplacé leur épique débraillé, étourdis au milieu du va-et-vient incessant et du tumulte de la Cité… bref, tous ceux qui, de près ou même de loin, touchent à la géographie, l’aiment, l’étudient, l’enseignent, la cultivent à un titre quelconque, en vivent et trop souvent, hélas ! en meurent, se trouvaient réunis quotidiennement, de deux à quatre heures, à la National Gallery, où se tenaient les assises du congrès.
De ce congrès en lui-même, rien à dire. Ni meilleur ni pire que les précédents et sans doute que ceux qui suivront. Chaque jour les membres arrivent avec l’implacable ponctualité de gens habitués à couper des minutes en quatre et des secondes en huit, retirent leur pardessus, apparaissent chamarrés de décorations polychromes, se saluent, s’installent, semblent prêter l’oreille aux choses palpitantes qui perdent sans doute à être nasillées par un personnage quelconque, et attendent patiemment le coup de quatre heures frappé par le marteau de l’horloge monumentale.
La séance est finie. Et c’est alors seulement que l’assemblée semble se dégeler. Il y a un de ces petits brouhahas de fin de classe, bien connus des écoliers, puis des conversations s’engagent, des présentations s’opèrent, des poignées de mains s’échangent, et on cause un peu de tout, même de la question agitée en séance.
Enfin, après un temps plus ou moins long subordonné à l’état de l’atmosphère, à l’intérêt de la chose exposée, au potin du jour, aux affaires ou au plaisir, l’assemblée délibérante se dissout sans délibérer.
Les membres quittent Trafalgar-Square par petits groupes qui se forment sous l’influence de la curiosité, de sympathies brusquement écloses, parfois aussi de contrastes entre personnes ou de rivalités entre citoyens de nationalités différentes. Et chacun s’en va où bon lui semble en attendant la prochaine, réunion.
Telle est, sauf légères variantes, la façon dont se comportent les congrès. On traite, au milieu de l’indifférence générale – indifférence de bon ton, d’ailleurs – un certain nombre de questions qui demeurent inconnues aux membres jusqu’à la publication du compte rendu, et on se sépare après congratulations générales, interviews de reporters et averses de médailles et de décorations.
Mais ces assises scientifiques ont du moins cela d’utile, qu’elles rapprochent des hommes qui s’ignoraient ou se méconnaissaient, créent parfois des liaisons durables, excitent une nouvelle émulation et produisent d’autre part des évènements tout à fait inattendus.
C’est positivement ce qui arriva le 13 mai – jour fatidique – à l’issue d’une séance aussi incolore que les précédentes.
Un géographe allemand – un géographe de profession appartenant à l’honorable corporation des sédentaires – avait pendant deux heures consécutives, parlé des voies d’accès au pôle Nord et si consciencieusement assommé l’auditoire, que chacun semblait, au sortir de la National Gallery, porter la banquise sur ses épaules.
Quatre hommes heureux d’échapper aux frimas distillés goutte à goutte par l’implacable orateur, se rencontraient sous l’entrée monumentale et échangeaient un shake-hand.
« Ah ! messieurs, quel "rasoir" que ce M. Ebermann avec son pôle Nord ! dit en français l’un d’eux avec une sorte d’effarement comique.
C’est à peine si la Néva est en débâcle depuis un mois… la moitié des États du tzar mon maître est encore sous la neige, j’accours ici comptant savourer ce petit rayon de soleil qui me fait risette, et votre compatriote, mon cher Pregel, sans égard pour un malheureux qui mène pendant six mois une existence d’ours blanc, parle… parle à me donner des engelures. »
Les trois autres se mettent à rire en entendant cette saillie, et le personnage désigné sous le nom de Pregel répond, également en français, mais avec un léger accent allemand :
Oh ! mon cher Sériakoff, prenez garde d’être injuste à l’égard de mon compatriote… Il a dit des choses parfaitement sensées…
– Vous protestez contre l’expression de rasoir ?… par égard pour vous et par amour de la couleur locale, je la remplace par celle de scie à glace… là !
Qu’en pensez-vous, monsieur d’Ambrieux ?
– Mais, répond évasivement ce dernier, je suis désintéressé dans la question.
– C’est-à-dire que vous voulez, avec votre courtoisie toute française, éviter jusqu’à l’ombre d’une récrimination à l’égard de ce monsieur qui s’est appesanti si lourdement sur l’abstention de vos nationaux relativement aux questions polaires.
Après tout, vous avez peut-être raison… un silence méprisant…
– Sériakoff ! interrompt brusquement l’Allemand Pregel en rougissant.
– Eh bien ! messieurs, dit d’une voix calme le quatrième personnage, muet jusqu’alors, n’allez-vous pas vous quereller pour une chose aussi insignifiante !
Allez-vous prendre feu au contact de la banquise ?
Songez plutôt que ma voiture vous attend, que mon cuisinier français élabore votre dîner, que mon maître d’hôtel fait tiédir mon vieux claret et glace mon meilleur champagne…
– Oh ! cher sir Arthur, voilà qui est parler d’or, et ce dernier mot me raccommode avec les icebergs, les hummocks, les paks et autres variétés de glaces, depuis la montagne jusqu’à l’aiguille.
« La glace a du moins cela de bon qu’elle sert à frapper le champagne. »
… Le dîner offert à ses trois invités par sir Arthur Leslie fut exquis et superlativement arrosé. Il se prolongea même fort longtemps et sembla de prime abord avoir fait oublier le mot aigre-doux proféré par Sériakoff, quand un propos du Russe vint remettre incidemment sur le tapis la question polaire.
Tenez, mon cher Pregel, dit-il en sablant lestement le verre où pétillait la blonde liqueur, croyez-moi, un pays qui produit un semblable nectar peut se désintéresser de bien des choses, fût-ce des expéditions arctiques.
– Quel enfant terrible vous faites, Sériakoff ! interrompit avec une sorte d’indulgence paternelle sir Arthur Leslie, de beaucoup plus âgé que le Russe.
Ne dirait-on pas, à vous entendre, que la science des découvertes vous est indifférente… que depuis dix ans et plus vous n’avez pas conquis une juste notoriété parmi ces vaillants explorateurs qui sont la gloire de notre fin de siècle !
– Trop aimable, en vérité, mon cher hôte, pour mes modestes exploits de globe-trotter.
Mais…
– Mais ?
– Les appréciations de meinherr Ebermann sur le rôle de la France m’ont laissé comme un arrière-goût d’amertume.
Que voulez-vous, j’aime la France, moi !
Je l’aime pour sa générosité, pour son désintéressement, pour son caractère chevaleresque… Je l’aime avec ses vertus et avec ses vices… Je l’aime enfin parce que je l’aime, comme une seconde patrie, et je ne suis pas le seul en Russie. »
À ces paroles vibrantes d’émotion et de sincérité, M. d’Ambrieux, l’œil brillant, les narines frémissantes, tendit silencieusement, par-dessus la table, sa main au Russe qui la serra énergiquement.
Eh ! mon cher, j’approuve d’autant plus votre sympathie pour la France, qu’à notre époque de fer et de triple alliance, il est un peu de mode de la décrier, reprit sir Arthur.
Elle a fort heureusement bec et ongles pour se défendre…
Du reste, la question n’est pas là.
Voyons, nous sommes ici un petit comité d’esprits éclairés, supérieurs à toute mesquine susceptibilité… capables d’entendre et de proclamer certaines vérités sans être froissés.
– Il est bien entendu que l’on peut tout dire quand on n’a pas d’intention blessante.
Où voulez-vous en venir, cher sir Arthur ?
– À ceci, mais je solliciterai préalablement de M. d’Ambrieux la faveur de parler à mon point de vue :
Je connais, mon cher collègue, votre ardent patriotisme et je veux que mon appréciation ne lui porte aucune atteinte, même la plus légère.
– Mais, mon cher hôte, je ne suis pas un de ces chauvins ombrageux qui ne peuvent souffrir la moindre contradiction.
Mon patriotisme n’est point aveugle, et le jugement, quel qu’il soit, porté par un homme comme vous sur mon pays, ne peut être qu’impartial.
Parlez donc, je vous en prie.
– Je proclame volontiers que pendant près d’un siècle, c’est-à-dire depuis 1766 jusqu’à 1840, la France surpassa, et de beaucoup, les autres nations, y compris l’Angleterre, par le nombre et les résultats des voyages maritimes entrepris pour la découverte de pays inconnus.
Je rappellerai avec admiration Bougainville, Kerguelen de Tremarec, La Pérouse, Pages, Marchand, Labillardière, d’Entrecasteaux, Freycinet, Duperré, Vaillant, Dupetit-Thouars, Laplace, Trehouart, Dumont d’Urville, dont les noms illustres tiennent la place la plus glorieuse dans les fastes géographiques.
Mais ne trouvez-vous pas, comme moi, que votre pays semble avoir, depuis un demi-siècle, renoncé à ces brillantes expéditions ?
– D’où vous concluez, sir Arthur ?
– Que dans le fond, sinon dans la forme, blâmable selon moi, en dépit de son apparente correction, meinherr Ebermann ne s’est point trop écarté de la stricte vérité.
– Mais, vous faites erreur, interrompit avec vivacité M. d’Ambrieux, et quelques noms pris au hasard dans l’intrépide phalange de nos explorateurs contemporains vous convaincront du contraire.
Le marquis de Compiègne et Alfred Marche au Gabon, de Brazza au Congo, Jean Dupuis au Tonkin, Crevaux, Thouar, Coudreau et Wiener dans l’Amérique du Sud, Soleillet au Sénégal, Caron à Tombouctou, Giraud aux grands lacs d’Afrique, Brau de Saint-Pol-Lias en Malaisie, Pinart dans l’Alaska, Neïs et Pavie en Indo-Chine, Bonvalot, Capus et Pepin en Asie et tant d’autres, partis avec leurs seules ressources ou des subsides insuffisants, presque dérisoires…
– Eh ! c’est positivement là où je trouve blâmable l’inertie de votre gouvernement, qui en somme est riche, comme aussi l’indifférence des simples particuliers qui, se trouvant en possession de fortunes considérables, aiment mieux thésauriser que de sacrifier leurs gros sous à une œuvre glorieuse.
L’épargne française, égoïste et liardeuse, n’a même pas su couvrir la souscription de l’infortuné Gustave Lambert, tandis que chez nous ou en Amérique, le premier millionnaire venu se fût empressé de subventionner l’expédition.
Tenez, mon cher collègue, trouvez-moi donc chez vous des Mécène comme notre Thomas Smith qui paya intégralement les frais des voyages de Baffin, ou comme Booth qui offrit à Bass 18 000 livres (450 000 francs) !
Et l’Américain Henry Grinnel qui commandita le docteur Kane ; et le Suédois Oscar Dickson qui ; après avoir fait les frais de six expéditions polaires, équipa la Véga pour Nordens-kiold ; et cet autre Américain, Pierre Lorillard, qui défraya votre compatriote Charnay au Yucatan ; et Gordon Bennett qui, après avoir envoyé Stanley à la recherche de Livingstone, paya de ses deniers la Jeannette…
Et quand l’État ou les millionnaires chômaient, l’humble obole des petits ne manquait pas aux voyageurs.
N’est-ce pas une souscription nationale qui permit au capitaine américain Hall d’équiper le Polaris, comme aussi aux Allemands de faire voguer sur les mers polaires la Germania et la Hansa, et enfin au lieutenant de l’armée américaine Greely d’atteindre 83° 23 ″ et de nous devancer glorieusement, nous autres Anglais, sur la route du pôle !
Voyons, mon cher d’Ambrieux, qu’avez-vous à répondre à cela ?
– D’autant plus, ajouta loyalement Pregel, que l’intrépidité comme aussi le désintéressement des explorateurs français, ainsi réduits, comme vous le disiez, à leurs seules ressources, n’en sont que plus méritoires.
Il ne nous en coûte nullement de reconnaître leur vaillance et leurs éminentes facultés.
Ainsi, mon cher Sériakoff, nous sommes d’accord ou à peu près, et voici l’incident soulevé par vous au sujet de ce pauvre meinherr Ebermann, réduit à ses proportions réelles.
– Eh ! donc, mon cher, si je me suis ainsi emballé, c’est que ce vieux géographe distillait mot à mot son venin avec une intention marquée d’être désagréable aux Français.
Ma parole ! s’il avait été plus jeune…
– Vous nous haïssez donc bien ! vous, nos amis d’hier ?
Vraiment, à vous entendre, on dirait que vous êtes Français.
– Vous voudriez peut-être que mes amis de là-bas vous portassent dans leur cœur !
– Je ne demande pas l’impossible.
Je trouve seulement que les Français ont la rancune tenace. – Sacrebleu ! Comme vous pratiquez généreusement le pardon des injures que vous avez commises, vous autres Allemands.
– Je ne comprends pas.
– Je m’explique.
L’Allemagne s’est battue contre la France… un duel entre nations… comme entre gentlemen.
Rien de mieux.
Mais que diriez-vous du gentleman qui, à l’issue d’un combat singulier, rançonnerait son adversaire vaincu et lui volerait sa montre ou son portefeuille ?
Vous, moi, sir Arthur Leslie, d’Ambrieux, tout le monde enfin, dirait que c’est un… ma foi ! je ne sais pas le mot allemand équivalent au mot français, très énergique, qui me brûle les lèvres.
Je voudrais cependant le connaître pour qualifier le rôle de l’Allemagne vis-à-vis de la France, car l’Alsace-Lorraine est un bijou de prix…
– Sériakoff !…
– Eh ! mon cher, voici la seconde fois que vous criez mon nom d’une façon toute bizarre…
On dirait l’éternuement d’un chai qui a une arête dans le gosier.
Si mes paroles vous sont désagréables, dites-le.
« L’Angleterre produit le meilleur acier du monde, et avec un peu de bonne volonté, nous pourrions trouver une jolie paire de lames pour nous faire la barbe demain matin. »
Très pâle, mais calme et résolu, Pregel allait riposter par un mot susceptible de rendre toute conciliation impossible.
Sir Arthur Leslie, en bon Anglais amateur de sport, flairant une rencontre dont il serait le témoin obligé, n’avait pas fait un geste pour arrêter la querelle naissante.
Du reste, le digue gentleman était un peu gris, et cela l’amusait, de voir ses convives s’asticoter. Fidèle à la politique de son pays qui consiste à faire battre les autres pour en tirer profit ou distraction, il attendait l’intervention du Français.
Elle ne se fit pas attendre.
« Messieurs, dit-il en développant lentement sa stature de géant, permettez-moi de vous mettre d’accord, en ma qualité de principal intéressé, ou tout au moins d’assumer les responsabilités d’une affaire dont je suis la cause occasionnelle. »
Pregel et Sériakoff voulurent l’interrompre et protester.
Je vous en prie, messieurs, laissez-moi parler ; vous jugerez ensuite et ferez ce que la raison commandera.
Si la France a de tout temps été, comme on le répète encore, assez riche pour payer sa gloire, elle ne l’était pas moins pour payer sa défaite.
Elle a soldé sans récriminer les milliards conquis et n’eût conservé des jours sombres de l’année maudite qu’un souvenir dont l’amertume se fût bientôt atténuée, si on ne lui eût imposé une atroce mutilation.
Vous, Anglais, vous, Russes, lui avez-vous tenu rancune de ses victoires et vous a-t-elle haïs pour ses défaites ?
Jamais ! Car si elle a été magnanime aux jours de succès, vous lui avez épargné, après ses revers, la suprême honte et l’affreuse douleur du démembrement.
Et vous semblez étonnés, vous, Allemands, si après avoir si cruellement pesé sur elle de tout le poids de vos victoires, elle conserve un souvenir amer de sa mutilation !
En présence de ce lambeau de sa chair brutalement arraché, devant cette plaie incurable qui saigne toujours à son flanc, vous vous dites : « C’est extraordinaire ! on ne nous aime pas en France, et on pense toujours à la revanche… »
Mettez-vous à ma place, vous, monsieur Pregel, que je regarde comme un patriote, et dites-moi ce que vous penseriez de nous, si nous acceptions de gaîté de cœur cette clause lugubre imposée par vos plénipotentiaires.
Ne demandez donc pas notre amitié, parce que cette amitié serait absurde ; ne demandez pas davantage l’oubli, parce que cet oubli serait monstrueux.
Et surtout, ne trouvez pas étrange si l’on se recueille là-bas, à l’occident des Vosges.
Aussi, avant de songer au superflu, nous devons préparer le nécessaire. Ce superflu, c’est pour nous cette gloire que procurent les expéditions périlleuses dont nous nous abstenons, au grand regret de votre compatriote meinherr Ebermann ; le nécessaire, c’est le souci de notre sécurité.
En ces temps de triple alliance, où le vieux dicton : si vis pacem para bellum transforme l’Europe en un formidable camp retranché, notre défense nationale a besoin de tous ses moyens. Elle exige qu’aucune unité, même la plus infime, ne soit distraite au profit d’une œuvre étrangère à notre régénération.
Nous restons chez nous, monsieur ! Et jusqu’à nouvel ordre, notre pôle Nord, c’est l’Alsace-Lorraine.
– Bravo ! s’écrie le Russe enthousiasmé, bravo ! mon vaillant Français.
– Mon cher d’Ambrieux, dit à son tour sir Arthur Leslie, vous parlez en gentleman et en patriote.
« Croyez à ma vive sympathie et à ma profonde estime. »
Pregel, ne trouvant rien à répondre, s’inclina courtoisement.
« Cependant, continua d’Ambrieux de sa voix vibrante, ce que notre gouvernement, sollicité par de si graves intérêts, ne peut pas, ne doit pas entreprendre, un simple particulier aurait peut-être la faculté de le tenter.
Somme toute, il n’y a pas, que je sache, péril en la demeure, et en cas de conflit immédiat, ce ne serait toujours qu’un volontaire de moins.
Monsieur Pregel, voulez-vous accepter un défi ?
– Monsieur d’Ambrieux, répondit l’Allemand, sans entrer dans des considérations d’ordre purement sentimental que j’admets et respecte chez vos concitoyens, j’accepte votre défi, à la condition toutefois qu’il ne doive susciter aucun incident capable de mettre aux prises nos gouvernements.
– Je l’entends bien ainsi.
Je possède une fortune considérable… Vous aussi, peut-être.
Du reste, peu importe !
Vous pourrez, en invoquant le précédent de la Germania et de la Hansa, trouver un appui que ne vous refuseront pas vos compatriotes, surtout quand ils sauront qu’il s’agit de répondre au défi d’un Français.
– Que voulez-vous dire ?
– Que je veux équiper à mes frais un navire et le conduire là-bas, sur la route du Pôle.
… Je vous propose d’en faire autant, et d’accepter un rendez-vous, au milieu de l’Enfer de Glace.
Au lieu de faire, comme à la National Gallery, de la géographie en chambre, nous nous élancerons, à travers l’inconnu, cherchant à devancer ceux qui nous ont précédés sur la voie douloureuse, et luttant à armes égales chacun pour la gloire de notre patrie.
Acceptez-vous ?
– J’accepte, monsieur, répondit gravement Pregel sans hésiter.
Votre proposition est trop belle pour que j’en décline le périlleux honneur, et ce ne sera pas de ma faute, je vous le jure, si là-bas le drapeau allemand ne s’avance pas plus loin que le pavillon français.
– Plus la lutte sera vive, plus l’honneur sera grand pour le vainqueur et je vous assure que, de mon côté, je ferai tout au monde pour assurer le triomphe de l’étendard aux trois couleurs.
– Monsieur, vous avez ma parole.
– Je vous engage la mienne.
– Quand voulez-vous partir ?
– Mais, de suite, si vous ne voyez nul inconvénient à ce départ précipité.
– Aucun.
– Eh bien ! messieurs, au revoir.
Merci de votre aimable hospitalité, sir Arthur Leslie.
Merci à vous, mon cher Sériakoff, d’avoir provoqué cet incident.
– Et vous m’emmenez, hein ! d’Ambrieux ?…
En ma qualité de Russe, je suis un peu parent de la banquise.
– Impossible, à mon grand regret, cher ami.
L’expédition doit être exclusivement française.
– Allons, tant pis !
J’eusse été pourtant bien heureux de vous accompagner, et de contribuer, dans la limite de mes moyens, à la victoire que je vous souhaite de tout cœur au pavillon français.
– Encore une fois, messieurs, au revoir, termina d’Ambrieux en prenant congé.
Nous sommes en mai et le temps presse.
– Celui-là, messieurs, ira loin ! dit sir Arthur Leslie quand d’Ambrieux fut sorti.
– Et il ne sera pas seul ! » riposta Pregel en se retirant à son tour.
Avant l’appareillage. – Le capitaine d’Ambrieux. – Pour la patrie ! – Un brave. – Descendant des Gaulois. – Construction de la Gallia. – Équipement d’un navire. – Matériel que comporte une expédition polaire. – Soins minutieux donnés à l’approvisionnement et à l’habillement. – Équipage bigarré mais irréprochable. – Tous Français. – Instant solennel. – Départ
« Le Havre, 1er mai 1887.
Mes chers parents,
Si je mets la main à la plume, c’est pour vous annoncer que nous appareillons aujourd’hui, à la marée du soir, c’est-à-dire dans deux heures, et à seule fin finale de vous donner de mes nouvelles, vu que d’ici à longtemps je ne trouverais pas de boîte aux lettres ni de facteurs.
Pour quant à vous dire que je suis content de mon engagement, je suis content. Mais je dois vous faire part d’abord que je ne navigue ni pour l’État, puisque j’ai achevé mon temps, ni pour une compagnie maritime, comme qui dirait Transatlantique ou Chargeurs, ni pour le compte d’un armateur faisant pêche ou négoce.
Je suis sur un navire appartenant à un homme riche qui voyage pour son agrément, et qui s’en va dans un endroit qu’on appelle pôle Nord, peu connu des matelots et même des amiraux.
Mais ça ne fait rien, car paraît que nous partons en découverte. Une idée de particulier calé en monnaie, qu’a du temps à perdre et de l’argent à faire gagner à de fins matelots.
Ainsi, moi qui vous parle, je suis engagé pour trois ans, à quatre-vingts francs par mois pour la première année, cent francs pour la seconde et cent vingt francs pour la troisième.
Pour être une somme conséquente, on pourra pas dire que ça soit pas une somme conséquente.
Bien mieux que ça encore. Paraît que tout un chacun touchera un dixième de sa solde en plus, à partir du jour où que le navire aura franchi le cercle, polaire.
Vous devez connaître ça, vous, mon ancien, qu’avez couru la bordée du côté des mers glaciales.
Paraît que ce cercle polaire, c’est comme qui dirait la ligne pour les pays froids. Le maître nous a expliqué ça, rapport à la chose de la haute paye ; mais, pour tant qu’à moi, je n’ai rien compris, sinon que ça me rapporterait un bitord de vingt-cinq ou trente pièces de cent sous par an.
Mais, bien plus fort que tout le reste. Notre engagement, à tout un chacun, porte qu’au retour, il y aura pour chaque homme une prime de mille francs, si on monte à une certaine hauteur du côté de ce nommé Pôle.
Dans ces conditions-là, c’est un vrai beurre de bourlinguer. Une campagne vous enrichit un matelot et lui permet de s’établir en rentrant.
Faudra donc pas vous étonner si vous restez sans nouvelles, ni vous tourmenter sur mon compte.
Pour lors, je vous annonce que je suis en bonne santé, et que je souhaite que la présente vous trouve de même, et je vous embrasse tous, le pé, la mé, les petits, en vous promettant que je ferai mon devoir de bon matelot normand.
Votre fils et frère pour la vie,
CONSTANT GUIGNARD.
Matelot à bord du navire Gallia, pour deux heures encore au bassin Bellot. »
Après avoir élaboré avec de grands gestes d’écolier malhabile cette lettre dont la forme un peu fantaisiste est scrupuleusement respectée, le marin plia le papier en quatre, l’insinua dans une enveloppe, cacheta celle-ci en appuyant de toute la force de son gros poing sur la portion gommée et se pencha au-dessus du bastingage.
Eh !… moussaillon… dit-il en hélant un gamin qui flânait en curieux sur le quai de la première darse du bassin.
– Voilà, mon ancien.
– Prends ce bout de billet et c’te pièce de dix sous.
Cours acheter un timbre, colle-le sur la lettre et mets-la dans le pertuis d’une boîte à poste.
« Tu boiras une bolée de cidre avec la monnaie.
– C’est inutile, mon garçon, dit un homme de haute taille, de belle et noble figure, qui, accoudé sur la lisse, a entendu la recommandation du matelot.
– À vos souhaits, capitaine, mais, pourtant, le bout de billet pour mes vieux de là-bas…
– Le maître va tout à l’heure se rendre à la poste, il emportera ta lettre avec les miennes et celles de tes camarades. »
Puis il ajoute, en s’adressant à un marin qui inspecte minutieusement les agrès du navire :
« Guénic, rassemble l’équipage. »
Ce dernier porte à ses lèvres un sifflet d’argent, et en tire une série de sons stridents qui font surgir du panneau de la machine et de la grande écoutille les hommes occupés à l’intérieur.
En moins d’une minute tout le monde est rangé au pied du grand mât, en face du capitaine.
« Mes amis, dit-il sans préambule, quand vous vous êtes engagés pour la campagne que nous allons entreprendre, on ne vous a pas caché les dangers et les souffrances qui vous attendaient.
Vous ayez signé en toute connaissance de cause, et pourtant, j’éprouve comme un dernier scrupule, avant de vous emmener là-bas, au pays inconnu dont tant de vaillants matelots ne sont pas revenus.
Dans deux heures et demie, le navire aura quitté la France pour deux ou trois années… peut-être pour toujours…
Voyons, mes amis, pas de fausse honte… pas d’hésitation, car l’instant est grave… êtes-vous toujours fermement résolus à me suivre quoi qu’il arrive ?…
S’il en est quelques-uns parmi vous qui craignent les souffrances, les privations, la maladie et la mort… qu’ils parlent sans appréhension et demandent à débarquer… je romprai de bon gré leur engagement et ne conserverai nul grief contre eux.
Bien plus, je vais remettre à chacun de vous deux cents francs, à titre de gratification pour votre excellente conduite à bord, pour les soins exceptionnels que vous avez donnés à l’armement du navire et à l’arrimage de tout le matériel ; cette somme est et demeure acquise à quiconque manifesterait l’intention d’abandonner mon bord.
Quoique vos résolutions doivent être prises depuis longtemps, réfléchissez cinq minutes encore… Consultez vos forces, faites appel à votre énergie, concertez-vous et donnez votre réponse définitive au maître d’équipage Guénic, qui me la transmettra. »
Il allait se retirer sur le gaillard d’arrière pour ne pas influencer par sa présence le groupe immobile des matelots, quand un jeune homme de moyenne taille, plutôt petit que grand, mais d’aspect singulièrement agile et vigoureux, quitte brusquement ses camarades, ôte son bonnet, salue crânement son chef et s’écrie :
Merci pour vos bonnes paroles et vos bonnes intentions, capitaine ; mais je vous déclare sans embardées, au nom de l’équipage, que nous vous suivrons partout !… fût-ce au diable s’il vous plaît d’y aller !
Tous, tant que nous sommes ici, Provençaux et Bretons, Normands et Gascons, Flamands et Alsaciens, car il y a de tout, même des Parisiens, sur ce crâne bateau, pas un ne flanchera…
« Je vous le jure !… Pas vrai, les autres ?…
– Nous le jurons ! » répondent d’une seule voix les hommes en agitant leurs bonnets.
Puis éclate un immense cri : « Vive le capitaine ! » qui se répercute jusqu’au fond du bassin.
À la bonne heure, mes braves ! reprend l’officier dont l’œil rayonne ; voilà qui est parlé en vaillants Français.
… L’œuvre à laquelle vous êtes associés désormais est périlleuse autant que grandiose… J’ajouterai qu’elle est en quelque sorte nationale, puisque, j’en ai le ferme espoir, nous planterons le drapeau tricolore là où jamais humain n’a mis le pied, et que l’honneur de nos découvertes rejaillira sur notre pays.
« Vive la France !
– Vive la France ! » rugissent en trépignant d’enthousiasme les matelots électrisés.
Un lier homme, en vérité, que cet officier vibrant de patriotisme et qui domine de toute la tête son équipage frémissant.
Oui, un fier homme, que l’on a déjà reconnu aux termes de son allocution et surtout à sa physionomie entrevue au Congrès géographique de Londres, car elle est de celles qu’on n’oublie pas.
Physionomie qui est essentiellement celle d’un – Français, comme aussi le nom : d’Ambrieux.
Quarante-deux ou quarante-trois ans, mais paraissant plus jeune que son âge, une taille de géant, des membres d’athlète. Ce qui frappe tout d’abord à son aspect, c’est la coupe du visage aux traits énergiques et pleins d’audace. Par une étrange rétrogradation vers le prototype de notre race, ce visage rappelle, à s’y méprendre, celui des anciens Gaulois, nos ancêtres qui ne craignaient qu’une chose, la chute du ciel !
Même front de statue antique, même chevelure fauve, mêmes yeux couleur d’aigue-marine, même nez à la fière courbure aquiline, rien ne manque à ce masque d’une époque héroïque, pas même les longues moustaches, fauves comme la chevelure, et qui retombent en deux pointes jusqu’au-dessous de la mâchoire.
Issu d’une opulente famille ardennaise, dont l’origine se perd dans la nuit des siècles, puisqu’elle remonte, dit-on, à Ambiorix, dont le nom se retrouve presque lettre pour lettre dans le sien, il venait d’être promu enseigne de vaisseau quand éclata la guerre franco-allemande.
Envoyé à l’armée de la Loire, il fut, après des prodiges de valeur, décoré à la bataille d’Arthenay. Blessé grièvement à la retraite du Mans, le gouvernement de la Défense nationale le nomma lieutenant de vaisseau à titre auxiliaire.
Remis simple enseigne, alors qu’il méritait mieux, par la commission de révision des grades, il fut tellement exaspéré de cette injustice, qu’il fit un coup de tête et donna sa démission, malgré les instances de l’amiral Jauréguiberry qui, ayant pu apprécier ses hautes capacités, l’affectionnait particulièrement.
Rendu maître d’une fortune colossale par la mort prématurée de ses parents, il se garda bien de verser dans l’ornière où trop souvent s’abattent les désœuvrés de notre époque.
Ayant conservé, fort heureusement, de son ancienne profession qu’il regrettait toujours, le goût de l’étude et des voyages, il se passionna pour la géographie et devint un de nos plus vaillants explorateurs.
Délégué par la Société de Géographie de France au Congrès international de Londres, on sait comment il brûla la politesse à ses collègues, à la suite du dîner offert par sir Arthur Leslie.
Comme il l’avait dit en prenant congé, le temps pressait, car on était au 13 mai, et la future expédition polaire n’existait encore qu’à l’état de projet, ou plutôt de défi.
Mais que ne peut l’argent, surtout quand il est mis en œuvre par un homme de la trempe de l’ancien officier de marine !
Il prit sans désemparer le train de Southampton, puis le bateau du Havre, débarqua douze heures après et courut d’une haleine aux chantiers de M. Normand.
Il lui fallait, coûte que coûte, un navire spécial, et dans le plus bref délai. Ainsi pris à l’improviste, mais jugeant aussitôt de l’envergure de l’homme à la grandeur de l’entreprise, l’éminent constructeur se mit à l’œuvre sans perdre un instant.
Ayant reçu carte blanche pour la dépense, il étudia minutieusement, avec d’Ambrieux, les plans du bâtiment à improviser et fit telle diligence, que trois semaines après, ces plans étaient établis, ainsi que le devis.
Le vingt-deuxième jour, on mettait en chantier la Gallia.
Sur ces entrefaites, l’ancien officier, qui s’occupait déjà de recruter des hommes pour son équipage, retrouva le capitaine au long cours Berchou qu’il avait eu sous ses ordres, comme sergent d’armes, à l’armée de la Loire.
Devenu capitaine de la marine marchande, Berchou, fin manœuvrier, homme de haute probité, d’action et de résolution, accepta avec enthousiasme la place de second.
Il entra aussitôt en fonctions et fut d’un précieux secours à son chef, très ferré sans doute en théorie nautique, mais ignorant maintes questions pratiques familières à Berchou qui avait l’œil à tout et ne passait sur aucun détail.
Quatre mois après sa mise en chantier, la Gallia était lancée. On était alors à la mi-septembre. Après deux autres mois, elle était pourvue de sa machine, de ses mâts, de ses agrès, et toute prête à être approvisionnée en vue de sa destination.
C’est un superbe spécimen d’architecture navale, malgré ses dimensions relativement restreintes, et son apparence un peu massive, sous laquelle un observateur superficiel ne soupçonnerait pas des qualités de premier ordre. Tout le superflu de l’élégance a été sacrifié à la solidité, car la Gallia doit, le cas échéant, résister comme un bloc plein aux terribles pressions des glaces. Elle est gréée en goélette, jauge seulement trois cents tonneaux, et porte une machine de deux cents chevaux, qui a fourni aux essais une vitesse de dix nœuds à l’heure ; vitesse et capacité suffisantes, car s’il importe peu de posséder une rapidité plus ou moins grande, entre les chenaux encombrés de glaçons, il n’est pas besoin d’un emplacement bien considérable pour transporter, sur le lieu de l’hivernage, les membres et le matériel de l’expédition.
Son avant renforcé d’une façon extraordinaire au moyen de pièces de bois ingénieusement disposées, est recouvert en outre d’une plaque d’acier qui se termine en un coin aigu formant l’étrave. L’élancement de cette étrave est nul, en ce sens qu’elle forme un angle droit avec la quille, de façon à permettre au navire de se frayer, sous l’impulsion de sa machine, un chemin à travers les glaces.
L’hélice et le gouvernail ont été disposés de façon à pouvoir être facilement ramenés à bord, au cas où une circonstance fortuite menacerait de mettre hors d’usage ces organes si essentiels.
En plus d’une petite chaloupe à vapeur bien saisie sur ses dromes, la Gallia possède trois baleinières et un bateau plat, de sept mètres de long sur un mètre quarante de large, pouvant contenir vingt hommes avec quatre tonnes de vivres et que quatre matelots peuvent transporter sur les épaules.
Le navire ayant été construit en vue de plusieurs hivernages consécutifs sous des latitudes où la vie semble de prime abord impossible, les précautions les plus minutieuses ont été prises pour combattre le froid, l’implacable et mortel ennemi.
Le logement de l’équipage, fractionné en trois chambres, est placé à l’avant et reçoit la chaleur d’un calorifère chauffé à la houille. Entre la paroi extérieure de ces chambres, garnies d’un épais revêtement de feutre, et la paroi intérieure de la coque, se trouve un espace libre rempli de sciure de bois pour empêcher l’invasion du froid et de l’humidité. Et toutes les issues par où pourrait s’introduire le plus léger souffle de la bise glacée, sont hermétiquement closes.
Les soutes aux vivres, qui regorgent littéralement, sont approvisionnées pour quatre ans. Peu de viande et de poisson salé. Mais en revanche, de véritables montagnes de conserves en boîtes, qui donnent presque l’illusion des vivres frais et permettent de varier l’ordinaire ; sans omettre le pemmican, d’une conservation si facile, et particulièrement nutritif sous un petit volume. Les vins et les spiritueux, tous de premier choix, surabondent, comme aussi le thé et le café, ces toniques par excellence.
Notons en passant le jus de citron en tablettes, les pastilles de chaux et de chlorate de potasse, des graines de cresson et de cochléaria, et autres antiscorbutiques destinés à combattre l’éventualité du scorbut, cet autre ennemi des expéditions polaires.
Puis le matériel scientifique, très complet, ainsi que la pharmacie ; puis la bibliothèque, un piano et divers instruments de musique ; puis encore un assortiment d’explosifs les plus énergiques, une puissante batterie d’accumulateurs. Planté, plusieurs centaines de mètres de fils métalliques enduits de gutta-percha, des scies à glace, des tarières immenses, des haches énormes, un appareil d’éclairage électrique, une vaste poche en caoutchouc que l’on gonfle en insufflant de l’air, et qui se transforme en radeau, bref, tout un monde.
Enfin, la sollicitude éclairée du chef n’a pas négligé l’importante question de l’habillement qui, sous la zone, hyperboréenne, est affaire de vie ou de mort.
Le magasin spécial renferme une collection réellement incomparable d’étoffes de laine et de fourrures. Épais gilets de tricots ouatés et doublés de flanelles, chemises, caleçons et pantalons de laine douce, pourvus de boutons en ivoire végétal, et cousus avec du fil en poil de chèvre, parce que la soie ou le lin deviennent cassants sous l’influence du froid. Bottes en toile à voile, bien préférables au cuir qui se racornit et se fendille dans la neige, bachelicks en fourrure couvrant complètement la tête, le cou et les épaules, gants en peau de loutre de mer, montant jusqu’au coude, et assez amples pour recouvrir la main déjà munie d’un gant de laine, casaques, pelisses en peau de mouton, d’élan et de bison, et pour finir, de grands sacs fourrés sur les deux faces, dans lesquels trois hommes peuvent se blottir côte à côte, pour bivouaquer en plein air.
Bref, le capitaine a su pourvoir à tout et procurer à son équipage un nécessaire à un point surabondant, que des gens inexpérimentés pourraient le regarder comme superflu.
Un exemple, entre cent, de cette sollicitude qui n’a omis aucun détail : toutes les cuillères sont en corne, de façon à éviter aux matelots de la Gallia, le contact de leur bouche avec le métal !
… Tous ces préparatifs, malgré leur longueur, leur multiplicité, leur minutie, n’avaient pas duré plus de onze mois, y compris l’établissement des plans, la construction du navire, son équipement, ses essais et jusqu’au recrutement du personnel.
Cette dernière opération, dont le second Berchou s’était tiré à son honneur, n’était pas une petite affaire, étant donné que le capitaine d’Ambrieux voulait des sujets d’élite, moralement et physiquement irréprochables.
Tous Français, d’ailleurs, c’était là une condition indispensable, car la Gallia ne devait, à aucun prix, embarquer d’étranger à bord.
Donc, tous Français, mais pris un peu de tous côtés et offrant les échantillons les plus divers des races composant notre population maritime.
Témoin la liste suivante, dressée par le maître d’équipage : 1° (À tout seigneur tout honneur) Guénic Trégastel, 46 ans. Breton. – 2° Fritz Hermann, 40 ans, Alsacien, maître mécanicien. – 3° Justin Henriot, 26 ans, Parisien, second maître mécanicien. – 4° Jean Itourria, 27 ans, charpentier, Basque. – 5° Pierre Le Guern, 35 ans, matelot baleinier, Breton. – 6° Michel Elimberri, 35 ans, matelot baleinier, Basque. – 7° Élisée Pontac, 33 ans, matelot baleinier, Gascon. – 8° Constant Guignard, 26 ans, matelot, Normand. – 9° Joseph Courapied, dit Marche-à-Terre, 29 ans, matelot, Normand. – 10° Julien Montbartier, 30 ans, matelot, Gascon. – 11° Chéri Bédarrides, 27 ans, matelot, Provençal. – 12° Isidore Castelnau, 31 ans, armurier, Gascon. – 13° Jean Nick, dit Bigorneau, 24 ans, chauffeur, Flamand. – 14° Arthur Farin, dit Plume-au-Vent, 25 ans, chauffeur, Parisien. – 15° Abel Dumas, dit Tartarin, cuisinier, Provençal.
De cette collection très hétérogène de braves gens, tous francs matelots, avaient surgi, dès le premier jour, des types extraordinaires, comiques volontaires ou inconscients, qui promettaient à leurs camarades quelques bonnes heures de douce gaieté. Entre autres, Jean Nick, dit Bigorneau, un ancien mineur têtu, naïf, n’aimant rien au monde que sa chaufferie, heureux de tripoter le charbon, et avalant par douzaines les bourdes les plus insensées. Il y a encore Arthur Farin, dit Plume-au-Vent, un ancien virtuose de café-concert, cœur d’or et caractère de fer, mais blagueur enragé, mystificateur à froid, et cet épique Abel Dumas, dit Tartarin !… Mossieu Dumasse !… qui, comme le héros de Tarascon, court d’abord les aventures par gloriole, croit, en fin de compte, que c’est arrivé, s’emballe et accomplit des prodiges.
On a pu voir précédemment combien, en dépit de la diversité de leur origine, ces hommes sont unis déjà dans une même pensée d’abnégation, et prêts, comme l’a déclaré Farin, dit Plume-au-Vent, l’orateur de l’équipage, à suivre toujours et quand même leur capitaine.
Il est temps, pour finir ce rapide exposé, de présenter en deux mots le second capitaine, M. Berchou, un Havrais de 41 ans, le lieutenant, M. Vasseur, un Charentais de 32 ans, et le docteur Gélin, petit homme sec, grisonnant, vif comme un salpêtre, médecin distingué, chasseur intrépide, naturaliste éminent et connaissant à fond les questions polaires étudiées sur nature, soit à Terre-Neuve soit au Groenland, où il a longtemps stationné.
Cependant, les dernières minutes s’écoulent, et la Gallia, dont la machine est en pression, frémit sur ses câbles d’amarrage. Guénic vient d’arriver du bureau de poste et rapporte une volumineuse correspondance. Il s’enlève à bord d’un seul élan par les tire-veilles et va prendre son poste.
L’instant solennel est arrivé, car la mer est étale.
Le capitaine fait hisser au mât de misaine le pavillon du Yacht-Club de France, une flamme tricolore avec une étoile blanche dans le bleu et le pavillon national à la corne, puis remet le commandement au pilote qui doit conduire le bâtiment en pleine mer.
Les amarres sont larguées, un coup de sifflet strident retentit, la machine pousse un long halètement et la Gallia s’avance avec une prudente lenteur vers l’écluse qui s’ouvre devant elle.
Elle traverse en biaisant le bassin de l’Eure, s’écluse de nouveau, gagne l’avant-port, accélère son allure, franchit l’entrée de la jetée, puis s’élance vers la haute mer, traînant à sa remorque le cotre du pilote qui bondit derrière elle sur les lames.
Le premier iceberg. – Enthousiasme du docteur pour les terres boréales. – Plume-au-Vent apprend ce que c’est que le Pôle. – Constant Guignard craint de ne pas trouver le cercle polaire. – À travers la brume. – Première escale. – Un pilote comme on en voit peu. – Julianeshaab.
Ma parole ! c’est un glaçon… une véritable montagne de glace flottante, ce qu’en terme de baleinier on appelle un iceberg… pas vrai, Le Guern, toi qu’as pincé dans les temps de la grande pêche.
– Foi de matelot ! t’as raison, Parisien, c’est un iceberg !
Tonnerre de Brest ! tu vois de loin, toi, pour un chauffeur… autant dire un rat de cambuse ou un terrien.
– Moi ! farceur, va !
À Paris, j’aperçois l’heure de l’Observatoire au Luxembourg… en tournant le dos à l’horloge.
Dis donc, le Maître a promis la goutte à celui qui signalerai la première glace… allons lui refiler la chose, hein !
Je t’invite à partager ma ration de tripoli.
– Plume-au-Vent, t’es un frère !
« Qué malheur que tu sois dans la machinerie ! En dix ans, tu ferais un gabier de beaupré. »
Puis, élevant la voix, il crie à tue-tête :
Glace par l’avant !
« Maître, à nous la goutte. »
Le lieutenant, alors de quart, fait aussitôt prévenir le capitaine qui déjeune avec le second et le docteur, et tous trois s’élancent sur le pont, une lorgnette à la main, pour reconnaître le premier ennemi.
Heureux de cette apparition qui lui annonce la proximité du moins relative de la terre groenlandaise, le capitaine étend à l’équipage la largesse promise par Guénic et retourne au carré, terminer son repas.
– Eh bien ! docteur, dit-il au médecin qui vient de se hisser dans les premières enfléchures, vous laissez en souffrance le déjeuner ?
– Ma foi oui, capitaine, sauf toutefois votre bon plaisir.
Voyez-vous, je suis un hyperboréen passionné, moi, et vous l’avouerai-je, la vue de cet iceberg m’a positivement coupé l’appétit.
Il faut que je l’examine à l’aise, que je le voie s’approcher, que je le salue au passage, comme tant d’autres saluent la première hirondelle.
– Faites donc comme vous l’entendrez. »
Le capitaine était redescendu depuis deux minutes à peine, qu’on signalait, par tribord, une seconde masse flottante, mais infiniment moins volumineuse que la première. Puis une troisième, et bientôt une quatrième, également de petites dimensions.
Allons, ça va bien !… ça va bien, murmurait le docteur tout radieux, sans se préoccuper de la bise aigre qui commençait à lui rougir le nez.
– Paraît, dit à voix basse le Parisien, que le docteur a une passion folle pour le pays des engelures.
– Mais oui, mon loustic, répond celui-ci, en homme habitué à percevoir les moindres bruits par l’auscultation, et possédant, de ce chef, une oreille superlativement fine.
Et vous l’aimerez comme moi, après votre première campagne, quand vous en aurez admiré la magnificence.
– Faites excuse, monsieur, reprit le chauffeur un peu gêné malgré son aplomb habituel, je ne croyais pas que vous m’entendiez.
– Il n’y a pas de mal, mon garçon.
Tiens !… encore une autre là-bas… par tribord !
Ma parole ! il en pleut !… est-ce que la débâcle serait commencée ?
Mais non, c’est impossible… nous ne sommes encore qu’au 15 mai.
– Pardon, excuse, monsieur le docteur, dit en hésitant le Parisien qui n’ose interroger, mais voudrait bien savoir.
– Quoi ? mon garçon.
C’est donc véritablement beau, un pays tout en glaces…
– Superbe ! éblouissant ! stupéfiant !
« Vous trouvez là des collines, des montagnes, des précipices, des arches, des aiguilles, des clochers, un chaos de masses tourmentées, aux formes étranges, des flamboiements incomparables de lumière, que sais-je encore !…
– Sauf vot’respect, monsieur le docteur, ce sera bientôt ?
– Certainement avant peu, car nous allons être, d’ici vingt-quatre heures, en vue du cap Farewell, qui forme la pointe inférieure du Groenland, par 60° environ de latitude Nord.
– C’est extraordinaire, continue le Parisien en s’enhardissant devant la bienveillante bonhomie de son interlocuteur, je croyais, moi, que la glace était là-bas comme chez nous… comme partout, c’est-à-dire unie comme la surface d’un étang gelé. »
Le docteur, après avoir quitté les haubans, s’est avancé, tout en causant, vers le gaillard d’avant, et part d’un immense éclat de rire qui fait retourner les matelots de quart.
Plume-au-Vent a conscience d’avoir dit une énormité, rougit, balbutie et ne sait trop quelle contenance garder.
Mais, malheureux, reprit le docteur en riant de plus belle, si c’est là l’idée que vous vous faites du Pôle, il fallait rester à Paris et vous mettre marchand de marrons.
Vous ne savez donc pas qu’il y a des glaciers tellement vastes qu’ils mesurent jusqu’à cent kilomètres de largeur, et jusqu’à cent et cent cinquante mètres de hauteur au-dessus de la surface des eaux.
Je dis : au-dessus de la surface des eaux, parce qu’ils descendent jusqu’à cinq et six cents mètres de profondeur.
– Tonnerre ! s’écria le Parisien interloqué.
– Et c’est de là que viennent les blocs flottants aperçus au large depuis un moment.
Sous l’influence du pâle soleil groenlandais et surtout sous l’effort incessant de la mer, ils se détachent par fragments plus ou moins gros, et s’en vont en dérive, jusqu’à ce qu’ils se fondent.
Vous verrez quand vous aurez passé le cercle polaire… je ne vous dis que ça !
– Tenez, monsieur le docteur, puisque vous êtes si complaisant, je me permettrai… j’oserai vous adresser une prière.
– Allez-y, mon garçon.
Nous sommes ici en famille… vous vous en apercevrez au cours de l’expédition, lorsque nous aurons vécu côte à côte, de la même vie, pendant de longs mois.
Voyons, qu’y a-t-il ?
– Eh bien ! depuis que nous avons quitté les eaux françaises, l’entretien a roulé, vous pouvez m’en croire, presque chaque jour sur ce damné Pôle !
Faut-il vous dire que pas un, parmi les camarades, même les baleiniers, n’a été fichu d’expliquer ce que c’est, et que moi, tout Parisien que je suis, et pas plus bête qu’un autre, je n’en sais pas le premier mot.
– C’est bien simple.
Le mot : pôle vient d’un verbe grec, πολειν, signifiant tourner, parce que le pôle est l’extrémité de l’axe autour duquel la sphère terrestre semble tourner en vingt-quatre heures.
– Pas possible !
Moi qui croyais que c’était un endroit très loin, au Nord, où il n’y a pas d’habitants, où il fait un froid de loup, et à l’entrée duquel les voyageurs se sont jusqu’à présent cassé le nez.
Tandis que c’est… voyons… l’axe… la sphère…
– Tenez : un exemple.
Prenez une sphère quelconque… une boule en bois, une orange plutôt : percez-la complètement d’une brochette, et faites-la tourner.
La brochette autour de laquelle tourne l’orange, c’est l’axe, comparativement à celui de la terre qui, lui, est imaginaire. Le Pôle, c’est le point où la tige de bois sort de l’orange.
– Mais il y en a deux !
– Sans doute, le pôle Nord et le pôle Sud.
C’est compris ?
– Tant qu’à peu près, monsieur le docteur.
Mais, d’autre part, y a ce fameux cercle polaire qui fait loucher mon camarade Constant Guignard, parce qu’il aime les pièces de cent sous.
– Ah ! oui, par rapport à la prime d’un dixième s’ajoutant aux appointements de l’équipage quand la Gallia l’aura franchi.
C’est tout simplement un parallèle à l’équateur terrestre, mené à 23° 27 ′ 57 ″ du pôle Nord et du pôle Sud.
– Ce qui revient à dire que nous serons à vingt-trois degrés environ du fameux pôle.
– Quant à l’équateur ?…
– C’est la ligne, avec son baptême… ce que j’ai été saucé, à mon premier voyage à Rio !
– La ligne… la ligne de qui ?… la ligne de quoi ?… voyons un peu, fichu étourneau.
– Dame ! m’sieu le docteur, c’est comme qui dirait… une chose… dont…
– C’est le cercle, toujours imaginaire, qui fait le tour de la terre et se trouve perpendiculaire à l’axe.
– J’y suis !… j’ai pigé la chose !
Si on coupait l’orange par son milieu, à égale distance des deux pôles, on en ferait deux calottes égales… deux hémisphères… vu que l’angle formé par la tige de bois et la base de chaque moitié formerait un angle droit.
– C’est très bien, et vous n’avez pas la tête dure.
« Donc le Pôle est à 90 degrés et c’est là qu’il nous faut aller.
– Et où nous arriverons, sinon je perds mon nom de Farin, dit Parisien, dit Plume-au-Vent. »
Pendant cet entretien auquel s’est prêté avec son habituelle bonhomie le docteur Gélin, les matelots de quart se sont approchés lentement des deux interlocuteurs, et ont fait tous leurs efforts pour en comprendre les termes.
Ont-ils réussi ? Peut-être. Dans tous les cas ils demeurent silencieux, se réservant probablement de trouver près de Plume-au-Vent des renseignements complémentaires.
Seul, Constant Guignard, le Normand économe, ronchonne, pendant que le docteur, comblé de remerciements, s’en va causer avec l’officier de quart.
Constant Guignard est très ennuyé d’apprendre que toutes ces définitions se rapportent à des lignes ou à des points imaginaires. Il se demande où et quand on pourra les trouver, comprenant, en bon Normand, qu’à défaut de bornes, de haies ou de fossés comme on en établit sagement pour séparer les champs, on devrait placer des jalons, des amers, en un mot, baliser l’océan ou les champs de glace pour ne pas commettre d’erreur.
Cependant, le capitaine, remonté sur le pont, a fait ralentir la vitesse du navire car les glaces apparaissent de plus en plus nombreuses. Il a envoyé dans la hune un homme chaudement vêtu et ordonné d’apprêter, pour la nuit, le fanal électrique dont la lueur éclatante permettra de reconnaître les écueils mouvants.
Dans vingt-quatre heures, au plus tard, il pense, comme vient de le dire le docteur, être en vue du cap Farewell, et atterrir au chef-lieu des établissements danois au Groenland, Julianeshaab, sa première escale.
Malgré son apparence un peu trapue, plutôt que lourde, la Gallia n’en a pas moins filé gaillardement ses huit nœuds à l’heure, et toujours à la voile, depuis quatorze jours. Il est vrai qu’elle a été favorisée constamment par une brise de S.-E. qui lui permit de marcher grand largue sans avoir eu à changer d’amure.
Après avoir ainsi fourni une course d’environ 5 200 kilomètres, et singulièrement économisé son combustible, le capitaine a commandé de carguer la voilure. Puis, il a fait allumer les feux, afin de gouverner plus facilement et rester le maître du navire aux approches du grand courant polaire et des glaces flottantes.
S’il est essentiel, en effet, de ne pas heurter un iceberg en dérive, il est urgent de ne pas être saisi par ce courant, dont un bras contournant le cap Farewell, pénètre dans le détroit de Davis et la mer de Baffin, pour remonter vers le Nord.
Un voilier ainsi entraîné risquerait fort, surtout dans la brume, de manquer l’entrée du fiord sur lequel se trouve Julianeshaab, à trente-cinq kilomètres de la côte. D’autant plus que la débâcle étant à peine commencée, le rivage est encombré de glaces, et l’embouchure du fiord réduite à un simple chenal. Jusqu’alors tout a marché à souhait ; le capitaine d’Ambrieux est au comble de ses vœux. Ayant fait ainsi toute la diligence possible, et accompli ses préparatifs dans le plus strict minimum de temps, il est en droit d’espérer avoir devancé son adversaire, et tout porte à croire qu’il a raison.
De l’Allemand, pas de nouvelles depuis le défi. En dépit des recherches les plus actives, il est demeuré introuvable.
Inquiet d’une disparition au moins singulière, cachant peut-être un piège ou tout au moins une ruse teutonne, d’Ambrieux a consulté patiemment, jour par jour, la liste des navires partis de tous les ports d’Europe, et indiquant, avec leur destination, le nom de leur capitaine.
Il n’a rien trouvé se rattachant de près ou de loin à la personnalité de Pregel ou à une expédition polaire. Du reste il est à supposer que Prégel se trouvait dans des conditions identiques à celles de son partenaire. Quelle raison, en effet, de penser qu’il aurait sous la main un navire tout prêt, tout agencé, avec son équipage, afin de profiter, l’année précédente, de la saison chaude pour gagner les latitudes hyperboréennes.
Il y a là, semble-t-il, une impossibilité matérielle.
Donc, il paraît certain, avéré, que la Gallia passera la première le cercle polaire, dont Julianeshaab, située par 60° 44 ′ de latitude nord, se trouve seulement à 5° 40 ′ sud.
Cette escale, au chef-lieu des établissements danois, a été jugée de prime abord indispensable et elle a contribué, en majeure partie, à faire avancer de quinze jours le départ de la Gallia.
En appareillant seulement deux semaines après, d’Ambrieux arrivait encore bon premier sur les navires baleiniers qui attendent la grande débâcle, c’est-à-dire la mi-juin, pour franchir le banc de glace et pénétrer dans les eaux du Nord où se trouvent les cétacés.
Mais le capitaine voulait absolument se procurer des traîneaux et des équipages de chiens pour remonter là où la navigation est devenue impossible, c’est-à-dire sur cette mer Paléocrystique entrevue par le capitaine Nares, lors de la mémorable expédition de l’Alert et de la Discovery.
Partisan absolu des idées de l’Américain Hall, cet intrépide et malheureux explorateur, qui dort, là-bas, l’éternel sommeil sous la formidable banquise, le traînage par les chiens lui paraît le seul possible, le seul pratiquement admissible.
Les chiens esquimaux sont en effet des auxiliaires incomparables dont le voyageur arctique ne saurait se passer.
Durs à la fatigue, d’une sobriété incroyable, insensibles à la température au point de coucher dans la neige par des froids qui solidifient le mercure, très vigoureux en outre, ils sont les agents essentiels de la traction à travers les glaces et les compagnons indispensables de l’explorateur.
Réfléchissez un moment aux difficultés inouïes de la traction opérée par des hommes, au surcroît écrasant de fatigues nécessité par ce labeur sans trêve, alors que la marche seule ne s’effectue qu’avec une peine infinie, au milieu du chaos sans limites et sous un ciel de fer !
Pensez aux chutes incessantes, aux immersions fréquentes, aux heurts, aux glissades nécessitant une recherche constante de l’équilibre. Tenez compte du froid qui parchemine la peau et mortifie la chair, et surtout de son action déprimante sur des organismes débilités par deux et quelquefois trois hivernages, et concluez aussi qu’il importe de soustraire les hommes à cette manœuvre de bête de somme, consistant à pousser les traîneaux emportant leurs vivres avec leurs effets de campement.
Donc il fallait, par l’adjonction d’une trentaine de chiens, compléter le matériel de l’expédition. Et comme on ne pouvait se les procurer qu’à Julianeshaab, avec l’approvisionnement de poisson séché nécessaire à leur alimentation, on allait mettre le cap sur le fiord après avoir reconnu le cap Farewell.
L’ordre donné par le capitaine de ralentir la marche du navire est on ne peut plus sage. En effet, à mesure que la Gallia, marchant sous petite vapeur, s’élève au Nord, les glaces deviennent de plus en plus nombreuses et encombrent la mer. Elle se trouve en outre soudain enveloppée d’une brume qui va en s’épaississant, au point que du mât de misaine on distingue à peine le beaupré.
Les heures se passent au milieu d’inquiétudes que nul ne songe à dissimuler, bien que l’aspect du capitaine, confiant dans la solidité de son navire, soit rassurant.
De temps en temps, la goélette heurte quelque masse vagabonde, un choc sourd retentit et une trépidation la secoue de l’étrave à l’étambot. Puis l’iceberg glisse en grinçant sur son flanc et l’on passe.
La nuit vient. Les feux de position sont allumés pour la tonne, et le fanal électrique remplace, à la misaine, le feu blanc habituel des bateaux à vapeur.
Comme d’Ambrieux est certain de sa direction, on avance toujours. Les heures s’écoulent et l’aube blanchit à travers les buées impalpables qui s’interposent comme une plaque de verre dépoli.
Six heures… huit heures… dix heures… Le cap a été doublé. Le chenal ne doit pas être loin. Le sifflet de la machine hurle sans relâche, les canons à signaux tonnent de cinq en cinq minutes.
Est-ce une illusion ? Il semble qu’on entende briser la vague là-bas, sur tribord.
Stop !
L’hélice, pour un instant, cesse de fonctionner, pendant que, à bord, le charivari devient de plus en plus intense.
Le navire semble immobile, mais, en réalité dérive au Nord. Le capitaine fait sonder, on ne trouve pas le fond à deux cents brasses.
« En avant ! »
La Gallia se remet en marche pour un quart d’heure, et, tout à coup, un hourra joyeux échappe à l’équipage.
Brusquement, le pan d’ouate se déchire et le soleil apparaît éclairant la côte ourlée de glaçons déchiquetés, stratifiés, érodés par les vagues.
Stop !… captain… stop !… crie une voix aiguë tout près du navire, mais au ras de l’eau.
– Tiens ! dit tranquillement l’homme de bossoir, un animal amphibie.
– Stop !… master captain !… Stop !…
« Moi, pilote… master… entrer navire Julianeshaab… reprend la voix en anglais hyperboréen.
– Un pilote… bravo ! qu’il soit le bienvenu. »
On lui lance un bout d’amarre qu’il attrape au vol.
« Mais… sa péniche ? » reprend un matelot, voulant désigner sans doute le fin kayak dans lequel le pilote est enfoui jusqu’à la ceinture.
On se dispose à crocher par les deux extrémités la légère embarcation, mais l’homme, sans lâcher son amarre, crie de son organe glapissant :
« Hisse là ! »
Et l’on hisse en vigueur, contenant et contenu, matière inerte et animée, qui se dédouble, aussitôt à bord, en une sorte de périssoire un peu moins lourde qu’une valise de main, et un monstre marin, ruisselant et aussi odorant que l’étal d’une harengère.
Un Esquimau pur sang, ou, comme on dit là-bas, un Groenlandais, et pas plus beau pour cela, du moins d’après notre esthétique européenne. Un nez de dimensions tellement réduites, que le possesseur de ce rudiment d’organe peut à peine le trouver pour se moucher avec ses doigts, des yeux obliques rappelant deux pépins de poire, mais en revanche des joues en lune, balafrées d’une bouche en tirelire, formant un ensemble où la plastique n’a rien à voir. Ajoutez une longue crinière aux brins aussi rigides que la moustache d’un phoque, un soupçon de barbe en balai, et vous avez le signalement très sincère de maître Hans Igalliko, un des plus fins lamaneurs de la côte.
Après avoir secoué, comme un barbet mouillé, l’odorante fourrure en peau de loutre qui enveloppe son torse trapu, il tend familièrement la main au capitaine qu’il reconnaît entre tous, tant la mâle prestance de M. d’Ambrieux le désigne de prime abord comme le chef.
Il absorbe ensuite comme du petit lait un quart de rhum libéralement versé par le cambusier, puis, aussi à l’aise que chez lui, va s’installer près de l’homme de barre.
Le brave garçon connaît, ma foi, admirablement son métier, et la Gallia ne pouvait trouver un meilleur guide pour pénétrer dans le canal anfractueux sillonnant l’embouchure du fiord glacé.
Grâce à la précision des renseignements qu’il fournit avec une incroyable surabondance de gestes et de paroles, la goélette pouvait, après deux heures de pilotage, mouiller ses ancres dans une petite rade, parfaitement abritée des vents soufflant du large et de la terre.
« Julianeshaab ! » dit le Groenlandais en étendant la main avec un geste de suprême orgueil.
Et soudain apparaissent aux yeux des matelots étonnés, une cinquantaine de misérables cabanes que dominent une petite église et un mât de pavillon.
C’est le chef-lieu des établissements danois.