
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Une vibrante sonnerie de bugle retentit.
« Commencez le feu ! »
Brusquement l’avenue conduisant au village, dont la rue principale est barricadée, s’emplit d’une fumée blanche d’où surgissent, comme des éclairs, de longues coulées de flammes.
Une détonation violente que domine le déchirement strident de la mitrailleuse, éclate sous les arbres dont les feuilles s’échevèlent, comme sous la poussée d’un vent d’orage.
Là-bas, à cinq cents mètres, un ouragan de fer s’abat en même temps sur la barricade, broyant les madriers, faisant voler en éclats les pierres, mutilant affreusement quelques hommes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Louis Boussenard
Le Défilé d’Enfer
roman
1891
© 2021 Librorium Editions
ISBN : 9782383830269
Prologue
La révolte des Bois-Brûlés
I
Héros du devoir. – La brèche. – La charge. – L’assaut. – Dévouement. – Trahison. – Ses conséquences. – Les victimes. – Ensevelis. – Mouvement tournant. – Lutte désespérée. – Tenir un quart d’heure. – Et après ?...
Une vibrante sonnerie de bugle retentit.
« Commencez le feu ! »
Brusquement l’avenue conduisant au village, dont la rue principale est barricadée, s’emplit d’une fumée blanche d’où surgissent, comme des éclairs, de longues coulées de flammes.
Une détonation violente que domine le déchirement strident de la mitrailleuse, éclate sous les arbres dont les feuilles s’échevèlent, comme sous la poussée d’un vent d’orage.
Là-bas, à cinq cents mètres, un ouragan de fer s’abat en même temps sur la barricade, broyant les madriers, faisant voler en éclats les pierres, mutilant affreusement quelques hommes.
« Dis donc, Louis, fait avec un intraduisible accent beauceron un vieux tout gris, d’une taille colossale, paraît qu’on nous accorde aujourd’hui les honneurs du canon. Mâtin !... on se met en frais, pour des sauvages ! »
– Honneur périlleux, mon cher Baptiste, répond cordialement un homme d’une quarantaine d’années, au visage énergique et sympathique, encadré d’épais favoris, et nous n’avons, pour répondre, que des fusils.
– Va toujours !... Avec un chef comme toi, des gars comme nous s’en iraient au diable et même plus loin. Tu t’appelles Louis Riel et nous sommes les Bois-Brûlés...
Une nouvelle salve retentit, coupant la parole à Baptiste, la barricade ébranlée frémit sur ses assises, trois hommes broyés par la mitraille s’abattent sans un cri.
« Tenez bon ici, dit brièvement Louis Riel : moi je monte au clocher surveiller l’attaque.
– Et puis, tu sais, ménage-toi si ça t’est possible, et tâche de ne pas t’exposer comme hier, que c’est un miracle si t’en es revenu.
– Adieu, Baptiste !... une bonne poignée de main... tu commandes ici au poste le plus périlleux... tu réponds de tout...
– Tant que je serai debout, foi d’homme ! »
Avec un calme superbe, le héros de l’indépendance des métis franco-canadiens remonte la rue où pleuvent les débris et les projectiles, et s’en va vers l’église défendue d’un côté par le mur crénelé du cimetière.
La batterie ennemie, tirant par section, tonne sans relâche, et les obus tombent ininterrompus sur le même point.
Derrière la barricade qui se désagrège lentement, à chaque salve, se tiennent une centaine d’hommes, au visage bronzé, dont les traits crispés, les yeux luisants démentent l’apparente impassibilité.
À peu près uniformément vêtu de blouses de chasse et de pantalons en peau de cerf tannée à la manière indienne, ils portent, pour la plupart, des carabines Winchester à répétition, armes terribles, entre les mains habiles de ces rudes habitants du nord-ouest.
Nul vestige d’ailleurs de distinction militaire, sur ces vêtements si commodes pour la vie d’aventures. Ni plumets, ni épaulettes, ni insignes de grades : rien ! Tout le monde soldat, avec un revolver, une hache, une carabine. Les chefs, on les connaît, on sait ce qu’ils valent, et on leur obéit d’enthousiasme.
Mais cette passivité va mal à leur bouillante ardeur. Recevoir des coups sans les rendre, cela met leur courage à une rude épreuve.
À tel point que l’un deux, interpellant le chef s’écrie :
« Voyons, père Baptiste, est-ce que tu vas nous laisser écheniller comme ça !... les canons de ces païens d’Anglais ne sont pas à six cents mètres... on pourrait s’arranger de façon à les faire taire.
– Ça s’peut ! mais faut des hommes de bonne volonté, avec ça malins tireurs, pour monter soit su’ les maisons, soit su’ la barricade... et dame ! y fait chaud, là-haut.
Cinquante métis Bois-Brûlés se présentèrent au milieu des débris qui pleuvent de toutes parts.
« Minute ! reprend Baptiste impassible.
« La plupart d’entre vous sont des pères de famille... du monde à ménager... faut de la jeunesse... en tout six gars lurons... un par canon, c’est trop juste.
« Primo d’abord, j’choisis mes trois garçons à moi, parce que je suis sûr de leur coup d’œil.
« Hé !... Jean !... Jacques !... François !... »
Trois beaux jeunes gens, presque des enfants, mais taillés en géants comme leur père, sortent du groupe et répondent militairement :
« Présents ! »
François n’a pas plus de seize ans, Jacques a environ dix-sept ans et Jean à peine dix-huit.
« Vous savez c’qu’y faut faire, c’pas !
« Prenez chacun un camarade, affalez-vous su’ les maisons, et fusillez-moi en grand ces canonniers de malheur.
« Allez, mes ch’tiots, ça presse ! »
À ce petit mot d’amitié renfermant comme une suprême caresse du vieux qui, peut-être, les sacrifie dans l’intérêt de tous, les jeunes gens s’élancent en poussant un de ces cris farouches, comme en proférait leur ancêtre indien suivant la piste de guerre.
Une catastrophe soudaine autant qu’imprévue, rend, hélas ! leur dévouement inutile, et compromet gravement la défense du village.
À peine ont-ils atteint, sains et saufs, par miracle, le sommet de la barricade, que celle-ci, comme soulevée de bas en haut, oscille, se désarticule sous l’irrésistible poussée d’une mine et s’effondre en les entraînant dans sa chute.
« Trahison ! s’écrie le vieux Baptiste en voyant, à travers le nuage de fumée qui suit une formidable explosion, les pauvres enfants rebondir et s’abîmer au milieu des débris.
Trahison !... à moi, les Bois-Brûlés !... sauvons-les s’il en est temps encore ; s’il est trop tard, vengeons-les !...
Aussitôt la fumée dissipée, la barricade apparaît coupée par une brèche praticable, à la rigueur, pour un assaillant brave, discipliné, bien armé.
Le canon gronde sans relâche, criblant d’obus cette brèche, tant pour l’élargir que pour empêcher les métis de la combler.
Au loin, les colonnes d’attaque se déploient à droite et à gauche dans des vergers en fleurs ; les bugles sonnent la charge. Les métis se jettent dans les maisons, pendant que Baptiste et quelques amis, insoucieux des projectiles éclatant autour d’eux, arrachent avec leurs doigts ensanglantés les débris sous lesquels sont ensevelis les jeunes gens.
Trahison !... le mot du vieux Baptiste court de bouche en bouche.
Certes, il a fallu la main d’un traître pour creuser ce boyau de mine long de cinq mètres, arrivant sous la rue au milieu de la barricade. Ce boyau part de la maison d’encoignure, à droite. En voici l’entrée dissimulée sous des planches recouvertes d’un matelas en feuilles de maïs. Un homme peut s’y glisser à quatre pattes pour y porter de la poudre, et agencer un fourneau de mine.
Voilà ce qui se dit en phrases hachées, ponctuées de détonations et interrompues par des cris de fureur.
La barricade eût résisté jusqu’à la nuit aux canons du général Middleton, et Batoche, l’humble village qui arrête les cinq mille hommes de l’armée régulière, le rempart de l’indépendance des Bois-Brûlés, Batoche, comme la veille et l’avant-veille, repoussait victorieusement l’attaque.
À la faveur des ténèbres, on pouvait facilement réparer cette fortification primitive mais robuste, à peine entamée par l’artillerie, et que les carabiniers de Winnipeg, pas plus que les grenadiers de Toronto, n’avaient pu enlever, malgré trois attaques furieuses.
Tandis que faute de ce retranchement, il va falloir se battre à découvert un contre trois, et dans des conditions encore plus désavantageuses d’armement et de discipline.
Mais le traître !... quel est ce misérable, qu’on en fasse bonne et prompte justice ?
Pardieu ! ce ne peut être que le propriétaire de la maison, le gars Toussaint... Toussaint Lebœuf... le mercanti qui tenait le petit bazar où chacun s’approvisionnait, à Batoche. Pas très scrupuleux peut-être, faisant un peu l’usure et, disait-on tout bas, la contrebande... mais si bon homme ! si gai compagnon !... offrant si volontiers une pipe de tabac ou un verre d’eau-de-vie !... Qui aurait cru cela ?... On aurait dû pourtant se défier du regard aigu de ses yeux gris, de son sourire énigmatique, de ses absences mystérieuses, si longues et si fréquentes !
Mais il était accouru à l’appel des chefs, et semblait un patriote.
Tenez, sa femme et ses enfants couchaient là... sur cette grande paillasse qui couvre le trou. Le plus jeune était malade, sans doute pour qu’on ne dérangeât pas la paillasse, sous laquelle se glissait la nuit le père pour accomplir son travail de taupe.
Hier il a fait partir tout son monde pendant la sortie, craignant pour la mère et les petits... et sans doute aussi pour son magot que la femme a dû emporter... le prix des denrées vendues quinze fois leur valeur depuis l’investissement, avec le produit de son usure et le paiement de sa trahison.
Aux premiers coups de canon, il a mis le feu à la mine, avec une mèche assez longue... et grâce à lui, le village va être enlevé.
Oh ! le misérable Judas !... Mais où se cache-t-il donc ? Il était là, un quart d’heure à peine avant l’explosion...
Toutes ces réflexions, longues à écrire, durent quelques secondes, car chacun parle en même temps au milieu d’un vacarme croissant.
Un hurlement de joie échappe au vieux Baptiste qui fouille, aidé de ses amis, les débris croulants. Il aperçoit enfin ses trois fils accroupis, tassés, comprimés sous une poutre inclinée formant appentis au-dessus d’eux. Ils vivent et appellent faiblement à l’aide !
Insoucieux des obus qui ronflent au-dessus d’eux, les travailleurs déblayent la place avec acharnement. D’un effort furieux ils empoignent les matériaux, s’attellent à la poutre, arrachent tout ce qui fait obstacle et retirent de l’excavation où ils allaient agoniser, Jean, Jacques et François, sanglants, contusionnés, presque sans souffle, incapables de se tenir debout.
« Allons, les ch’tiots, du nerf ! dit le père Baptiste en débouchant sa gourde de chasseur, c’est pas l’instant de se trouver mal... un coup d’eau-de-vie, hein !... »
Chez de tels hommes, les défaillances ne durent guère. Leur énergie naturelle et leur vigueur plus encore que la rasade les remettent sur pied.
« Et les trois camarades ?... »
– Morts !... »
Moins heureux que Jean et ses frères, ils ont été projetés en avant et broyés par la mitraille.
« Tout ça se réglera en bloc avec le Judas », gronde Baptiste les dents serrées.
Dix minutes se sont écoulées depuis l’explosion. Dix minutes pendant lesquelles n’ont cessé de battre la brèche les obus et les balles de la mitrailleuse, pour empêcher les métis de faire front aux colonnes d’attaque, et pour faciliter en même temps à celles-ci l’accès de la redoute éventrée.
Tout à coup le canon se tait. Les troupes, marchant par files de quatre parallèlement à la route où sont braquées les pièces, se réunissent en avant, et se ruent en masse, précédées des bugles qui sonnent éperdument.
Les hommes crient : « Hourra ! » et escaladent les débris croulants, étonnés du silence de mort qui accueille leur soudaine irruption.
Très braves devant un péril manifeste, tout prêts à s’élancer sur un front hérissé de baïonnettes, les Anglais éprouvent comme une vague hésitation, d’ailleurs très courte, devant ce trop facile succès qui semble présager une embûche.
Les premiers rangs, un peu compacts, débouchent en courant, pour se défiler le long des maisons, où les projectiles ne peuvent plus aussi facilement les atteindre.
« Feu !... feu ! à volonté !... » crie une voix vibrante. Et l’ordre est ponctué d’un coup de carabine.
L’officier qui court en avant du premier peloton s’abat lourdement, la tempe trouée.
Et brusquement, des maisons crénelées à hauteur d’homme, jaillit une double coulée de flammes et de fumée. Une série de détonations sèches, stridentes, retentissent, bientôt suivies d’une indicible clameur. Puis au milieu des flocons blancs d’où surgit la langue de feu, un tournoiement confus des hommes en vareuses gris de fer qui oscillent, titubent, tombent, roulent avec des gestes de fous, des contorsions de damnés.
En un clin d’œil, il y a cinquante miliciens massacrés à bout portant par les carabines Winchester.
Baptiste, ses trois fils et cinq ou six autres métis, embusqués dans la maison du gars Toussaint, font un feu d’enfer.
« Hardi, les enfants ! clame le vieux ; tapez à plein tas... fusillez-moi ces païens d’Engliches.
« Hardi !... Hardi !... mort aux chiens d’hérétiques ! »
Les « païens d’Engliches » sont de fiers soldats qui tombent mais ne reculent pas. De nouveaux contingents arrivent sans cesse, à tel point que les métis ont épuisé les cartouches enfermées dans le tube à répétition des carabines ; en outre, les armes sont tellement chaudes qu’on peut à peine les tenir à la main.
Leur situation commence à devenir critique, puisqu’il faut au moins le temps matériel de recharger.
S’il ne leur arrive pas du renfort, ils vont être débordés, puis cernés dans les maisons, dont quelques-unes commencent à flamber.
Tous les assaillants ne sont pas morts, loin de là. Aussi les survivants, désespérant de déloger de tels adversaires, se sont mis en devoir de les enfumer, de les griller, s’ils s’obstinent à rester.
Mais que fait donc Louis Riel qui, de l’église, assiste aux péripéties de la lutte et devrait envoyer du secours ?
Le chef des Bois-Brûlés a fort à faire de son côté.
Il se préparait à détacher une centaine d’hommes frémissant au bruit de la bataille à laquelle ils n’ont pas pris part jusqu’alors, quand il entend crier : « Aux armes ! » à l’autre bout du village.
Un pressentiment l’avertit que là est le danger.
Le général Middleton, un vieux routier, a fait là-bas une fausse attaque accompagnée d’un vacarme infernal pour opérer une diversion. Maintenant il a tourné le village et dirigé ses contingents vers l’autre extrémité où il n’est pas attendu, car là se trouve le cimetière, formidablement crénelé.
Un homme envoyé par Baptiste apprend en même temps au chef des révoltés la trahison du gars Toussaint, l’explosion de la barricade, la position périlleuse du groupe chargé de la défendre, et lui demande instamment du secours.
Louis Riel comprend alors le plan du général. Grâce à l’ignominie du gars Toussaint, l’obstacle sur lequel se sont brisés depuis trois jours les efforts de l’ennemi n’existe plus. Les troupes régulières vont donc emporter tôt ou tard les maisons où luttent Baptiste et ses hommes. Dès lors, l’accès du village étant libre de ce côté, les métis occupant l’église, la place publique et la seconde barricade seront pris entre deux feux, grâce au mouvement tournant exécuté par le général.
Les événements sont, hélas ! bien près de donner raison au chef des Bois-Brûlés. Batoche va être emporté par le fait, sans précédent jusqu’alors, d’une trahison perpétrée par un métis franco-indien !
II
Guerre civile. – Le drapeau blanc fleurdelisé emblème révolutionnaire. – Les Bois-Brûlés. – Louis Riel. – Le siège de Batoche. – Idée originale de François. – Serment de vengeance. – En retraite. – Comment les « sauvages » traitent leurs prisonniers. – Affreux malheur.
Le long et rude hiver canadien a pris fin depuis quinze jours. Au froid terrible qui gèle à fond les rivières, éclate les roches, fracasse les arbres, a succédé, sans transition, un printemps hâtif, dont la température annonce, à brève échéance, l’arrivée d’un été brûlant.
Le 5 février 1885, le thermomètre s’abaissait à 30 centigrades au-dessous de zéro à Winnipeg, chef-lieu de la province de Manitoba. Le 4 mai suivant, il montait à 20 au-dessus de zéro.
Aussi, a-t-il suffi d’une semaine pour transformer l’hivernal désert, dont l’éblouissante et monotone blancheur s’étendait, implacable, comme un suaire sans fin, sur tout ce qui vit aujourd’hui.
Le sol mollit et s’attiédit, les eaux s’écoulent, les plantes vivaces redressent leurs tiges, les arbres commencent à charrier une sève généreuse, et bientôt, sous la chaude et vivifiante caresse du soleil, la nature en éveil arbore en un clin d’œil son opulente parure.
Huit jours encore et les vergers sont en fleurs. Les rameaux blancs de givre se couvrent de l’odorante neige des corolles ; les herbes se nuancent de bleu, de rose et de jaune ; les bourgeons éclatent sous la poussée des feuilles.
Les hirondelles se poursuivent avec leurs petits cris incisifs et joyeux, les pies et les geais jacassent éperdument, et l’oiseau-mouche à gorge de rubis, arrivé déjà du Mexique, apparaît comme une braise au milieu des pommiers, des poiriers, des abricotiers dont les fleurs le grisent d’un nectar capiteux et subtil.
... Mais si la nature est en fête au Manitoba, cette jeune et déjà opulente province du Canada, ou, comme on dit là-bas, de la « Puissance », il n’en est pas de même pour l’homme.
Contraste douloureux, l’homme, ainsi qu’on vient de le voir, se bat avec acharnement et depuis trois jours, au milieu de ces splendeurs printanières. Chose plus navrante encore que ce contraste, la lutte implacable qui va se terminer par un massacre sans merci, est engagée entre frères !...
C’est la guerre civile, le plus épouvantable des fléaux, qui ravage en ce moment le paisible district.
... Une belle rivière, large de cent vingt mètres, roule du sud-ouest au nord-est ses eaux profondes, troublées par le dégel. Par 106º ouest du méridien de Greenwich, elle s’infléchit un peu vers le nord et rencontre, par 52º 30’ de latitude septentrionale, un joli village formidablement crénelé et barricadé.
La rivière est le Saskatchewan du nord, un des principaux affluents du lac Winnipeg. Le village, habité par les descendants des anciens colons franco-canadiens, s’appelle Batoche.
C’est aujourd’hui le 12 mai 1883, date cruelle pour ces fils toujours aimés de la vieille France.
Le village est édifié partie en pierres, partie en troncs d’arbres non équarris et reliés par des entretoises donnant aux constructions une solidité à toute épreuve. Il s’adosse à l’ouest de la rivière qui, de ce côté, l’abrite contre toute surprise. Les rues, barrées à hauteur des toitures par des barricades régulièrement construites selon les règles de la stratégie, sont gardées par les géants aux cheveux noirs, au visage bronzé.
On vient de voir à l’œuvre ces vaillants métis qui, las de subir les injustices britanniques, se sont levés en masse pour défendre, sous la conduite de leur compatriote Louis Riel, leurs droits odieusement méconnus.
Du reste, la rébellion est complète, absolue, au point qu’elle a banni jusqu’aux couleurs nationales. Ce n’est pas, en effet, le drapeau anglais qui flotte sur le clocher de Batoche. Pour que la protestation soit encore plus éloquente, s’il est possible, les hommes composant le corps de troupe cantonné dans le village ont arboré le drapeau blanc fleurdelisé d’or, le vieil emblème de la monarchie française, le noble étendard de Champlain et de Montcalm, le fondateur et le martyr de l’indépendance canadienne, l’étendard des héros dont le souvenir est sacré aux Français d’Amérique.
Pensée touchante qui a dicté le choix de cet emblème aux arrière-petits-fils traités de sauvages, honnis, dépossédés par l’insolent envahisseur, et les reporte au temps où les ancêtres luttaient jusqu’au dernier souffle et succombaient glorieusement pour la liberté.
À l’est de Batoche, où commande au nom du droit et de la justice Louis Riel, se trouve, à mille mètres environ, un camp retranché occupé par des troupes régulières : infanterie, artillerie et quelques escadrons de cavalerie légère, fournis par la police à cheval.
Un fossé profond, de hautes et massives palissades circonscrivent l’enceinte dont les portes sont défendues par des canons, près desquels se tiennent en permanence les servants.
Le postes sont doublés, les sentinelles perdues également.
À chaque instant les patrouilles d’éclaireurs sillonnent les environs battus minutieusement par les pelotons de cavalerie. Rude besogne, rendue périlleuse par les insurgés qui, blottis au fond des rifle pits, trous où ils se dissimulent pour tirer, déciment cruellement les grand gardes. La moitié des hommes valides – le camp renferme pas mal de blessés – se repose pendant que l’autre veille.
Les cinq mille soldats du général Middleton, commandant en chef l’armée canadienne, sentant l’approche d’une action décisive, s’y sont préparés avec une ardeur mêlée de colère. Ils ont, en effet, à venger plusieurs échecs sérieux infligés par des adversaires inférieurs en nombre, en armement, en discipline, si dédaigneusement qualifiés de sauvages, par les Anglais et les journaux à leur dévotion.
Avant-hier encore, les sauvages ont bel et bien culbuté les soldats réguliers s’élançant à l’assaut de Batoche, et s’imaginant l’emporter sans coup férir.
Pour tenter une attaque de vive force, le général Middleton possédait, outre l’appoint du nombre, un steamer armé en guerre, le Northcote, qui, remontant le Saskatchewan, criblait Batoche de projectiles et opérait ainsi une diversion redoutable.
Ni la bravoure des miliciens, ni leur nombre, ni l’artillerie du steamer, ni celle du corps de troupe ne purent briser l’héroïque résistance des métis. Bien mieux, ces derniers, quittant à un moment donné leurs tranchées et leurs rifle pits, attaquèrent à leur tour les réguliers et la canonnière. Le Northcote, assailli par un feu d’enfer, est à moitié désemparé, son équipage massacré du haut des berges du Saskatchewan par les infaillibles tireurs Bois-Brûlés. Il dut se retirer loin du théâtre de la lutte, pendant que les insurgés repoussaient, jusque dans le camp, les grenadiers de Toronto et les carabiniers de Winnipeg. Deux pièces de canon et une mitrailleuse Gatling purent seules arrêter l’impétuosité farouche de leur élan et sauver le général Middleton d’un désastre complet.
... Un mot, en passant, pour expliquer, sinon pour justifier cette lutte fratricide qui vient de reprendre le 12 mai, avec un terrible acharnement.
En 1867, aussitôt après la confédération du Haut et Bas-Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick en Dominion ou Puissance du Canada, les ministres du jeune État rachetèrent à la Compagnie de la baie d’Hudson son privilège territorial, évalué à sept millions de kilomètres carrés. Sur cet immense domaine habitaient, en 1870, deux mille blancs, quinze mille métis, et, en bloc, soixante-dix mille Indiens.
Issus des unions entre les anciens trappeurs français et les femmes indiennes, ces métis vivaient comme chez eux, sur des terrains occupés de père en fils et consacrés à l’agriculture ou à l’élevage.
Naturellement la Compagnie n’avait jamais eu l’idée de cadastrer ces terres où chacun se sentait plus qu’à l’aise et n’avait nulle envie d’empiéter sur le voisin.
Mais tout changea du jour où, cessant d’être les tenanciers de l’ancienne compagnie, ils relevèrent directement du gouvernement de la Puissance.
On sait que, au Canada, il existe un antagonisme séculaire entre Anglais et Français d’origine, conquérants et annexés. Antagonisme d’autant plus vif qu’il se complique d’une question religieuse.
Les métis ou Bois-Brûlés du nord-ouest sont des catholiques fervents qui ont pieusement conservé, avec la religion paternelle, l’usage exclusif de la langue française du siècle dernier, avec ses tournures naïves et ses gracieux archaïsmes.
Ce ne sont donc pas des sauvages, comme affectent de le dire les fanatiques protestants de l’est, mais de vaillants agriculteurs, de braves pères de famille élevant leur nombreuse lignée dans l’amour de Dieu, le goût du travail, le culte des vieux souvenirs.
Malgré tout, on ne voulut pas voir en eux de loyaux et fidèles sujets, possesseurs du sol en raison des droits conférés par une occupation séculaire, mais des sauvages qu’on se mit en devoir d’évincer sans plus de formalité.
C’était une excellente occasion pour les orangistes, disposant de la majorité au gouvernement, de satisfaire leurs rancunes nationales et religieuses, et de faire une opération lucrative.
Des arpenteurs anglais bâclèrent à leur façon un cadastre de fantaisie, et quand les premiers occupants parlèrent de leurs droits, il leur fut répondu, avec l’exaspérante arrogance anglaise, que tout droit sans titre est un droit sans valeur.
Dès lors les colons orangistes de l’est arrivèrent de la province d’Ontario et s’installèrent à leur place !
Las de réclamer en vain, les Bois-Brûlés se soulevèrent, sous la conduite de Louis Riel, un jeune métis de vingt-six ans, élevé au collège de Montréal. Ils furent vaincus par le colonel Wolseley, mais leur protestation armée ne fut pas inutile, puisqu’ils obtinrent gain de cause et furent amnistiés, tant l’injustice était criante.
Tout alla bien pendant quelques années, quand la fertilité des provinces du nord-ouest provoqua un nouvel et plus intense mouvement d’émigration, qui amena de nouveaux et plus graves conflits de propriété.
Pour la seconde fois, les colons dénient les droits des métis, prétendent les déposséder et les traiter comme des Indiens nomades, c’est-à-dire les repousser devant leur civilisation, les parquer dans des réserves et prendre leur place.
Pour la seconde fois aussi, les métis s’adressent à Louis Riel, leur protecteur naturel, et Louis Riel répond à leur appel. Il reçoit leurs réclamations, les porte au gouvernement, puis entame avec lui d’énervantes et interminables négociations.
Il semble que dans cette circonstance les hommes d’État canadiens aient voulu pousser à bout les Bois-Brûlés, dont la vertu dominante n’est certes pas la patience, et les contraindre à un nouvel éclat.
C’était inévitable. Las d’être bernés depuis des années, ils se révoltent en 1885, au mois de janvier, et font prisonniers les membres du gouvernement provincial. Arraché à ses négociations par cette précipitation de tous points regrettable, Louis Riel accourt se mettre à la tête des insurgés dont le nombre grossit, et qui l’acclament avec enthousiasme.
Un groupe important, sous la conduite de Gabriel Dumont, a déjà obligé le général Crozat d’évacuer Fort Carlton, et assiégé Battleford, chef-lieu du district de Saskatchewan.
Louis Riel, commandant en chef, se fortifie dans Batoche, de façon à pouvoir combiner avec Dumont une action décisive.
Aussitôt le gouvernement et les chambres prennent peur. Des crédits sont votées d’urgence pour défendre les régions menacées. Le général Middleton réunit à la hâte cinq mille hommes et se met en route, pour enlever Batoche et débloquer Battleford.
Les rigueurs d’un hiver terrible arrêtent sa marche rendue fort difficile par les troupes de partisans qui escarmouchaient sans relâche et décimaient sa petite armée.
Il dut hiverner à Fish-Creek et put seulement se remettre en campagne vers la fin d’avril. Il assiégea sans retard Batoche devant lequel il eut la prudence d’élever un camp retranché.
Il attaqua résolument le 9 mai et fut repoussé. Le 10, deuxième attaque non moins inutile. Le 12 au matin, la troisième action s’engage.
... D’un seul mot, digne des héros de Tacite, Louis Riel a électrisé les siens :
« Enfants de la vieille France, vous combattez sous le drapeau de vos pères... soyez dignes d’eux, et faites votre devoir. »
Et ils firent leur devoir simplement, héroïquement, jusqu’à ce que la trahison les livrât sans défense à un ennemi supérieur en nombre, en armement, en discipline...
Trahison !... à ce mot qui résonne lugubrement à ses oreilles, Louis Riel envisage la situation avec le sang-froid et le coup d’œil d’un stratégiste consommé. Instinctivement, il sent que toute résistance va devenir impossible. La prolonger outre mesure, c’est provoquer un désastre irréparable.
Ses hommes se feront tuer jusqu’au dernier s’il exige d’eux le suprême sacrifiée. Mais après ?... Si, du moins, leur mort assurait le triomphe de l’idée pour laquelle ils combattent !
La rage au cœur, les larmes aux yeux, il murmure d’une voix étouffée, pendant que le messager de Baptiste, tout pâte, attend un ordre :
« Allons, c’est fini !... il faut battre en retraite pendant qu’il en est temps encore et tirer ces malheureux de ce guet-apens...
« J’ai charge d’existences, et je frémis en pensant aux veuves et aux orphelins.
« Oh ! maudits soient à jamais les traîtres !
« ... Toi, dit-il à l’homme, retourne là-bas et dis à Baptiste qu’il tienne encore un quart d’heure, puis qu’il se replie sur l’église. »
Cinq minutes après, l’estafette avait rejoint les débris de la barricade où la lutte continuait avec une opiniâtreté sauvage.
« Adieu !... Baptiste, dit-il après avoir transmis l’ordre de Louis Riel.
– Adieu !... quoi ?...
– Je reviens... de là-bas... avec une balle... en pleine poitrine...
« Si tu te sauves... jure-moi... de poursuivre... fût-ce au fond de l’enfer, Toussaint... qui nous a perdus... et de lui faire payer...
– Je le jure !
– Merci ! balbutie le blessé qui s’abat en vomissant un flot de sang.
– Tonnerre ! Encore un bon de moins... Eh ! gare à toi, petit, dit-il en terrassant d’une main son plus jeune fils menacé à bout portant par une carabine emmanchée de sa baïonnette ruisselante.
– Tu ne tueras plus personne ! » gronde le second, Jacques, d’une voix sourde, en fendant d’un coup de hache la tête du milicien.
C’est maintenant le tour de Jean qui, pour ménager ses dernières cartouches, a aussi empoigné sa hache.
Le vieux Baptiste, adossé à une maison en flammes, se trouve entouré de quatre soldats en vareuse gris de fer.
« Rends-toi ! lui crie un sergent.
– Des bêtises ! répond le Bois-Brûlé.
– Ah ! tu veux toucher au père... toi », crie Jean qui lui abat une épaule.
François s’est relevé avec l’agilité d’un tigre entre deux de ces soldats qui l’ont cru mort.
Ceux-ci, voyant son extrême jeunesse, pensent avoir bon marché de lui et veulent le saisir. L’adolescent étend ses bras d’athlète, et sans effort apparent, les colle à la muraille fumante en disant :
« Bougeons pas !
– Des prisonniers ?... demande le père, quéque t’en veux faire ?
– Une idée à moi, p’pa... une crâne idée...
« Jean, et toi, Jacques, essayez d’attraper chacun une veste grise... dépêchez-vous, frères... »
La mêlée est épaisse, mais la fusillade peu intense, ainsi qu’il arrive dans les corps à corps entre combattants très excités.
Par un hasard tenant du prodige, ni Baptiste ni ses fils, qui ne se sont guère ménagés, ne portent de blessures graves. Des éraflures, des contusions, quelques estafilades légères, c’est tout.
Jacques allonge la main sur la carabine brandie par le quatrième soldat, la relève et tire à lui brusquement. Le milicien, obéissant à cette irrésistible traction, s’abat sur la figure, est cueilli au vol par le jeune Bois-Brûlé qui, un peu goguenard de son naturel, le tend à son frère en disant :
« Voici l’objet.
– Bon ! c’est assez de trois, reprend François avec sa prodigieuse tranquillité.
« P’pa, vous savez... le quart d’heure promis à Louis Riel est passé.
– Ça s’peut ben, mais faut faire bonne mesure...
– À votre idée, p’pa... mais les autres battent en retraite... voyez, nous sommes presque seuls.
« Jean, prends un soldat et mets-le sur ton dos... Jacques, à toi l’autre... à moi le troisième...
« Vous, p’pa... sans vous commander, marchez devant... nous allons vous suivre en file indienne... »
Le vieux Baptiste a fait trop bonne mesure. Sans l’idée originale de son jeune fils, tous quatre essuyaient un feu de peloton envoyé par un groupe que vient de former un officier.
Mais, nul n’ose plus tirer, dans la certitude absolue d’atteindre les soldats ainsi transformés en boucliers très efficaces, bien qu’un peu encombrants.
Les jeunes Bois-Brûlés délaient au grand trot, l’un derrière l’autre et précédés de leur père, sans être aucunement retardés par le poids additionnel d’un milicien porté à dos, jambes pendantes, avec son fourniment.
Ils arrivent enfin sains et saufs devant l’église. Louis Riel a mis les minutes à profil pour commencer la retraite qui s’opère avec une incroyable célérité, mais dans un ordre superbe, du côté de la rivière. Il y a toujours un simulacre de défense pour cacher ce mouvement. Il est d’ailleurs si téméraire et en apparence si désespéré, que le général ne l’a pas aperçu.
Du reste, les maisons de pierre sont autant de forteresses qu’il faut enlever une à une, et celles de bois flambent toutes à la fois, en produisant une fumée intense qui dissimule suffisamment les évolutions des métis.
Près des trois quarts ont déjà franchi la rivière au moment où Baptiste et ses fils débouchent sur la place avec leurs prisonniers.
À la vue des vareuses grises, quelques exaltés, furieux de leur échec, veulent faire un mauvais parti aux miliciens qui, se voyant aux mains des gens dont on leur a exalté la férocité, s’attendent à être massacrés.
Mais Baptiste se met devant eux et dit d’un ton ne souffrant pas de réplique :
« Voyons, camarades, j’sommes-t’y des sauvages pour tuer des prisonniers ?
« D’abord, c’est nous qui les avons pris !... Ils sont à nous... pas à d’autres, et j’sommes libres d’en faire ce que je voulons.
« Y a-t-y quéqu’un pour me démentir « icite » ?
– Oui, oui, t’as raison, père Baptiste.
– En outre, ces gensses-là nous ont empêchés d’être tués...
« Ça, c’est peut-être un peu malgré eux, je ne dis pas, mais enfin la chose existe.
« Et je trouve, moi, Baptiste, que ça mérite récompense.
« La preuve, c’est que je vais leur rendre la liberté.
« Y en a-t-il que ça gêne parmi vous ?...
– Non !... non ! fais à ton idée, Baptiste.
– Vous entendez, messieurs les soldats, tout le monde consent.
« Eh bien, continue le vieux Bois-Brûlé d’un ton plein de dignité, vous êtes libres !
« Allez rejoindre vos camarades et dites-leur comment les sauvages traitent leurs ennemis.
– Et moi, monsieur, interrompt en français un des miliciens saluant militairement, je vous remercie au nom de mes camarades et au mien.
« Vous êtes un gentleman !
– Maintenant, mes amis, ajoute le brave métis en s’adressant à ceux qui l’entourent, y s’agit de ne pas moisir en place.
« Continuez à vous défiler en douceur du côté de la rivière... moi, je reste icite avec mes gars pour soutenir la retraite.
« Nous abandonnerons la place les derniers. »
Les miliciens, heureux d’en être quittes à si bon compte, ont fait demi-tour et se sont élancés vers leurs camarades qui se rapprochent en tiraillant.
Baptiste s’assied tranquillement sur une poutre à demi carbonisée, bourre sa pipe et se baisse pour ramasser un tison. Un coup de feu plus sec, plus strident que les détonations des Winchester, éclaté dans une direction opposée diamétralement aux deux corps de miliciens.
Le Bois-Brûlé se redresse convulsivement, pousse un cri rauque et va pour s’abattre en avant, frappé d’une balle entre les deux épaules.
Prompts comme la pensée, ses fils s’élancent et le soutiennent.
« Jésus !... mon Dieu !... mes pauvres chers enfants... Je suis mort !... dit-il d’une voix étouffée.
III
Blessure mortelle. – Dernières volontés. – L’assassin. – Mort d’un brave. – En retraite. – Seuls. – Au milieu des ennemis. – Un sergent. – « Fusillez-moi ça ! » – Intervention inattendue. – Un ardent défenseur. – Assistance houleuse. – Renfort. – La caution. – Amis !
Pâles, crispés, hagards, les jeunes gens demeurent sans un mot, sans un geste, comme s’ils étaient, du même coup, atteints en plein cœur.
« Portez-moi devant l’église, ajoute le blessé... surtout que pas un ne s’éloigne pour chercher du secours... c’est inutile... je vais mourir et je veux vous avoir là... jusqu’à la fin. »
D’affreux sanglots soulèvent la poitrine des trois fils pendant qu’ils transportent, selon son désir, leur père dont les traits contractés annoncent une souffrance atroce.
« Père !... il faut voir pourtant, sanglote François.
– À ton idée, mon enfant... »
Jacques et Jean l’allongent sur le sol, en le retournant bien doucement sur le côté. François fend avec son couteau la blouse en peau de cerf percée d’un petit trou rond.
À peine si quelques gouttes de sang coulent de la plaie déjà cerclée d’une sinistre aréole brune.
La balle, de très faible calibre, a brisé l’épine dorsale un peu en biais et traversé un poumon. Un épanchement se produit à l’intérieur et très rapidement, car la respiration devient difficile.
Le jeune homme, ayant déjà guerroyé pas mal, a trop l’expérience des blessures pour ne pas constater l’horrible vérité : son père n’a pas un quart d’heure à vivre !
Éperdu, affolé, à la pensée de voir expirer ce père tant aimé, il tombe lourdement sur les genoux en balbutiant :
« Père !... père !... non... vous ne mourrez pas.
– Mes chers enfants, écoutez-moi, dit d’une voix déjà râlante Baptiste, qui conserve une admirable sérénité.
« Adossez-moi au mur... bien !...
« Reculez-vous un peu... que je vous voie tous trois...
« Je meurs assassiné par un des nôtres... j’ai entendu le coup... ce n’est pas la détonation d’une arme de guerre... mais celle d’un rifle canadien... Le trou de la balle n’est pas plus gros qu’un tuyau de plume...
« N’est-ce pas, François !
« Je n’ai pas d’ennemis, n’ayant fait de mal à personne... un seul homme avec intérêt à ma mort... c’est Toussaint Lebœuf... le traître qui nous a livrés...
« Toussaint a entre les mains une grosse somme à moi appartenant... dix mille dollars... Vous entendez !... cinquante mille francs en monnaie de France... confiés pour les faire valoir... votre fortune... qu’il veut s’approprier...
« Mon Dieu que je suis déjà faible ! et j’ai tant à vous dire...
« Jean !... la gourde ! »
Docilement l’aîné des Bois-Brûlés débouche la gourde à demi pleine d’eau-de-vie et l’approche des lèvres du moribond qui boit à longs traits.
« Merci, mon grand enfant... je me sens mieux.
« Il vous faut retrouver à tout prix Toussaint, et lui faire rendre, par tous les moyens possibles, cet argent...
« Vous entendez... les dix mille dollars... votre bien... loyalement gagnés par moi aux mines d’or du Caribou.
« ... Comme chrétien je pardonne à mon ennemi.
« ... Vous verrez plus tard si, en votre âme et conscience, vous devez pardonner à celui qui a vendu ses frères, et rendu inutile tant de sang versé.
« ... Vous allez être bien seuls... bien isolés dans la vie..., conduisez-vous toujours comme si vous agissiez sous mes yeux, et dites-vous, quand vous douterez : que penserait le père... s’il était là ?
« Ne faites jamais à autrui ce que vous ne voudriez pas qui vous fût fait à vous-même... et restez toujours... de bons et loyaux Français...
« Portez mes adieux à Louis Riel... dites-lui qu’il ne capitule pas et ne se rende jamais à ces gens-là...
« Un mourant voit juste et loin... votre cause est perdue... Il vaut mieux, pour lui et les plus compromis, passer aux États-Unis...
« Quant à vous, retournez au Caribou, près de vos oncles... les Perrot... les frères de défunte votre chère et digne mère... dites-leur...
« ... Ah ! mon Dieu !... ma vie s’en va... j’ai encore.
« Adieu ! mes enfants bien-aimés... je meurs en vrai fils de Français... en bon chrétien... »
Sa main ébauche un signe de croix, puis une gorgée de sang lui remplit la bouche. Une suprême convulsion l’agite, il se raidit et meurt l’œil fixé sur la croix du clocher, alors qu’un métis essayait d’en arracher, au milieu d’une grêle de balles, le drapeau blanc.
Au moment où Baptiste expirait dans les bras de ses fils, les derniers Bois-Brûlés battaient en retraite avec cette précipitation particulière aux soldats d’arrière-garde, toujours au moment de perdre le contact, et qui chez eux ressemble à une déroute.
Pourtant, chacun en passant ralentit le pas, puis s’arrête, se découvre devant le cadavre du vétéran de l’indépendance des métis, et adresse à ses fils quelques rudes et affectueuses paroles de condoléances.
Pendant un moment, Jean, Jacques et François, abîmés dans leur douleur, ont tout oublié, en présence de leur cher mort...
« Frères, dit Jean, qui le premier semble s’éveiller d’un cauchemar, il faut l’emporter... là-bas avec les nôtres...
– Oui, frère, tu as raison, répond Jean, les vestes grises vont arriver et nous ne pourrions pas lui faire des funérailles selon notre cœur.
– Frères !... s’écrie François, alerte !... les voici ! »
Confiant dans sa vigueur, il se baisse et soulève le cadavre qu’il tient étroitement embrassé. Il va s’élancer vers le passage situé entre deux maisons en flammes, et qui a donné accès à la petite armée de Louis Riel, quand des voix lui intiment brutalement l’ordre de s’arrêter.
« Halte-là... ! pas un geste ! pas un mouvement ou vous êtes morts ! »
Une vingtaine de miliciens, les habits en désordre, la barbe et les cheveux roussis, débouchent du passage qu’ils viennent de trouver. Il en arrive également du côté opposé.
En un moment, les jeunes gens voient un cercle menaçant de baïonnettes les entourer.
L’instant est critique et les réguliers, très excités par la lutte, furieux d’une résistance aussi prolongée, tout désappointés de n’avoir pas réussi à capturer Louis Riel, semblent, comme tout à l’heure les métis, vouloir malmener les prisonniers.
Ceux-ci, acculés à la muraille de l’église, ont couché le cadavre et se tiennent devant lui, résolus à faire tête à la foule en armes, pour lui épargner une suprême profanation.
« By God !... pas tant d’histoires, grogne un sergent haut de six pieds, sec comme une latte, à longs favoris roux, à vastes dents jaunes.
« Ces gens-là sont des rebelles à l’autorité de Sa Majesté la Reine, des incendiaires, des assassins, des sauvages !
« Fusillez-moi ça ! »
La guerre, entre hommes de pays étrangers, a ses usages imposés aux belligérants par des conventions internationales qui stipulent essentiellement les soins aux blessés, et le respect aux prisonniers.
La guerre civile ne connaît ni usages ni conventions. C’est l’homicide fléau dans toute son horreur, sans les palliatifs, hélas ! insuffisants, apportés par notre civilisation. À tel point que l’adversaire désarmé n’a pas toujours la vie sauve, que le blessé lui-même ne trouve pas grâce devant le vainqueur, quand le pardon serait si facile et en même temps si logique, entre citoyens du même pays !
Faut-il que les haines de famille soient si farouches et si tenaces, qu’on se refuse, entre membres de cette famille, ce qu’on accorde à des étrangers !
Le sergent long et roux appartenait à cette catégorie de gens toujours prêts à coller au mur ceux de l’adverse partie. Dans la foule des miliciens se trouvaient des volontaires disposés à fournir le peloton d’exécution.
On veut entraîner les jeunes Bois-Brûlés qui résistent.
Laissez-nous enterrer notre père ! dit Jean fièrement.
– God bless me ! vocifère le sergent, ivre de brandy, ce qui n’est pas une circonstance atténuante, les sauvages font des façons !...
« Qu’à cela ne tienne ! On vous enterrera tous les quatre, si cela peut vous faire plaisir. »
Il allonge en même temps son fusil dans la direction de Jacques, plus rapproché, pour lui brûler la cervelle, à bout portant.
Son doigt cherche la détente, le coup va partir.
Brusquement un homme, portant aussi l’uniforme de l’armée régulière, accourt à toutes jambes, fend les rangs et relève la carabine dont la balle fait voler un large plâtras, arraché à la muraille.
« Sergent ! crie l’homme indigné, vous alliez commettre une infamie.
– De quel droit, riposte avec hauteur le sous-officier, m’empêchez-vous d’accomplir de justes représailles ?
– C’est vrai !... c’est vrai !... vocifèrent plusieurs miliciens.
« De justes représailles !... le sergent a raison. »
Se sentant soutenu, ce dernier reprend avec une colère croissante :
« Des sauvages qui pillent, volent, incendient, assassinent et scalpent...
– Mensonge ! interrompt l’homme qui protège les métis.
« Et vous savez bien que ceux-ci, dans l’intérêt même de leur cause, désavouent les excès des Indiens.
– Peu importe !
– Du reste, ne sont-ils pas à demi Indiens... rebelles à l’autorité...
« Allons, camarade, faites place ! et vous, soldats, feu sur ces vermines de sauvages !
Mais le milicien, au lieu de se ranger, se jette devant Jean, Jacques et François, dont l’admirable fermeté ne se dément pas.
« Eh bien ! s’écrie-t-il, superbe d’indignation, tirez donc et assassinez-moi avec eux.
« Car moi vivant, je jure qu’il ne tombera pas un cheveu de leur tête. »
Naturellement le sergent qui a mal débuté ne veut pas en avoir le démenti. Au Canada, comme ailleurs, l’autorité, surtout celle d’un subalterne, ne peut ni ne doit fléchir ou se tromper.
La généreuse tentative du soldat rallie quelques miliciens, mais la majorité est franchement hostile. Il craint d’être enlevé de force, et regarde anxieusement de tous côtés s’il ne lui arrive pas de secours.
Un cri de joie lui échappe à la vue de deux hommes débouchant aussi du passage au milieu des flammèches et des tisons.
« À moi !... Stephen... à moi !... Peter !... »
Ceux-ci reconnaissent aussitôt celui qui profère cet appel désespéré...
« Edward !... Edward Middleton... et nos métis !...
Ils accourent, bousculent de droite et de gauche le groupe et se joignent à leur ami.
Ils n’ont que le temps de lui jeter un mot d’interrogation.
« Qu’y a-t-il, Edward ?...
– Ce qu’il y a, répond celui-ci dont l’exaspération est à son comble...
« Tenez !... regardez ces trois jeunes gens auxquels nous devons la vie...
« Eh bien !... sous prétexte de représailles, on veut les assassiner !...
« Ce sergent, ivre ou fou...
– Je suis votre supérieur et je vous ordonne d’obéir...
– Et moi, je le crie bien haut : c’est vous qui êtes les sauvages ! Vous qui, victorieux, voulez égorger des hommes sans défense.
« Si c’est ainsi que vous entendez la civilisation, j’en rougis pour le drapeau anglais. »
Sans se préoccuper des murmures qui couvrent sa voix, l’intrépide milicien hausse encore le ton.
« Puisque la question d’humanité ne vous touche pas, laissez-moi du moins faire appel à votre justice.
« Tout à l’heure, en plein feu de la bataille, mes amis et moi, nous fûmes les prisonniers de ce vieillard que ses fils pleurent...
« Leur parti venait d’être trahi et vaincu... Au lieu d’assouvir sur nous une fureur légitime en pareil cas, on nous rendit généreusement la liberté !...
« Et il n’y en eut pas un seul, parmi ces sauvages, vous entendez, pas un seul pour protester.
« À mon tour, je réclame pour eux la vie sauve et la liberté.
« Je me porte avec mes deux amis caution pour eux, et nous en répondons corps pour corps.
« S’il en est parmi vous auxquels ne suffit pas la garantie d’Edward Middleton, le neveu, le fils adoptif du général, j’attends qu’ils viennent me le dire en face. »
L’accent vibrant du milicien, ses paroles généreuses, son attitude résolue, celle de ses deux compagnons, et enfin le nom respecté du chef suprême de la petite armée, triomphent des hésitations dernières.
Le sergent, n’osant plus s’opposer à la volonté formelle d’un simple soldat si bien apparente, met l’arme sur l’épaule et s’en va en grognant.
Sa retraite est le signe d’une dissolution complète. La troupe se disperse, la cause est gagnée.
Les Bois-Brûlés et les miliciens restent seuls en présence.
Ils échangent une vigoureuse et cordiale étreinte, puis Middleton ajoute, pour terminer ce dramatique incident :
« Vous pouvez maintenant rendre les derniers devoirs à votre père.
« Nous restons avec vous et notre présence vous servira de sauf-conduit.
« Notre dette est payée, mais nous ne sommes pas quittes.
« Puisque nous avons appris à nous connaître et à nous estimer sur la champ de bataille... puisque toute animosité entre gens comme nous n’a aucune raison d’être... voulez-vous qu’une loyale et sincère amitié succède aux injustes préjugés d’autrefois.
– De tout notre cœur, répond, au nom de ses frères, Jean, l’aîné, en mettant sa main dans celle d’Edward.
« Nous sommes et serons toujours vos amis.
« Puisse cette affection, qui ne s’éteindra jamais, présager l’union de tous ceux dont la haine, issue d’un cruel malentendu, a fait tant de victimes. »
Livre premier
Première partie
Pour venger un père
I
Ce que l’Américain entend par telescoper et boomer. – Défilé d’Enfer et Lac du Diable. – Accroissement d’une ville. – Beaux jours passés. – La loi de Lynch. – Sac d’un cabaret. – Assassinat et incendie. – Shérif original. – Les exploits de Bob Kennedy. – Pendu à un poteau télégraphique.
En Amérique où le temps est plus que jamais et plus que partout ailleurs de l’argent, il n’est pas de petite économie. Non seulement il faut agir, mais encore parler vite. Aussi, le Yankee, pénétré de cette vérité, s’est-il mis à sabrer, à tort comme à travers, au milieu des règles et des usages de sa langue maternelle.
À quoi bon des périphrases qui encombrent et ralentissent les conversations, surtout quand on peut les remplacer par des mots ?
Et si les mots manquent, on les forge de toutes pièces. Inventer un mot, la belle affaire ! pour des gens ayant improvisé le chemin de fer transcontinental !
Exemple, suggéré par cette idée de chemin de fer.
Deux trains lancés à toute vapeur se rencontrent sur la même voie. En raison du choc formidable produit par cette rencontre, les wagons s’enfoncent mutuellement et rentrent, pour ainsi dire, les uns dans les autres. L’idée d’une pareille catastrophe est exprimée généralement au moyen de substantifs, de verbes, d’articles, d’adjectifs et autres formules grammaticales empruntées aux idiomes de tous les pays.
L’Américain, en homme pressé, raconte cela d’un seul mot qui remplace une description, même très sommaire, du sinistre. Il dit simplement : deux trains se sont télescopés... c’est-à-dire sont entrés l’un dans l’autre comme les tubes d’une lunette.
Est-il possible de parler d’une façon plus concise et plus énergique ? Le mot de télescopé ne mentionne-t-il pas tout, jusques et y compris l’aplatissement des voyageurs écrabouillés comme des insectes ?
Dans un autre ordre de choses, le Yankee ne dit pas qu’une ville prend de l’extension, que sa population augmente, que son chiffre d’affaires s’accroît. C’est trop long pour un homme qui raconte en un seul mot l’anéantissement de deux trains.
Il annonce que telle ou telle ville boome.
Le substantif anglais boom signifie : bout-dehors. Les bouts-dehors sont de petites vergues supplémentaires, destinées à allonger les vergues principales, de façon à établir de nouvelles voiles.
Dont le néologisme boomer, issu d’un vocable maritime, signifie textuellement : prendre de l’envergure. On l’a étendu à toutes sortes d’acceptions pour exprimer l’idée d’extension subite, de succès énorme, d’engouement général. On voit boomer des villes, des actions, des pilules, des journaux, des mines de pétrole...
Bien mieux, ce mot baroque a été adopté par les Canadiens qui l’ont introduit dans la langue française, et s’en servent quotidiennement dans leurs journaux. À tel point qu’il n’est pas rare de trouver des phrases comme celle-ci : « On peut affirmer que les immigrants boomeront cette année sur tel ou tel point. »
Or, le 1er juin 1885, c’est-à-dire trois semaines après les événements racontés précédemment, on annonçait que Hell-Gap « boomait ». Hell-Gap – Défilé d’Enfer – cité d’avant-garde du Grand-Ouest, se trouvait à cette époque par 99º longitude à l’occident de Greenwich et 48º de latitude septentrionale, à cinq kilomètres au nord du lac du Diable (Devil’s Lake), sur la rivière Mauvaise-Coulée.
Ne cherchez pas sur la carte. Après avoir coup sur coup boomé et déboomé, après avoir été brûlée deux fois, Hell-Gap a émigré de dix lieues à l’orient et s’appelle aujourd’hui Devil’s Lake City : Ville du lac du Diable.
Or, le 1er juin 1885, Hell-Gap, simple minning camp, ou pour s’exprimer en français usuel, vulgaire agglomération de tentes et de baraques de bois, grossissait, de jour en jour, comme une rivière en mal d’inondation.
La position est d’ailleurs excellente. Situé sur le territoire des États-Unis, à quatre-vingts kilomètres seulement de la frontière canadienne, et à cent quarante kilomètres du chemin de fer qui relie Winnipeg à Minneapolis et à tout le réseau américain, le minning camp, devenu bien vite cité, semble appelé à une fortune rapide.
Aux tentes loqueteuses, aux ignobles log-houses en troncs bruts et couverts de plaques de gazon, succèdent les frame-houses, maisons en planches, indiquant déjà un certain confort. On a tracé cinq ou six avenues, larges de soixante-dix mètres, coupées à angle droit par une vingtaine de rues larges de cinquante. Il y a déjà une banque, trois églises, un court-house (palais de justice), quatre hôtels et une infinité de saloons, lisez cabarets, où des empoisonneurs sans vergogne vendent à prix d’or les drogues incendiaires si chères aux gosiers yankees.
De telle façon que Hell-Gap, qui comptait, il y a deux mois, cinq cents habitants manquant de l’indispensable, en comprend aujourd’hui deux mille vivant dans une abondance relative. Et si la nouvelle est vraie, que les sables alluvionnaires de la rivière Mauvaise-Coulée renferment de l’or en notable quantité, il y en aura dix mille à la fin de l’année.
On ne sait plus dès lors où s’arrêtera un « boom » si bien commencé, car le pays, une fois l’or épuisé, sera très favorable à l’élevage du bétail, comme en général toutes les plaines du Dakota.
Cependant, si la majeure partie des habitants semble enchantée d’une prospérité qui se chiffre en beaux dollar sonnants, il est certaine catégorie de gens que ce nouvel état de choses ne semble pas ravir absolument.
Jadis, il y a quelques semaines, au bon temps des log-houses, Hell-Gap était le lieu d’élection des irréguliers arrivant, d’une part, de la frontière canadienne avec un compte ouvert chez le shérif ; d’autre part aussi, les gentlemen qui, dans les États de l’est américain, avaient eu des difficultés avec dame Justice, y retrouvaient très volontiers les collègues venus de la « Puissance ». Faillis, repris de justice, déclassés, virtuoses du couteau et de l’arme à feu s’installaient, comme sur un terrain neutre, à portée des deux frontières, travaillaient quand ils ne pouvaient pas faire autrement, buvaient dès qu’ils possédaient quelques grains d’or, jouaient un jeu d’enfer quand le lavage des sables avait été fructueux, et se massacraient volontiers quand la brutale ivresse des bars leur flambait le sang et leur incendiait la cervelle.
Il n’y avait d’autre loi que celle du bon plaisir, appuyée d’un solide couteau – bowie-knife – et d’un revolver Colt, sortant à tout propos du pistol-pockett – poche à pistolet – placé en arrière et sous la ceinture du pantalon.
Et voilà que tout à coup, des gens venus on ne sait d’où, et ne valant certes pas mieux que les premiers occupants, émettent la fantaisie baroque de modifier cette organisation, ou plutôt cette absence d’organisation offrant un si agréable spécimen d’anarchie.
Ils ont la prétention de tout réglementer, à tel point qu’il faut payer maintenant, dans les saloons, la consommation autrement qu’à coups de revolver ; que les hôteliers veulent voir la couleur des dollars des clients, et qu’il ne suffit plus d’appartenir à l’estimable classe des desperados pour se faire héberger et abreuver gratuitement.
La preuve, c’est que sous les auspices de ces fournisseurs timorés et outrecuidants s’est formé un comité de vigilants. Ces vigilants ont pris la loi en main et la font exécuter d’une façon primitive, mais radicale. À la moindre velléité d’entorse donnée à cette nommée Loi, le comité, représenté par des gens masqués, armés jusqu’aux dents, accourt, empoigne le délinquant, lui met une corde au cou, et le hisse au premier arbre venu. Comme variante, il peut être accroché à un isolateur de poteau télégraphique, ou sauter, le nœud coulant sous le menton, du pont placé au-dessus de la rivière Mauvaise-Coulée.
Si encore il y avait un shérif ! Peut-être pourrait-on s’entendre avec lui, car, en Amérique, il n’est guère de fonctionnaire capable de résister à l’octroi d’un bon pourboire.
Arrive un shérif. Très brave homme sans doute, mais, par hasard, incorruptible !...
Incorruptible, c’est un malheur. Peut-être est-il faible ? Dans ce cas, il faut le tâter.
Aussitôt dit, aussitôt fait. L’exécution de ce mirifique projet, éclos dans le cerveau d’une demi-douzaine de sacripants, ne souffre aucun retard. Sous la conduite d’un certain Bob Kennedy, voleur de chevaux entérite, échappé jusqu’alors par miracle aux vigilants, ils saccagent un saloon dont le patron ne leur avait pas témoigné des égards suffisants. On brise les glaces, on mitraille à coups de revolver les fûts de whisky dont le contenu ruisselle jusque dans la rue, et finalement, on contraint, le couteau sur la gorge, le saloon-keeper à verser le montant de la caisse aux mains de ce cher Bob Kennedy.
Le débitant hésite, se débat, cherche des faux-fuyants, et veut gagner du temps pour sauver sa recette.
Bob, un peu nerveux, va pour le piquer légèrement au niveau de la pomme d’Adam, afin de faire pénétrer en lui la persuasion. Ce n’est pas la persuasion, mais la maudite lame qui entre jusqu’à la colonne vertébrale.
Le bar-keeper pousse un cri rauque et tombe mort aux pieds de Bob qui dit, stupéfait de ce dénouement tragique :
« Je ne l’ai pas fait exprès !...
« C’est curieux comme il y a des gens qui ont la vie tendre » ! »
Après cette oraison funèbre dénuée d’artifice et de fleurs de rhétorique, le contenu du tiroir-caisse passe aux mains de l’association. Puis, pour en finir, Bob, jamais à bout d’expédients, jette une allumette sur le whisky ruisselant à flots. L’intérieur du bar s’enflamme comme un punch colossal, le cadavre grille, la maison flambe, et les vigilants accourent furieux, pour faire payer aux gredins ce nouveau méfait.
Bob et ses amis se sont réfugiés dans un saloon voisin et rival, naturellement, dont la porte s’est hospitalièrement ouverte. Ils se barricadent et ouvrent le feu sur les vigilants dont plusieurs sont atteints grièvement. Arrive enfin le shérif, seule autorité légale et reconnue officiellement.
Très bravement, d’ailleurs, il s’avance vers la porte close et dit :
« Bob ! mon garçon, rendez-vous, au nom de la loi !
– Je le veux bien ; mais, pour Dieu ! shérif, puisque vous parlez au nom de la loi, renvoyez donc ces vigilants dont la constitution et les procédés sont illégaux.
– Je vous donne ma parole que nul ne vous touchera.
– C’est bien !... nous nous rendons... placez-vous au milieu de nous, et prévenez ces drôles qu’au premier geste suspect nous vous faisons sauter la cervelle. »
Le trajet du bar au court-house s’opéra sans encombre, les vigilants étant bien certains de repincer avant peu les sept malandrins. Mais ils comptaient sans une idée originale du shérif qui tenait à les remettre intacts au jury.
Comme Hell-Gap n’a pas encore de prison, le shérif dut interner ses prisonniers dans son bureau situé au premier étage du court-house. Craignant en outre que les vigilants ne vinssent les lui enlever pendant la nuit, pour les accrocher aux poteaux télégraphiques, il leur laissa leurs revolvers afin qu’ils pussent au besoin se défendre.
Enfin, connue le bureau n’est pas aménagé pour être transformé en salle à manger, il les emmena, dès le lendemain, prendre deux fois par jour leur repas à un hôtel voisin, à l’exception toutefois de Bob, mis aux fers comme plus dangereux.
Tout marcha, bien pendant trois jours, quand le shérif dut s’absenter pour aller remplir au loin les devoirs de sa charge. Il confia les prisonniers à deux de ses amis, nommés Robert Ollinger et William Bonny en leur recommandant, naturellement, la plus grande vigilance1.
Pénétré de l’importance de ses devoirs, Ollinger chargea avec ostentation un fusil de chasse à deux coups et fit même remarquer à Bob qu’il mettait dix-huit chevrotines dans chaque canon.
L’heure du déjeuner étant arrivée, il accota le fusil contre un mur et conduisit à l’hôtel-restaurant les pensionnaires externes, laissant en tête-à-tête avec Bob, William Bonny qui se mit à lire un journal en attendant que le repas de Bob fût apporté.
Ce dernier, depuis son arrestation, s’ennuyait fort, et cherchait une occasion de dire adieu au court-house. Ayant réussi, après des prodiges de patience et d’adresse, à se débarrasser d’une de ses menottes, il envoya sur la tête de Bonny un formidable coup de poing qui interrompit brusquement la lecture de celui-ci.
Avant que Bonny tout épouvanté ait pu gagner la porte, il tombait frappé d’une balle de revolver entre les deux épaules. Bob, cet exploit accompli, s’arma du fusil chargé de chevrotines, ouvrit la fenêtre et attendit les événements.
La détonation ayant été attendue de l’hôtel, Ollinger accourait.
« Hallo ! Bob ! mon cher homonyme ! » cria Kennedy du balcon.
Robert Ollinger leva la tête et aperçut son prisonnier.
« Voici votre fusil ! Le reconnaissez-vous ?...
« Vous voyez, mon pauvre Robert, quand on charge un fusil, on ne sait pas pour qui l’on travaille...
« La preuve !... »
Une double détonation retentit et le malheureux s’abat sur le sol, les reins brisés.

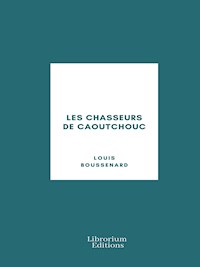


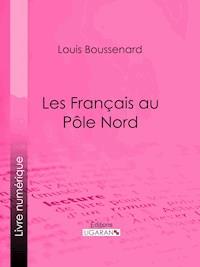













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










