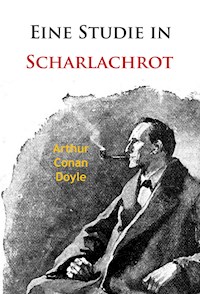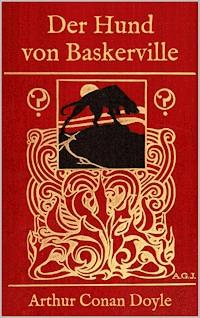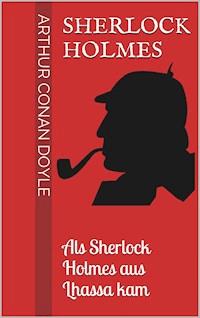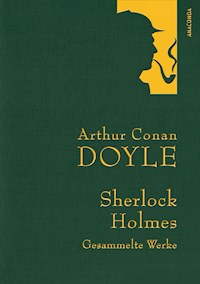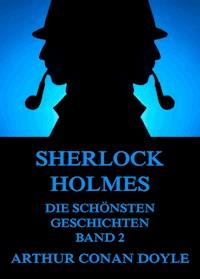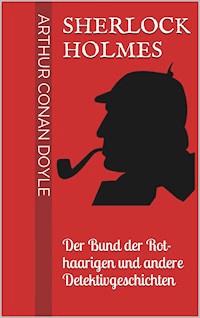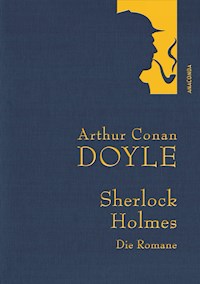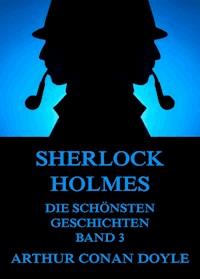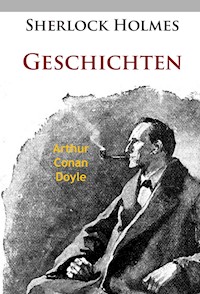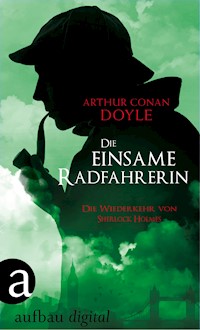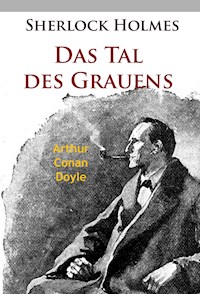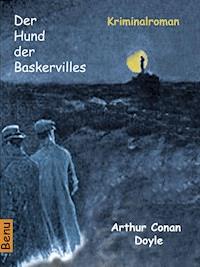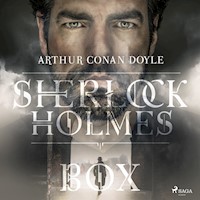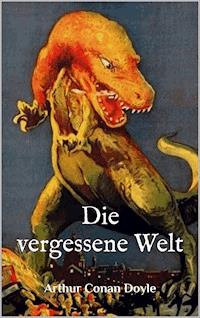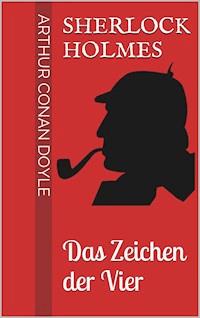4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Un groupe cosmopolite de touristes, parti du Caire à bord du Korosko pour une croisière sur le Nil, est enlevé par une troupe de derviches musulmans fanatiques qui tentent de les emmener à Karthoum pour y être vendus comme esclaves. Suivent maintes péripéties, «pimentées» de considérations politiques tenues par des anglais, des français et des américains sur la présence militaire anglaise en Égypte et en Afrique en cette fin du XIXe siècle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
La tragédie du Korosko
Chapitre 1Chapitre 2Chapitre 3Chapitre 4Chapitre 5Chapitre 6Chapitre 7Chapitre 8Chapitre 9Chapitre 10Page de copyrightChapitre 1
Le public se demandera peut-être pourquoi les journaux n’ont jamais raconté l’histoire des passagers du Korosko. À une époque comme la nôtre, où les agences de presse scrutent tout l’univers à la recherche du sensationnel, il paraît incroyable que le secret ait protégé si longtemps un incident international d’une telle importance. Bornons-nous à dire que cette discrétion reposait sur des motifs fort valables, à la fois politiques et d’ordre privé. D’ailleurs, un certain nombre de personnes étaient au courant des faits ; une version de ceux-ci parut même dans un journal de province, qui s’attira aussitôt un démenti. Les voici maintenant transcrits sous la forme d’un récit. Leur exactitude est garantie par les dépositions faites sous la foi du serment par le colonel Cochrane Cochrane, du club de l’Armée et de la Marine, par les lettres de Mademoiselle Adams, de Boston, Mass., ainsi que par le témoignage recueilli au cours de l’enquête secrète menée au Caire par le Gouvernement auprès du capitaine Archer, des méharistes égyptiens. Monsieur James Stephens a refusé de nous communiquer par écrit sa version de l’affaire ; mais comme les épreuves de ce livre lui ont été soumises, comme il n’y a apporté ni corrections ni suppressions, nous sommes en droit de supposer qu’il n’a relevé aucune inexactitude matérielle, et que ses objections à notre publication se fondaient surtout sur des scrupules personnels.
Le Korosko avait une carène en carapace de tortue, l’étrave renflée, la poupe arrondie, un tirant de quatre-vingt centimètres et le profil d’un fer à repasser. Le 13 février 1895 il appareilla de Shellal, près de la première cataracte, à destination de Ouadi-Halfa. Je possède la liste des passagers de cette croisière ; la voici :
Colonel Cochrane Cochrane … … … … … … … … .. Londres.
M. Cecil Brown … … … … … … … … … … … … … … … … Londres.
John H. Headingly … … … … … … … … … … … … … … Boston, U.S.A.
Mlle Adams … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Boston, U.S.A.
Miss S. Adams … … … … … … … … … … … … … … … … .. Worcester, Mass. U.S.A.
M. Fardet … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Paris.
M. et Mme Belmont … … … … … … … … … … … … … … Dublin.
James Stephens … … … … … … … … … … … … … … … .. Manchester.
Rev. John Stuart … … … … … … … … … … … … … … … . Birmingham.
Mme Shlesinger, la nurse
et un enfant Florence.
Voilà quels étaient les touristes qui partirent de Shellal, avec l’intention de remonter les trois cent trente kilomètres du Nil nubien qui séparent la première cataracte de la deuxième.
Pays étrange, cette Nubie ! Sa largeur varie entre quelques kilomètres et quelques mètres, car son nom ne s’applique qu’à la bande étroite de terres cultivables. Verte, mince et bordée de palmiers, elle s’étend de chaque côté du large fleuve couleur de café. Au-delà, sur la rive libyenne, commence le désert sauvage qui se prolonge sur toute la largeur de l’Afrique. Sur l’autre rive, un paysage pareillement désolé s’étale jusqu’à la mer Rouge lointaine. Entre ces deux immensités arides, la Nubie s’étire le long du fleuve comme un ver de terre tout vert. Par endroits elle s’interrompt : le Nil coule alors entre des monts noirs et craquelés par le soleil ; des sables mouvants orange décorent leurs vallées. Partout on décèle des vestiges de races disparues et de civilisations submergées. Des tombeaux bizarres s’inscrivent sur le flanc des collines ou se découpent contre l’horizon : pyramides, tumuli, rocs servant de pierres tombales ; mais partout, des tombeaux. De-ci de-là, quand le bateau contourne une pointe rocheuse, on aperçoit sur la hauteur une ville abandonnée, des maisons, des murailles, des remparts ; le soleil passe à travers les fenêtres ou les créneaux carrés. On apprend que la ville a été édifiée par des Romains, ou par des Égyptiens ; à moins que son nom et son origine n’aient été irrémédiablement perdus. On reste stupéfait ; on se demande pourquoi une race humaine, quelle qu’elle ait été, a bâti dans une solitude aussi rude. On admet difficilement la théorie selon laquelle ces constructions n’ont eu d’autre but que de défendre l’accès de la plaine fertile contre les pillards et les sauvages du Sud. Mais en tout cas elles se dressent encore, ces cités silencieuses et rébarbatives ; et au sommet des monts, on peut voir les tombeaux où sont ensevelis leurs habitants ; de loin elles ressemblent aux sabords d’un cuirassé. Telle est la région mystérieuse et morte que traversent en fumant, bavardant, flirtant, les touristes qui remontent vers la frontière égyptienne.
Les passagers du Korosko s’entendaient bien entre eux ; ils avaient déjà fait presque tous ensemble le trajet du Caire à Assouan ; le Nil est capable de faire fondre toutes les glaces, y compris la plus résistante : l’anglo-saxonne. Ils avaient une chance inouïe : leur groupe était exempt de LA personne déplaisante qui, à bord d’un petit navire, suffit à gâcher l’agrément de tous. Sur un bateau à peine plus important qu’une grande vedette, un raseur, un cynique, un grognon tiennent à leur merci tous les passagers. Heureusement le Korosko n’avait rien embarqué qui ressemblait à un gêneur. Le colonel Cochrane Cochrane était l’un de ces officiers que le gouvernement britannique, conformément au règlement, déclare incapables de service actif à un certain âge, et qui démontrent la valeur du règlement en consacrant le reste de leur existence à explorer le Maroc ou à chasser le lion dans la Somalie. Brun, se tenant très droit, le colonel manifestait volontiers de la courtoisie déférente, mais son regard avait la froideur d’une commission d’enquête ; très soigné dans sa tenue vestimentaire, précis dans ses habitudes, il était gentleman jusqu’au bout des ongles. Pratiquant l’aversion des Anglo-Saxons pour les épanchements, il se cantonnait dans une réserve qui pouvait passer à première vue pour de l’antipathie ; mais il avait parfois du mal à dissimuler le bon cœur et les sentiments humains qui influençaient ses actes. À ses compagnons, de voyage il inspirait plus de respect que d’affection : tous avaient en effet l’impression qu’il n’était pas homme à laisser s’épanouir en amitié une relation de croisière ; pourtant, une fois accordée, cette amitié devenait partie intégrante de lui-même. Sa moustache était grisonnante, très militaire ; mais il avait gardé des cheveux extraordinairement noirs pour son âge. Dans la conversation il ne faisait jamais allusion aux nombreuses campagnes où il s’était distingué ; il expliquait cette discrétion en disant qu’elles remontaient au début de l’ère victorienne, et qu’il sacrifiait sa gloire militaire sur l’autel de sa jeunesse immortelle.
Monsieur Cecil Brown (je prends les noms dans l’ordre de la liste) était un jeune diplomate qui appartenait à une ambassade sur le continent ; n’ayant pas tout à fait rompu avec le style d’Oxford, il péchait un peu par excès de subtilité, mais sa conversation était fort intéressante et témoignait d’une culture certaine. Il avait un beau visage triste, une petite moustache qu’il cirait soigneusement aux extrémités, une voix grave, et une négligence d’attitude que compensait une charmante façon de sourire lorsqu’il se laissait aller à sa fantaisie. Il s’efforçait de contrôler par un scepticisme railleur ses enthousiasmes juvéniles bien naturels ; dans ce cas il tournait le dos à l’évidence pour exprimer des idées qui choquaient le premier venu. Pour le voyage il avait emporté des livres de Walter Pater, et il restait assis toute la journée sous la tente avec un roman et son carnet de croquis à côté de lui sur un tabouret. Sa dignité personnelle lui interdisait de faire des avances aux autres, mais si ses compagnons décidaient de venir lui parler, il se révélait aussi courtois qu’aimable.
Les Américains avaient constitué un groupe à part. Originaire de la Nouvelle-Angleterre et diplômé de Harvard, John H. Headingly complétait son éducation par le tour du monde. Il symbolisait parfaitement le jeune Américain, vif, observateur, sérieux, assoiffé de savoir, et à peu près libre de préjugés ; animé d’un beau sentiment religieux, nullement sectaire, il gardait la tête froide au sein des orages soudains de la jeunesse. Il semblait moins cultivé que le diplomate d’Oxford ; en réalité il l’était davantage, car ses émotions plus profondes contrebalançaient des connaissances moins précises. Mademoiselle Adams était la tante de Mademoiselle Sadie Adams : vieille fille de Boston, petite, énergique, ingrate de visage, elle comprimait difficilement une grande tendresse inemployée ; c’était la première fois qu’elle quittait l’Amérique, et une tâche entre toutes la passionnait : hisser l’Orient au niveau du Massachusetts. À peine débarquée en Égypte, elle avait trouvé que ce pays avait besoin d’être éclairé ; elle s’en occupa fébrilement. Les ânes au dos écorché, les chiens affamés, les mouches collées autour des yeux des bébés, les enfants tout nus, les mendiants importuns, les femmes en haillons, tout semblait défier sa conscience ; aussi se lança-t-elle avec courage dans une œuvre réformatrice. Comme toutefois elle ne parlait pas un mot de la langue du pays, et comme elle était incapable de se faire comprendre, sa remontée du Nil laissa l’Orient à peu près dans l’état où elle l’avait découvert, mais procura par contre à ses compagnons de voyage de nombreux sujets d’amusement. Sa nièce Sadie, qui partageait avec Madame Belmont l’honneur d’être la passagère la plus populaire du Korosko. N’était pas la dernière à s’en divertir. Très jeune, fraîche émoulue du Smith Collège, elle possédait encore la plupart des qualités et des défauts de l’enfance. Elle avait la franchise, la confiance un peu naïve, la droiture innocente, l’intrépidité, et aussi la loquacité et l’irrespect de son âge. Mais ses défauts eux-mêmes plaisaient, d’autant plus que cette grande et belle fille paraissait plus âgée qu’elle ne l’était réellement, à cause des boucles basses qui ourlaient ses oreilles et des formes pleines de son corps. Le frou-frou de ses jupes, sa voix décidée et franche, son rire agréable étaient toujours bien accueillis à bord du Korosko. Le colonel lui manifestait de la gentillesse bienveillante, et le diplomate d’Oxford cessait d’être artificiel quand Mademoiselle Sadie Adams s’asseyait à côté de lui.
Nous parlerons plus brièvement des autres passagers. Certains étaient plus intéressants que d’autres, mais tous étaient corrects et de bonne éducation. Monsieur Fardet, Français accommodant bien que raisonneur, soutenait des opinions arrêtées touchant les machinations politiques de la Grande-Bretagne et l’illégalité de sa situation en Égypte. Monsieur Belmont, robuste Irlandais aux cheveux gris, avait remporté presque tous les concours de tir au fusil de Wimbledon et de Bisley ; il était accompagné de sa femme, pleine de charme et de grâce, très raffinée, et délicatement enjouée comme on l’est en Irlande. Madame Shlesinger, veuve d’un âge moyen, paisible et douce, n’avait d’yeux que pour son enfant qui avait six ans. Le Révérend John Stuart était un pasteur non conformiste de Birmingham, presbytérien ou congrégationaliste ; doté par le Créateur d’une corpulence considérable qu’accompagnait une lenteur léthargique, il possédait aussi un fond d’humour simple qui avait fait de lui, d’après mes renseignements, un prédicateur à succès et un orateur efficace bien qu’asthmatique, quand il parlait sur des estrades ultra-radicales.
Il y avait enfin Monsieur James Stephens, avoué à Manchester (l’un des associés de la firme Hickson, Ward et Stephens) qui voyageait pour dissiper les effets d’une mauvaise grippe. Stephens s’était fait lui-même : il avait commencé par laver les carreaux de la société avant de diriger l’affaire. Pendant trente années, il s’était adonné à un travail aride, technique, et il n’avait vécu que pour satisfaire de vieux clients et en attirer de nouveaux. Son esprit et son âme étaient imprégnés du formalisme et de la rigueur des lois qu’il avait pour mission d’expliquer. Son tempérament ne manquait pourtant pas de noblesse et de sensibilité ; mais celles-là commençaient à s’étioler comme s’étiolent, dans la City, toutes les vertus humaines. Il travaillait par habitude, et, célibataire, il n’était intéressé par rien d’autre : son âme s’était cuirassée, pareille au corps d’une religieuse du Moyen Âge. Quand il tomba malade accidentellement, la Nature l’avait houspillé, expulsé de son repaire, et expédié dans le vaste monde, loin de Manchester et de sa bibliothèque remplie d’autorités reliées en veau. Au début, il l’avait vivement regretté. Puis, progressivement, ses yeux s’étaient ouverts, et il s’était vaguement rendu compte que son travail était bien banal à côté de cet univers merveilleux, divers, inexplicable, qu’il avait ignoré. Il en venait même à se demander si cette pause dans sa carrière ne se révélerait pas plus importante que sa carrière en soi. Des intérêts nouveaux le submergèrent, et ce juriste presque quinquagénaire sentit s’allumer en lui les derniers feux d’une jeunesse que trop de lectures avaient étouffée. Il était trop têtu pour convenir que ses manières avaient toujours été sèches et précises et qu’il usait d’un langage légèrement pédant ; cependant il lut, réfléchit et observa ; il soulignait et annotait son Baedeker, comme autrefois il avait souligné et annoté ses livres de droit. Il avait embarqué au Caire, et il s’était lié avec Mademoiselle Adams et sa nièce. Le franc-parler et la hardiesse de la jeune Américaine l’amusaient : Sadie en échange lui vouait le composé de respect et de pitié dû à ses connaissances et à ses limites. Ainsi devinrent-ils bons amis, et on souriait en voyant la figure sombre de l’avoué et le clair visage de la jeune fille penchés sur le même guide.
Le petit Korosko remontait le Nil en lançant des jets de fumée et d’écume ; il faisait plus de bruit et d’embarras avec ses cinq nœuds à l’heure qu’un transatlantique à l’assaut d’un record. Sur le pont, sous la tente épaisse, la petite famille de ses passagers était assise ; régulièrement au bout de quelques heures, le bateau accostait afin de leur permettre de visiter une nouvelle série de temples. Mais les ruines devenaient de moins en moins antiques, les touristes qui s’étaient rassasiés à Gizeh et à Sakara en contemplant les plus vieux monuments construits par l’homme commencèrent à se lasser de temples qui dataient tout au plus du début de l’ère chrétienne. En Égypte, on remarque à peine des ruines qui en tout autre pays seraient l’objet d’une vénération émerveillée. Les touristes n’eurent donc que des regards languissants pour l’art semi-grec des bas-reliefs de la Nubie ; ils gravirent le mont de Korosko afin d’assister au lever du soleil sur le sauvage désert oriental ; ils consentirent à admirer le grand temple d’Abou-Simbel, parce qu’une vieille race avait creusé une montagne comme un fromage ; enfin, au soir du quatrième jour de leur voyage, ils arrivèrent à Ouadi-Halfa, la ville-frontière, avec quelques heures de retard provoquées par une légère défectuosité dans les machines. Ouadi-Halfa était aussi une ville de garnison. Le lendemain matin, ils devaient se rendre en expédition sur le célèbre roc d’Abousir, d’où l’on jouit d’une vue magnifique sur la deuxième cataracte. À huit heures et demie, alors que les passagers étaient assis sur le pont après dîner, Mansoor l’interprète, un Syrien mâtiné de Copte, s’avança pour annoncer, comme chaque soir, le programme du lendemain.
– Mesdames et Messieurs, dit-il, demain n’oubliez pas de vous lever au premier coup de gong, afin que l’excursion soit terminée pour midi. Quand nous serons arrivés à l’endroit où des ânes nous attendent, nous les enfourcherons pour nous enfoncer de huit kilomètres dans le désert ; nous passerons devant un temple d’Ammon-Ra, qui date de la dix-huitième dynastie, puis nous atteindrons le roc d’Abousir dont la célébrité est incomparable. Quand vous serez arrivés, vous comprendrez que vous êtes à la lisière de la civilisation ; d’ailleurs, en poussant de quelques kilomètres plus loin, vous vous trouveriez dans le pays des derviches ; vous vous en rendrez compte quand vous serez au sommet. De là-haut, vous distinguerez la deuxième cataracte dans un paysage qui comprend toutes les variétés des sauvages beautés naturelles. Toutes les célébrités du globe ont gravé leurs noms sur la pierre ; donc, vous ne faillirez pas à ce rite…
Mansoor attendit un petit rire étouffé ; il s’inclina quand il l’entendit.
– … Vous rentrerez ensuite à Ouadi-Halfa, où vous passerez deux heures au corps des méharistes ; vous assisterez au pansage des animaux, vous irez faire un tour au bazar. Je vous souhaite donc une très joyeuse et très bonne nuit.
Ses dents blanches brillèrent à la lumière de la lampe ; puis son long pantalon foncé, sa veste courte anglaise et son tarbouche rouge disparurent successivement au bas de l’échelle. Le bourdonnement des conversations, qu’avait interrompu son arrivée, reprit de plus belle.
– Je me repose sur vous, Monsieur Stephens, déclara Sadie Adams, du soin de tout connaître d’Abousir. J’aime bien savoir ce que je regarde quand je le regarde, et non pas six heures plus tard dans ma cabine. Par exemple, je n’ai pas retenu grand-chose d’Abou-Simbel et des peintures murales, bien que je les ai vues hier.
– Moi je n’espère jamais me tenir au courant, dit sa tante. Quand je serai de retour, saine et sauve, dans Commonwealth Avenue, et quand il n’y aura plus d’interprète pour me bousculer, j’aurai tout le temps de lire ; je pourrai alors me passionner et désirer revenir par ici. Mais vous êtes vraiment trop aimable, Monsieur Stephens, d’essayer de nous documenter.
– J’ai pensé que vous souhaiteriez avoir quelques renseignements précis ; aussi vous ai-je préparé un petit résumé, répondit Stephens en tendant une feuille de papier à Sadie.
Elle y jeta un coup d’œil à la lumière de la lampe du pont et son rire jeune fusa en cascade.
– Re Abousir ! lut-elle. Voyons, qu’entendez-vous par Re, Monsieur Stephens ? Vous aviez déjà écrit « Re Ramsès II » sur le dernier papier que vous m’avez remis !
– C’est une habitude que j’ai acquise, Mademoiselle Sadie, déclara Stephens. Une coutume dans la profession que j’exerce quand on fait un mémo.
– Un quoi, Monsieur Stephens ?
– Un mémo… Un mémorandum, si vous préférez. Nous mettons Re Tel ou Tel, pour désigner de quoi nous parlons.
– Je veux croire que c’est une bonne méthode, dit Sadie ; mais elle me semble un peu étrange quand elle s’applique à des paysages ou à des pharaons égyptiens. Re Cheops… Vous ne trouvez pas cela drôle ?
– Non, je ne peux pas dire que je le trouve drôle.
– Je me demande si les Anglais possèdent moins d’humour que les Américains ou si c’est une autre forme d’humour… murmura la jeune fille.
Elle avait une manière paisible, abstraite de s’exprimer, elle donnait l’impression de penser tout haut.
– … Je croyais qu’ils en possédaient moins ; mais quand on réfléchit, Dickens, Thackeray, Barrie et quantité d’autres humoristes que nous admirons sont des Anglais. Par ailleurs, au théâtre, je n’ai jamais entendu un public rire plus fort que le public de Londres. Tenez : nous avions derrière nous un spectateur qui, chaque fois qu’il riait, provoquait un tel courant d’air que ma tante se retournait pour voir si une porte ne s’était pas ouverte. Mais vous usez de certaines expressions drôles, Monsieur Stephens !
– Qu’avez-vous trouvé encore de drôle, Mademoiselle Sadie ?
– Eh bien, quand vous m’avez envoyé le ticket du temple et la petite carte, vous avez commencé votre lettre : « Ci-inclus, veuillez trouver… » Et, à la fin, entre parenthèses, vous aviez mis « Deux pièces jointes ».
– Formules courantes dans les affaires, Mademoiselle.
– Dans les affaires ! répéta Sadie avec une gravité feinte.
Un silence tomba.
– Il y a une chose que je désire ! déclara Mademoiselle Adams de la voix dure et métallique qui camouflait son cœur tendre. C’est de voir le Parlement de ce pays et de lui exposer un certain nombre de faits. Une loi imposant l’usage du collyre serait l’une de mes propositions ; une autre serait l’abolition de ces sortes de voiles qui transforment les femmes en balles de coton trouées pour les yeux.
– Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elles portaient des voiles, dit Sadie. Jusqu’au jour où j’en ai vu une qui avait relevé le sien. Alors j’ai compris !
– Elles me fatiguent, ces femmes ! s’écria Mademoiselle Adams irritée. Autant prêcher le devoir, la décence et la propreté à un traversin ! Tenez, hier encore à Abou-Simbel, Monsieur Stephens, je passais devant l’une de leurs maisons (si vous pouvez appeler maison ce pâté de boue) ; j’ai vu deux enfants sur le pas de la porte, avec l’habituelle croûte de mouches autour de leurs yeux et de grands trous dans leurs pauvres petites robes bleues ! Je suis descendue de mon âne ; j’ai relevé mes manches ; je leur ai lavé la figure avec mon mouchoir ; j’ai recousu leurs robes… Dans ce pays, je ferais mieux de débarquer avec ma boîte à ouvrage qu’avec une ombrelle blanche, Monsieur Stephens ! Bref, je me suis piquée au jeu, et je suis entrée dans la maison. Quelle maison ! J’ai fait sortir les gens qui s’y trouvaient et j’ai fait le ménage, comme une domestique. Je n’ai pas plus vu le temple d’Abou-Simbel que si je n’avais jamais quitté Boston. Par contre, j’ai vu plus de poussière et de crasse entassées dans une maison grande comme une cabine de bain de Newport que dans n’importe quel appartement d’Amérique. Entre le moment où j’ai retroussé mes manches et celui où je suis repartie, avec le visage noir comme cette fumée, il ne s’est pas écoulé plus d’une heure ; peut-être une heure et demie, au maximum ! Mais j’ai laissé cette maison aussi nette qu’une boîte neuve. J’avais sur moi un exemplaire du New York Herald ; je l’ai étendu sur leur étagère. Eh bien. Monsieur Stephens, je suis allée me laver les mains au-dehors, et quand je me suis retournée, les enfants avaient encore les yeux pleins de mouches et ils n’avaient pas changé, sauf qu’ils avaient chacun sur la tête un petit chapeau de gendarme fait avec mon New York Herald ; Mais dites-moi, Sadie, il va être dix heures et l’excursion de demain commence tôt !
– C’est tellement beau, ce ciel de pourpre et ces grandes étoiles d’argent ! murmura Sadie. Regardez le désert silencieux, et les ombres noires des montagnes. C’est formidable ! Mais terrible aussi… Quand on pense que nous sommes réellement, comme vient de le dire l’interprète, à la lisière de la civilisation, avec rien d’autre que de la sauvagerie et du sang répandu là où luit si joliment la Croix du Sud, eh bien, on a l’impression qu’on se tient en équilibre sur le bord d’un volcan !
– Chut, Sadie ! Ne dites pas de bêtises, mon enfant ! s’écria sa tante. Vous risquez d’effrayer ceux qui vous entendraient.
– Mais ne le sentez-vous pas vous-même, ma tante ? Regardez ce grand désert qui se perd dans les ténèbres. Écoutez le chuchotement triste du vent qui vole au-dessus ! Je n’ai jamais vu de spectacle plus solennel !
– Je suis ravie que nous ayons enfin trouvé quelque chose qui vous rende solennelle, ma chérie ! Parfois j’ai pensé… Au nom des vivants, qu’est cela ?
De quelque part au milieu des ombres des montagnes, de l’autre côté de l’eau, un cri aigu avait jailli ; il monta dans le ciel étoilé, et finit par s’étouffer dans une sorte de plainte sinistre.
– Un chacal, tout simplement, Mademoiselle Adams, expliqua Stephens. J’en avais déjà entendu un quand nous étions allés voir le Sphinx au clair de lune.
Mais l’Américaine s’était levée ; son visage trahissait un profond désarroi.
– Si c’était à refaire, dit-elle, je ne serais pas descendue au-delà d’Assouan. Je ne sais pas ce qui m’a prise de vous emmener jusqu’ici, Sadie. Votre mère pensera que je suis complètement folle, et je n’oserais plus jamais la regarder en face si un incident désagréable se produisait. J’ai vu de ce fleuve tout ce que je voulais voir ; j’ai hâte de rentrer au Caire.
– Voyons, ma tante ! protesta Sadie. Cela ne vous ressemble guère d’être pusillanime !
– Je ne sais pas ce que j’ai, Sadie, sinon les nerfs à fleur de peau, et cette bête miaulant là-bas était de trop. Je me console en pensant que demain nous ferons demi-tour après avoir vu ce roc ou ce temple, je ne sais plus. Je suis écœurée de rocs et de temples, Monsieur Stephens ! Je serais enchantée si je n’en voyais plus un seul de toute ma vie. Venez, Sadie ! Bonne nuit !
– Bonne nuit ! Bonne nuit, Mademoiselle Adams !
La tante et la nièce regagnèrent leur cabine.
Monsieur Fardet bavardait à voix basse avec Headingly, le jeune diplômé de Harvard ; entre deux bouffées de cigarette, il se penchait pour lui faire ses confidences.
– Des derviches, Monsieur Headingly ? disait-il en excellent anglais mais en séparant les syllabes comme la plupart des Français. Mais il n’y a pas de derviches. Les derviches n’existent pas !
– Moi, je croyais que le désert en était rempli, répondit l’Américain.
Monsieur Fardet jeta un regard oblique vers l’endroit où brillait dans les ténèbres le feu rouge du cigare du colonel Cochrane.
– Vous êtes Américain, et vous n’aimez pas les Anglais, murmura-t-il. Tout le monde sur le continent sait que les Américains sont hostiles aux Anglais.
– Ma foi, déclara Headingly de sa voix lente et réfléchie, je ne nierai pas que nous avons nos petits désaccords, et que certains de mes compatriotes, spécialement ceux de souche irlandaise, sont des anti-Anglais enragés ; cependant la grande majorité des Américains ne pense aucun mal de la mère patrie. Les Anglais peuvent parfois nous exaspérer, mais ils sont de notre famille ; nous ne l’oublions jamais.
– Soit ! dit le Français. Du moins puis-je m’exprimer avec vous comme je ne pourrais pas le faire avec les autres sans les offenser. Et je répète qu’il n’y a pas de derviches. Les derviches ont été inventés par Lord Cromer en 1885.
– Vous ne parlez pas sérieusement ! s’écria Headingly.
– C’est un fait bien connu à Paris ; il a été publié par LaPatrie et d’autres journaux renseignés.
– Mais c’est colossal ! Voudriez-vous dire par là, Monsieur Fardet, que le siège de Khartoum et la mort de Gordon et le reste ont fait partie d’un vaste bluff ?