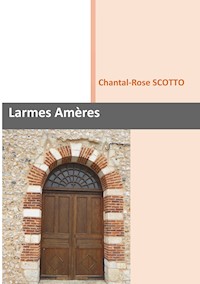
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La vie n'était pas que rose au Bec. Des petits secrets existaient bel et bien au Château. Une vieille histoire circulait parmi les gens de maison et se racontait parfois à la veillée. Quelqu'un chapardait la nuit dans les garde-mangers de Margot. Un larcin dangereux et destructif qui jetait l'opprobre sur les habitants du domaine. La suspicion planait sur tous les habitants du château créant une ambiance chargée de haine et de mauvais souvenirs. Le doute planait sur tout l'office qui se scrutait avec aigreur. L’œuvre d'un larron affamé car les portions prélevées étaient de belles tailles. Que dire des histoires d'amour vécues par les uns, par les autres ?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Table des matières
Chantal-Rose SCOTTO Biographie
Partie 1 : Larmes amères
CHAPITRE I
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII
CHAPITRE VIII
CHAPITRE IX
CHAPITRE X
CHAPITRE XI
Partie 2 : Le Château des Larmes
CHAPITRE I
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
ÉPILOGUE
Chantal-Rose SCOTTO
Biographie
Je me situe aujourd’hui entre mémoires et autobiographies. Ne ressentant aucune tendance autobiographique, j’applique tant de filtres sur mes mémoires, je suis moi. Pas de confession expiatoire de péchés véniels ou capitaux, pas d’épanchement ni même de curriculum vitae où ne subsistent année par année que les belles choses de la vie.
Mes confessions sont le récit rétrospectif en prose qu'une personne telle que moi, émotionnelle et réelle, fait de sa propre existence, mettant l'accent sur sa vie individuelle et en particulier l'histoire de sa personnalité…
Ma famille et le monde de ma jeune vie, insouciante et heureuse, me révélaient une autre de leurs forces, captées dans l'enfance. J’avais dix ans, la violence se déchaînait dans l'injustice, la bêtise, le scandale, l'horreur et l’indépendance de l’Algérie. Je demeurais insouciante de beaucoup de choses que les gens prennent au sérieux, mais ma vie cessa d'être un jeu. À la force de l’âge, je connus mes racines et ne feignis plus d'échapper à ma situation : je tentai de l'assurer.
La réalité pesa dès lors son poids. Encore, il me paraît outrecuidant de tant parler de moi. Je ne renie pas ma préférence pour l’histoire inventée, dans laquelle, sans ostentation aucune, j’infiltre quelques ressemblances avec ce qui est moi, créateur.
Entre ces deux moments de ma vie, jeune femme, j’ai lié des amitiés, j’ai voyagé, j’ai beaucoup lu, et j’ai commencé ma carrière d'écrivain. J’évoque la transition qui me fit passer de jeune femme soumise à l’éducation ambiguë fondée sur un silence mensonger, un secret, à la femme consciente de ses responsabilités et résolue à s'engager dans la littérature.
J’allais m’engager dans le récit de mes doutes, mettre en scène mes souvenirs racontant des faits contemporains et dresser un portrait d’auteur de moi-même. Me glisser au cœur d’un monologue étranger, mon journal intime, favorise cette intrusion, et aussi certains romans que j’ai lus. Ma destination fut différente et je me suis réjouie d’avoir quitté ce chemin chaotique pour entrer dans la seule divagation d’histoires inventées, que le style du genre policier permettait de tisser. Ce sentier initiatique caillouteux et pentu appelait mes ardeurs et empressements. D’un tout autre regard, un boulevard s’étirait devant moi, ses larges voies m’attiraient tandis qu’une peur viscérale paralysait l’action, et je regardais du point le plus haut d’un pont imaginé, l’abysse élargissant ses parois pour mieux m’y accueillir.
Je livrais ligne après ligne dans des cahiers à spirales, me repentant de ne jamais passer à l’acte, des dialogues racontant l’histoire de cette jeune fille qui ne pouvait pas rencontrer l’amour. Je désirais ardemment qu’elle soit heureuse ! Ainsi, je changeais son destin et retraçais la donne. Je créais et donnais vie aux acteurs, aux chanteurs, et les planches des théâtres vibraient en se chargeant de leurs émotions. Les voix s’envolaient au-delà des décors, les mots et la musique triomphaient de l’humain. L’âme des créateurs envoûtait l’orchestre qui sublimait l’œuvre du compositeur, pendant que le pentagramme placé dans le point haut du décor, dans un balancement régulier et lancinant, hypnotisait l’assemblée des auditeurs.
Chantal-Rose SCOTTO
Partie 1
Larmes amères
CHAPITRE I
Les propriétaires recevaient presque tous les midis et souvent le soir. Ainsi, plusieurs fois par semaine l’office devait faire face à un surcroit de travail. Il fallait s’occuper des invités des enfants en plus des autres convives. Pendant les grandes vacances, du 15 juin au 15 septembre, les petits profitaient à pleins poumons de l’air sain et iodé pour récupérer de leur année de fatigue. Ils étaient nombreux ! Les quatre enfants des châtelains venaient avec leur propre famille, soit, pas moins de quatre enfants chacun.
L’organisation de cette période estivale au château réclamait une rigueur d’intendance que seul Jean-Étienne, maître d’hôtel, était en mesure d’imposer ! Le faste traditionnellement déployé dans cette société n’était pourtant pas de mise ici. Seule une exquise qualité, la ponctualité, agrémentée d’une courtoisie à toute épreuve, répondait à toutes les situations. Les règles de vie indispensables garantissaient le bon fonctionnement du domaine. Les journées étaient parfaitement rythmées, les matinées étant consacrées aux obligations et en particulier aux révisions des cours pour les enfants. Toutes les matières étaient passées en revue, sauf peut-être la musique, tandis que les parents se rendaient dans les villages alentour pour y faire quelques achats. Les après-midis étaient quant à eux réservés à la bicyclette et à la plage de Bruneval pour ramasser des coquillages, s’amuser, nager et brunir ! Enfin, les soirées étaient retenues pour les échanges familiaux, les jeux de société et les veillées après le diner. L’extinction des lumières avait lieu à 22 h 30 pour toute l'assemblée.
La jeunesse grandissait vite et tout le monde au domaine s’ingéniait à lui offrir de beaux moments. Chacun pouvait alors noter que la troisième génération ne respectait plus rien, même si la bienveillance, la douceur et la gratitude imprégnaient leurs paroles et leurs gestes envers Bonne-maman et Bon-papa.
Au service de cette famille d’aristocrates depuis de longues années, Jean-Étienne donnait parfois sa version de l’histoire à la veillée :
– Nous devions mettre les formes pour effectuer notre service devant cette bande de petits nantis, disait-il en les regardant. Sans reconnaissance pour la vie choyée offerte au château, ils en profitaient bien. Il hochait la tête en signe de connivence. Et les enfants réagissaient du haut de leur jeune âge.
L’office au grand complet et tous les habitants de ce vieux domaine au cœur de la campagne normande aimaient les enfants, leur joie, l’esprit de modernité qu’ils insufflaient, leurs idées débordantes d’espoirs et leurs rêves romantiques, mêlés de technologies futuristes. L’un d’entre eux avait prétendu sans sourire qu’il deviendrait le plus grand explorateur de l’espace, tandis qu’une autre affirmait qu’elle serait la première chirurgienne du pays et qu’elle opèrerait les cerveaux. Le plus jeune avait dit son désir d’établir sa renommée en qualité d’évêque, alors que son cousin était déjà général de l’armée française.
Ce n’était pas tout, en les écoutant les gens de l’office comprenaient que tout allait changer, et vite. Ces enfants-là étaient la modernité du pays, ils imaginaient la vie autrement et qui, tout naturellement, en parlaient devant le personnel, parfois même requéraient leur avis. La magie de la jeunesse opérait, ils regardaient vers le ciel et aussitôt ils volaient de continent en continent, inventant des jeux et bâtissant des écoles pour tous les enfants du monde, des grandes ! Leurs rêves s’énonçaient clairement, on les voyait perchés sur leur vélo et sans transition ils imaginaient des bolides. Ils lisaient l’histoire de Michel Strogoff et subitement tout Jules Vernes était à leur portée, ils visitaient en pensées Ekaterinbourg et naturellement s’en allaient jusqu’à Irkoutsk… Entre eux les gens de l’office attendaient des nouveautés à la cuisine – et c’était déjà énorme –, mais là ils rêvaient trop haut et leurs rires sauvaient la situation.
Imperturbable, Jean-Étienne poursuivait, à voix basse, comme pour lui-même : « Lorsqu’ils séjournaient au Bec, chaque matin de 9 h à 11 h 30, ils devaient chacun à son niveau, travailler avec application le français, les mathématiques et autres matières. Une institutrice de l’école catholique recrutée par mes soins et recommandée par l’évêque se livrait inlassablement à la dure bataille de la répétition des règles de grammaire et tables de multiplication. Dès tout petit, ils maitrisaient l’écriture.
Du printemps à l’automne, les jeudis matin de beau temps elle enseignait le catéchisme à ceux qui se trouvaient présents, assis près de l’entrée principale. Les prières devaient être récitées sans hésitation, avec concentration, et redites le dimanche à la grand-messe. Pas la plus petite dérogation n’était envisageable.
Nous, les gens de l’office, nous souffrions avec eux, car aucune faiblesse ne leur était accordée. L’institutrice avait conscience de sa mission et elle conduisait ses jeunes élèves au succès. Ils progressaient vite et bien. Si bien que d’une année à l’autre, nous ne les reconnaissions plus. Instruits, intelligents et beaux, ils riaient de tout et ils représentaient dans ce domaine vieillot et alourdi par le poids des traditions la force vive de la maison.
Lorsque le maître d’hôtel terminait son récit, Maddy prenait la parole sans se faire prier. Elle ne ratait jamais l’occasion de participer, le plus sérieusement du monde, sur un ton mi-figue, mi-raisin : « Ce n’était pas le pire, racontait-elle en fixant les plus jeunes du regard. Le plus difficile pour nous tous à l’office demeurait la rigueur de notre maître d’hôtel, qu’il imposait sous forme de règles de conduite très sévères et antiques ». Les enfants riaient, ils n’imaginaient absolument pas la discipline à laquelle ils échappaient.
Alors, d’un même cœur tous se mettaient à rire.
CHAPITRE II
Le personnel du château se composait de trois cuisinières rompues à la tâche. Elles étaient rapides et efficaces, faisant avec art chauffer poêles et fourneaux. Le visage de Margot, la titulaire, arborait une vilaine marque de vin agrémentée d’un poil noir au beau milieu de la joue droite. Mais à force de la voir, personne n’y attachait plus aucune importance. Pétillants et vifs, ses yeux marron faisaient d’ailleurs oublier cette imperfection. Seul son sourire bienveillant transparaissait. Le travail de cette femme de tête, énergique et organisée, consistait entre autres à élaborer des menus qu’elle soumettait à la châtelaine.
La maîtresse de maison approuvait d’un regard bienveillant les propositions de Maddy. Parfois elle exigeait tel ou tel légume, toujours et sans défaillance les menus ainsi suggérés étaient acceptés. Simplement, l’abondance ici n’était pas de mise. Si la variété et la bonne qualité étaient certes appréciées, les potages et les soupes tenaient une place prépondérante au diner. Quant aux repas de fêtes qui étaient assez nombreux, ils justifiaient quelques directives supplémentaires et Madame recommandait de prévoir de larges portions, voilà tout.
Le petit rituel entre les deux femmes pour l’établissement des menus avait lieu le premier jour de chaque mois. Il apportait du sens à cette étrange cohabitation. L’estime et le respect présidaient à tout entretien entre les maîtres et le personnel.
Aimant la nature et soucieuse d’en respecter le cours, Margot cuisinait en épousant le rythme des saisons pour composer ses mets, et remerciait le ciel de l’abondance du potager. Il fournissait légumes, fines herbes et fruits divers. Forte et confiante, puisqu’elle servait d’année en année les mêmes menus, riant de ses fameux stratagèmes, elle les tenait pourtant secrets bien qu’ils fussent connus de tous. Sa carte était équilibrée, variée et revenait naturellement avec régularité. Chaque année, au jour donné, ressortant ses recettes et menus de ses archives privées qu’elle cachait jalousement, Margot les servait à la satisfaction de tous. Elle n’était pas chiche de détails et croyait sincèrement que tous plongeaient dans ses petits mensonges. Elle cuisinait à merveille, les palais étaient ravis, les hôtes la félicitaient chaque jour, c’était le principal à ses yeux. Pour les viandes, les cuisinières se fournissaient à la ferme des Moyel, où le choix et la qualité étaient irréprochables. Le fermier avait expliqué un matin de nostalgie tout le travail à l’étable : « La traite à la main comme ils faisaient tous, demande de l’expérience pour être efficace.
« Je prends place sur un tabouret sur le côté de l’animal et l’on place un récipient entre ses jambes. Je saisis un trayon et je le presse doucement avec un déplacement vers le bas, ce qui en fait sortir le lait. Dans le cas de la vache, une main tire un trayon pendant que l’autre relâche le voisin selon un rythme assez rapide ». Ici, disaient les cuisinières, nous apprenons de tous !
Puis la cuisinière servait les rôtis du dimanche avec fierté. Quant aux volailles et en particulier les poulets rôtis, cuits moelleux et dorés à point, ils recevaient pour tout assaisonnement du beurre salé et une cuillère de vinaigre de vin. Ils étaient succulents et appréciés de tous. Ils n’étaient servis que le dimanche midi. La tablée enthousiaste en réclamait toujours davantage.
Élément précieux et dévoué, Jeannette était tâcheron. C’était différent pour elle, ses aspirations la portant dans une autre direction. Elle possédait un autre état d’esprit, mais avait-elle choisi sa vie ? Rien n’était moins sûr ! Dans sa famille tout le monde se mariait tôt, plusieurs générations vivaient sous le même toit. Mais pas elle. Jeannette tenait son ménage avec détermination. Son statut lui suffisait. Elle avait un mari aimant et travailleur, sur lequel elle veillait tendrement. Il n’allait pas au café et ses gages servaient en totalité à leur famille composée de trois enfants. Il possédait de surcroit une maisonnette héritée de ses parents, avec une basse-cour ne laissant pas le moindre instant de répit à Jeannette. Avec ses bêtes, elle pouvait assurer, une vie correcte à ses enfants. Le surplus était vendu tôt le dimanche matin aux hallettes, place du marché, ou directement sur le marché un peu plus tard, avant la messe. Ses journées n’en finissaient pas. Elle avait tant à faire à la maison !
Elle était encore une toute jeune fille lorsqu’elle avait été engagée. Puis son mariage avait été parrainé par les châtelains et le nouveau couple avait reçu en cadeau de noces une paire de draps en lin, inusables. La lingère avait brodé leurs initiales. C’était un beau présent. Les châtelains du Bec n’étaient pas radins. Ils savaient agir avec élégance et marquaient tous les évènements concernant le personnel. S’ils comptaient au plus juste, personne ici ne se plaignait.
Le premier enfant de Jeanne avait été une bonne chose, il était arrivé dans la joie et l’espoir du jeune couple. Mais le deuxième et le troisième avaient beaucoup fatigué la jeune femme. En concertation avec Jean-Étienne, les châtelains avaient décidé d’alléger ses horaires. Cinq jours et demi par semaine, c’était bien suffisant. Jeannette était profondément reconnaissante. Remplissant sa tâche avec célérité et beaucoup de dévouement, elle prenait son service à huit heures et pouvait désormais quitter l’office chaque soir à cinq heures. Elle aimait son travail.
Dans l’organisation, venait ensuite Armande, qui était seconde en titre. Sa jeunesse et ses emportements marquaient sa construction psychologique en devenir. Son désir de modernité et de changement résolument tournés vers le futur se révélait sensé et intelligent. Cela l’embellissait dans son naturel et sa pauvreté. Elle criait à qui voulait l’entendre qu’elle ne resterait pas ici, que son avenir était tracé puisqu’un mariage avec le petit-fils des châtelains était prévu. Ils se plaisaient, assurait-elle, il lui avait compté fleurette et elle avait succombé à la romance de ce jeune homme de bonne famille. Il avait su y faire ! Elle, répétait à la ronde qu’elle serait riche et servie et que, par-dessus le marché, elle ne mettrait plus jamais les pieds à l’église et encore moins à confesse, car elle était convaincue qu’il tiendrait sa promesse, il avait juré. Tout cela ne plaisait guère et les langues vipérines s’étaient déliées sans retenue, révélant les failles dans l’apparente unité de la brigade de service. Ces deux versants de la société, bien distincts, se heurtaient parfois, fusionnaient aussi. Ils ne partageaient pas seulement un toit, mais ressentaient souvent le même état d’âme.
À son corps défendant, car elle n’en jouait pas, Armande était jolie, gracieuse et plaisante. Pourtant son éducation était limitée. Elle venait d’un milieu où, faute de temps, les enfants n’allaient pas à l’école. Le travail dans les fermes était indispensable pour survivre à la pauvreté et chaque petit devait remplir sa tâche. La vie de la famille en dépendait. Le travail aux champs était rude.
Armande le racontait parfois : « Je partais dans la charrette avec ma fourche et je revenais assise sur le tas de foin ! Le fauchage des blés était réservé aux hommes et celui de la mise en gerbe, aux femmes. Le travail des fauchaisons requérait un certain art, car il ne fallait pas altérer la paille qui permettait notamment aux animaux de se nourrir. La paille servait en outre à la fabrication des toits. Le blé ramassé à la fourche était mis en bottes puis en gerbes, on le liait avec un fil de lin. Et nous devions entasser les gerbes en quintaux dans le champ pour séchage, s’enflammait la domestique aux mains rugueuses. Ensuite, nous les mettions en meules pour la grande journée des battages en ferme. Ainsi rassemblées en meules, elles donnaient une impression de richesse et c’était beau. Alors, il séchait. Souvent, le temps de séchage durait jusqu’à la fin du mois d’aout, elles demeuraient sous le soleil. Il n’était pas rare d’y voir les enfants jouer dedans. Cela permettait également aux petites mains des environs de glaner pour la nourriture de la volaille.
Sur le sujet, Armande était incollable. La vérité est cependant qu’elle s’appropriait très vite ce qu’elle entendait et voyait. Et tout naturellement elle prenait parfois des airs de mémoire du village, et s’y voyait déjà ! La promiscuité des classes engendrait occasionnellement certaines familiarités, mais tout cela ne portait pas à conséquence. C’est elle qui organisait la fête des moissons pour le Bec. Tous les fermiers prenaient part à ce rituel religieux, de même que les aristocrates, la grande noblesse et la bourgeoisie locale. Chaque fermier déposait au pied de l’autel ce qui représentait sa récolte puis, le dernier dimanche de septembre, à la grand-messe de onze heures, pour célébrer les dons de la nature et la main généreuse de Dieu, le prêtre bénissait l’assemblée et les produits. Pendant la somptueuse cérémonie de la fin de l’été, le prêtre bénissait les récoltes, entouré des enfants de chœur, du diacre et du Suisse, accompagnés par l’organiste qui s’en donnait à cœur joie et jouait tout son savoir. À la fin de la messe, sur le parvis de l’église, tout le monde se saluait. Les uns et les autres s’observaient, échangeaient, comptaient les naissances et les morts, et parfois même y ajoutaient celles du bétail.
Au domaine, l’équipe d’entretien comptait en son sein un garçon de ferme, Lucien, qui était le plus âgé. Il n’effectuait plus de tâches lourdes. Chaque jour, une heure avant le déjeuner, il se rendait dans les cuisines pour récupérer les épluchures de légumes. Celles-ci faisaient le délice de la basse-cour, dont elle constituait la moitié de l’alimentation. En inspectant la propreté des poulaillers, il ramassait les œufs du jour et les rapportait en cuisine. Le soir il rentrait les volailles et jetait une « pouque » en cauchois, c’est-à-dire des sacs de toile sur les cages à lapins qui demeuraient ainsi dans le noir pendant la nuit, c’était ainsi.
Rien ne se perdait !
Vu de l’extérieur, d’aucuns diront automatisme ! Non, il y avait du cœur et de l’attention dans chaque geste qu’accomplissaient les gens de maison. Cependant la vie n’était pas que rose au Bec. Les petits secrets existaient bel et bien. Justement, à propos de secret, une vieille histoire circulait entre ces gens de maison. Margot avait constaté que l’on chapardait dans ses garde-mangers. Il y avait « une sorte d’épidémie dangereuse et destructive de vols dans les cuisines », donc la suspicion planait sur le domaine. Les faits jetaient l’opprobre sur tout le monde. L’office se scrutait avec aigreur. Qui pouvait se livrer à ce petit jeu ? Un larron affamé sans doute, car les portions prélevées étaient de belle taille.
Margot et Jean-Étienne avaient donc secrètement élaboré une stratégie de surveillance, d’une part pour trouver le voleur mais aussi pour éviter d’attirer l’attention des châtelains. Chaque matin les garde-mangers étaient contrôlés.
Or voilà qu’un matin, un jambon de près de cinq kilos qui séchait suspendu au plafond avait été retrouvé tranché nettement. Et les fromages étaient largement entamés ! Les soupçons pesaient sur les jeunes, car qui aurait pu agir de la sorte parmi les domestiques ? Le cynisme du voleur ne connaissait-il donc pas de limites ? Les suppositions allaient bon train. Ce devait être une main experte mais délicate, celle d’une femme selon Margot, ce qui faisait rire généreusement l’office ! C’était au contraire un homme costaud et grand selon Jean-Étienne. Les paris étaient ouverts, mais il fallait quand même attraper les jambons haut suspendus, s’écriait Lucien, plein de bon sens. Mais, qui ? Après quinze jours d’enquête serrée, les larcins avaient cessé. Hélas, personne ne fut démasqué, de vagues soupçons pesèrent un temps sur l’une des relations de Tit’René, rien d’exact ni de bien satisfaisant. Ce vol et la déception de ne pas en avoir découvert les auteurs laissaient un gout amer et ternissaient l’aura de la cuisinière en titre, c’était grave ! Cela marquerait les esprits.
Bien entendu, rien ne permettait de soupçonner les petits-enfants en vacances au château et leurs amis, pourtant de vrais garnements. Margot, en riant, préférait évoquer le fantôme des cuisines qu’elle avait surnommé Gustave puis Gus. Elle ajoutait sans plaisanter qu’elle entendait une drôle de voix chanter les lamentations dans les cuisines vers minuit. Quand les faits remontaient les soirs de veillées, les moqueries allaient bon train.
De l’office au salon, tout le monde comptait sur le jardinier Raymond et son fils Tit-René, qui le suivait comme son ombre et qui mesurait une tête de plus que lui. Tit’René n’avait pas vraiment de qualification. L’office ne connaissait plus leur nom de famille. Raymond avait pour tâche, outre celles du quotidien, de remplir les bidons d’eau. Il les déposait dans une pièce nommée pompeusement la citerne. Cela lui prenait une bonne heure de son temps, parcimonieusement utilisé. C’était ainsi chaque jour de la semaine. Bien qu’il semblât malingre et que ses tourments et sa solitude aient affaissé ses épaules, Raymond était fort comme un bucheron. Jamais d’écart, jamais de virée au café, aucune femme n’était entrée dans sa morne vie. Il tentait de transmettre les rudiments de son art à Tit-René qui n’en avait que faire. Ayant grandi sans la tendresse de sa mère partie trop tôt vers l’au-delà, le diablotin était devenu un boulet pour Raymond qui, tout brave et dévoué qu’il fût, n’avait pas su combler ce terrible et trop grand besoin d’affection.
Pour s’en sortir Tit'René avait trouvé une solution. Oh, il ne l’avait pas découverte tout seul, non, c’était le fils Jean de la ferme de la mare au Clerc qui ressassait sans cesse la même histoire et qui un soir de grande boisson avait lancé l’idée. Tit’René s’en était emparé et l’avait faite sienne. Il avait cogité de longs moments. Un cambriolage ! Grâce au fils Jean, l’un de ces gars qui savaient écrire et lire, il avait suivi en cachette les exploits d’un brigand de grand chemin. C’était quelqu’un.
Exténué, Raymond tentait sur tous les tons de lui parler, de lui expliquer ce qu’était la vie et de lui faire admettre combien il était difficile de trouver une bonne place. Au Bec, le personnel était assez bien traité, la paye y était honnête mais s’il perdait ce travail, c’en serait fini de lui. Il deviendrait vagabond !
Ce père pourtant soucieux de l’élever correctement désespérait devant l’inertie de son fils trop chéri. Celui-ci n’aimait pas l’armée et n’avait aucun penchant pour la calotte. Rien ne lui convenait ! Mauvais en calcul, il ne pouvait pas se lancer dans le commerce et surtout lequel ? Jardinier installé à son compte ? Autant ne pas y songer.
Son fils était fainéant et, Raymond devait se l’avouer, il n’était pas très intelligent. Il acceptait très mal les ordres donnés et se croyait malin en accomplissant les choses à son idée. Naturellement, cela finissait toujours mal. Raymond en avait déduit que son fils n’avait pas de cervelle et que par conséquent il n’était pas responsable. Considérant à juste titre qu’il souffrait d’une tare, Raymond le surprotégeait d’une certaine manière.
En revanche, Tit’René courait les filles, sans succès d’ailleurs, buvait chez « Le Seigneur » et faisait des blagues aux conséquences désastreuses. Pour ça, oui, il était fort ! Les châtelains étaient bien bons de le garder.





























