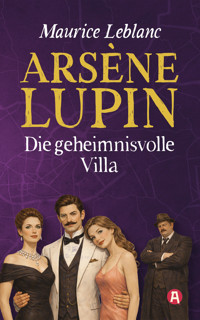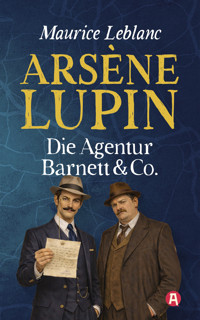1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Französisch
Le Cercle rouge est un roman cinématographique adapté par Maurice Leblanc. Il est adapté du film américain à épisodes The Red Circle.
Il est paru d'abord en 82 feuilletons dans Le Journal, en 1916-1917.
Les 12 épisodes, qui constituent ce roman, sont :
Le Client du docteur Lamar
La Main d'une inconnue
Le Passé surgit
Le Manteau noir
Des voleurs mystérieux
Un autre cercle apparaît
Où l'on retrouve les bijoux
Chasse à l'homme
La Situation se tend
La Vengeance de San Smiling
La Dame au cercle rouge
Épilogue
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
SOMMMAIRE
PROLOGUE
Premier épisode
LE CLIENT DU DOCTEUR LAMAR
Épisode |2|
LA MAIN D’UNE INCONNUE
Épisode |3|
LE PASSÉ SURGIT…
Épisode |4|
LE MANTEAU NOIR
Épisode |5|
DES VOLEURS MYSTÉRIEUX
Épisode |6|
UN AUTRE CERCLE APPARAÎT
Épisode |7|
OÙ L’ON RETROUVE LES BIJOUX
Épisode |8|
CHASSE À L’HOMME
Épisode |9|
LA SITUATION SE TEND
Épisode |10|
LA VENGEANCE DE SAM SMILING
Épisode |11|
LA DAME AU CERCLE ROUGE
ÉPILOGUE
Notes
MAURICE LEBLANC
LE CERCLE ROUGE
ROMAN
Le Journal, 1922
Raanan Editeur
Livre 892 | édition 1
PROLOGUE
I
— Et tu vois, vieux Jim, prononça le gardien, en frappant sur l’épaule de l’homme, on a repeint les murs de ta cellule. Si tu les esquintes de nouveau, gare à toi ! Hein ! plus d’inscriptions. Sinon…
L’homme ne bougeait pas, juché sur un escabeau. Le gardien le regarda un instant, et, d’une voix plus douce, où il y avait de la pitié :
— Allons, tu es plus calme. Cela t’a réussi, l’isolement. Ah ! coquin ! c’est que tu nous en as fait voir avec tes crises ! C’est-il fini ? Tant mieux. À bientôt, vieux Jim !
L’homme resta seul dans sa cellule, au milieu de la lumière indécise qui glissait de deux lucarnes taillées en sifflet dans l’épaisseur du mur, au milieu du silence sépulcral que troublaient parfois des hurlements lointains.
Jim paraissait cinquante ans. Ses cheveux gris tombaient sur son front en longues mèches. Sous le vêtement rayé que portent les prisonniers aux États-Unis, il était maigre, mais d’une carrure d’athlète. Sa face, d’une pâleur pierreuse, aux grands traits lourds, était figée dans une expression hagarde.
Jim se leva et s’approcha de la grille qui servait de porte à la cellule. Entre ses mains puissantes, il en saisit les barreaux, et, un moment, apathiquement distraits, ses regards errèrent dans l’ombre du couloir, où le gardien s’était éloigné. Puis il se mit à marcher de long en large dans la cellule étroite.
L’allure était à la fois pesante et élastique, comme celle d’un grand fauve. Et, tout à coup, il s’arrêta, ainsi que la bête s’arrête, sous le choc d’une sensation : désir qui s’éveille, instinct qui cherche à s’assouvir.
Ses yeux se fixèrent d’abord sur la muraille nue, à droite de la grille, et face aux lucarnes. Le plâtre en était recouvert d’une peinture brune, Presque noire, et toute neuve comme l’avait dit le gardien. Cela parut l’embarrasser. Ses doigts frémirent, impatients et crispés. Mais il y avait, dans l’encoignure, un petit placard d’angle où il rangeait son pain et sa cruche d’eau. Il l’ouvrit. À l’intérieur, la couche de plâtre était blanche, lisse et propre.
Alors Jim revint à son escabeau, qu’il empoigna et fit pirouetter. En dessous du siège, le bois s’était fendu. Il introduisit un de ses ongles dans cette fente et la suivit jusqu’à son extrémité. Quelque chose tomba, un morceau de mine de crayon, d’un rouge écarlate.
Tenant cette mine entre le pouce et l’index, il retourna vers le placard. Là, debout, le coude appuyé contre l’un des rayons, posément, avec une tension de tout l’être, qui durcissait son visage, il se mit à dessiner quelque chose sur le plâtre blanc.
Quand il eut fini, il recula un peu pour contempler son œuvre.
Il avait dessiné un cercle rouge.
Un cercle, large environ comme un bracelet de femme, un cercle à peu près régulier dans son diamètre, mais inégal dans la ligne épaisse qui le formait, tantôt plus étroite et tantôt plus renflée ; inégal aussi dans sa couleur tantôt plus éclatante et tantôt plus foncée ; un cercle de sang, rouge vif ici, là presque noir.
Jim en avait fixé tous les détails, non pas au hasard et selon une simple fantaisie, mais comme si, devant lui, eût été un modèle dont il n’eût pas pu ne point reproduire la plus insignifiante particularité.
Il le regarda longtemps, longtemps, avec des expressions diverses et rapides qui contractaient ses traits, expressions de fureur, de haine, de désespoir, de résignation farouche. Ses yeux s’emplissaient de ce rouge anneau insolite, de cette petite figure énigmatique qui semblait lui dire tant de choses terribles et douloureuses. Et, soudain, il parut souffrir à un tel point que, brusquement, il referma la porte du placard et s’en écarta.
Mais il n’avait pas fait quatre pas en arrière qu’il bondit sur lui-même, étouffant un cri de stupeur.
En face de lui, sur la partie du mur qui s’étendait entre le placard et la grille, sur cette surface lisse et brunie du plâtre nouvellement repeint, il y avait un cercle rouge.
Pas une seconde, il n’hésita et, si folle que fût l’idée qui assaillit son cerveau, il l’accepta aussitôt. Le cercle qu’il voyait, c’était celui-là même qu’il venait de dessiner.
En deux enjambées, il sauta jusqu’au placard : le premier cercle était là.
Mais alors, l’autre ?… l’autre qui jaillissait de la muraille nue ?…
Il tourna la tête et regarda de côté, en tremblant, avec l’espérance de ne plus le voir et la certitude profonde de le voir encore.
Il le vit.
Il le vit. Ses regards s’y clouèrent ardemment. Le second cercle était l’image du premier… en même temps, il en différait… En quoi ?… En quoi ?… Même grandeur, même aspect, même éclat sanglant… et pourtant…
À pas sournois, Jim se glissa le long du mur, et, tout à coup, projeta sa main violemment.
Il le tenait ! Il l’avait écrasé comme on écrase une bête nuisible ! Il l’avait anéanti ! Quel soulagement !
Il écarta la main. Cette fois, il ne put retenir un cri rauque qui déchira sa gorge.
Le cercle rouge était plus loin, à trente centimètres de distance.
Et voilà que se produisit la chose du monde la plus effarante : le cercle rouge bougea de nouveau ! Il se mit à danser sur la muraille nue, allant et venant, disparaissant, reparaissant, bondissant.
Sous nos paupières closes, un point de lumière qui persiste danse ainsi souvent, s’enfle et diminue, devient un disque frissonnant, se transforme en un anneau de clarté, se multiplie, se divise en feux follets qui jouent dans le temple fermé de notre vision. De même, Jim voyait — mais devant ses yeux grands ouverts — toute une fantasmagorie de cercles rouges, de points lumineux, de taches de sang, de couronnes écarlates, de boules enflammées qui tourbillonnaient en une ronde éperdue.
Sa raison s’égara. Il s’abattit sur le mur, et de ses poings formidables il frappa sans relâche, forcené, tandis que, de sa gorge, jaillissaient des cris incohérents.
— Eh bien ! Jim, qu’est-ce qu’il y a ? Encore tes accès de rage ? C’était le gardien que le bruit avait attiré et qui regardait entre les barreaux.
Jim recula et, par un effort, se maîtrisa, non pas qu’il eût peur, mais il ne voulait pas que le gardien entrât et vît le cercle rouge sur la muraille.
Le gardien examina l’homme durant quelques instants. Des gouttes de sueur baignaient le visage et le cou de Jim. Cependant, il paraissait maintenant calme et maître de lui.
— C’est fini, n’est-ce pas ? Un peu de silence à présent ! dit le gardien, qui s’éloigna.
Jim n’avait plus bougé. De nouveau, il regardait la muraille.
Le cercle rouge n’était plus là.
En même temps, par un phénomène inconcevable, mais dont il ne pouvait mettre en doute un seul moment la réalité affreuse, il avait la sensation nette, irrécusable, que le cercle rouge traversait l’étoffe de son vêtement, s’imprimait dans son dos, pénétrait dans sa chair et la brûlait comme un fer chauffé à blanc.
Sensation diabolique ! Et, pourtant, comment la nier ?
C’était intolérable. D’un coup, Jim sauta de côté, livrant passage à cette chose inconnue qui le torturait, et la chose se rua sur le mur, comme projetée par une puissance indomptable.
Le cercle était là de nouveau.
Et puis, soudain, il disparut. Plus rien. La muraille vide.
Jim respira.
Mais il y eut, coup sur coup, deux apparitions, deux boules de lumière qui jaillirent du mur, encore une interruption, puis toute une série d’éclairs, séparés les uns des autres par des intervalles réguliers.
Machinalement, Jim les compta, ainsi que l’on compte les vibrations lumineuses d’un phare.
Il y en eut quinze.
Une autre interruption. Puis deux éclairs.
Jim attendit. Mais il ne se produisit plus rien et, au bout de quelques minutes, il put croire qu’il ne se produirait plus rien.
— Deux… Quinze… Deux… murmura-t-il, se rappelant les nombres respectifs des trois séries d’apparitions du cercle rouge.
Cela n’eut pour lui, tout d’abord, aucune signification, car il n’en cherchait point. Mais, après un instant, il eut cette idée, tout à fait inconsciente, d’ailleurs, de confronter chacun de ces nombres avec la lettre qui lui correspondait dans l’alphabet.
Il obtint un B, un O et un B.
Alors, il éprouva une surprise sans bornes. Réunies, ces trois lettres — il s’en rendit compte — formaient un mot, ou plutôt un nom : Bob.
Et Bob, c’était le nom de son fils.
L’émotion le fit chanceler, il dut s’asseoir sur l’escabeau. Mais son effroi mystérieux était dissipé. Il n’était plus en face d’un prodige, et, sans comprendre encore la crise par laquelle il venait de passer, sans comprendre qu’il avait été le jouet de son cerveau malade et que le cercle rouge qu’il avait dessiné, ce cercle rouge qui l’obsédait, s’était, par hallucination toute naturelle, confondu avec la tache de lumière qui dansait sur le mur pour lui transmettre les signaux de son fils Bob, il comprenait, du moins, l’origine de cette tache de lumière et le sens de ces signaux.
Un grand apaisement l’envahit. Le cauchemar sournois et terrifiant de l’inexplicable s’éloignait de lui. Il savait.
Il savait ! Quelque part, juché sur un toit voisin, Bob, à travers le soupirail d’une des lucarnes de la cellule, l’avertissait de sa présence au moyen d’une petite glace de poche qui captait des rayons de soleil et les envoyait dans la cellule obscure.
II
Cette lucarne, par où un peu de jour et d’air entrait dans la cellule, était toujours ouverte. Le soupirail, en pente douce, qui perçait un mur d’environ deux mètres d’épaisseur, de la lucarne à la cellule, allait en s’évasant.
Bien souvent, Jim s’était glissé à plat ventre jusqu’à l’orifice extérieur, trop étroit pour qu’on ait cru nécessaire de le griller, et de là, pendant de longues heures, le prisonnier avait plongé son regard plein d’ennui farouche sur une petite cour, sombre comme un puits, dont il apercevait, à trente pieds au-dessous de lui, les pavés humides et verdâtres.
Jim, après s’être assuré que le couloir était désert, refit cette manœuvre. Ses épaules, trop larges, se heurtèrent aux moellons des parois, mais sa tête émergea.
En face et un peu au-dessus de lui, il y eut un léger sifflement.
Il leva les yeux.
Bob se trouvait sur un toit, de l’autre côté de la cour, au bas d’une pente d’ardoises si abrupte que c’était folie de s’y aventurer. Deux corps de cheminées en briques l’encadraient, et Jim s’avisa, sans surprise d’ailleurs, car il savait son fils assez peu brave, qu’une corde lui entourait la taille et que quelqu’un, par conséquent, posté derrière une des cheminées, devait le tenir solidement.
Trois mètres au plus séparaient le père et le fils. Bob allait parler, mais Jim lui souffla :
— Tais-toi. Pas un mot.
Alors Bob saisit à côté de lui une planche qui était posée sur les ardoises et la rabattit comme un pont-levis entre le toit et le rebord de la lucarne.
— Non, protesta Jim, c’est idiot ! on va te surprendre !
Il avait reculé, et il vit son fils qui se laissait glisser le long de la planche.
Jim redescendit dans la cellule. Bob, adolescent long et mince, et qui semblait désarticulé comme un acrobate, passa sans trop de peine par la lucarne et rejoignit son père. Il défit le lien fixé à sa ceinture.
Tout cela n’avait pas duré deux minutes.
Le soleil avait dû disparaître derrière les hautes maisons voisines, l’ombre était plus lourde au creux de la cellule, et c’est à peine si Jim distinguait les traits de son fils.
Il murmura :
— Pas de bruit… le gardien est là…
Il appuya sa main sur l’épaule de Bob, le poussa à un endroit où on ne pouvait pas le voir de la grille et chuchota d’une voix brève et dure :
— Qu’est-ce que tu veux ?… Pourquoi es-tu venu ? Parle…
Bob subissait la réaction de son effort excessif et du danger couru.
Peut-être aussi avait-il peur de son père. Il était blafard et haletait. Enfin, il commença un récit gémissant de son entreprise. Il avait eu l’idée, « avec un de ses amis », de monter sur le toit de l’immeuble voisin ; il avait hésité en face des lucarnes…
— Je ne savais pas laquelle c’était… Et comment t’avertir ? Trois fois, nous sommes venus…
Jim l’interrompit :
— Cesse de baliverner. Parle… Pourquoi es-tu venu ? Que veux-tu de moi ?…
— Eh bien ! mais… balbutia Bob… voilà… peut-être bien que tu pourrais t’évader…
— M’évader ? par quel moyen ? Je ne suis pas une couleuvre, moi… Et puis, tu sais bien que je ne veux pas m’évader ! Un bandit de mon espèce doit rester dans sa cage… Ici, je ne peux pas nuire !… J’ai fait trop de mal, déjà…
Il jeta ces mots, d’une voix sombre. Puis, ayant réfléchi, il ajouta :
— D’ailleurs, tu mens. Tu ne tiens pas tant que ça à ce que je sois libre… Tu ne vas pas me parler d’affection, hein ? Ce n’est pas un sentiment qui te gêne… Ni moi non plus, du reste… Tu as fait ce qu’il fallait pour ça. J’aurais voulu un fils… un vrai fils, quoi… Un homme, un travailleur, vivant d’un métier honnête… au lieu de ça…
Il n’avait pas lâché l’épaule de Bob, il la serra d’une main brutale.
— Qu’est-ce que tu fais, maintenant ? Il y a six mois, quand j’étais encore libre, je t’avais trouvé une place sérieuse… Quoi ? Qu’as-tu dit ? On t’a renvoyé ? Et alors ? Comment vis-tu ? Chez qui travailles-tu ? Car tu travailles, j’espère ?
— Oui, je travaille, grogna Bob.
— Chez qui ? Réponds donc !
— Chez… chez Sam Smiling.
Jim sursauta.
— Chez Sam Smiling !… Chez ce cordonnier de malheur !… Ah ! par exemple…
— Mais c’est un de tes amis ! risqua Bob.
— Tais-toi ! C’est un bandit !… un vrai bandit, lui ! Il sait ce qu’il fait… il sait toujours ce qu’il fait…
— Mais, je t’assure, il s’occupe de moi, il me donne de bons conseils.
— Allons donc ! Sam Smiling ! Je les connais, ses conseils !… Ah ! tu « travailles » chez lui ? Mais alors… je comprends… Avoue donc : c’est lui qui t’envoie ?
Jim tremblait de colère. Il se contint cependant pour ne pas effrayer son fils et pour obtenir de lui un aveu complet.
— Eh bien, oui, murmura Bob, c’est lui qui m’envoie… Du reste, il n’y a rien à cacher, au contraire… C’est pour une bonne action, acheva-t-il avec emphase.
— Une bonne action ? lui ? fit le vieux Jim, dont les poings se crispaient. Enfin, raconte… après tout… on verra…
— Voilà… prononça Bob, qui ne se défiait plus. Il paraît qu’il y a trois ans, vous avez rendu tous les deux service à un banquier très riche, là-bas, dans le Far-West. Et il vous a dit que si vous veniez à San Francisco, où il habite, il faudrait aller le trouver, que, s’il était absent, sa fille vous recevrait, il la préviendrait… Pour qu’elle vous reconnaisse, vous n’auriez qu’à lui présenter, à sa fille…
— Présenter quoi ?
— Eh bien, un bracelet… un bracelet de corail, qui t’appartenait à toi… et qui avait appartenu à…
— À ma femme, dit Jim d’une voix sourde.
— Et alors, un jour, paraît-il, il y a eu une dispute entre toi et Sam et le bracelet a été cassé. Sam en a pris la moitié… Maintenant le banquier voyage en Europe et Sam a appris, par hasard, qu’on veut le dévaliser… Alors, il veut prévenir la fille, mais pour qu’elle ait confiance en lui, il te demande l’autre moitié du bracelet… Tu vois comme c’est simple.
— Oui, dit Jim, qui faisait tous ses efforts pour rester maître de lui… Oui, c’est très simple… Il ne s’est pas donné de mal pour inventer ça, Sam Smiling. Mais il me croit donc devenu idiot pour me laisser prendre à une histoire aussi grossière… En effet, il veut inspirer confiance, il ira à San Francisco, et, une fois dans la maison il volera, il assassinera… et tu seras son complice.
— Je pensais bien que tu refuserais, murmura Bob ; mais il a voulu à toute force que j’essaie…
— Et c’est lui qui t’a amené ici, c’est lui qui te tenait par la corde ?…
Jim s’interrompit. Sa colère montait et l’étouffait. Un silence sourd pesa sur le père et sur le fils. Dans l’angle où ils se trouvaient, la seconde lucarne les éclairait un peu et sa lumière tombait sur les mains frissonnantes du vieux Jim.
Et soudain, Jim s’aperçut que son fils, dont l’épaule touchait la sienne, s’était mis à trembler ; il entendit sa voix gémir, avec une épouvante inexprimable :
— Ah ! le Cercle rouge !… le Cercle rouge sur ta main… Ne me fais pas de mal… Grâce… c’est Sam qui m’a forcé à venir…
Jim ne bougea pas d’abord. Il savait bien que le Cercle rouge s’était dessiné sur le dos de sa main droite, et que l’horrible stigmate connu de son fils et connu de tous, que l’horrible stigmate, marque visible de ses instincts criminels, s’arrondissait en une couronne de sang sur la peau rugueuse. Il le savait au bouillonnement de ses idées mauvaises, au déchaînement des forces irrésistibles qui le poussaient à la violence…
Une minute s’écoula, terrifiante, Bob tremblait toujours sans avoir le courage de fuir, ou de se défendre, sans pouvoir jeter un cri d’appel. Le père se raidissait dans une tension de toute son énergie, qui gonflait ses muscles comme des cordes.
Et le Cercle, rose d’abord, puis rouge vif, s’empourprait d’un afflux de sang qui lui donnait une sorte de relief au-dessus de la peau.
— Le Cercle rouge ! bégaya Bob… j’ai peur… j’ai peur… le Cercle…
Il n’acheva pas. Son père l’avait saisi à la gorge de ses deux mains exaspérées, et l’adolescent s’écrasa sur le parquet.
Il n’y eut pas de lutte, il n’y eut pas de résistance. Jim, à genoux, implacable, serrait.
Dans l’ombre, le stigmate étincelait ou, du moins, Jim croyait en voir le scintillement, et il ne voyait que cela, et il ne regardait que cela, cette flamme qui courait sous sa peau, ce serpent de feu qui tournait indéfiniment sur lui-même, immobile en apparence, mais vivant d’une vie infernale.
Il avait l’impression affreuse que ses deux mains jointes traçaient autour du cou de son fils le plus épouvantable des cercles rouges, celui de la mort.
Il lâcha prise subitement. Cette vision de la mort le bouleversait. Son fils étranglé par lui ! Durant quelques secondes, le génie mauvais de l’instinct fut tenu en échec, mais durant quelques secondes seulement. Le Cercle rouge n’avait pas disparu.
Jim bondit jusqu’à la grille. Il lui semblait entendre les pas du gardien faisant sa tournée.
Au même moment, Bob, toujours étendu sur le sol et qui ne pouvait ou n’osait se relever, lança une plainte assez haute.
Alors, Jim s’affola. Sa crise évoluait, sa surexcitation changeait d’objet. Le gardien allait venir. Et ce serait l’arrestation de Bob, ce serait son fils en prison.
Et le Cercle rouge pénétrait dans sa chair, souffrance intolérable ! Le Cercle rouge entraînait ses idées en un tourbillon vertigineux, où il y avait des flammes et du sang.
Les pas s’approchèrent.
D’un effort violent Jim, à bout de bras, le poussa jusqu’à la lucarne ouverte. Un obstacle. Puis, le fracas de quelque chose qui tombait sur les pavés de la cour. C’était la planche, le pont qui reliait la lucarne au toit voisin.
Une dernière poussée.
Bob disparut.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Lorsque le gardien entra dans la cellule, il trouva le vieux Jim écroulé par terre et qui sanglotait convulsivement…
Premier épisode
LE CLIENT DU DOCTEUR LAMAR
I
Le stigmate héréditaire
Ce matin-là, le mardi 13 juin, le docteur Max Lamar, médecin légiste attaché à l’administration de la police de Los Angeles, travaillait avec sa sténographe dans son bureau officiel.
Le bureau était une vaste pièce froide et morose, aux meubles sévères, aux boiseries brunes, et qui avait cet aspect revêche et impersonnel qu’on pourrait appeler le style administration. Deux portes s’y ouvraient : l’une, vitrée, avec une inscription : Docteur Max Lamar, donnait sur une galerie ; l’autre, pleine, communiquait avec le bureau des secrétaires.
La sténographe, Mlle Hayes, était une jeune fille de vingt-quatre à vingt-cinq ans, habillée avec sévérité ; elle était loin d’être jolie, mais son visage était intelligent et sérieux.
Elle répéta à mi-voix la dernière phrase qui lui avait été dictée : « … En résumé, la responsabilité du sujet paraît grandement atténuée par l’hérédité lourde qui pèse sur lui… »
Et, le crayon en l’air, elle attendit la suite, les yeux fixés sur son patron.
Celui-ci restait silencieux. Assis devant sa grande table encombrée d’instruments, de papiers et de documents de toutes sortes, il relisait une note avec attention. Dans la pièce on n’entendait aucun bruit que le tic-tac de l’horloge fixée au mur.
Mais la matinée s’avançait. Le docteur Lamar avait hâte de terminer son travail. Il se leva et se mit à marcher lentement d’un bout à l’autre de la chambre.
— Où en étions-nous, mademoiselle Hayes ? demanda-t-il.
Elle relut la phrase inachevée.
Il alluma une cigarette et reprit sa dictée d’une voix lente et nette.
Le docteur Max Lamar étonnait vivement ceux qui, le connaissant de réputation, le voyaient pour la première fois.
Étant donné la profonde expérience et la somme de connaissances acquises que dénotaient ses remarquables études sur la criminalité, sur les impulsions morbides, sur les tares héréditaires physiques et morales, on se serait attendu à voir un personnage d’âge mûr, un homme de cabinet, prématurément vieilli.
Max Lamar n’était rien de tout cela. À trente-six ans, il gardait tout l’aspect d’un jeune homme, grand, svelte, musclé, élégant et correct dans son complet sombre et bien coupé, il présentait l’image de la force souple et rapide.
L’intelligence était inscrite sur son large front que découvrait son épaisse chevelure noire. Dans ses yeux gris, pénétrants, clairs et assurés, dans toutes les lignes de son visage rasé, aux traits réguliers, au teint mat, on lisait la perspicacité, la décision et l’énergie, une énergie pouvant aller jusqu’à l’inflexibilité, jusqu’à la résolution la plus impitoyable… Mais quand il souriait, quand un sentiment de pitié ou de tendresse détendait ses traits, on se rendait compte de toute la bonté qu’il cachait sous son habituel sang-froid.
Ses amis disaient de lui qu’il était le plus sûr et le plus serviable des hommes, et cette opinion était partagée par tous les malheureux qu’il avait jugés dignes d’intérêt au cours de ses enquêtes et qu’il avait secourus avec une bienveillance éclairée et discrète.
Ses ennemis — c’est-à-dire quelques-uns des plus mauvais parmi les individus composant la misérable clientèle que lui assignaient ses fonctions — le redoutaient extrêmement. Tout le gibier de prison et d’asile qu’il visitait, tous les dévoyés, tous les alcooliques, tous les demi-fous, tous les monomanes dont il pesait les tares et mesurait le discernement tremblaient sous son regard scrutateur et, devant lui, oubliaient leurs mensonges.
Mais Max Lamar avait encore d’autres ennemis, il est vrai : un petit nombre de confrères de médiocre valeur et qui ne pouvaient lui pardonner d’avoir conquis, très jeune encore, une situation importante et élevée.
Ceux-là disaient que Max Lamar poussait si loin l’amour de son métier qu’il dépassait les bornes de ses fonctions et qu’il lui arrivait parfois de se laisser emporter par la curiosité professionnelle, par sa passion pour les investigations criminalistes, jusqu’à poursuivre des enquêtes sur le terrain qui n’est plus celui du médecin, mais du détective.
Mais lui, à ces critiques dont l’écho plusieurs fois lui était venu aux oreilles, répondait, en riant, de son rire tranquille :
— C’est vrai, c’est plus fort que moi. La solution d’un problème psychologique vaut plus pour moi que la solution d’un problème de science exacte. Il m’est difficile de résister à la tentation qui me saisit toujours de déchiffrer l’énigme que laisse derrière lui un malfaiteur habile. Du reste, n’est-ce pas pour moi indispensable que d’étudier le crime pour connaître le criminel ? Ce n’est pas dans les livres qu’on apprend la médecine, c’est à l’hôpital ; ce n’est pas dans un bureau fermé que se résout l’inconnue de la responsabilité ou de l’irresponsabilité d’un sujet. Mon laboratoire, c’est le grouillement de larves humaines qui s’agitent dans les bas-fonds de la grande ville, et j’analyse l’écume de la société, comme un chimiste analyse un corps composé d’éléments encore ignorés…
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Quand il eut terminé son rapport, le docteur Lamar revint à sa table de travail.
Onze heures venaient de sonner. Il avait dicté deux lettres et s’apprêtait à en commencer une troisième, quand la porte qui donnait dans le bureau des secrétaires s’ouvrit.
Un employé parut et s’avança vers son chef :
— Une lettre pour vous, monsieur le docteur.
Max Lamar prit la lettre qu’on lui tendait et l’ouvrit, pendant que l’employé rentrait dans son bureau.
En lisant, Max Lamar tressaillit imperceptiblement. Une expression de vif intérêt passa sur son visage. Il posa la lettre devant lui et resta silencieux et pensif.
— Mademoiselle Hayes, dit-il enfin à sa sténographe il est probable que je ne viendrai pas ici ce tantôt, et pas demain non plus, peut-être. Préparez la copie en double expédition du rapport que je viens de vous dicter. Tout à l’heure, en sortant, je donnerai mes instructions aux secrétaires…
» Je vais avoir beaucoup à faire pendant quelques jours, ajouta-t-il à demi-voix et comme se parlant à lui-même… et c’est une besogne qui vaut la peine que je la fasse moi-même. »
Enfoncé dans son fauteuil, il s’absorba dans ses réflexions et seul le frémissement de ses narines indiqua son excitation intérieure.
— Oui, reprit-il après quelques minutes de silence, une besogne qui en vaut la peine… Vous ferez demander à l’administration le dossier de Jim Barden, mademoiselle Hayes… Je vais avoir sans doute à le compléter…
— Le dossier de Jim Barden ? Bien, monsieur, dit la sténographe, en prenant une note.
Elle leva les yeux sur son patron et ajouta :
— C’est un criminel, monsieur ?
Mlle Hayes était curieuse comme toutes les femmes, mais elle était curieuse seulement pour sa satisfaction personnelle et non pas pour faire part aux autres de ce qu’elle avait appris. Le docteur Lamar savait qu’il pouvait compter sur sa discrétion et il savait aussi qu’elle lui était entièrement dévouée.
Aussi, il lui arrivait souvent de raconter dans le détail à Mlle Hayes les affaires qu’il poursuivait. C’était pour lui, estimait-il, un exercice excellent. Il aimait à « parler » les problèmes qui le préoccupaient, y trouvant souvent, en les exposant, des clartés nouvelles et l’avantage d’une utile mise mise en ordre de ses idées.
— Voici ce qui vous renseignera, mademoiselle Hayes, dit Lamar en lui tendant la lettre qu’il venait de recevoir.
La jeune fille lut ce qui suit :
« À Monsieur Max Lamar, médecin légiste.
» Mon cher Max,
» Le fameux Jim Barden, que nous tenons emprisonné dans notre asile d’aliénés va, sur un rapport favorable du médecin-chef de l’hôpital, être remis en liberté.
» Je m’empresse de vous en aviser, afin, que vous puissiez continuer l’active surveillance que vous avez toujours exercée sur lui.
» Bien cordialement à vous.
» Randolph Allen, chef de police. »
— Alors, Jim Barden est un fou ? demanda la sténographe.
— Vous voyez bien que non, puisque le médecin-chef lui signe son exeat, dit le docteur Lamar, avec un léger sourire.
Il eut un mouvement d’épaules et continua :
— Du reste, que Jim Barden soit fou ou non, c’est ce que je ne sais pas moi-même. Je sais seulement que c’est l’être le plus dangereux pour la société que je connaisse. Je l’étudié depuis plusieurs années. Trois fois, j’ai dû le faire enfermer dans un asile d’aliénés ; trois fois, après un temps plus ou moins long, il a été remis en liberté.
— Mais, pourquoi le relâche-t-on, s’il est fou ? dit la jeune fille.
— On le relâche quand il n’est plus fou. Il ne l’est que par intermittence et jamais complètement. On pourrait dire plus exactement que, par périodes plus ou moins longues, il change d’âme. Autant que j’aie pu m’en rendre compte, il y a en Jim Barden deux hommes dissemblables. Cela ne va pas, chez lui, jusqu’au doublement tranché et défini d’existence, que nous appelons l’état prime et l’état second, où un même individu a en lui deux personnalités distinctes, différentes, parfois diamétralement opposées d’instinct et de goût, qui se succèdent en s’ignorant l’une l’autre, Non, Jim Barden, est toujours Jim Barden. Jamais il ne cesse d’être lui-même pour devenir un autre. Mais en lui, à des intervalles irréguliers, se dresse une impulsion irrésistible qui le pousse vers le mal et qui fait de lui un criminel déterminé, habile et redoutable. Alors, il ne connaît plus rien que la violence déchaînée de ses instincts féroces. En tout temps, d’ailleurs, c’est un homme taciturne, farouche, brutal et soupçonneux ; mais, dans les périodes de calme, il a, je crois, le remords des crimes qu’il a commis pendant qu’il est sous l’influence morbide. J’ai épié son sommeil et je l’ai vu parfois se tordre d’angoisse sous le poids de cauchemars affreux, je l’ai entendu gémir, se plaindre, se débattre comme pour repousser des visions d’horreur.
— Quel forfait a-t-il commis ? demanda la jeune fille, frissonnante.
— Je ne les connais pas tous, et ceux dont on le soupçonne n’ont jamais été prouvés, tant son habileté est grande. Mon ami Randolph Allen, le chef de police, qui vient de me prévenir est, comme moi, persuadé que Jim Barden est coupable de nombreux crimes, exécutés toujours avec autant d’adresse que d’audace.
— Et on le laisse faire ?
— La loi est la loi. Barden est couvert par son adresse diabolique, et c’est, je vous le répète, un malade autant qu’un coupable. Il est dominé par la fatalité de son hérédité, il porte sur lui la marque de son destin.
Mlle Hayes regarda avec surprise le docteur Lamar.
— La marque de son destin ? répéta-t-elle avec curiosité.
— Oui, Jim Barden est sous l’influence du Cercle Rouge.
— Le Cercle Rouge ? Qu’est-ce que cela, monsieur Lamar ? demanda, de plus en plus intriguée, la jeune fille. Est-ce que c’est un cercle d’anarchistes ? ajouta-t-elle à la réflexion.
Max Lamar secoua la tête.
— Non, c’est un phénomène physiologique mystérieux et frappant. Dans les moments où Jim devient un impulsif dominé par ses instincts criminels, où il est comme un fauve qui cherche une proie, sur le dos de sa main droite apparaît une marque. C’est d’abord une ombre rose, à peine visible, qui se précise rapidement, fonce de couleur, devient un stigmate circulaire, irrégulier, écarlate, qui couvre l’épiderme de sa main comme une couronne de sang : le Cercle Rouge.
— Monsieur Lamar, d’où lui vient cela ? murmura avec un frémissement de terreur Mlle Hayes.
— Je ne sais pas. C’est une particularité physiologique analogue sans doute à ces nœvus qu’on appelle vulgairement taches de vin, à ces signes violets ou bruns que beaucoup de personnes présentent.
— Mais cela n’est rouge que par moments, dites-vous ?… Comment est-ce possible ?…
— Vous m’en demandez trop, mademoiselle Hayes, je vous ai dit que c’était inexplicable. On peut remarquer pourtant que, chez toutes les créatures humaines, certaines émotions font rougir le visage. Eh bien, le visage de Jim Barden ne rougit jamais, quelle que soit la fureur qui l’agite, mais alors, sur sa main, paraît le Cercle rouge…
— Dans les bas-fonds où vit cet homme, cette particularité est bien connue et l’environne d’une sorte de terreur superstitieuse. On l’appelle Jim-Cercle-Rouge et on raconte — je ne sais si c’est une légende — que ce stigmate est héréditaire. On affirme que, dans le passé, de génération en génération, il y a toujours eu un membre de la famille Barden qui était un être moralement taré, extravagant, fou ou criminel, et qui portait, au dos de la main droite, cette même marque mystérieuse.
Le docteur Lamar fit une pause. Il alluma une cigarette, regarda un moment, pensivement, les tourbillons de fumée frisée qui s’envolaient de ses lèvres et continua :
— Jim Barden a un fils. C’est le type parfait de ce que les Français appellent un jeune apache, ce qui est montrer peu d’égards pour ces anciens et fiers guerriers de nos prairies. Il a une vingtaine d’années et il s’est contenté, jusqu’ici, de vivre en marge de la société, traînant de bar en bar, et chapardant tout ce qui se trouve à sa portée. Il n’a, jusqu’à présent, jamais été pincé dans une affaire sérieuse, et je n’ai pas entendu dire non plus que personne ait vu sur sa main le terrible Cercle rouge.
Le docteur Lamar se leva et regarda sa montre.
— Mademoiselle Hayes, voilà les données du problème. Vous en savez autant que moi. Maintenant, il est midi, le moment approche où Jim Barden doit être mis en liberté. Je vais aller l’attendre à sa sortie afin de savoir ce qu’il fera et de surveiller secrètement ses faits et gestes. Sans doute, il va essayer de retrouver son fils, et il retournera chez lui, c’est-à-dire dans un asile mystérieux que la police est persuadée qu’il s’est ménagé — car il disparaît quand il veut, sans qu’on puisse retrouver sa trace.
Le docteur Lamar se coiffa de son chapeau et ouvrit un tiroir de son bureau. Il y prit un revolver de précision qu’il glissa dans une poche et une paire de menottes d’acier, nickelées, étincelantes et jolies comme une parure, qu’il mit dans une autre poche.
— Que le Cercle Rouge ne vous fasse pas oublier mes instructions, mademoiselle Hayes, recommanda-t-il.
— Non, monsieur, dit la jeune fille.
— Et maintenant, il faut que je me hâte si je veux assister au lâcher de la bête fauve, murmura-t-il en sortant.
II
Une mise en liberté
L’asile pénitentiaire, vaste construction massive, aux murs rébarbatifs, aux fenêtres défendues par d’épais barreaux, semblait plus sinistre encore sous le radieux soleil d’un midi de printemps.
Une auto luxueuse tourna l’avenue déserte et, d’une allure rapide et moelleuse, vint s’arrêter devant la lourde grille qui barrât l’entrée principale de l’asile.
La portière s’ouvrit. Deux femmes élégantes en descendirent. Une jeune fille d’abord, qui sauta légèrement sur le trottoir et se retourna pour offrir l’appui de sa main à sa compagne, une une dame d’un certain âge, qui mit pied à terre à son tour.
La jeune fille sonna à la grille. Un gardien parut, salua les dames qu’il semblait connaître, les fit entrer et s’éloigna. Il revint bientôt dire que le directeur attendait Mme Travis et Mlle Florence Travis.
Mme Travis, une femme de cinquante ans environ, vêtue de noir avec une distinction sobre, au visage calme et bon sous ses cheveux déjà presque blancs, se retourna vers la jeune fille. Celle-ci regardait pensivement la lourde grille qui séparait — comme une barrière placée entre le bonheur et le malheur — le lugubre couloir, sombre et froid sous la voûte pesante, du jour éclatant, vibrant et libre de la rue.
— Viens-tu, Flossie ? lui dit-elle avec un accent qui décelait toute sa tendresse.
Flossie, ce diminutif charmant, allait bien à cette radieuse jeune fille, dont la beauté semblait éclairer cette morne geôle.
Elle paraissait grande et élancée dans sa souple robe de velours noir rayé de larges bandes blanches, dont le corsage échancré dégageait le cou délicat que caressait une fourrure de renard blanc. Elle avait un joli visage au teint pur, à la bouche fraîche, aux grands yeux parfois rêveurs et presque graves, parfois pétillants d’une gaieté d’enfant, au front blanc que couvraient à demi les cheveux bruns bouffants sous la gracieuse toque blanche. Tout en elle était harmonieux, séduisant et l’humeur capricieuse et fantaisiste de Florence Travis, son dédain pour les futiles préoccupations qui absorbaient les autres jeunes filles, l’originalité sincère et spontanée de ses goûts et de ses idées ajoutaient une sorte de personnalité savoureuse et prenante à son caractère indépendant, volontaire, mais foncièrement droit et dont le signe distinctif était une compassion ardente pour toutes les misères et toutes les infortunes.
Et c’était ce dernier sentiment que partageait et encourageait Mme Travis qui, ce matin-là, amenait Florence dans le lugubre asile où tant de misérables épaves du crime et de la folie étaient détenues.
À l’appel de Mme Travis, la jeune fille s’était retournée.
— Oui, mère, je viens. Je regardais cette grille si lourde, si impitoyable, répondit-elle avec une sorte de frisson. Je pense aux malheureux sur qui elle est fermée comme la dalle d’un tombeau…
— C’est pas souvent du monde bien fameux, ma belle demoiselle, intervint le vieux gardien, et qui n’est pas toujours digne de votre charité.
Florence ne répondit pas.
Le gardien les précéda jusqu’au cabinet du directeur.
Celui-ci, assis à son bureau, au fond de la grande pièce sévère, aux murs couverts de casiers administratifs, se leva pour recevoir les deux dames.
Le directeur, M. Miller, était un homme froid, morose et solennel, qui souffrait de l’estomac, ce qui assombrissait encore son caractère, déjà peu enclin à la gaieté.
Il exerçait ses fonctions avec une autorité indifférente et la régularité d’un rouage qui concourt automatiquement à la marche de la grande machine judiciaire.
Mais nul n’échappait au charme de Florence. En la voyant, M. Miller se souvint qu’il était un homme, qu’il avait jadis été jeune et peut-être amoureux et que l’humanité n’est pas tout entière composée de prisonniers et de gardiens. Il eut un sourire aimable en indiquant des sièges.
— Vous ne vous découragez donc pas, mademoiselle ? Vous continuez votre œuvre malgré les déceptions qu’elle vous a procurées ? C’est une belle abnégation et une noble tâche pour une jeune fille.
— Pourquoi me découragerais-je ? interrompit Florence. Ce n’est pas parce que j’ai eu quelques déceptions comme vous dites… Oui, oui, monsieur Miller, ajouta-t-elle en riant, je sais bien que Jones, dont l’hiver dernier, je me suis occupée, a essayé de faire cambrioler notre résidence de Blanc-Castel, et que Bates a vendu, pour boire, le cheval et la voiture que nous lui avions achetés pour son métier de marchand ambulant, si bien que, pendant un mois, il a été ivre-mort… Mais je sais très bien aussi que j’ai réussi plus souvent que je n’ai échoué et que plusieurs de vos anciens pensionnaires, grâce à l’aide que nous leur avons donnée, sont maintenant rentrés dans le droit chemin et gagnent honnêtement leur vie. On ne réussit pas à chaque tentative, vous ne l’ignorez pas, monsieur Miller, et c’est très beau déjà de réussir quelquefois… J’ai tant de pitié pour tous ces déshérités, pour toutes ces épaves de la vie qui, bien souvent, sont plus à plaindre qu’à blâmer…
Elle s’arrêta les yeux brillants, son joli visage tout animé d’émotion.
Le directeur la regardait avec une admiration visible, où il y avait un peu d’étonnement railleur.
— Hélas ! mademoiselle Travis, voilà un enthousiasme qu’un vieux fonctionnaire comme moi ne peut plus ressentir. J’ai vu trop de choses… Mais cela ne m’empêche pas d’apprécier vos préoccupations humanitaires… et votre zèle infatigable… Vous êtes si différente des autres jeunes filles !…
— Je ne sais pas si je suis différente, dit Florence ; en tout cas, je n’ai pas grand mérite, car je sais bien que tout ce qui amuse mes amies ne m’amuse pas du tout, moi ! Et quand on est riches et heureuses comme nous le sommes, c’est un devoir de s’occuper des pauvres gens…
— Sans doute, sans doute… reprit M. Miller. Mais vous venez, mesdames, pour voir le fameux Jim Barden, qu’on va libérer… Si votre influence s’exerce sur cet homme-là, mademoiselle Travis, j’en serai bien surpris… Enfin, je vais donner l’ordre qu’on l’amène ici.
Le directeur sonna. Un gardien parut, auquel il donna ses instructions et qui s’éloigna vers l’intérieur de l’asile.
―――
Dans le quartier réservé aux internés les plus dangereux, Jim se tenait debout au bord de sa cellule. On eût dit une bête fauve captive ; de la bête fauve il avait l’apathie taciturne, l’aspect farouche, résigné et redoutable.
À travers les barreaux de la lourde grille qui l’enfermait, il avait passé son bras droit, et sa main pesante pendait en dehors. Ses yeux fixes regardaient droit devant lui, sans paraître rien voir, et il restait là sans bouger, comme une sombre image de révolte impuissante et de désespoir égaré.
Pensait-il ? Des souvenirs traversaient-ils son cerveau ? Regardait-il le passé, le présent ou l’avenir ?… Il demeurait immobile et, en apparence, presque hébété.
Soudain, sur sa main droite, une marque se dessina, un stigmate circulaire, rose d’abord, puis plus foncé et qui devint comme une couronne écarlate, irrégulière : le Cercle Rouge. Jim Barden entrait en fureur.
Il éleva sa main jusque devant ses yeux, regarda le stigmate mystérieux et eut un sourd ricanement de fou. Un pas retentit. Jim baissa la main. Le gardien parut, portant un paquet de vêtements. Il ouvrit la porte et les jeta au prisonnier.
— Habille-toi, ordonna-t-il. Tu vas me suivre chez le directeur et on te mettra en liberté.
Et il reprit :
— Mais oui, vieux Jim, en liberté. Voilà ce que c’est que d’être raisonnable. Depuis quelques mois, il n’y a rien à dire, tu es sage ! J’ai remarqué que ça date du jour où je t’ai trouvé ici, par terre, pleurant comme un enfant… Ça t’a calmé. Depuis, pas de crise. Alors on te donne la clé des champs…
Sans un mot, sans un signe de surprise, d’émotion ou de joie, sans jeter un dernier regard sur sa cellule, Jim, quand il eut revêtu ses anciens habits, un complet gris abîmé et fripé, suivit le gardien chez le directeur.
— Eh bien Jim Barden, vous voilà libre, lui dit celui-ci qui voulait être cordial avec son pensionnaire, pour faire plaisir à Florence Travis. Je pense que vous nous récompenserez de notre bienveillante décision en faisant tout ce qui sera en votre pouvoir pour vous en montrer digne, en devenant un bon sujet… Du reste, voici deux dames charitables qui ont la bonté de s’intéresser à vous et qui veulent bien vous venir en aide.
Jim Barden, à son entrée dans le bureau de M. Miller, avait jeté un regard sur Florence et sa mère, mais, au geste du directeur, il ne tourna pas la tête vers elles.
— Je ne demande rien, dit-il seulement d’une voix dure.
Florence se leva et fit deux pas vers lui.
— Nous le savons que vous ne demandez rien, dit-elle doucement, mais nous serions très heureuses de pouvoir vous aider.
— Oui, intervint avec bonté Mme Travis, vous allez vous trouver sans domicile, sans argent…
— C’est mon affaire, interrompit brutalement Barden. Je n’ai besoin de personne. On m’a mis en cage, mais ce n’est pas une raison pour qu’on vienne me voir comme une bête curieuse.
Il enfonça son chapeau sur sa tête et fit un mouvement vers la porte mais Florence, s’élançant vers lui, mit sa main blanche et fine sur sa manche grossière.
— Non, non, ne partez pas ainsi ! Je comprends bien… Vous avez tant souffert… Mais ne croyez pas que c’est une banale curiosité qui nous amène ici… Je veux que vous redeveniez un honnête homme, un homme heureux… Il n’est pas trop tard… Sans doute vous n’êtes pas seul au monde ?… Vous avez une famille ?… une femme ?
Un tressaillement secoua les lourdes épaules de l’homme. Une crispation douloureuse passa sur son visage.
— Ma femme, il y a vingt ans qu’elle est morte, dit-il sourdement.
— Oh ! je vous demande pardon… je vous ai fait de la peine… murmura la jeune fille, émue par cette lueur d’émotion sur ce visage farouche. Mais si votre femme est morte, peut-être avez-vous des enfants qu’il vous faut protéger, diriger dans la vie, qui vous aimeront et vous soutiendront dans votre vieillesse… Une fille ?… Un fils ?…
— Un fils… répéta Jim à voix basse, avec une expression d’amertume.
Il resta un instant pensif, puis, sans rien ajouter, écarta brusquement la main que Florence avait posée sur son bras, et, plus sombre que jamais, d’un pas pesant, se dirigea vers la porte.
Le gardien, d’un regard, consulta le directeur. Celui-ci fit un signe affirmatif ; le gardien laissa passer l’homme, et, le long des corridors lugubres, l’accompagna pour le faire sortir de l’asile.
— Voici une tentative peu encourageante, mademoiselle Travis, commença M. Miller.
Mais Florence qui était restée sur place, regardant s’éloigner le prisonnier libéré, interrompit le directeur.
— Non, non, c’est impossible ! Je ne puis le laisser partir comme cela ! s’écria-t-elle. Il y a du bon en lui, j’en suis sûre ! Je l’ai vu tressaillir quand je lui ai parlé de sa femme. Il a l’air si sombre, si désespéré ! il doit être si malheureux !… Je vais le rejoindre, essayer encore…
Malgré les appels de sa mère, qui se hâta de la suivre, la jeune fille s’élança hors du cabinet du directeur et se mit à courir pour rattraper Jim Barden.
La grille venait de s’ouvrir devant celui-ci. Jim la franchit et se trouva sur l’avenue déserte. Un moment, il resta immobile, les yeux clignotants au sortir de l’ombre intérieure, indécis peut-être sur sa direction et sans doute étourdi par le grand air, par le grand jour, par la liberté. Puis il fit quelques pas pour s’éloigner.
C’est à ce moment que Florence le rejoignit.
La jeune fille, rose, essoufflée d’avoir couru, sans se soucier d’être vue en pleine rue parlant à cet homme à l’aspect de bandit, mit de nouveau sa main sur le bras de Jim Barden.
Celui-ci s’arrêta, sa face se contracta dans une expression de sombre impatience.
— Écoutez-moi, lui dit la jeune fille avec le plus charmant des sourires ; j’ai encore un mot à vous dire. Je crois que tout à l’heure, je vous ai irrité. Je m’y suis mal prise, probablement, et je vous ai fait de la peine. Ce n’était pas mon intention, je vous assure… Pardonnez-moi, et pour me prouver que vous ne m’en voulez pas, permette-moi de vous avancer ceci, afin que vous puissiez vivre en attendant du travail.
Elle avait tiré de son réticule un petit rouleau de billets de banque qu’elle lui tendit.
Jim Barden eut un mouvement. Une colère alluma ses yeux. Brutalement, de la main de la jeune fille, il arracha les billets de banque qu’il froissa et jeta à terre.
— Je n’en veux pas de votre argent ! gronda-t-il d’une voix rauque. Je ne suis pas un mendiant !
— Je vous en prie, insista Florence.
Mais elle s’arrêta, interdite. Ce n’était plus le même homme. Un accès soudain de rage aveugle avait saisi Jim Barden :
— Allez-vous me laisser tranquille ! hurla-t-il le visage convulsé et en faisant un pas vers Florence.
Il était si menaçant que le gardien, qui regardait la scène, se jeta sur lui et le saisit à bras le corps.
Jim eut un rugissement étouffé et ses mains puissantes étreignirent la gorge du gardien.
La lutte fut brève. L’homme au Cercle Rouge, avec une force décuplée par la rage, se dégagea et, fou de fureur, s’élança le poing levé sur la jeune fille.
Une main vigoureuse saisit le bras menaçant. Le forcené vit devant ses yeux le canon d’un revolver braqué sur lui.
— Haut les mains ! ordonna une voix brève.
C’était Max Lamar, qui intervenait.
En sortant de son bureau, il s’était dirigé, comme il en avait manifesté l’intention à sa sténographe, vers l’asile.
Là, se dissimulant dans un angle de mur d’où l’on voyait la grille, il avait attendu la sortie de l’être redoutable qu’il s’était donné pour mission d’empêcher de nuire.
De ce poste d’observation, il avait assisté à la scène de violence qui s’était déroulée entre Barden et la jeune fille, et s’était précipité au secours de celle-ci.
— C’est encore vous, gronda Barden, en jetant un regard sanglant au jeune homme.
— Haut les mains ! répéta durement Lamar.
Jim-Cercle-Rouge hésita une seconde, mais la violence de sa crise était tombée ; le revolver restait braqué sur lui, le tenant en respect. Il obéit et leva les deux bras, tout en grondant sourdement comme une bête prise.
Max Lamar, sans le perdre du regard, sans cesser de le tenir sous la menace de son arme, se fouilla et sortit de sa poche les menottes qu’il y avait placées.
— Passez-lui ces bracelets, ordonna-t-il au gardien, qui s’apprêta à obéir.
Florence, nous l’avons dit, n’avait pas reculé devant le poing brandi de Jim Barden. Calme, résolue, un peu pâle, plus jolie que jamais dans son intrépidité fière, elle avait vu son sauveur dompter le forcené dont elle avait, sans le vouloir, provoqué la rage. Mais, quand le gardien s’apprêta à passer les menottes aux poignets de celui-ci, quand elle comprit qu’on allait replonger dans sa cellule le misérable qui venait à peine de goûter à la liberté, elle se jeta en avant, bouleversée par la pitié.
— Non, non, dit-elle à Max Lamar. Laissez-le aller, monsieur… Je vous en prie… C’est de ma faute, j’ai été maladroite. Je l’ai exaspéré par mon insistance indiscrète, qu’il a dû prendre pour une offense… Je vous en prie, laissez-le libre…
Ses beaux yeux imploraient ; elle tendit vers le jeune médecin des mains suppliantes. Max fut ébloui par la beauté de la jeune fille. Pourtant, il eut encore une hésitation.
— Je vous en prie, répéta-t-elle, d’un ton irrésistible.
— Allez-vous-en, dit Max Lamar au vieux bandit, qui se tenait maintenant devant lui, immobile et paraissant retombé dans une morne apathie. Allez-vous-en, vous êtes libre ! Remerciez cette jeune dame que vous menaciez et dont la générosité m’empêche de vous renvoyer d’où vous venez.
Jim Barden ne répondit pas un seul mot. Il enfonça son chapeau sur ses yeux et s’éloigna d’un pas lourd et sans tourner la tête.
Florence le suivit du regard. Sur son joli visage, il y avait une expression d’indéfinissable pitié. Puis elle se retourna vers Max Lamar et le remercia avec effusion.
— Sans vous, sans votre généreuse intervention, sans votre courage et votre énergie, je n’aurais pas échappé à la fureur de ce malheureux, termina-t-elle, les yeux brillants de gratitude.
— Florence, mon enfant, n’as-tu aucun mal ? cria avec angoisse Mme Travis, qui accourait, ayant de loin suivi sa fille et assisté, bouleversée, à la fin de la brève scène de violence.
— Non, non, ma mère ; grâce à monsieur je suis saine et sauve, dit gaiement la jeune fille.
Max Lamar, on a pu s’en rendre compte, n’était pas un personnage craintif ou timide.
Pourtant, en face de la jeune fille qui lui disait sa gratitude, un moment, il était resté troublé.
Machinalement, il se pencha, ramassa les billets de banque froissés par la main de Jim et les remit à Florence. Cependant, Mme Travis l’accablait à son tour de remerciements chaleureux, et Max Lamar reprit son aisance d’homme du monde.
— Je vous en prie, madame, vous allez, me laisser penser que vous ne m’auriez pas cru capable d’une action toute naturelle. Du reste, je faisais mon métier… Ce n’est pas que je sois détective, ajouta-t-il en riant, mais je suis médecin, — le docteur Max Lamar, — et mon rôle est, parfois de dompter les fous…
— Oui, oui, n’est-ce pas, cette fureur ne pouvait être que de la folie ? Que lui avais-je fait ? s’exclama la jeune fille.
— C’est un fou, mais ce n’est pas seulement un fou, dit Max Lamar, dont le visage s’assombrit. C’est un être redoutable — plus redoutable que jamais, il vient de le prouver par sa rage inexplicable — qui est maintenant lâché. Je crains que votre générosité ne m’ait fait commettre une imprudence, mademoiselle. Enfin, je vais exercer une surveillance active…
— Oh ! monsieur, vous m’en direz les résultats ! cet homme m’intéresse et m’apitoie, il paraît si farouchement désespéré, dit Florence au jeune médecin. Et si vous voulez bien perdre quelques minutes à me parler de vos recherches et de vos travaux, ajouta-t-elle, j’en serais très heureuse… Ce sont des questions si profondément intéressantes, si étranges, si mystérieuses… Nul ne les a étudiées comme vous…
Mme Travis joignit son invitation à celle de sa fille, et Max Lamar s’engagea à aller rendre visite aux deux dames.
Florence et sa mère remontèrent dans leur auto, qui démarra.
Max Lamar, immobile, suivit des yeux la voiture jusqu’à ce qu’elle eût disparu.
Alors, seulement, il s’éloigna dans la direction qu’avait prise Jim Barden.
Dans l’auto qui l’emportait à toute allure, Florence, pour rassurer et calmer Mme Travis, bouleversée par la scène qui avait eu lieu, fut plus joyeuse et plus enjouée que de coutume. Par instants, pourtant, un nuage de tristesse fugitive assombrissait ses traits et il semblait qu’elle dût faire effort pour reprendre sa gaieté.
Dans une avenue bordée de riches maisons particulières, l’auto fit halte devant la grille d’un jardin splendide, au milieu duquel s’élevait une habitation luxueuse. C’était Blanc-Castel, la résidence des deux dames.
Celles-ci descendirent de voiture et entrèrent. Pendant que Mme Travis gagnait la maison, Florence se dirigea lentement vers le fond du parc.
Une femme de quarante-cinq à quarante-six ans, très simplement vêtue de noir, au visage énergique et bon, la rejoignit aussitôt. On l’appelait Mary. Elle avait été la nourrice de Florence et, depuis lors, était restée auprès d’elle, amie fidèle plus encore que gouvernante de la jeune fille, qu’elle entourait d’un dévouement attentif et inlassable d’une profonde tendresse.
Après avoir échangé avec elle quelques paroles, la voyant pensive, elle la quitta, emportant le chapeau et la fourrure de la jeune fille.
Celle-ci, seule, fit encore quelques pas au milieu de la luxuriante végétation, parmi laquelle serpentaient les allées du parc.
Elle arriva auprès d’un large bassin, où une fontaine élevait le murmure musical de son flot jaillissant.
Sur un canapé d’osier elle s’assit et longtemps demeura songeuse, mordillant distraitement une fleur coupée. Peu à peu, l’expression de son visage devint mélancolique. Une nerveuse inquiétude agita Florence. Elle laissa tomber la fleur et, comme si elle éprouvait une soudaine souffrance, elle porta la main à sa poitrine.
— Florence, mon enfant, qu’avez-vous ? Vous souffrez ? murmura près d’elle une voix inquiète.
Florence tourna la tête, vit sa gouvernante qui était revenue, et lui sourit.
— Non, Mary, je vous assure. Je n’ai rien. Pourquoi souffrirais-je ?
— Pourquoi, je l’ignore, mais je vois bien que vous n’êtes pas comme de coutume. Voyons, faites comme quand vous étiez une enfant, ajouta la gouvernante en s’asseyant familièrement auprès de la jeune fille. Dites vos peines à votre vieille nourrice. Qu’avez-vous ?
— Je ne sais pas, Mary, je vous jure, je ne sais pas… C’est peut-être l’émotion de cette scène pénible… Mais non, de coutume je ne suis pas si peureuse…
Florence resta un moment silencieuse et, d’une voix assourdie, reprit :
— C’est autre chose… C’est un pressentiment qui m’obsède, contre lequel je lutte depuis plus d’une heure, sans pouvoir le chasser. Le pressentiment d’un malheur qui va m’arriver…
Elle tressaillit, regarda autour d’elle anxieusement et, plus bas encore :
— D’un malheur qui vient de m’arriver… maintenant… au moment où je vous parlais, un malheur irréparable… C’est fou, mais j’ai l’impression nette et cruelle qu’un des miens vient de disparaître…
Tremblante, comme une enfant cherchant protection, elle s’appuya sur l’épaule de sa fidèle compagne. Celle-ci la serra contre elle avec tendresse et la calma par de douces paroles.
Mais la voix de la gouvernante était étrangement troublée et une angoisse emplissait ses yeux.
III
Comment Bob comprend le sport
M. Robert Barden, que ses amis intimes, c’est-à-dire les jeunes rôdeurs et les cambrioleurs débutants, les filous de haute et basse pègre, les ex-boxeurs noirs tombés dans l’ivrognerie et l’attaque nocturne, les anciens domestiques jaunes devenus des voleurs et des faussaires, les malfaiteurs des deux sexes — en un mot, toute l’écume des villes de l’ouest des États-Unis — qui composaient la sphère de ses relations, appelaient familièrement Bob, était un jeune homme de grande espérance.
Ce n’était pas que, jusqu’à ce jour, il se fût particulièrement distingué par quelque coup d’éclat ou par quelque canaillerie sensationnelle. Non, l’occasion lui avait manqué, prétendait-il lui-même pour s’excuser (il est vrai que les malveillants disaient que c’était le courage). Mais il n’avait guère plus de vingt ans et il avait tout le temps de se rattraper.
C’était un jeune gentleman au teint plombé, aux cheveux collés aux tempes sous la casquette trop enfoncée, aux yeux faux et fuyants, à la mise négligée, à la démarche veule et à la parole traînante.
Il avait pour le travail, quel qu’il fût, une horreur instinctive et presque maladive, et, par contre, une fâcheuse propension à considérer comme sien le bien d’autrui. Du reste, il ne tenait pas particulièrement à voler, n’aimant pas du tout les villégiatures que le gouvernement américain offre aux gens de son acabit, et il professait à part lui que la crainte du policeman est le commencement de la sagesse… Cependant, comme, avant tout, il voulait ne rien faire, comme son vague métier de cordonnier le dégoûtait tant qu’il l’avait, depuis des mois, abandonné, il glissait de plus en plus sur la pente où le poussaient sa paresse et ses vices et qui aboutit généralement, non à la paille humide, puisqu’il n’y en a plus dans les cachots, mais au bagne, si ce n’est pire.
M. Bob Barden, ce jour-là, se trouvait de très mauvaise humeur.
Depuis le matin, il était en butte aux coups d’une fortune contraire. Tout d’abord, dès l’aube, à son avis, c’est-à-dire vers neuf heures, son logeur, homme brutal, redouté pour ses muscles d’ancien lutteur, l’avait jeté dehors, las de ne jamais toucher le loyer de sa misérable chambre. Bob avait obtenu à grand’peine la permission d’emporter ses bagages, consistant en trois faux cols (deux sales et un propre), deux mouchoirs troués et un peigne aux dents cassées.
Ensuite, il avait attendu en vain, à un rendez-vous fixe, un de ses meilleurs amis, M. Isaac Hands, qui devait lui apporter sa part du produit de la vente d’une bicyclette, trouvée l’avant-veille, toute seule, au coin d’une rue.
Enfin, une tentative faite, en désespoir de cause, pour emprunter un dollar à une autre de ses connaissances, un vieux receleur, Jérémie Shaw, avait essuyé un échec absolu, environné de considérations mortifiantes sur les incapables et les peureux.
Quant à s’adresser à Sam Smiling, il n’y avait pas à y songer. Après l’échec de la tentative faite pour obtenir de Jim Barden la seconde moitié du bracelet de corail, Sam, bien que Bob eût failli se rompre les os au cours de sa mission, l’avait mis à la porte de chez lui, et Bob craignait trop le redoutable cordonnier pour l’affronter de nouveau.
En conséquence, vers onze heures, dans un bar mal famé, Bob se trouvait assis devant un verre d’alcool qu’on avait consenti à lui servir à crédit. Apathique et morne, les mains dans ses poches vides, un bout de cigarette collé à la lèvre, il prêtait une oreille distraite à la conversation tenue en argot par trois chenapans de sa connaissance, qu’accompagnait une personne de mœurs peu farouches, qui pour le moment, la tête dans ses mains, dormait sur la table.
— Alors, c’est la bande à Sam Smiling qui a fait le coup ? dit, à mi-voix, un personnage chétif et blême. Vous avez des détails, Wilson ?
— Oui, dit Wilson, un gros homme bien nourri, à encolure de campagnard jovial et qui intercalait : « On peut le dire » entre toutes ses phrases. J’ai failli en être, mais j’étais à travailler ailleurs et je l’ai regretté, on peut le dire ! C’est Sam qui a tout monté lui-même.
— Ah ! c’est le malin des malins, le cordonnier, déclara le troisième, un mulâtre colossal, aux oreilles écrasées par la pratique du catch-as-catch-can.