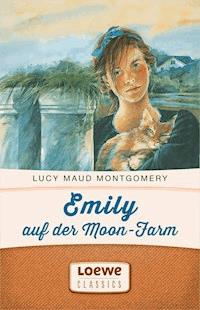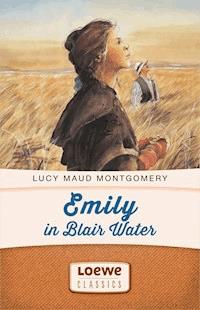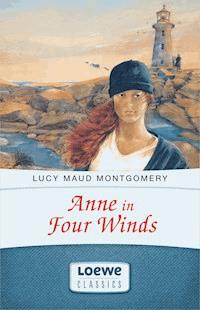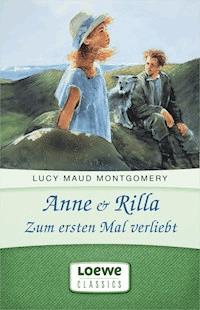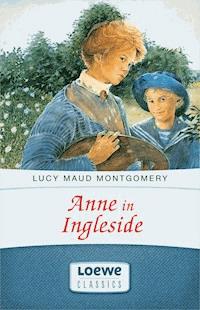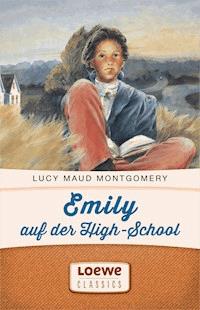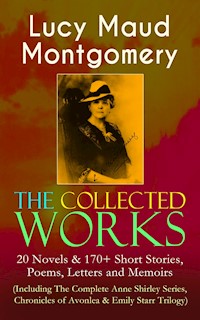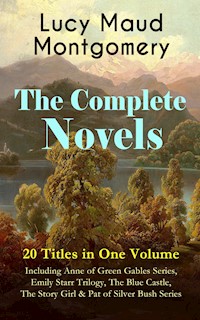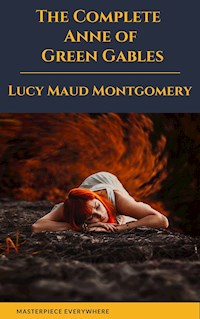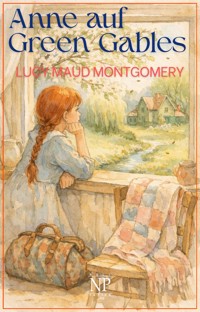9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tim Word
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Entrez dans le monde enchanteur du "Château bleu" de Lucy Maud Montgomery, un récit captivant qui vous fera tomber des nues et vous transportera dans un lieu d'espoir, de rêves et de transformations inattendues.
Les pages de ce délicieux roman racontent l'histoire de Valancy Stirling, une femme apparemment ordinaire menant une vie monotone, accablée par les attentes de la société et les contraintes de sa propre nature timide. Piégée dans les limites de sa famille stricte et étouffant dans une mer de normes sociales, Valancy aspire à quelque chose de plus, quelque chose d'extraordinaire qui apporterait de la couleur et de la vitalité à son existence.
Mais tout change lorsque Valancy reçoit une nouvelle dévastatrice qui la libère des chaînes de la conformité. Face à un avenir sombre, elle décide de s'embarquer dans un voyage audacieux à la découverte de soi, découvrant les profondeurs cachées de son esprit et le courage qu'elle n'a jamais su posséder.
Alors que Valancy échappe à la routine de sa vie, elle tombe sur un lieu isolé et mystique connu sous le nom de Château bleu, un sanctuaire rempli de beauté sauvage et de possibilités infinies. Entre ses murs éthérés, elle trouve le réconfort et la chance de réécrire son propre destin, embrassant les merveilles de la vie avec une vigueur nouvelle.
Sous la magie de la prose lyrique de Montgomery, les lecteurs seront captivés par le voyage captivant de Valancy vers la réalisation de soi, alors qu'elle défie les conventions et apprend à saisir la tapisserie vibrante de la vie. En chemin, elle rencontre une série de personnages mémorables, chacun avec ses propres rêves et désirs, ce qui ajoute de la profondeur et de la richesse à l'histoire.
"Le château bleu" est une exploration exquise de la résilience de l'esprit humain, une célébration du pouvoir de l'amour et un testament de la force indomptable qui réside en chacun de nous. L'art de la narration de Montgomery tisse un récit envoûtant, enveloppant les lecteurs dans un monde où les rêves deviennent réalité et où les secondes chances abondent.
Plongez dans les pages du "Château bleu" et laissez-vous emporter par son enchantement dans un lieu où le courage fleurit, où les cœurs se ressoudent et où la poursuite du bonheur est accueillie à bras ouverts. Ce classique intemporel est un véritable bijou qui vous laissera bouche bée, vous inspirant à saisir les possibilités qui s'offrent à vous et vous rappelant que parfois, les aventures les plus extraordinaires peuvent commencer par un simple acte de bravoure.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
LE CHÂTEAU BLEU
Par Lucy M. Montgomery
Copyright© 2023 by Tim Word.
All rights reserved, including the right to reproduce this book or portion thereof in any form whatsoever.
Copyright© 2023 by Tim Word. All rights reserved, including the right to reproduce this book or portion thereof in any form whatsoever.
Copyright© 2023, Tim Word. Tous droits réservés. Toute reproduction même partielle du contenu, de la couverture ou des icônes par quelque procédé que ce soit (électronique, photocopie, bandes magnétiques ou autre) est interdite sans les autorisations de Tim Word.
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’Auteur ou de ses ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII
CHAPITRE VIII
CHAPITRE IX
CHAPITRE X
CHAPITRE XI
CHAPITRE XII
CHAPITRE XIII
CHAPITRE XIV
CHAPITRE XV
CHAPITRE XVI
CHAPITRE XVII
CHAPITRE XVIII
CHAPITRE XIX
CHAPITRE XX
CHAPITRE XXI
CHAPITRE XXII
CHAPITRE XXIII
CHAPITRE XXIV
CHAPITRE XXV
CHAPITRE XXVI
CHAPITRE XXVII
CHAPITRE XXVIII
CHAPITRE XXIX
CHAPITRE XXX
CHAPITRE XXXI
CHAPITRE XXXII
CHAPITRE XXXIII
CHAPITRE XXXIV
CHAPITRE XXXV
CHAPITRE XXXVI
CHAPITRE XXXVII
CHAPITRE XXXVIII
CHAPITRE XXXIX
CHAPITRE XL
CHAPITRE XLI
CHAPITRE XLII
CHAPITRE XLIII
CHAPITRE XLIV
CHAPITRE XLV
BIBLIOGRAPHIE
CHAPITRE I
S'il n'avait pas plu un certain matin de mai, la vie de Valancy Stirling aurait été totalement différente. Elle serait allée, avec le reste de son clan, au pique-nique de fiançailles de Tante Wellington et le docteur Trent serait allé à Montréal. Mais il a plu et vous allez savoir ce qui lui est arrivé à cause de cela.
Valancy se réveilla tôt, dans l'heure sans vie et sans espoir qui précède l'aube. Elle n'avait pas très bien dormi. On ne dort pas bien, parfois, quand on a vingt-neuf ans le lendemain et qu'on est célibataire, dans une communauté et un milieu où les célibataires sont simplement ceux qui n'ont pas réussi à se trouver un homme.
Deerwood et les Stirling avaient depuis longtemps relégué Valancy au rang de vieille fille sans espoir. Mais Valancy elle-même n'avait jamais tout à fait renoncé à un certain espoir pitoyable, honteux, que la romance viendrait encore à sa rencontre - jamais, jusqu'à ce matin humide et horrible où elle s'est réveillée en réalisant qu'elle avait vingt-neuf ans et qu'elle n'était convoitée par aucun homme.
C'est là que le bât blesse. Valancy ne voyait pas d'inconvénient à être une vieille fille. Après tout, pensait-elle, être une vieille fille ne pouvait pas être aussi terrible que d'être mariée à un Oncle Wellington ou à un Oncle Benjamin, ou même à un Oncle Herbert. Ce qui lui fait mal, c'est qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'être autre chose qu'une vieille fille. Aucun homme ne l'avait jamais désirée.
Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle restait seule dans l'obscurité légèrement grisonnante. Elle n'osait pas se laisser aller à pleurer aussi fort qu'elle le voulait, pour deux raisons. Elle craignait que les pleurs ne provoquent une nouvelle crise de douleur au niveau du cœur. Elle en avait eu une après s'être mise au lit, pire que toutes celles qu'elle avait eues jusqu'à présent. Et elle craignait que sa mère ne remarque ses yeux rouges au petit déjeuner et ne la harcèle de questions minutieuses, persistantes et semblables à celles d'un moustique pour en connaître la cause.
« Supposons, » pensa Valancy avec un sourire affreux, « que je réponde en disant la vérité : ‘Je pleure parce que je ne peux pas me marier.’ Comme ma mère serait horrifiée - bien qu'elle ait honte chaque jour de sa vie de sa fille célibataire. »
Mais bien sûr, il faut sauver les apparences. Valancy entendait la voix dictatoriale de sa mère affirmer que « ce n'est pas un comportement de jeune fille que de penser aux hommes. »
Imaginer l'expression de sa mère fit rire Valancy, car elle avait un sens de l'humour que personne dans son clan ne soupçonnait. D'ailleurs, il y avait beaucoup de choses chez Valancy que personne ne soupçonnait. Mais son rire était très superficiel et elle resta allongée là, une petite silhouette recroquevillée, futile, écoutant la pluie tomber à verse à l'extérieur et observant, avec un dégoût maladif, la lumière froide et impitoyable qui s'insinuait dans sa chambre laide et sordide.
Elle connaissait par cœur la laideur de cette chambre, la connaissait et la détestait. Le sol peint en jaune, avec un hideux tapis « crocheté » près du lit, sur lequel se trouvait un chien grotesque « crocheté » qui la regardait toujours en souriant lorsqu'elle se réveillait ; le papier délavé, rouge foncé ; le plafond décoloré par de vieilles fuites et traversé de fissures ; le petit lavabo étroit et pincé ; le lambrequin de papier brun orné de roses violettes ; le vieux miroir tacheté avec la fissure qui le traverse, posé sur la coiffeuse trop petite ; le pot de vieux pot-pourri fabriqué par sa mère lors de sa mythique lune de miel ; la boîte recouverte de coquillages, dont un coin a éclaté, que la cousine Stickles avait fabriquée lors de son enfance tout aussi mythique ; la pelote à épingles perlée dont la moitié des perles a disparu ; l'unique chaise jaune et raide ; la vieille devise défraîchie, "Partie mais pas oubliée", écrite en laines colorées sur le visage sinistre de l'arrière-grand-mère Stirling ; les vieilles photographies d'anciens parents bannis depuis longtemps des pièces du dessous. Il n'y avait que deux photos qui ne représentaient pas des membres de la famille. La première, un vieux chromo représentant un chiot assis sur le pas d'une porte pluvieuse, rendait toujours Valancy triste. Ce petit chien malheureux, accroupi sur le pas de la porte sous la pluie battante ! Pourquoi personne n'ouvrait-il la porte et ne le laissait-il pas entrer ? L'autre image était une gravure délavée et passe-partout de la reine Louise descendant un escalier, que tante Wellington lui avait généreusement offerte à l'occasion de son dixième anniversaire. Pendant dix-neuf ans, elle l'avait regardée et détestée, cette belle reine Louise, suffisante et satisfaite d'elle-même. Mais elle n'avait jamais osé la détruire ou l'enlever. Mère et Cousine Stickles auraient été horrifiées, ou, comme Valancy l'exprimait irrévérencieusement dans ses pensées, auraient piqué une crise.
Toutes les pièces de la maison étaient laides, bien sûr. Mais en bas, les apparences étaient quelque peu entretenues. Il n'y avait pas d'argent pour les pièces que personne ne voyait jamais. Valancy se disait parfois qu'elle aurait pu faire quelque chose pour sa chambre elle-même, même sans argent, si on le lui avait permis. Mais sa mère avait rejeté toutes les suggestions timides et Valancy n'avait pas insisté. Valancy n'a jamais persisté. Elle avait peur. Sa mère ne supportait pas l'opposition. Mme Stirling boudait pendant des jours si elle était offensée, avec les airs d'une duchesse insultée.
La seule chose que Valancy aimait dans sa chambre, c'est qu'elle pouvait s'y isoler la nuit pour pleurer si elle le voulait.
Mais, après tout, qu'importait qu'une chambre, dont on ne se servait que pour dormir et s'habiller, soit laide ? Valancy n'était jamais autorisée à rester seule dans sa chambre pour une autre raison. Les gens qui voulaient être seuls, pensaient Mme Frederick Stirling et Cousin Stickles, ne pouvaient vouloir être seuls que dans un but sinistre. Mais sa chambre au Château Bleu était tout ce qu'une chambre devrait être.
Valancy, qui était si soumise, si silencieuse, tant rejetée et tant snobée dans la vie réelle, avait l'habitude de se laisser aller à une certaine splendeur dans ses rêveries. Personne dans le clan Stirling, ou ses ramifications, ne s'en doutait, surtout pas sa mère et la cousine Stickles. Elles n'ont jamais su que Valancy avait deux maisons - la laide boîte de briques rouges d'une maison, sur Elm Street, et le Château Bleu en Espagne. Valancy avait vécu spirituellement dans le Château Bleu depuis qu'elle s'en souvenait. Elle n'était qu'une fillette lorsqu'elle s'est retrouvée en possession du château. A chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle le voyait clairement, avec ses tourelles et ses bannières sur les hauteurs des montagnes couvertes de pins, enveloppé dans sa faible beauté bleue, dans le ciel du coucher de soleil d'une terre belle et inconnue. Tout ce qu'il y a de plus beau et de plus merveilleux se trouve dans ce château. Des bijoux que les reines auraient pu porter, des robes de feu et de lumière, des divans de roses et d'or, de longues volées de marches de marbre peu profondes, avec de grandes urnes blanches, que montaient et descendaient des jeunes filles élancées et vêtues de brume, des cours à piliers de marbre, où se trouvaient des fontaines chatoyantes et où les rossignols chantaient parmi les myrtes, des salles de miroirs qui ne reflétaient que de beaux chevaliers et de belles femmes, elle-même la plus belle de toutes, pour le regard de laquelle des hommes mouraient. Tout ce qui la soutenait dans l'ennui de ses journées était l'espoir de faire des rêves la nuit. La plupart des Stirling, sinon tous, seraient morts d'horreur s'ils avaient su la moitié des choses que Valancy avait fait dans son Château Bleu.
D'une part, elle avait un certain nombre d'amants. Oh, rassurez-vous, un seul à la fois. L'un d'eux l'a courtisée avec toute l'ardeur romantique de l'époque de la chevalerie, l'a conquise après une longue dévotion et de nombreux exploits, et s'est marié avec elle en grande pompe dans la grande chapelle du Château Bleu, surmontée d'une bannière.
À douze ans, cet amoureux était un beau garçon aux boucles dorées et aux yeux d'un bleu céleste. À quinze ans, il est grand, sombre et pâle, mais forcément beau. À vingt ans, il est ascétique, rêveur, spirituel. À vingt-cinq ans, il avait une mâchoire bien taillée, légèrement grimaçante, et un visage plus fort et rugueux que beau. Valancy n'a jamais dépassé les vingt-cinq ans dans son Château Bleu, mais depuis peu - très peu - son héros avait des cheveux roux, fauves, un sourire tordu et un passé mystérieux.
Je ne dis pas que Valancy a délibérément assassiné ces amants lorsqu'elle les a dépassés. L'un d'entre eux s'est simplement évanoui au fur et à mesure qu'un autre arrivait. Les choses sont très pratiques à cet égard dans les Châteaux Bleus.
Mais, en ce matin du jour de son destin, Valancy ne trouvait pas la clé de son Château Bleu. La réalité la pressait trop, aboyant sur ses talons comme un petit chien exaspérant. Elle avait vingt-neuf ans, elle était seule, indésirable, défavorisée, la seule fille modeste d'un beau clan, sans passé ni avenir. Aussi loin qu'elle pouvait regarder en arrière, la vie était terne et sans couleur, sans la moindre tache pourpre ou cramoisie. Aussi loin qu'elle pouvait regarder vers l'avenir, il semblait certain que ce serait la même chose jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une petite feuille flétrie et solitaire s'accrochant à un rameau hivernal. Le moment où une femme réalise qu'elle n'a plus de raison de vivre - ni amour, ni devoir, ni but, ni espoir - lui réserve l'amertume de la mort.
« Et je dois continuer à vivre parce que je ne peux pas m'arrêter. Il se peut que je doive vivre quatre-vingt ans, » pensa Valancy, dans une sorte de panique. « Nous vivons tous horriblement longtemps. Cela me rend malade d'y penser. »
Elle était contente qu'il pleuve - ou plutôt, elle était tristement satisfaite qu'il pleuve. Il n'y aurait pas de pique-nique ce jour-là. Ce pique-nique annuel, au cours duquel tante et oncle Wellington - on pensait toujours à eux dans cette succession - avaient inévitablement célébré leurs fiançailles lors d'un pique-nique trente ans auparavant, avait été, ces dernières années, un véritable cauchemar pour Valancy. Par une coïncidence malicieuse, c'était le même jour que son anniversaire et, après ses vingt-cinq ans, personne ne l'oubliait.
Même si elle détestait aller au pique-nique, il ne lui serait jamais venu à l'esprit de se rebeller contre lui. Sa nature n'avait rien de révolutionnaire. Et elle savait exactement ce que tout le monde lui dirait au pique-nique. L'oncle Wellington, qu'elle n'aimait pas et méprisait même s'il avait réalisé la plus grande aspiration des Stirling, "épouser de l'argent", lui dirait dans un chuchotement, "Tu ne penses pas encore à te marier, ma chère ?" et partirait ensuite dans le fou rire avec lequel il concluait invariablement ses remarques ennuyeuses. La tante Wellington, que Valancy respectait profondément, lui parlait de la nouvelle robe en mousseline d'Olive et de la dernière lettre dévouée de Cécil. Valancy devait avoir l'air aussi satisfaite et intéressée que si la robe et la lettre avaient été les siennes, sinon tante Wellington serait offensée. Et Valancy avait décidé depuis longtemps qu'elle préférait offenser Dieu plutôt que tante Wellington, car Dieu pourrait lui pardonner, mais tante Wellington ne le ferait jamais.
Tante Alberta, très grosse, avec l'aimable habitude de toujours appeler son mari « il », comme s'il était la seule créature masculine au monde, qui ne pouvait jamais oublier qu'elle avait été une grande beauté dans sa jeunesse, présentait ses condoléances à Valancy sur son teint blafard...
« Je ne sais pas pourquoi toutes les filles d'aujourd'hui ont des coups de soleil. Quand j'étais petite, ma peau était rose et crème. J'étais considérée comme la plus belle fille du Canada, ma chère. »
Peut-être l'oncle Herbert ne dirait-il rien, ou peut-être ferait-il cette remarque plaisante : « Comme tu grossis, Doss ! » Et alors tout le monde rirait de l'idée excessivement humoristique de voir le pauvre petit Doss maigre grossir.
L'oncle James, beau et solennel, que Valancy n'aimait pas mais respectait parce qu'il était réputé très intelligent et qu'il était donc l'oracle du clan - les cerveaux n'étant pas très nombreux chez les Stirling - ferait probablement remarquer avec le sarcasme de hibou qui lui avait valu sa réputation : « Je suppose que tu es occupé avec ton coffre à espoirs ces jours-ci ? »
Et l'oncle Benjamin posait certaines de ses abominables énigmes, entre deux gloussements, et y répondait lui-même.
« Quelle est la différence entre Doss et une souris ? »
« La souris veut nuire au fromage et Doss veut charmer les hommes. »
Valancy l'avait entendu poser cette énigme cinquante fois et à chaque fois, elle avait envie de lui jeter quelque chose à la figure. Mais elle ne l'a jamais fait. En premier lieu, les Stirling ne lançaient tout simplement pas d'objets ; en second lieu, l'oncle Benjamin était un vieux veuf riche et sans enfant, et Valancy avait été élevée dans la crainte et la réprimande de son argent. Si elle l'offensait, il l'exclurait de son testament - à supposer qu'elle en fasse partie. Valancy ne voulait pas être rayée du testament de l'oncle Benjamin. Elle avait été pauvre toute sa vie et en connaissait l'amertume. Elle a donc supporté ses énigmes et a même esquissé de petits sourires torturés à leur propos.
Tante Isabel, franche et désagréable comme un vent d'est, la critiquait d'une manière ou d'une autre - Valancy ne pouvait pas prévoir comment, car tante Isabel ne répétait jamais une critique - elle trouvait à chaque fois quelque chose de nouveau à vous mettre sous le nez. Tante Isabel se targuait de dire ce qu'elle pensait, mais n'aimait pas trop que les autres lui disent ce qu'ils pensaient. Valancy ne disait jamais ce qu'elle pensait.
La cousine Georgiana - du nom de son arrière-arrière-grand-mère, qui avait été nommée en l'honneur de Georges IV - racontait avec dolorisme les noms de tous les parents et amis décédés depuis le dernier pique-nique et se demandait « lequel d'entre nous sera le premier à partir ? »
Abusivement compétente, Tante Mildred parlait sans cesse de son mari et de ses odieux prodiges de bébés à Valancy, parce que Valancy était la seule personne qu'elle pouvait trouver pour le supporter. Pour la même raison, la cousine Gladys - en réalité la première cousine Gladys une fois enlevée, selon la manière stricte dont les Stirling calculaient les liens de parenté - une grande dame mince qui admettait avoir un tempérament sensible, décrivait minutieusement les tortures de sa névrite. Et Olive, la starlette de tout le clan Stirling, qui avait tout ce que Valancy n'avait pas - la beauté, la popularité, l'amour - exhibait sa beauté et présumait de sa popularité et exhibait ses insignes d'amour en diamants aux yeux éblouis et envieux de Valancy.
Il n'y aurait rien de tout cela aujourd'hui. Et il n'y aurait pas d'emballage de cuillères à café. L'emballage était toujours laissé à Valancy et à Cousin Stickles. Et une fois, il y a six ans, une cuillère à café en argent du service de mariage de tante Wellington avait été perdue. Valancy n'a jamais entendu parler de cette cuillère à café en argent. Son fantôme est apparu à la manière de Banquo à chaque fête de famille qui a suivi.
Oh, oui, Valancy savait exactement à quoi ressemblerait le pique-nique et elle bénissait la pluie qui l'en avait sauvée. Il n'y aurait pas de pique-nique cette année. Si tante Wellington ne pouvait pas fêter le jour sacré, elle ne fêterait rien du tout. Remercions les dieux, quels qu'ils soient, pour cela.
Comme il n'y aurait pas de pique-nique, Valancy décida que, si la pluie se maintenait dans l'après-midi, elle irait à la bibliothèque chercher un autre des livres de John Foster. Valancy n'avait jamais été autorisée à lire des romans, mais les livres de John Foster n'étaient pas des romans. Il s'agissait de « livres sur la nature » - c'est ce que la bibliothécaire a dit à Mme Frederick Stirling – « sur les bois, les oiseaux, les insectes et d'autres choses du même genre, vous savez. » Valancy fut donc autorisée à les lire - en protestant, car il n'était que trop évident qu'elle les appréciait trop. Il était permis, voire louable, de lire pour améliorer son esprit et sa religion, mais un livre qui plaisait était dangereux. Valancy ne savait pas si son esprit s'améliorait ou non, mais elle sentait vaguement que si elle avait rencontré les livres de John Foster il y a des années, la vie aurait pu être différente pour elle. Ils lui semblaient laisser entrevoir un monde dans lequel elle aurait pu entrer un jour, mais dont la porte lui était à jamais barrée. Ce n'est que depuis un an que les livres de John Foster se trouvent à la bibliothèque de Deerwood, bien que le bibliothécaire ait dit à Valancy qu'il était un écrivain bien connu depuis plusieurs années.
« Où habite-t-il ? » avait demandé Valancy.
« Personne ne le sait. D'après ses livres, il doit être canadien, mais on ne peut pas en savoir plus. Ses éditeurs ne veulent rien dire. Il est fort probable que John Foster soit un nom de plume. Ses livres sont tellement populaires que nous ne pouvons pas les garder, même si je ne vois vraiment pas ce que les gens y trouvent à redire. »
« Je pense qu'ils sont merveilleux, » dit timidement Valancy.
« Oh, et bien... » Mlle Clarkson sourit d'un air condescendant qui reléguait les opinions de Valancy dans les limbes. « Je ne peux pas dire que je m'intéresse beaucoup aux insectes moi-même. Mais Foster semble savoir tout ce qu'il y a à savoir à leur sujet. »
Valancy ne sait pas non plus si elle s'intéresse beaucoup aux insectes. Ce n'était pas la connaissance étrange qu'avait John Foster des créatures sauvages et de la vie des insectes qui la passionnait. Elle ne pouvait pas dire ce que c'était - un attrait alléchant d'un mystère jamais révélé - un soupçon d'un grand secret juste un peu plus loin - un écho faible et insaisissable de choses charmantes et oubliées - la magie de John Foster était indéfinissable.
Oui, elle allait recevoir un nouveau livre de Foster. Cela faisait un mois qu'elle n'avait pas eu La Récolte du Chardon, et Mère ne pouvait donc pas s'y opposer. Valancy l'avait lu quatre fois - elle en connaissait des passages entiers par cœur.
Et elle pensait presque aller voir le Dr Trent à propos de cette étrange douleur au cœur. Elle l'avait ressentie assez souvent ces derniers temps, et les palpitations devenaient gênantes, sans parler des vertiges occasionnels et de l'étrange essoufflement. Mais pouvait-elle aller le voir sans le dire à personne ? C'était une idée des plus audacieuses. Aucun des Stirling n'a jamais consulté un médecin sans tenir un conseil de famille et obtenir l'approbation de l'oncle James. Ils se rendirent donc chez le docteur Ambrose Marsh de Port Lawrence, qui avait épousé la seconde cousine Adélaïde Stirling.
Mais Valancy n'aimait pas le docteur Ambrose Marsh. De plus, elle ne pouvait pas se rendre à Port Lawrence, à quinze miles de là, sans y être emmenée. Elle ne voulait pas que l'on sache pour son cœur. Il y aurait eu un tel tapage et tous les membres de la famille seraient venus pour en parler et la conseiller, la mettre en garde et lui raconter d'horribles histoires de grands-tantes et de cousins quarante fois éloignés qui avaient été « comme ça » et qui étaient « tombés raides morts sans prévenir, ma chère . »
Tante Isabel se souviendrait qu'elle avait toujours dit que Doss avait l'air d'une fille qui aurait des problèmes cardiaques – « si pincée et si piquée » ; et l'oncle Wellington le prendrait comme une insulte personnelle, alors « qu’aucun Stirling n'a jamais eu de maladie cardiaque auparavant » ; et Georgiana présagerait dans des apartés parfaitement audibles que « la pauvre, chère petite Doss n'est pas pour longtemps dans ce monde, j'en ai peur » ; et la cousine Gladys disait : « Mon cœur est comme ça depuis des années », d'un ton qui laissait entendre que personne d'autre n'avait le droit d'avoir un cœur ; et Olive - Olive était simplement beau, supérieur et horriblement sain, comme pour dire : « Pourquoi toute cette agitation pour une superfluité fanée comme Doss quand vous m'avez moi ? »
Valancy pensait qu'elle ne pouvait en parler à personne à moins d'y être obligée. Elle était persuadée que son cœur n'avait rien de grave et qu'elle n'avait pas besoin de se préoccuper de tout ce qui se passerait si elle le mentionnait. Elle s'éclipserait discrètement et irait voir le Dr Trent le jour même. Pour ce qui est de la facture, elle disposait des deux cents dollars que son père avait déposés à la banque pour elle le jour de sa naissance. Elle n'avait jamais été autorisée à utiliser ne serait-ce que les intérêts de cette somme, mais elle en retirait secrètement assez pour payer le docteur Trent.
Le docteur Trent était un vieil homme bourru, franc et distrait, mais il était une autorité reconnue en matière de maladies cardiaques, même s'il n'était qu'un médecin généraliste à Deerwood, une ville hors du commun. Le docteur Trent avait plus de soixante-dix ans et des rumeurs circulaient sur son intention de prendre bientôt sa retraite. Aucun membre du clan Stirling n'était jamais allé le voir depuis qu'il avait dit à la cousine Gladys, dix ans auparavant, que sa névrite était imaginaire et qu'elle s'en réjouissait. On ne peut pas traiter avec condescendance un médecin qui insulte ainsi sa cousine germaine - sans compter qu'il est presbytérien alors que tous les Stirling vont à l'Église anglicane. Mais Valancy, entre le diable de la déloyauté envers le clan et la mer profonde de l'agitation, du bruit et des conseils, pensait qu'elle allait tenter sa chance avec le diable.
CHAPITRE II
Lorsque la cousine Stickles frappe à sa porte, Valancy sait qu'il est sept heures et demie et qu'elle doit se lever. D'aussi loin qu'elle se souvienne, la cousine Stickles avait toujours frappé à sa porte à sept heures et demie. La cousine Stickles et Mme Frederick Stirling étaient debout depuis sept heures, mais Valancy avait le droit de rester couchée une demi-heure de plus en raison d'une tradition familiale qui voulait qu'elle soit délicate. Valancy se leva, bien qu'elle détestât se lever plus que jamais ce matin-là. Pourquoi se lever ? Une autre journée morne comme toutes celles qui l'avaient précédée, pleine de petites tâches insignifiantes, sans joie et sans importance, qui ne profitaient à personne. Mais si elle ne se levait pas immédiatement, elle ne serait pas prête pour le petit déjeuner de huit heures. Chez Mme Stirling, l'heure des repas est une règle stricte et rapide. Petit-déjeuner à huit heures, dîner à une heure, souper à six heures, année après année. Aucune excuse n'était tolérée pour les retards. Valancy se leva donc, frissonnant.
La pièce était glaciale, avec le froid cru et pénétrant d'un matin humide de mai. La maison serait froide toute la journée. L'une des règles de Mme Frederick était de ne pas faire de feu après le 24 mai. Les repas étaient préparés sur le petit poêle à pétrole du porche arrière. Et bien que le mois de mai puisse être glacial et le mois d'octobre gelé, aucun feu n'était allumé avant le 21 octobre, selon le calendrier. Le 21 octobre, Mme Frederick a commencé à cuisiner sur la cuisinière de la cuisine et a allumé un feu dans le poêle du salon le soir. On murmurait dans la famille que feu Frederick Stirling avait attrapé le rhume qui l'avait emporté pendant la première année de vie de Valancy parce que Mme Frederick n'avait pas allumé de feu le 20 octobre. Elle l'a allumé le lendemain, mais c'était un jour trop tard pour Monsieur Frederick Stirling.
Valancy enleva et suspendit dans l'armoire sa chemise de nuit en coton grossier non blanchi, au col montant et aux manches longues et serrées. Elle mit des sous-vêtements de même nature, une robe de vichy marron, des bas noirs épais et des bottes à talons en caoutchouc. Ces dernières années, elle avait pris l'habitude de se coiffer en baissant le store de la fenêtre près du miroir. Les rides de son visage n'apparaissaient alors pas aussi clairement. Mais ce matin, elle a tiré le store jusqu'en haut et s'est regardée dans le miroir lépreux avec la détermination passionnée de se voir telle que le monde la voyait.
Le résultat était plutôt épouvantable. Même une beauté aurait trouvé cette lumière latérale dure et non adoucie éprouvante. Valancy avait des cheveux noirs, courts et fins, toujours sans éclat bien qu'elle leur donnât cent coups de brosse, ni plus ni moins, tous les soirs de sa vie et qu'elle frottât fidèlement les racines avec l'huile pour cheveux de Redfern, plus sans éclat que jamais dans leur rudesse matinale ; des sourcils noirs, fins et droits ; un nez qu'elle avait toujours trouvé beaucoup trop petit, même pour son petit visage blanc à trois coins ; une petite bouche pâle qui s'entrouvrait toujours sur de petites dents blanches et pointues ; une silhouette mince et aux seins plats, plutôt au-dessous de la taille moyenne. Elle avait échappé, on ne sait comment, aux pommettes hautes de la famille, et ses yeux marron foncé, trop doux et ombragés pour être noirs, avaient une inclinaison presque orientale. Mis à part ses yeux, elle n'était ni jolie ni laide, juste insignifiante, conclut-elle amèrement. Comme les lignes autour de ses yeux et de sa bouche étaient évidentes dans cette lumière impitoyable ! Et jamais son visage étroit et blanc n'avait paru aussi étroit et aussi blanc.
Elle se coiffait en pompadour. Les pompadours sont depuis longtemps passés de mode, mais ils étaient en vogue lorsque Valancy a commencé à se coiffer et tante Wellington avait décidé qu'elle devait toujours porter ses cheveux de cette façon.
« C'est la seule façon de vous ressembler. Votre visage est si petit que vous devez lui donner de la hauteur par un effet pompadour », disait Tante Wellington, qui énonçait toujours des lieux communs comme s'il s'agissait de vérités profondes et importantes.
Valancy avait rêvé de se coiffer en tirant ses cheveux vers le bas sur son front, avec des bouffants au-dessus des oreilles, comme Olive le faisait avec les siens. Mais le dicton de Tante Wellington eut un tel effet sur elle qu'elle n'osa plus jamais changer de style de coiffure. Mais il y a tant de choses que Valancy n'a jamais osé faire.
Toute sa vie, elle a eu peur de quelque chose, pensa-t-elle amèrement. Depuis l'aube de ses souvenirs, lorsqu'elle avait eu si terriblement peur du gros ours noir qui vivait, d'après ce que lui avait dit la cousine Stickles, dans le placard sous l'escalier.
« Et je le serai toujours, je le sais, je n'y peux rien. Je ne sais pas ce que ce serait de ne pas avoir peur de quelque chose. »
Peur des crises de bouderie de sa mère, peur d'offenser l'Oncle Benjamin, peur de devenir la cible du mépris de la Tante Wellington, peur des commentaires mordants de la Tante Isabel, peur de la désapprobation de l'Oncle James, peur de heurter les opinions et les préjugés de tout le clan, peur de ne pas sauver les apparences, peur de dire ce qu'elle pense vraiment de tout, peur de la pauvreté dans sa vieillesse. La peur, la peur, la peur, elle ne pouvait jamais y échapper. Elle la liait et l'enlaçait comme une toile d'araignée d'acier. Ce n'est que dans son Château Bleu qu'elle pouvait trouver un répit temporaire. Et ce matin, Valancy n'arrivait pas à croire qu'elle avait un Château Bleu. Elle ne pourrait plus jamais le retrouver. Vingt-neuf ans, célibataire, sans désir - qu'avait-elle à voir avec la châtelaine féerique du Château Bleu ? Elle allait rayer à jamais de sa vie ce genre d'enfantillage et affronter la réalité sans broncher.
Elle se détourna de son miroir hostile et regarda dehors. La laideur de la vue la frappait toujours comme un coup de massue : la clôture en lambeaux, le vieux magasin de carrosserie délabré dans le lot voisin, recouvert de publicités grossières aux couleurs violentes ; la gare sinistre au-delà, avec les horribles épaves qui traînaient toujours autour d'elle, même à cette heure matinale. Sous la pluie battante, tout avait l'air pire que d'habitude, surtout l'horrible publicité « Gardez votre teint d'écolière. » Valancy avait gardé son teint d'écolière. C'était justement le problème. Il n'y avait aucune lueur de beauté nulle part – « exactement comme dans ma vie, » pensait Valancy avec tristesse. Sa brève amertume était passée. Elle acceptait les faits avec autant de résignation qu'elle les avait toujours acceptés. Elle faisait partie des gens que la vie laisse toujours passer. Il n'y avait rien à changer à ce fait.
C'est dans cet état d'esprit que Valancy descendit prendre son petit-déjeuner.
CHAPITRE III
Mon "buggy à essence" était le premier et pendant longtemps la seule
Le petit-déjeuner était toujours le même. La bouillie d'avoine, que Valancy détestait, les toasts et le thé, et une cuillère à café de marmelade. Mme Frederick trouvait deux cuillères à café extravagantes, mais cela n'avait pas d'importance pour Valancy, qui détestait aussi la marmelade. La petite salle à manger froide et lugubre était plus froide et plus lugubre que d'habitude ; la pluie ruisselait par la fenêtre ; des Stirlings disparus, dans d'atroces cadres dorés, plus larges que les tableaux, brillaient sur les murs. Et pourtant, la Cousine Stickles a souhaité à Valancy de nombreux et heureux retours de la journée !
Tout ce que sa mère a dit, c'est : « Tiens-toi droit, Doss. »
Valancy s'est redressée. Elle parlait à sa mère et à la cousine Stickles des choses dont elles parlaient toujours. Elle ne s'est jamais demandé ce qui se passerait si elle essayait de parler d'autre chose. Elle le savait. C'est pourquoi elle ne l'a jamais fait.
Mme Frederick était vexée que la Providence lui envoie un jour de pluie alors qu'elle voulait aller à un pique-nique, elle prit donc son petit déjeuner dans un silence boudeur dont Valancy lui était plutôt reconnaissante. Mais Christine Stickles ne cessait de se plaindre, comme d'habitude, de tout - du temps, de la fuite dans le garde-manger, du prix des flocons d'avoine et du beurre - Valancy sentit tout de suite qu'elle avait beurré sa tartine trop abondamment - de l'épidémie d'oreillons à Deerwood.
« Doss ne manquera pas de les attraper, » prédit-elle.
« Doss ne doit pas aller là où elle risque d'attraper les oreillons, » dit Mme Frederick.
Valancy n'avait jamais eu les oreillons, ni la coqueluche, ni la varicelle, ni la rougeole, rien de ce qu'elle aurait dû avoir, rien que d'horribles rhumes chaque hiver. Les rhumes de Doss étaient une sorte de tradition dans la famille. Rien, semblait-il, ne pouvait l'empêcher de les attraper. Mme Frederick et la cousine Stickles faisaient de leur mieux. Un hiver, elles ont gardé Valancy enfermée de novembre à mai, dans la salle de séjour bien chaude. Elle n'avait même pas le droit d'aller à l'église. Valancy a attrapé rhume sur rhume et s'est retrouvée avec une bronchite en juin.
« Aucun membre de ma famille n'a été comme ça, » a déclaré Mme Frederick, laissant entendre qu'il s'agissait d'une tendance propre aux Stirling.
« Les Stirling prennent rarement froid, » dit la cousine Stickles avec ressentiment. Elle avait été une Stirling.
« Je pense, » dit Mme Frederick, « que si une personne décide de ne pas avoir de rhume, elle n'en aura pas ! »
C'était donc ça le problème. Tout était de la faute de Valancy.
Mais ce matin-là, l'insupportable grief de Valancy était qu'on l'appelait Doss. Elle l'avait supporté pendant vingt-neuf ans et, d'un seul coup, elle sentit qu'elle ne pouvait plus le supporter. Son nom complet était Valancy Jane. Valancy Jane était plutôt terrible, mais elle aimait bien Valancy, avec son côté étrange et exotique. Valancy s'était toujours étonnée que les Stirling aient permis qu'elle soit baptisée ainsi. On lui avait dit que son grand-père maternel, le vieil Amos Wansbarra, avait choisi ce nom pour elle. Son père avait ajouté le nom Jane pour le rendre plus civilisé, et l'ensemble de la famille avait résolu la difficulté en la surnommant Doss. Elle n'a jamais reçu le nom de Valancy que de la part d'étrangers.
« Mère, » dit-elle timidement, « pourriez-vous m'appeler Valancy après cela ? Doss a l'air si... si... je n'aime pas ça. »
Mme Frederick regarde sa fille avec étonnement. Elle portait des lunettes dont les verres très résistants donnaient à ses yeux un aspect particulièrement désagréable.
« Quel est le problème avec Doss ? »
« Cela semble tellement puéril, » a hésité Valancy.
« Oh ! » Mme Frederick avait été une Wansbarra et le sourire des Wansbarra n'était pas un atout. « Je vois. Eh bien, cela devrait vous convenir alors. Vous êtes assez enfantine en toute conscience, ma chère enfant. »
« J'ai vingt-neuf ans, » dit désespérément la chère enfant.
« Je ne le proclamerais pas sur tous les toits si j'étais vous, ma chère, » dit Mme Frederick. « Vingt-neuf ans ! J'étais mariée depuis neuf ans quand j'avais vingt-neuf ans. »
« J'ai été mariée à dix-sept ans, » dit fièrement Cousine Stickles.
Valancy les regarda furtivement. Mme Frederick, à l'exception de ces terribles lunettes et de son nez crochu qui la faisait ressembler davantage à un perroquet qu'à un perroquet lui-même, n'était pas mal en point. À vingt ans, elle aurait pu être assez jolie. Mais la cousine Stickles ! Et pourtant, Christine Stickles avait déjà été désirable aux yeux d'un homme. Valancy avait l'impression que Cousine Stickles, avec son visage large, plat et ridé, son grain de beauté au bout de son nez déformé, ses poils hérissés sur le menton, son cou jaune et ridé, ses yeux pâles et saillants, sa bouche mince et froncée, avait encore cet avantage sur elle - ce droit de la regarder de haut. Et pourtant, la cousine Stickles était nécessaire à Mme Frederick. Valancy se demandait pitoyablement ce que c'était que d'être désirée par quelqu'un, d'être nécessaire à quelqu'un. Personne au monde n'avait besoin d'elle, et rien ne manquerait à la vie si elle en sortait brusquement. Elle était une déception pour sa mère. Personne ne l'aimait. Elle n'a jamais eu la moindre amie.
« Je n'ai même pas le don de l'amitié, » s'était-elle un jour avoué piteusement.
« Doss, tu n'as pas mangé tes croûtes, » dit Mme Frederick d'un ton de reproche.
Il a plu toute la matinée sans discontinuer. Valancy a assemblé un édredon. Valancy détestait découper des édredons. Et ce n'était pas nécessaire. La maison était pleine de courtepointes. Il y avait trois grands coffres remplis d’édredons dans le grenier. Mme Frederick avait commencé à ranger des courtepointes lorsque Valancy avait dix-sept ans et elle continuait à les ranger, même s'il semblait peu probable que Valancy en ait un jour besoin. Mais Valancy devait travailler et le matériel de couture était trop cher. L'oisiveté était un péché capital chez les Stirling. Lorsque Valancy était enfant, on l'obligeait à écrire chaque soir, dans un petit carnet noir et détesté, toutes les minutes qu'elle avait consacrées à l'oisiveté au cours de la journée. Le dimanche, sa mère l'obligeait à les totaliser et à prier dessus.
En cette matinée particulière de ce jour du destin, Valancy n'a passé que dix minutes dans l'oisiveté. Du moins, Mme Frederick et Cousin Stickles auraient appelé cela de l'oisiveté. Elle est allée dans sa chambre pour se procurer un meilleur dé à coudre et elle a ouvert La Récolte du Chardon au hasard, avec un sentiment de culpabilité.
« Les bois sont si humains, » a écrit John Foster, « que pour les connaître, il faut vivre avec eux. Une promenade occasionnelle à travers les bois, en s'en tenant aux sentiers battus, ne nous permettra jamais d'entrer dans leur intimité. Si nous voulons être amis, nous devons les rechercher et les gagner par des visites fréquentes et respectueuses à toute heure, le matin, à midi et le soir, et en toute saison, au printemps, en été, en automne et en hiver. Sinon, nous ne les connaîtrons jamais vraiment et toutes nos prétentions ne s'imposeront jamais à eux. Ils ont leur propre façon de tenir les étrangers à distance et de fermer leur cœur aux simples visiteurs occasionnels. Il ne sert à rien de chercher les bois pour un motif autre que l'amour pur et simple ; ils nous démasqueront immédiatement et nous cacheront tous leurs doux secrets de l'Ancien Monde. Mais s'ils savent que nous venons à eux parce que nous les aimons, ils seront très gentils avec nous et nous donneront des trésors de beauté et de plaisir qui ne s'achètent ni ne se vendent sur aucune place de marché. Car les bois, lorsqu'ils donnent, le font sans réserve et ne cachent rien à leurs vrais adorateurs. Nous devons aller à leur rencontre avec amour, humilité, patience, vigilance, et nous apprendrons quelle beauté poignante se cache dans les endroits sauvages et les intervalles silencieux, à la lueur des étoiles et au coucher du soleil, quelles cadences de musique étrange sont harponnées sur les vieilles branches de pin ou chantonnées dans les bosquets de sapins, quelles saveurs délicates s'exhalent des mousses et des fougères dans les coins ensoleillés ou sur les ruisseaux humides, quels rêves, mythes et légendes d'un temps plus ancien les hantent. Alors le cœur immortel des bois battra contre le nôtre et sa vie subtile s'insinuera dans nos veines pour nous faire sien à jamais, de sorte que, où que nous allions ou que nous errions, nous serons toujours attirés par la forêt pour y trouver notre parenté la plus durable. »
« Doss, » appelle sa mère depuis le hall d'entrée, « que fais-tu toute seule dans cette chambre ? »
Valancy laissa tomber La Récolte du Chardon comme un charbon ardent et s'enfuit en bas vers ses parcelles ; mais elle ressentit l'étrange exaltation de l'esprit qui lui venait toujours momentanément lorsqu'elle se plongeait dans l'un des livres de John Foster. Valancy ne connaissait pas grand-chose aux bois - à l'exception des bosquets hantés de chênes et de pins autour de son Château Bleu. Mais elle avait toujours secrètement rêvé de les connaître et un livre de Foster sur les bois était la meilleure chose à faire après les bois eux-mêmes.
À midi, la pluie s'est arrêtée, mais le soleil n'est apparu qu'à trois heures. Valancy dit alors timidement qu'elle pense aller en ville.
« Pourquoi veux-tu aller en ville ? » demanda sa mère.
« Je veux prendre un livre à la bibliothèque. »
« Tu as acheté un livre à la bibliothèque la semaine dernière. »
« Non, c'était quatre semaines. »
« Quatre semaines. C'est absurde ! »
« C'est vrai, Mère. »
« Vous vous trompez. Il est impossible que cela ait duré plus de deux semaines. Je n'aime pas les contradictions. Et je ne vois pas pourquoi vous voulez acheter un livre, de toute façon. Vous perdez trop de temps à lire. »
« Quelle est la valeur de mon temps ? » demanda Valancy avec amertume.
« Doss ! Ne me parle pas sur ce ton. »
« Nous avons besoin de thé, » dit la cousine Stickles. « Elle pourrait aller le chercher si elle veut se promener - bien que ce temps humide soit mauvais pour les rhumes. »
Ils discutèrent encore dix minutes et finalement Mme Frederick accepta à contrecœur que Valancy y aille.
CHAPITRE IV
La cousine Stickles a appelé Valancy en sortant de la maison : « Tu as mis tes bottes en caoutchouc ? »
Christine Stickles n'avait jamais oublié de poser cette question lorsque Valancy sortait par temps humide.
« Oui. »
« Avez-vous mis votre jupon de flanelle ? » demande Mme Frederick.
« Non. »
« Doss, je ne te comprends vraiment pas. Tu veux encore mourir de froid ? » Sa voix laissait entendre que Valancy était déjà morte de froid plusieurs fois. « Monte tout de suite et mets-le ! »
« Mère, je n'ai pas besoin d'un jupon en flanelle. Mon jupon de satin est suffisamment chaud. »
« Doss, souviens-toi que tu as eu une bronchite il y a deux ans. Va et fais ce qu'on te dit ! »
Valancy est partie, mais personne ne saura jamais à quel point elle a failli jeter l’hévéa dans la rue avant de partir. Elle détestait ce jupon de flanelle grise plus que tout autre vêtement qu'elle possédait. Olive n'a jamais eu à porter de jupon de flanelle. Olive portait de la soie à volants, du linon transparent et des volants à lacets en pellicule. Mais le père d'Olive avait « de l'argent de mariage » et Olive n'a jamais eu de bronchite. Et voilà.
« Vous êtes sûre de ne pas avoir laissé le savon dans l'eau ? » demanda Mme Frederick. Mais Valancy était partie. Elle tourna au coin de la rue et regarda en arrière dans la rue laide, primitive et respectable où elle vivait. La maison des Stirling était la plus laide de cette rue - elle ressemblait plus à une boîte en briques rouges qu'à toute autre chose. Trop haute pour sa largeur, elle était encore plus haute à cause d'une coupole de verre bulbeuse. Autour d'elle régnait la paix désolée et stérile d'une vieille maison dont la vie a été vécue.
Au coin de la rue, il y avait une très jolie petite maison, avec des fenêtres à battants en plomb et des pignons à double pente - une maison neuve, une de ces maisons que l'on aime dès qu'on les voit. Clayton Markley l'avait construite pour sa fiancée. Il devait épouser Jennie Lloyd en juin. La petite maison, disait-on, était meublée du grenier à la cave, prête à accueillir sa maîtresse.