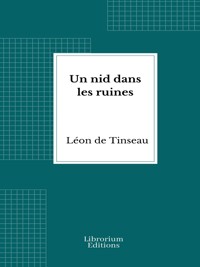0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Il y a quelques années, des troubles sérieux ayant éclaté en Crête, un navire de guerre français reçut l’ordre d’observer, à distance courtoise, les complications qui pourraient surgir et de protéger, au besoin, la sûreté de la population chrétienne.
Le Prométhée, alors hivernant sur nos côtes en rade de Villefranche, fut désigné pour cette mission. Il devait gagner au plus tôt le mouillage de Rhodes, choisi à cause de son voisinage du point menacé. Peu d’heures après la réception du télégramme ministériel, le commandant Guérin mettait le cap sur Toulon pour porter ses approvisionnements au complet. Deux jours plus tard, le cuirassé filait vers l’Orient.
Dire que tout le monde à bord, du commandant au dernier chauffeur, bénissait les Crétois, ce serait une exagération invraisemblable. La perspective de ces longues semaines à passer sous les vieux murs des Chevaliers de l’Hôpital n’avait rien de récréatif. Au carré, c’étaient de véritables gémissements.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
LE CHEMIN DE DAMAS
LÉON DE TINSEAU
1894
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385740023
I
Il y a quelques années, des troubles sérieux ayant éclaté en Crête, un navire de guerre français reçut l’ordre d’observer, à distance courtoise, les complications qui pourraient surgir et de protéger, au besoin, la sûreté de la population chrétienne.
Le Prométhée, alors hivernant sur nos côtes en rade de Villefranche, fut désigné pour cette mission. Il devait gagner au plus tôt le mouillage de Rhodes, choisi à cause de son voisinage du point menacé. Peu d’heures après la réception du télégramme ministériel, le commandant Guérin mettait le cap sur Toulon pour porter ses approvisionnements au complet. Deux jours plus tard, le cuirassé filait vers l’Orient.
Dire que tout le monde à bord, du commandant au dernier chauffeur, bénissait les Crétois, ce serait une exagération invraisemblable. La perspective de ces longues semaines à passer sous les vieux murs des Chevaliers de l’Hôpital n’avait rien de récréatif. Au carré, c’étaient de véritables gémissements.
— Voilà bien ma chance ! disait un enseigne de première classe, tout en appuyant ses épaules à la cloison et en s’arc-boutant des genoux contre la table, pour parer le tangage. Là-bas, nos camarades se chauffent au soleil, ou bien ils font valser les Américaines.
— Vous vous plaigniez l’autre jour que le bateau servait de but de promenade à tous les rastaquouères de Nice ! dit un aspirant.
— Messieurs, proposa un autre, si quelqu’un d’entre nous a jamais vu Neuvillars content de son sort, qu’il lève la main !
Toutes les mains restèrent au fond des poches qui les abritaient ; Paul regagna sa chambre en haussant les épaules. Rien qu’à voir le sourire de ses camarades, il était manifeste que ce jeune officier n’était pas l’ami de tout le monde.
— C’est une fameuse bêtise pour un homme que de se faire marin sans avoir le goût de la mer, dit un observateur qui n’avait pas encore parlé. Non seulement Neuvillars n’aime pas son métier, mais il le déteste.
— Ça c’est vrai ! dirent les jeunes gens tout d’une voix.
Puis on parla du métier en général, et il faut bien avouer que ceux-là mêmes qui l’aimaient en parlèrent comme un mari bien élevé parle de sa femme : sans outrer l’éloge.
Il est impossible de nier que le jeune enseigne du Prométhée se montrait rarement satisfait des personnes et des choses, de son métier moins que du reste. Mais il ne faut pas s’y tromper : depuis que le nouveau système naval a fait de chaque navire une galerie de machines, et de chaque officier un ingénieur, on a vu paraître chez les jeunes marins ce qu’on pourrait appeler une esthétique nouvelle.
Ce mot ne s’applique pas, bien entendu, au patriotisme et au courage, mais au caractère, à l’humeur, à l’esprit. Tous ne se piquent plus de réaliser l’ancien type légendaire, gai toujours, fou quelquefois, amoureux à chaque occasion, croyant à ses heures et prenant le temps comme il vient. Certains, qu’on pourrait surnommer les pessimistes de la carrière, affectent des façons directement opposées.
Graves et renfermés en eux-mêmes, la tête bourrée de formules, tout à la fois mécaniciens, électriciens, artilleurs, chimistes, forgerons, voyant les objets sous leur côté pratique, ils n’estiment pas que la pluie, le vent, la chaleur soient plus doux à l’épiderme d’un marin qu’à celui d’un homme ordinaire.
Habitués, en même temps, à ne voir dans les forces de la nature qu’un pouvoir inutile quand il n’est pas contraire, ces serviteurs du progrès font bon marché de la poésie et de l’idéalisme.
Quant à l’amour, ils ne l’estiment pas plus et le connaissent moins encore que ne font leurs contemporains de la terre ferme. C’est assez pour eux de savoir que le marin fait prime sur le marché conjugal, bien qu’il tourne aisément à l’époux tatillon, autoritaire, surveillant la cuisine, choisissant les toilettes et gouvernant les nourrices. (Mais les embarquements apportent de salutaires interruptions à ce despotisme.) Un bon mariage, après les galons de lieutenant de vaisseau, fait partie de leur programme. Que peut-on demander de plus au sexe féminin sauf des blanchisseuses — noires ou blanches — en attendant le mariage ?
Enfin, que gagne-t-on à visiter toutes les côtes du monde, sinon la fièvre ? L’avancement ? Il est pour les habiles qui se font de belles relations au Parlement. La fortune ? On la trouve partout, excepté sur un navire de guerre. Le bonheur ? Qui donc y croit encore dans leur génération ?
Il faut ajouter qu’une chose avait manqué à Neuvillars, sans laquelle tout se dessèche en nous et autour de nous, comme dans un désert privé de fontaines. Au collège, dont la mort de ses parents lui avait ouvert trop tôt les portes, il avait rencontré tout ce qui peut adoucir l’épreuve : le bien-être matériel dans un établissement du nouveau système, une santé victorieuse du travail et de la croissance, des succès dignes d’envie, tout… excepté la tendresse maternelle, ce grand noviciat de tous les amours à venir, l’amour de Dieu, l’amour de la Patrie, l’amour de la Femme. Combien il faut les plaindre, ceux dont l’enfance n’a pas connu la féconde chaleur de certains baisers, et qui parviennent quelquefois jusqu’à l’âge des premières neiges sans avoir senti le généreux tressaillement d’une de ces caresses qui anoblissent pour toujours, comme faisait jadis la parole tombée de la bouche d’un roi !
Le tuteur de Paul de Neuvillars, le plus honnête et le plus occupé des hommes d’affaires, était parvenu à compléter l’éducation du jeune orphelin, malgré l’absence de toute fortune. Pas une fois il n’avait manqué de le faire inscrire pour le voyage de vacances, préparé et dirigé par les soins de l’établissement. A la fin de son année de rhétorique, Paul connaissait une bonne partie de l’Europe ; mais il ignorait jusqu’au son d’une parole tendre. Il avait alors quinze ans.
Comme il fallait remplacer le toit du collège par un autre, le savant précoce fit choix, parmi toutes les écoles, de celle qui ouvre ses portes aux plus jeunes concurrents. Vers la fin de sa dix-septième année, il entrait au Borda, sans bien savoir pourquoi, car il eût éclaté de rire si quelqu’un lui eût parlé de sa vocation maritime.
Bientôt l’autre hémisphère du globe eut sa visite, et tout porte à croire que ce jeune homme véritablement beau, quoiqu’un peu court de taille, entendit force paroles d’amour en toutes les langues — sauf dans la vraie.
Mais il fut assez heureux (d’aucuns diront : assez à plaindre) pour ne pas s’y tromper. Il honorait toutes ces tendresses d’un mépris égal, sans y voir d’autres différences que la couleur des épidermes.
Puis, revenu au port, il retrouva les séductions nationales, sans éprouver de modification sérieuse dans son opinion sur le sexe. Seulement il reprochait à l’amour des blanches tout un côté de complication, de formalisme et de comédie inconnu dans ce qu’il appelait « le rayon de couleur ».
— Et puis, disait-il, quelle différence dans le prix des articles.
Tel était Paul de Neuvillars lorsqu’il fut désigné pour faire station à Rhodes, c’est-à-dire à vingt-six ans. Ce malheureux n’avait jamais entendu les mots : Je vous aime, dans la bouche d’une femme qu’il aurait osé saluer dans la rue, s’il l’avait rencontrée une heure après.
Enfermé dans le cercle vicieux fatal aux jeunes hommes sans famille et sans fortune, il ignorait les vraies femmes parce qu’il n’allait pas dans le monde, et il n’allait pas dans le monde parce que rien ne l’y attirait.
Cela n’empêche qu’il croyait connaître les femmes jusqu’au tréfonds de leur nature, jusqu’à la mieux cachée de leurs fibres. Peu à peu, à force de les mépriser, il en était venu à les haïr sourdement, ce qui est un « état d’âme » assez fréquent chez les hommes de la fin du siècle. D’ailleurs les femmes nous le rendent bien ; mais, dans cette guerre sans victoires, l’avantage apparent n’est pas pour elles, car le roman et le théâtre, ces mâchicoulis d’où l’on verse la poix fondue et l’huile bouillante, sont aux mains de leurs ennemis et Dieu sait si elles sont épargnées ?
Pauvres femmes ! Elles n’avaient pas beau jeu devant Paul. Si la séduction leur manquait, il les biffait purement et simplement par un seul mot, de la liste des créatures dignes d’être tolérées en ce bas monde. Si elles étaient belles, ce jeune tyran leur faisait secrètement un crime de ne pas tomber dans ses bras à première vue. Que si quelque héroïne à la vertu chancelante lui faisait cet honneur, il en tirait occasion pour qualifier le sexe en bloc d’une épithète moins que galante. Il disait volontiers :
— Les balances de la justice, le glaive de la loi, les lauriers du mérite, la vertu des femmes… autant de fausses antiquités du même musée !
De ce musée-là, comme on peut croire, ce n’est pas lui qu’il aurait fallu nommer conservateur.
II
Il y eut une grande joie parmi les Rhodiotes quand ils entendirent le salut des canons du Prométhée. Le cuirassé mouillait en rade, sous la tour ronde, massive, encore menaçante, du fort Saint-Elme, couronnée de ses glorieux créneaux, surmontée comme d’une aigrette menue par la tourelle blanche de son phare.
Pour bien comprendre l’importance relative de l’événement, il faudrait pouvoir se figurer l’existence ordinaire de cette petite cité, jadis si fameuse, dont la population chrétienne se réduit à quelques milliers d’habitants riches ou pauvres, cantonnés dans les faubourgs.
Nulle comparaison ne saurait peindre cette existence au lecteur français, qui pâlit d’épouvante au nom seul de certains chefs-lieux réputés pour leur tristesse, parce qu’on n’y trouve pas de théâtre, ou pour leur éloignement, parce que les journaux parisiens n’y sont distribués qu’après vingt heures de route.
Avez-vous habité, seulement pour quelques jours, une des îles disséminées le long de nos côtes, si près du continent que, du haut de ses falaises, votre œil pouvait distinguer parfois la maison d’un ami sur la terre ferme ?
Quelques milles tout au plus vous séparaient du sol vivant, vibrant, animé par les pulsations régulières de l’existence. Même par un beau soleil, ce coin de terre avait la mélancolie de l’exil, la solitude glacée de la prison. Mais si la brume étendait son voile entre vous et « la terre », si les vagues empêchaient le canot de la poste de franchir l’étroit canal, vous éprouviez la sensation du marin perdu au milieu des flots sur son navire, condamné à se suffire à lui-même, privé de toute joie.
O mortel ingrat, ignorant votre bonheur !
Que diriez-vous si l’arrêt du sort vous ordonnait d’habiter Rhodes ? Cachée à l’écart, ainsi qu’une princesse survivant à sa dynastie détrônée, l’île glorieuse pleure son esclavage et son délaissement dans une région trop peu connue, hors de cette grande route de l’Orient que sillonnent chaque jour tous les marins du monde. Le paquebot français qui la visitait naguère dédaigne aujourd’hui de s’y arrêter, dernière et fâcheuse marque d’oubli envers la plus noble filleule du royaume des lis. Une fois toutes les deux semaines, le vapeur autrichien y dépose de rares voyageurs et un sac de lettres.
Voilà tout ce qui rattache au reste du monde celle de qui le nom fut autrefois la terreur de l’Islam. De pauvres navires turcs, grecs, italiens, vulgaires et sombres commerçants, débarquent à peine sur le môle de son port leurs équipages déguenillés, et, la cargaison chargée en toute hâte, reprennent leur route vers les grandes cités où règnent l’activité et l’opulence.
Pour ses nouveaux maîtres eux-mêmes, Rhodes n’est qu’un objet d’indifférence ou de mépris, avec cette crainte qui s’attache aux murailles d’une prison. Le pacha qui voit sa faveur diminuer tremble dans son yali du Bosphore, en songeant que bientôt, peut-être, il connaîtra cette suprême disgrâce : l’exil à Rhodes. La terre ferme, il est vrai, n’est qu’à huit lieues. Des hauteurs de l’île on aperçoit aisément les montagnes de l’Asie Mineure teintées de bleu foncé ou d’azur pâle, selon les heures de la journée. Mais ce rivage sans villes, sans séductions, sans promesses, n’a rien qui attire et qui console. Le plus grand nombre des Rhodiotes meurt sans l’avoir touché, sans avoir souhaité de le voir de plus près.
Ils ne souhaitent rien, d’ailleurs, ces heureux et ces sages, rien que de finir leurs jours dans ce paradis terrestre où le ciel a caché leur berceau, parmi les buissons de roses qui parfument jusqu’au nom de leur île bien-aimée.
Que de fois, causant avec les belles jeunes filles, roses vivantes qui fleurissent dans leur grâce capiteuse à l’ombre des platanes séculaires ou des donjons en ruine, que de fois j’essayai vainement d’éveiller dans leur cœur le désir des triomphes qui attendraient leur beauté, au milieu de nos plaisirs et de nos fêtes !…
Telle était Ariane Marcopoli, la plus admirée, la plus aimée aussi des jeunes Rhodiotes, à l’époque où commence cette histoire. Mais comment faire comprendre à des lecteurs habitués à nos héroïnes, — si compliquées, mais d’une complication si uniforme, — comment leur faire comprendre la séduisante originalité de cette étrange créature ? Comment leur expliquer cette Ève orientale, non pas tirée de la côte d’un seul homme, mais lentement composée, ainsi qu’une précieuse mosaïque, des instincts, des passions, des défauts, des grandeurs de tant de races qui se sont heurtées, égorgées, étreintes, sur cette terre de bataille et d’amour ?
Le nom de famille d’Ariane, étiquette ambiguë, grecque autant qu’italienne, fait deviner une partie seulement des alliances qui se sont croisées dans cette maison. Les Marcopoli de Rhodes, sujets du Sultan, revendiquaient la glorieuse estampille hellénique, tout en se montrant fiers de compter une branche parmi cette haute bourgeoisie vénitienne, dont l’antiquité vaut une noblesse. La mère d’Ariane, morte depuis dix ans, était Anglaise ; mais une aïeule, disparue plus récemment, lui avait infusé le sang généreux d’une vieille race française. Le père Marcopoli autrefois négociant, aujourd’hui riche propriétaire — dix mille livres de rente sont une fortune à Rhodes disait en parlant de sa fille qu’il adorait comme un être surnaturel :
— Son mari sera un habile homme s’il parvient à s’y reconnaître. Elle est Orientale par la loi et le tempérament, Grecque par la naissance, Italienne par les mouvements passionnés de son âme, Anglaise par l’éducation, Française par le cœur et les idées.
Il n’avait pas besoin d’ajouter qu’elle était la meilleure et la plus droite des créatures, car c’était une vérité connue dans l’île toute entière. À cette vérité s’en joignait une autre encore plus évidente : Ariane était d’une rare beauté. Mais la jeune descendante de Phidias et d’Apelles avait dans l’imagination le type idéal et n’était pas satisfaite d’elle-même, en quoi elle avait été aidée par sa grand’mère qui lui répétait dès la quinzième année :
— Mon enfant, on vous dira probablement que vous êtes belle, parce que vous êtes unique héritière. N’en croyez pas un mot. Vous êtes passable, rien de plus.
Ariane devait son éducation très forte et très large à cette vieille femme, austère pour son propre compte, charmante pour les autres.
Ceux qui prétendent — non sans quelque apparence de vérité — que le bonheur n’est pas de ce monde, auraient changé d’avis s’ils avaient pu voir ce qu’était l’existence de cette jeune fille entre son père et son aïeule.
Aussi elle n’eut même pas un regard pour les prétendants qui tournaient déjà leurs yeux vers cette fleur à peine éclose. A toutes les demandes, elle répondait invariablement :
— Qu’il me prouve qu’un bonheur humain peut dépasser pour moi le bonheur présent, et je serai sa femme.
C’était un discours bien long pour dire : Je n’aime personne ! Et pourtant elle inspirait de ces amours qui ne se guérissent pas. Un jeune homme, en ce temps-là, succombait lentement à un mal de langueur dont les médecins ne pouvaient découvrir la cause. Il savait bien, lui, que c’étaient les yeux vert pâle d’Ariane Marcopoli qui le faisaient mourir.
Poète et musicien, portant le sceau divin de la mort et de la passion sur son visage éclairé de deux grands yeux noirs où brûlait la fièvre, il avait troublé, sans le vouloir, plus d’une riche héritière de l’aristocratique faubourg Néohori.
Hélas ! Ariane s’endormait, indifférente, au bruit de la guitare et de la voix qui chantait cette mélodie, si souvent répétée depuis par les amoureux Rhodiotes :
Comme j’ai souvent parlé de toi
Aux vagues couronnées d’écume,
Qui viennent se briser
Sur mon rivage désert !…
Au matin, l’ingrate avait oublié les vers et la musique, et toujours sa jolie bouche disait non, si le jeune troubadour voulait obtenir mieux qu’une fleur jetée de la terrasse à demi voilée par les roses. Quand il est allé dormir pour toujours à l’ombre des grands cyprès, il a voulu garder sur sa poitrine le dernier présent tombé des doigts de celle qui n’avait pu l’aimer. A cette époque, elle ne connaissait l’amour que comme elle connaissait le malheur : pour l’avoir vu chez les autres.
De ces deux inconnus le premier qui la visita ne fut pas celui que son cœur attendait, le plus grand des malheurs qui pouvaient la frapper fondit sur elle. Sa grand’mère mourut, et la moitié de la population chrétienne de l’île se pressa aux obsèques de cette femme de bien, qui laissait derrière elle comme un long sillon de bonnes œuvres. Un seul mot peut exprimer ce que souffrit Ariane : elle fut tout près de mourir elle-même. Du moins, si elle ne mourut pas, chacun put voir qu’elle ne retrouverait de longtemps ni la force de sa santé, ni certains rayons éblouissants de son victorieux sourire.
Cependant la vie recommença pour elle, du moins dans sa forme extérieure, la vie étroite, monotone, mais très enviable, de ces insulaires qui ne cherchent jamais à dépasser le cercle de leur horizon bleu. Ses amies la virent reparaître dans ces réunions d’excellente intimité où la danse, la musique, des jeux de société séculaires, un bavardage d’oiseaux, quelques tasses de café turc, une becquée de confitures de roses, le tout assaisonné d’amours plus ou moins sérieux, tient la place de cette mise en scène compliquée et fatigante dont s’enorgueillissent nos fêtes civilisées.
Après les fêtes de Pâques ou de la Pentecôte, suivant le calendrier, Ariane et son père quittaient leur maison de ville pour la campagne de Trianda, située à une heure de distance, au fond d’une baie délicieuse. Cette résidence d’été, vaste et commode plutôt qu’élégante, ressemblait dès lors à un caravansérail toujours peuplé d’amis et de parents, jeunes ou vieux. Là, tout servait de prétexte à des réunions continuelles, où l’on s’amusait comme on cherche vainement à s’amuser dans nos châteaux les plus à la mode. La cueillette des roses pour les confitures, la préparation des figues pour l’hiver, la récolte et le pressage des olives, la vendange, l’arrivée d’un cousin venant de Smyrne ou de l’Europe, la réception de quelque touriste recommandé, autant de motifs pour déployer cette belle hospitalité orientale qui ne s’épuise jamais, parce qu’elle donne seulement ce qu’elle peut donner, sans se préoccuper d’éblouir.
Telle est la vie que mènent à Rhodes ceux que l’on y considère comme les privilégiés et les opulents. Certes, il faut s’attendre à faire sourire en peignant cette claram Rhodon dédaignée par Horace, où l’on meurt encore d’un amour non partagé, où les jeunes gens vont chanter le soir sous les fenêtres des jeunes filles avec qui, deux heures plus tôt, ils ont joué au furet. Mais ces jeunes filles sont souvent d’une beauté remarquable, presque toujours d’un esprit agréablement malicieux, bonnes musiciennes, bien instruites, facilement amusables, pétries des jolis défauts qu’une fille d’Ève doit montrer sous peine de donner à croire qu’elle cache certains vices. Que celui qui n’a jamais bâillé dans le grand monde parisien rie de ce monde en miniature — où l’on ignore l’ennui !
III
Le Commandant et les Officiers du Prométhée prient M… de leur faire l’honneur de passer la soirée à bord, le 15 février 188…, au mouillage de Saint-Elme.
On dansera.
Une soixantaine de cartes ainsi libellées avaient profondément agité la haute société rhodiote. Enfin on allait avoir un vrai bal ! On allait valser aux accords d’un véritable orchestre, et non plus autour d’un piano fatigué.
Au lieu du salon modeste d’une kokona quelconque, l’élégance, pour se déployer, allait avoir le pont d’un immense navire. Les danseurs du lieu, excellents à coup sûr, mais toujours les mêmes, allaient trouver des rivaux.
Et quels rivaux ! Des marins français, les plus galants officiers du monde ! Parmi eux, quelques admirateurs sans doute, peut-être un bon mari… Les épouseurs sont comptés, pesés, connus à Rhodes, comme les poires sur l’étroit espalier d’un jardinet de banlieue.
Dès huit heures du soir, les premiers invités se présentèrent à l’échelle ornée de ses tire-veilles en velours et de son tapis de gala. Cette « bordée » impatiente n’offrait rien de remarquable. Il faut même avouer qu’elle jeta quelque découragement dans l’âme des jeunes officiers qui s’avançaient, à tour de rôle, vers la coupée, afin d’offrir le bras aux dames et de les conduire aux banquettes préparées pour elles. Un de ces travailleurs de la mer croisa Neuvillars qui revenait à vide, et lui dit tout bas :
— C’est un beau spectacle ! On croirait que nous faisons la chaîne des gargousses, pendant l’exercice du branle-bas de combat.
— Courage ! répondit l’enseigne. Il paraît que nous entretenons « le prestige des vieux souvenirs français ». Le commandant l’affirmait au rapport. Quant à moi, j’ai envie de proposer un changement de tour à l’heureux mortel qui vient de prendre le quart jusqu’à minuit. De la passerelle on ne peut voir le défilé de ces caricatures.
Mais bientôt les canots qui accostaient laissèrent distinguer une amélioration progressive dans « la qualité du fret ». Enfin, au coup de neuf heures, les vraies élégantes arrivèrent toutes à la fois, manœuvre habile, concertée d’avance, ayant pour but de rester en groupe, entre soi, et d’être placées au premier rang des danseuses.
— Ouf ! voici la dernière palanquée ! dit Neuvillars.
En même temps il se préparait à recevoir, pour « l’arrimer », une retardataire, sombre et peu intéressante dans sa toilette noire, qui gravissait l’échelle suivie d’un homme aux cheveux grisonnants. Il offrit son bras à la nouvelle venue, sans voir ses traits cachés sous une ample dentelle.
« L’air d’une vieille dévote allant faire ses oraisons », pensa-t-il.
Mais quand ils furent devant le commandant, pour le « salamalek » obligatoire, la dentelle fut rejetée en arrière d’un geste plein de grâce, et le vieux marin eut une expression de surprise et d’admiration non déguisée.
— Mademoiselle, dit-il en arrondissant le coude après un salut profond, j’use de mon droit de commandant pour vous enlever pendant une minute à M. de Neuvillars. Et j’use de mon droit de grand-père pour vous proclamer la plus belle de nos invitées.
À ces mots, Paul regarda « la vieille dévote », et, la suivant d’un long regard pendant qu’elle s’éloignait au bras du chef :
— Toujours ma chance ! fit-il à demi-voix, en haussant les épaules. J’étais tombé sur une jolie personne, et Guérin me la souffle !
N’ayant rien de mieux à faire, il voulut tout au moins se renseigner sur la nouvelle venue.
Précisément une chaise restait vide auprès d’une grosse dame empanachée, qui rougit de plaisir et de timidité en se voyant l’objet des attentions du bel enseigne. Au bout de quelques phrases, Paul avait mis l’entretien sur la jeune fille en noir que promenait le commandant. Or il se trouva que la grosse dame avait une fille mûrissante et peu demandée. On devine quels renseignements sortirent de sa bouche sur « la plus belle des invitées » : Neuvillars avait cité les paroles du commandant.
Ariane Marcopoli ! Une personne coquette, fantasque, originale, conduisant elle-même ses poneys, gâtée par son imbécile de père, très abandonnée à elle-même depuis la mort de sa grand’mère qui avait emporté dans la tombe tout le bon sens de la maison.
— Elle a laissé une petite fille terriblement jolie, répéta Neuvillars, avec une indifférence à tout le reste qui, dans la circonstance, avait quelque chose de cruel.
— Oh ! vous ne l’avez pas vue en plein jour. Mais, jolie ou non, elle sait tourner la tête aux hommes. L’un de ses amoureux est au cimetière depuis deux ans, et tout le monde suit de quoi il est mort.
— Empoisonné ? demanda Paul en baissant la voix avec un sérieux imperturbable.
— Non, répondit la charitable Rhodiote sans comprendre. Mais on a refusé ce pauvre sot après l’avoir affolé de toutes les manières. Sans doute, il nous faut un prince. Mais, monsieur, ne croyez pas que toutes nos jeunes filles ressemblent à cette demoiselle.
— Oh ! madame, je le vois bien ! fit Neuvillars en cédant sa place, après un regard significatif, à une danseuse fort essoufflée qui revenait sous l’aile maternelle.
Déjà il s’éloignait. On devine qu’il ne songeait plus qu’à retrouver Ariane, mais elle avait disparu. Vainement il la chercha, d’abord au milieu de la mêlée d’un quadrille, puis au buffet, prématurément assiégé. Enfin il l’aperçut, dissimulée, autant que le permettait le ruissellement de la lumière électrique, dans une sorte de niche toute brillante d’acier, dont la masse sombre de l’énorme canon d’arrière formait le toit. Elle était seule ; mais on voyait à son air que cette solitude lui pesait peu.
Adossée à l’affût plutôt qu’assise, ses mains fines, gantées de noir, croisées sur un genou, elle avançait la tête pour contempler le coup d’œil du bal, pose gracieuse qui dégageait son col onduleux des plis d’une robe de soie légère à peine ouverte.
Tandis qu’elle était ainsi absorbée, une voix dît, presque à son oreille :
— Si j’étais poète, quel beau sujet pour une ode : la Force et la Beauté ! Un canon Krupp de cent tonnes et… Ariane Marcopoli !
Elle tourna un peu la tête, aperçut Neuvillars et parut contrariée plus qu’intimidée, imperceptiblement dédaigneuse. Un mouvement nerveux souleva plusieurs fois ses sourcils bruns, dont la ligne exquise et singulière était moins pareille à la courbure d’un arc qu’à l’inflexion sobrement contournée d’une de ces palmes que l’on voit dans les tableaux, portés par les jeunes saintes.
Comme elle ne répondait pas, l’enseigne abandonna le sujet poétique et dit d’un air de protection tant soit peu familier :
— Vous vous ennuyez déjà ? Aussi pourquoi vous blottir dans cet affût qui vous cache à vos danseurs ?
Cette fois elle répondit, avec une simplicité quelque peu hautaine :
— Je ne m’ennuie jamais seule. Quant à mes danseurs, ils savent tous qu’ils ne doivent pas m’inviter ce soir.
— Faut-il comprendre que vous faites aux officiers du Prométhée la grâce de vous réserver pour eux ?
— Ce ne serait que juste. Mais je me réserve pour moi-même, ou plutôt pour mon deuil.
— Vous aimiez beaucoup votre grand’mère ? demanda Neuvillars, pour la surprendre en se montrant si bien informé.
Il croyait avoir affaire à nos professeurs d’analyse en jupons, qui s’occupent fort peu de savoir ce qu’on leur demande, beaucoup de pénétrer ce qu’a en vue l’interlocuteur, ce qu’il connaît, ce qu’il ignore, ce qu’il veut, d’où il vient, où il va. Mais, à Rhodes, on n’y met pas tant de profondeur et de malice. Les traits d’Ariane s’adoucirent extrêmement, lorsqu’elle entendit prononcer le nom de sa grand’mère.
— Il ne faut pas dire que je l’aimais ; je l’aime encore, répondit-elle ; je ne puis croire qu’elle m’a quittée depuis deux ans. Mon père m’a ordonné de sortir ce soir… Mais j’ai beaucoup plus envie de pleurer que de danser. J’étouffe sous une angoisse douloureuse, comme si je faisais quelque chose de mal. Connaissez-vous le mati ?
— Non, répondit Paul en ouvrant de grands yeux.
— C’est ce que vous nommez en France le mauvais œil. Il est sur ma personne ce soir, je le sens. Tout à l’heure, à la maison, je ferai brûler l’olivier bénit pour en respirer la fumée.
— Je vous le conseille, répondit le jeune officier en réprimant un sourire. Mais je crois qu’un tour de valse pourrait déjà contrarier le mati, sinon le chasser tout à fait.
— Oh ! non, soupira-t-elle en remuant la tête d’un air convaincu. Et pourtant quelle fête superbe ! Je n’ai jamais rien vu d’aussi beau.
À vrai dire, le coup d’œil était de ceux qu’on n’oublie pas. Une tente énorme couvrait une partie du pont du Prométhée, entièrement dégarni, de l’énorme pièce d’arrière au réduit central, de tout ce qui pouvait gêner la danse.
Des trophées militaires, disposés avec l’adresse connue des matelots, servaient de lustres, éclairés d’une profusion de lampes qui versaient la lumière électrique avec une prodigalité folle. Malheur aux laides, et à celles qui n’étaient plus jeunes ! Mais le sévère Neuvillars lui-même était obligé de convenir qu’aucun éclairage ne pouvait mettre en faute la beauté d’Ariane.
Une longue table, chargée de boissons fraîches et de mets solides, marquait l’extrémité arrière de ce hall improvisé. En face, une tribune adossée au réduit central supportait les musiciens du bord, artistes peu raffinés, mais capables, au dire de l’équipage, « de souffler plus dur et plus longtemps que les terriens de la grande Opéra de Paris tous ensemble ».
Sur ce point, les décorateurs avaient déployé leur effort principal. Une abondante frondaison, dérobée aux palmiers qui croissent à Rhodes en abondance, dissimulait l’orchestre et reposait les yeux fatigués par le scintillement de l’acier et du cuivre qui brillaient de toute part. Au centre de cette verdure, sous l’étamine endormie des pavillons, le buste en plâtre d’un homme barbu contemplait, de l’air ennuyé d’un maître de maison qui voudrait aller au lit, cette fête française donnée à cinq cents lieues de la France. Autour du buste, les électriciens du Prométhée avaient serti une auréole formée de lampes tricolores. Ce coin, laid d’une laideur artificielle d’ailleurs inévitable, était le seul côté de l’arrangement et de la décoration qui pût prêter à la critique. Neuvillars le fit remarquer à mademoiselle Marcopoli.
— C’est vrai, dit-elle. Mais alors pourquoi le voyez-vous ? Nous sommes entourés de tant de belles choses — non pas seulement ici, mais dans toute la vie — qu’il est facile de tourner les yeux vers ce qui est beau et ce qui est bon, en évitant de regarder le reste.
— Vous trouvez que la vie est une belle et bonne chose ?
— Oui. Cependant je porte un deuil éternel sur mes épaules et dans mon cœur. Mais je remercie Dieu qui m’a donné et me laisse encore tant de joies en ce monde. Et puis, j’aime tant mon pays ! Tous les voyageurs déclarent que c’est un paradis terrestre.
— Oh ! un paradis terrestre !… Il parait qu’on meurt d’amour dans votre île. Ceci n’a rien de très édénique.
La phrase était plutôt rude, s’adressant à celle qui l’entendait. À cette époque Neuvillars était un vrai fils de sa génération, qui se pique de dire aux femmes leurs vérités. Sans perdre contenance, Ariane répondit :
— Voulez-vous dire par là qu’on est incapable de mourir d’amour en France ?
— Absolument incapable, mademoiselle ; ne vous faites pas d’illusions sur notre compte.
— Vraiment ! Est-ce donc que l’amour vous est une chose inconnue ? Ou bien ne trouve-t-on personne, chez vous, qui soit digne d’inspirer l’amour dont on meurt… ou de le ressentir, ce qui est mille fois plus estimable ?
— Grand merci ! protesta Neuvillars en riant très haut. J’espère bien ne jamais me faire estimer de la façon que vous dites. Vertu de moi j’aimerais mieux peupler de mes victimes tout un cimetière.
En ce moment, Ariane qui n’avait pas quitté des yeux son interlocuteur se leva d’un air lassé. Croyant qu’elle voulait faire le tour du bal, Neuvillars offrit son bras, qui fut accepté après une hésitation inaperçue. Évitant les couples que la valse entraînait dans son tourbillonnement fougueux, les deux promeneurs s’avançaient d’une marche lente. Ariane paraissait ignorer qu’elle se trouvait au milieu d’une fête, que bien des regards d’admiration la suivaient sans pouvoir se détacher d’elle. Sa poitrine semblait gênée d’une sorte d’oppression ; ses beaux sourcils battaient l’air comme les grandes ailes brunes d’une hirondelle qui hésite à prendre son vol. Tout à coup elle dit à son compagnon qui commençait à l’observer curieusement :
— Cette musique et cette lumière sont fatigantes. Je me trouve ridicule au milieu de cette joie. Comme j’ai mal fait d’obéir à mon père !
— Ah ! mademoiselle : si le commandant vous entendait ! Lui que je vois là-bas si fier de son illumination et de son orchestre !… Eh bien, alors, venez ! Je vais vous montrer quelque chose de mieux que nos lampes électriques.
Déjà il l’entraînait, sans qu’elle essayât de résister, vers l’escalier qui conduisait à la dunette centrale. Arrivés à la dernière marche, ils purent se croire sur le terre-plein d’une forteresse étroite mais formidablement armée.
Autour d’eux, au-dessus de leurs têtes, à leurs pieds, se heurtaient des contrastes de lumière et d’ombre avec une violence inouïe. Tout ce qu’atteignaient les rayons d’une lune éblouissante, apparaissait comme poudré d’une couche palpable de fluide lumineux. Les teintes véritables étaient noyées dans un ruissellement laiteux, uniforme. L’œil confondait l’éclat jaune des cuivres avec le scintillement pâle des aciers, la peinture grise des blindages avec l’enduit chamois des cheminées grosses comme des tours, qui plongeaient dans une ombre épaisse tout un côté du bastion flottant.
Ariane avait alors au-dessous d’elle le carré long formé par la tente qui laissait passer confusément la lumière très chaude du bal, les notes bruyantes des instruments, les voix des danseurs et même les parfums répandus par les robes des jeunes femmes. Rien ne se perdait dans cette nuit calme comme l’atmosphère d’un boudoir. Mais, à côté du simple et grandiose triomphe de la nature, cet effort laborieux du plaisir humain semblait ridicule et impuissant.
— Nous ne sommes pas encore assez loin de ceux qui s’amusent, dit mademoiselle Marcopoli à son compagnon.
Alors ils gagnèrent la partie antérieure de la dunette centrale, d’où ils dominaient l’avant du navire. Là, par un contraste saisissant, tout était immobile et sombre. Là des centaines d’hommes se reposaient des fatigues du travail ou veillaient silencieux, sous le respect de la discipline. Seul, un matelot armé se promenait le long de la balustrade, sans que l’on entendît le bruit de ses pas étouffé par une natte de jonc. Et, sur la passerelle du quart, sommet aérien de cette acropole, on distinguait la silhouette immobile et la casquette blanche de ce même officier que Neuvillars avait proclamé heureux, parce qu’il était délivré par son service des ennuis du bal. Peut-être, en ce moment, le jeune enseigne portait-il un peu moins d’envie à son camarade.
Mademoiselle Marcopoli semblait perdue dans l’extase de cette nuit radieuse. Elle était adossée à la balustrade, en une pose qui faisait valoir la souple harmonie de sa taille. Sa main droite reposait, dégantée, sur l’acajou, et prenait, à la clarté de l’astre nocturne, la blancheur d’un marbre nouvellement ciselé.
Tantôt ses yeux pâles, mystérieux, incomparablement purs, semblaient interroger les étoiles comme des sœurs bien-aimées ; tantôt ils paraissaient leur répondre. On pensait en les voyant à ces mignonnes dagues orientales qui semblent d’inoffensifs bijoux dans leur fourreau serti de turquoises, mais dont l’acier brillant peut menacer tout à coup dans une main fine et nerveuse.
Parmi les ondes argentées de cette lumière, la beauté d’Ariane trouvait son cadre le mieux choisi. Sa robe noire, presque entièrement fermée, laissait voir la naissance d’un cou délié comme celui d’une statue antique. La bouche un peu grande, aux lèvres souvent frémissantes, était plutôt une bouche de Muse qu’une bouche d’amoureuse. La tête se distinguait par une rare petitesse. Le front, à demi caché sous l’envahissement des boucles brunes, rayonnait d’intelligence et proclamait l’absolu pouvoir de l’âme sur toute la personne. Vue comme elle était alors, cette jeune Grecque eût fait tomber à genoux un poète. Mais Paul de Neuvillars était un simple artiste moderne, dont les sens pouvaient frémir et le cerveau vibrer, sans que le cœur fût convié à la fête. Il trouvait Ariane assez en dehors de l’ordinaire pour l’étudier ; il l’eût trouvée assez belle pour la peindre ; il ne la trouvait point assez terrestre et assez femme pour la désirer. Cependant il la dévorait des yeux.
Soit qu’elle éprouvât une gêne à cette ardente curiosité, soit qu’elle craignît la fraîcheur de la brise nocturne, elle retira l’écharpe de gaze blanche qui flottait autour de sa taille et s’en fit, d’un seul mouvement rapide, un voile pareil au yachmak des musulmanes. Comme par enchantement, la belle chrétienne devint tout à coup une odalisque échappée de ses grilles d’or, pour venir rêver dans la nuit amoureuse aux côtés d’un jeune guerrier franc.