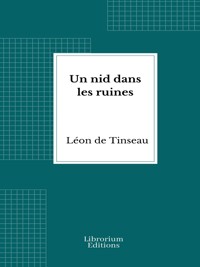
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Mon père était diplomate.
Je me souviens de ma joie quand il fut envoyé à Paris, entre la guerre de Crimée et celle d’Italie, comme chargé d’affaires d’un petit royaume d’Allemagne dont on ne parle plus guère aujourd’hui. Ma joie, cependant, n’était pas sans un mélange de frayeur ; car, étant orpheline et déjà dans ma vingtième année, je devais tenir une légation qui aurait paru plus que modeste à bien d’autres, mais qui prenait, aux yeux de mon inexpérience, les proportions d’une ambassade de premier rang.
Je fis part de ces craintes à mon cher père.
— Tu feras comme moi, répondit-il : tu te débrouilleras. Tu n’es pas sotte et tu n’es pas laide. Tu parles bien le français. Tu es habituée déjà aux révérences de Cour devant des Majestés royales ou impériales. Tu sais la danse, la pâtisserie et la musique. Avec cela on se tire d’affaire partout.
Véritablement, je me tirai d’affaire assez vite : il me faut ajouter que nul n’en fut plus surpris que moi.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Un Nid dans les Ruines
Léon de Tinseau
© 2024 Librorium Editions
ISBN : 9782385746407
UN NID DANS LES RUINES
I
Mon père était diplomate.
Je me souviens de ma joie quand il fut envoyé à Paris, entre la guerre de Crimée et celle d’Italie, comme chargé d’affaires d’un petit royaume d’Allemagne dont on ne parle plus guère aujourd’hui. Ma joie, cependant, n’était pas sans un mélange de frayeur ; car, étant orpheline et déjà dans ma vingtième année, je devais tenir une légation qui aurait paru plus que modeste à bien d’autres, mais qui prenait, aux yeux de mon inexpérience, les proportions d’une ambassade de premier rang.
Je fis part de ces craintes à mon cher père.
— Tu feras comme moi, répondit-il : tu te débrouilleras. Tu n’es pas sotte et tu n’es pas laide. Tu parles bien le français. Tu es habituée déjà aux révérences de Cour devant des Majestés royales ou impériales. Tu sais la danse, la pâtisserie et la musique. Avec cela on se tire d’affaire partout.
Véritablement, je me tirai d’affaire assez vite : il me faut ajouter que nul n’en fut plus surpris que moi.
J’aurais pu même, du moins on me l’assura, « faire mon trou » à la Cour des Tuileries. L’impératrice me témoigna très vite une bienveillance quasi maternelle, qui cachait probablement une certaine dose de compassion pour ma simplicité de goûts et d’allures, dans un milieu où les femmes ne péchaient guère par un excès de simplicité. L’empereur et les hommes de son entourage ne laissaient pas que d’en sourire, cependant il aurait fallu être encore plus simple que je n’étais pour ne pas voir qu’on me trouvait jolie. De bonne foi (je peux bien en convenir après tant d’années) j’imagine que je l’étais — pour ceux qui aiment les blondes.
Car j’étais blonde, non pas comme les blés, mais comme l’or sortant du polissoir d’un orfèvre ; je ne savais littéralement que faire de mes cheveux, à cause de leur longueur et de leur abondance. Avec cela des yeux bleus, francs et honnêtes, passablement éveillés, une peau très blanche, un air de santé, des dents que j’aurais pu montrer par coquetterie, mais que je montrais par la seule raison de ma bonne humeur continuelle : voilà pour la tête de mademoiselle Hedwige de Tiesendorf. Cette jeune beauté n’eût rien perdu à grandir de deux pouces ; du moins elle avait une main de race, des pieds montrables, des mouvements souples et, sans l’horreur qu’elle avait d’être sanglée, on eût peut-être parlé de sa taille.
Mais, plus au moral encore qu’au physique, j’avais horreur du contraint, de l’arrangé, de l’apprêté. Une chose que je n’ai jamais pu comprendre, c’est qu’on m’ait trouvé de l’esprit. D’ailleurs ceux qui m’en trouvaient — on décidera si c’est bon ou mauvais signe — étaient invariablement des hommes ayant passé la cinquantaine. Il est vrai qu’avec les jeunes je ne songeais qu’à une chose : à danser, car j’adorais la danse. On me déclara bientôt la meilleure valseuse de la Cour ; et Napoléon III, grand valseur lui-même, voulut bien m’inviter quelquefois dans les sauteries intimes de Compiègne. Pauvre empereur ! Pauvre Hedwige ! Tous deux vous portiez des couronnes à cette époque. La sienne a roulé dans la poussière. L’or de la mienne s’est changé en argent. Dieu me garde de me plaindre !
Je ne fus pas longue à me sentir à l’aise avec les Majestés. Mais, pendant des mois, je fus timide et balbutiante en présence d’un personnage qui, aux yeux de mon père, était un personnage très important : je veux parler du chef de nos cuisines. Il y avait la même distance entre M. Bruneau — c’était son nom — et mes cordons-bleus allemands des temps passés, qu’entre Richard Wagner et un organiste de village. Mon père se vantait d’avoir le meilleur cuisinier de Paris. Ce qui est certain, c’est qu’il avait le plus inventif. A la veille de chacun de nos grands dîners, M. Bruneau me soumettait des menus chargés de plats, dont la nomenclature fantaisiste me rendait folle. Naturellement j’acceptais les yeux fermés, n’osant solliciter une explication. Je dois dire que les convives, presque toujours, s’extasiaient, sans pouvoir d’ailleurs imaginer quelles substances animales ou végétales entraient dans la composition de l’aliment dégusté. Le lendemain, je louais le chef-d’œuvre à son auteur ; quelquefois, s’il souriait, j’avais le courage de lui demander :
— Mais enfin, monsieur Bruneau, comment pouvez-vous avoir de telles idées ?
Alors le grand homme, qui était petit avec une physionomie ravagée d’artiste, rejetait sa toque en arrière et me contait l’histoire de son inspiration. Tantôt ça lui était venu pendant une promenade (non solitaire sans doute) dans les allées du Bois, sous un clair de lune poétique, entre deux rossignols qui se répondaient d’un buisson à l’autre. Ou bien l’Esprit avait parlé pendant que Bruneau écoutait l’opéra, car il était mélomane. Ou bien l’éclair avait lui pendant ces insomnies qui tourmentent les poètes. Bruneau quittait alors sa chambre, allumait son fourneau et composait… Je dus à ces compositions nocturnes, outre des plats restés au répertoire, un incident que je raconterai à son heure, et dont le souvenir est une des nombreuses blessures inguérissables de ma vie.
Revenons à l’époque de mes débuts dans le grand monde parisien ; ce fut la saison fleurie, la matinée alcyonienne de mon histoire. Ah ! j’ai été bien heureuse — pendant un an !
Que mon père ait laissé un souvenir comme diplomate aux bords de la Seine, j’ai lieu d’en douter, par la raison que les affaires de notre petit royaume allaient toutes seules. Peut-être, d’ailleurs, n’était-il pas un Rouher ni un Palmerston — grâce à Dieu il ne fut pas un Bismarck ! — mais il avait à mes yeux une qualité plus précieuse, qui était d’adorer sa fille. S’il n’était pas illustre dans sa carrière, il était connu et apprécié comme maître de maison. Nos invitations devinrent bientôt fort recherchées, précisément parce qu’elles ne pouvaient être étendues, vu les dimensions de notre hôtel.
— Tous ces gens viennent pour te voir et pour t’entendre, disait mon excellent père. (Je jouais les valses de Strauss, qui devenait à la mode, comme on les joue à Vienne.)
— Pas du tout, lui répondais-je. Ils viennent à cause de Bruneau et de ses plats inédits.
Je suis portée à croire que nous avions raison tous les deux.
Ce qui est certain, c’est que Bruneau et ses plats n’eurent aucune part dans une soirée de tableaux vivants qui fit parler de moi, ou plutôt de mes cheveux, pendant une semaine. Ce n’était pas la première fois qu’on m’engageait à nous mettre en évidence, eux et moi ; jusque-là, toute permission de ce genre m’avait été refusée. Mon éducation était sévère. Les bals costumés et autres exhibitions qui, à cette période, exhibèrent tant de choses, n’étaient pas du goût de mon père, tout au moins quand il s’agissait d’y voir figurer sa fille. Et pourquoi ne pas avouer qu’en me tenant ainsi à l’écart, mon père avait un motif d’ordre particulier ? Ce motif, c’était mon cousin Otto de Flatmark, jeune officier des gardes de notre souverain.
Otto, favori de mon père qui n’avait pas de fils, était aussi le mien ; entendez par là que je l’aimais comme un frère. Pauvre garçon ! C’était trop peu pour lui, car il m’adorait… autrement qu’on n’adore une sœur. A l’âge de seize ans, m’étant laissée convaincre que je partageais cet amour, j’avais permis qu’on nous fiançât ; et mon père me gardait pour ce fiancé, contre les rivaux possibles, avec un soin jaloux. Mais nous devions attendre, pour nous marier, que mon cousin eût un grade supérieur. En ce qui me concerne, j’attendais fort patiemment. Nous échangions une lettre chaque semaine ; je lui contais mes faits et gestes pour l’amuser ; lui me contait son adoration, qui ne m’amusait pas toujours. Mon cher Otto ! Pour la première fois de ma vie je ne t’ai pas écrit toutes mes impressions, à la suite de mon triomphe dans le personnage d’Ophélie, car ce fut un triomphe — hélas !
Naturellement j’avais un Hamlet pour partner, et quel Hamlet ! Le marquis de Noircombe, ni plus ni moins. Il faut avoir vécu dans le grand monde parisien, à cette époque, pour comprendre le prestige qui environnait ce nom, porté par un homme beau, riche, élégant, à l’air fatal, connu pour être aimé de toutes les femmes et pour n’en distinguer aucune, sinon, de temps à autre, par une attention fugitive qui laissait dans les larmes une malheureuse de plus. Il était brun, pâle ; triste, disaient les unes, dédaigneux, affirmaient les autres — les dédaignées sans doute. C’était un de mes danseurs. Quelquefois nous nous retrouvions au bal quatre ou cinq jours de suite, à plusieurs bals quelquefois dans la même soirée ; et ces rencontres n’étaient pas fortuites, il prenait soin de m’en informer. Puis, tout à coup, au moment où je commençais à le croire occupé de moi, il disparaissait pendant des semaines, comme pour m’empêcher de trop m’occuper de lui. On devine si c’était le moyen d’être oublié d’une jeune fille romanesque, rêveuse, au cœur très neuf, qui essayait, sans y parvenir, d’aimer un fiancé qu’elle n’avait pas choisi.
Quand on sut que le marquis de Noircombe acceptait de figurer dans un tableau vivant, ce fut une rumeur. Il avait toujours témoigné son mépris pour ce qu’il appelait : les figures de cire, de même que pour les comédies de salon en général. Moi-même je l’avais entendu répéter :
« Je me demande pourquoi les femmes du monde se donnent tant de mal pour nous faire regretter les comédiennes. »
On comprendra que j’avais de quoi me sentir troublée à la nouvelle qu’il avait non seulement accepté, mais, assurait-on, demandé, de faire Hamlet avec moi. Nous fûmes laissés libres de choisir l’épisode ; je déclarai que je ne voulais pas jouer la folie.
— Car enfin cette pauvre fille n’a pas toujours eu le cerveau dérangé. Ne pourrait-on trouver quelque chose de moins rebattu ?
— Bien, répondit M. de Noircombe avec un étrange sourire. Mais vous savez à quoi cela vous oblige. Avant d’avoir perdu la raison, Ophélie était amoureuse.
A ces mots je me sentis rougir comme une blonde peut rougir quand elle s’en mêle. Toutefois, il n’y avait pas à reculer, d’autant moins que mon père était là, ainsi que les maîtres de maison, nos amis intimes, qui organisaient la fête. On décida que le tableau aurait pour thème les propres paroles d’Ophélie, au second acte du drame de Shakespeare :
« Il me saisit par le poignet, me tenant éloignée de toute la longueur de son bras, tandis que, son autre main sur le front, il scrutait mon visage comme s’il eût voulu le peindre. Il resta longtemps ainsi. Enfin, remuant la tête, imprimant une légère secousse à mon bras, il poussa un soupir douloureux, profond, au point qu’on aurait dit que sa poitrine allait se fondre. Alors il s’éloigna, la tête tournée en arrière, semblant se diriger sans le secours de ses yeux, car, jusqu’au moment où il disparut, leur regard ne m’avait pas quittée… »
Aux répétitions, M. de Noircombe joua son rôle comme tout le monde aurait pu le jouer. Enfin le rideau s’écarta pour le spectacle attendu.
Après tant d’années révolues, je n’ai pas besoin d’être modeste. J’étais une Ophélie fort présentable malgré mes yeux bleus (il est admis que la fille de Polonius avait des prunelles couleur d’algue marine). Mais je doute qu’elle eût pu l’emporter sur moi par la chevelure. Quel royal manteau d’or ! C’est, de toutes mes « beautés », celle que je regrette le plus. Pour me consoler, je me figure — et j’en ai le droit — qu’il a passé sur les épaules de ma fille.
Mon Hamlet, fort élégant dans son pourpoint de velours noir, se dégela en présence du public. C’est du moins ce que j’entendis le lendemain. J’entendis cela, et je lus autre chose : cette phrase tombée de la plume d’un chroniqueur fameux qui assistait à la soirée :
« Je n’ai jamais rien vu de plus séduisant, de plus tendre, de plus ému, j’allais dire de plus effrayé, que mademoiselle de T… Quant au marquis de N… il était beau d’une beauté fatale, implacable, ironique, tyrannique, diabolique. S’il s’agissait d’acteurs professionnels, je leur ferais le reproche d’avoir changé le spectacle. Ce n’est pas du Shakespeare qu’ils nous ont donné, c’est du Gœthe. Ce n’est pas Ophélie, ce n’est pas Hamlet que nous avons admirés ; c’est Marguerite et Méphistophélès. »
Non ! jamais je n’oublierai l’effet que produisit sur moi ce passage quand mon père me l’apporta, moitié fier, moitié mécontent ; car, à cette époque, on n’avait pas encore l’habitude de voir les gens du monde cités — mieux que par des initiales — pour la moindre tasse d’eau chaude versée ou bue par eux. Marguerite et Méphistophélès ! Ah ! oui, c’était bien cela ! Tandis que la main de cet homme meurtrissait mon poignet, tandis que ses yeux fascinaient les miens — pendant une heure ou pendant une minute, je n’aurais pu le dire — ma volonté s’était retirée de moi, s’était fanée en quelque sorte, à la façon d’une pauvre fleur brûlée par un souffle satanesque. J’avais eu peur, peur à pousser un cri d’angoisse, peur comme l’enfant égaré qui voit s’approcher le ravisseur farouche. Et cet homme m’avait prise, volée, emportée, pour ne me rendre jamais. S’il avait laissé là ma personne — il l’avait dédaignée, sans doute — du moins il venait de ravir toute la partie invisible de mon être. J’étais à sa discrétion, incapable de lutter contre lui avec le moindre espoir. Il était plus grand, plus savant, plus puissant que moi. Pas meilleur, mon instinct m’en avertissait. Qu’importe ? Marguerite et Méphistophélès !…
Je ne connais plus, sinon par ouï-dire, les jeunes Parisiennes d’aujourd’hui. Pourtant ce que je sais d’elles me fait prévoir le jugement que porteront sur moi les filles de celles qui furent alors mes amies. Les unes m’accorderont leur pitié : « Pauvre petite Allemande !… Croquemitaine lui faisait encore peur ! » D’autres diront : « C’est un cas d’hypnotisme. Hedwige de Tiesendorf était un sujet. » Toutes seront d’accord pour cette conclusion : « Vingt marquis de Noircombe, même en costume d’Hamlet, auraient beau rouler leurs yeux et froncer leurs sourcils, nous ne perdrions pas la tête si vite ! »
Je pense que ces demoiselles ont raison. Deux heures de bicyclette le matin, autant de lawn-tennis l’après-midi, autant de flirt le soir, c’est un régime qui empêche de croire à Croquemitaine… et d’être la victime du cœur ou de l’imagination. Quant à moi, dont le régime physique et moral était tout autre, j’avais perdu la tête purement et simplement. Le jour qui suivit « le tableau », je fis semblant d’être malade pour ne pas sortir, parce que j’avais peur de rencontrer le marquis. Puis, bientôt, je fus obligée de m’avouer que je mourais d’envie de le revoir.
Alors j’eus encore plus peur, et je m’enfermai encore mieux. Cependant je n’avais pas d’illusions. Je savais que toutes les grilles, tous les verrous du monde ne pourraient me défendre contre ma destinée. Je savais que Noircombe allait sortir d’une trappe quelque jour, me saisir de nouveau le poignet dans sa griffe — et m’emporter en enfer, à moins que ce ne fût dans le paradis ! Ma surprise fut donc des moins grandes lorsque mon père, un matin, me déclara qu’il voulait me parler d’une chose sérieuse.
— A vrai dire, continua-t-il, peu s’en est fallu que je refuse de t’en parler. Tu es fiancée. Je ne vois donc pas quel intérêt peut avoir pour toi une demande en mariage.
Il se tut, croyant sans doute que j’allais abonder dans son sens. Mais je restai de marbre, et je pus voir que cette réserve l’étonnait. Il reprit aussitôt, les yeux fixés sur les miens :
— J’ai réfléchi que la liberté de l’âme humaine est un droit sacré. La preuve, c’est que Dieu lui-même nous laisse le libre arbitre. Or, pour que l’âme soit libre, il ne faut pas qu’elle ignore. Je suis convaincu, d’ailleurs, qu’Otto lui-même ne désire pas que tu l’épouses, comme tu l’épouserais s’il était le seul homme vivant. L’amour est imparfait, s’il n’est accompagné du choix. Pour choisir, il faut avoir comparé. Tu vas être à même de le faire, d’autant mieux qu’il ne s’agit pas du premier venu. Peut-être que tu devines le nom de celui qui se propose : le marquis de Noircombe.
J’essayai de dire une parole et ma langue remua dans ma bouche, mais sans produire un son. En même temps mes bras glissèrent le long de mon corps ; mon dos s’appuya, inerte, à mon fauteuil. Je sentis que je m’évanouissais. « Quel bonheur ! pensai-je. Me voilà dispensée de répondre ! »…
Une sueur froide baignait mon front et mes tempes ; j’ouvris les yeux. Mon père, à genoux près de moi, me soignait comme aurait pu le faire celle qui m’a quittée trop tôt. Je me souvins alors ! « … le nom de celui qui se propose : le marquis de Noircombe » !
Il était venu ; il ne pouvait manquer de venir, je le savais bien. Un seul obstacle aurait pu l’empêcher d’accomplir son dessein : ma mort !… Mais je n’étais pas morte ; la vie recommençait ; ou plutôt c’était une nouvelle vie qui commençait dans une nouvelle personne. Plus que jamais la terreur s’empara de moi ; je refermai les yeux pour tâcher de dormir encore une minute, avant les grandes fatigues des combats prochains. Les mains de mon père ne s’agitaient plus ; je devinais son regard navré. Il murmura ces mots à demi-voix :
— Pauvre Otto !
Ce fut le signal d’une explosion de larmes. Sur la poitrine de celui qui fut mon meilleur ami, mon seul ami avec notre vieux Roi, je pleurais dans la volupté d’un soulagement. On va penser que ces larmes étaient la preuve de mon bon cœur. Hélas ! elles étaient plutôt la preuve de je ne sais quelle bizarre, cruelle honnêteté. Il me semblait que chacune de ces gouttes chaudes, roulant sur mes joues, soldait ma rançon, payait mon affranchissement, acquittait l’indemnité que je devais au malheureux dont j’allais briser la vie. Ainsi pleuré par moi, qu’aurait-il à me réclamer encore ? Il est probable que mon père devina cet étrange marché, car il me demanda :
— Est-ce donc déjà un amour mort que tu pleures ?
Je répondis en m’essuyant les yeux :
— Non. Ce qui n’a jamais existé ne saurait mourir. Dieu m’est témoin que j’ai fait tous mes efforts, pendant quatre années, pour aimer Otto. Je n’ai pas pu !…
— Tu as été plus heureuse quand il s’est agi d’un autre ! me reprocha mon père malgré sa bonté. Il ne t’a pas fallu quatre ans pour…
— Si par là, interrompis-je avec force, vous voulez dire que j’ai été coquette avec monsieur de Noircombe, vous êtes injuste à mon égard. Plus d’un homme, depuis notre arrivée en France, m’a déclaré des sentiments tendres ; lui, jamais. S’il l’eût fait, je l’aurais traité comme j’ai traité les autres.
— Faut-il donc supposer qu’il a fait sa demande sans la moindre raison de croire qu’il a chance d’être accueilli ? Faut-il croire, en même temps, que c’est par pur hasard que tu t’es évanouie, quand j’ai prononcé son nom ?
Que pouvais-je répondre ? Je pouvais du moins ouvrir mon cœur, exposer, sinon expliquer, la mystérieuse influence qui l’avait envahi. Mon père m’écouta sans rien dire. D’autres se fussent moqués de leur fille ; lui n’en fit rien. Il était — la chose semblait évidente — presque aussi effrayé que moi.
— Veux-tu, demanda-t-il après un moment de réflexion, que je fasse venir Otto ?
— Si je l’aimais, pensez-vous que je ne l’aurais pas fait venir moi-même, dès le lendemain de cette fatale soirée ? Hélas ! si je l’aimais, si j’aimais quelqu’un, tous les Noircombe de la terre seraient impuissants à me troubler, même pour une minute.
— Eh bien, puisque tu n’aimes personne, épouse ton cousin ! Tu l’aimeras bientôt. De nouveaux devoirs absorberont ta vie. Dans quelques mois tu riras de tes terreurs présentes.
— Non, mon père, je n’épouserai pas Otto. Mon cœur est trop loyal et je me sens trop à la merci de… de mon maître.
— Ah ! s’écria mon père avec impatience, il est ton maître parce que tu l’aimes follement !
— Peut-on aimer un homme et trembler à sa seule pensée ? répondis-je.
— Laisse-moi lui faire savoir que tu le refuses.
— Comme il vous plaira. Mais il serait plus juste de dire que vous le refusez. Ma volonté a disparu.
— Nous verrons bien.
Mon père, à ces paroles, me laissa toute brisée et s’éloigna, sans doute pour aller dire son fait au marquis, par l’intermédiaire de son envoyé. Quant à moi j’allai me mettre au lit où je restai, sans être bien malade. J’y étais encore deux jours après. C’était le soir. Mon père m’avait embrassée avant d’aller dormir, et j’avais congédié mademoiselle Ordan, mon institutrice devenue ma dame de compagnie. Pour hâter le sommeil, j’ouvris un volume que j’étais en train de lire. Un billet s’en échappa, d’une écriture inconnue…
« Pourquoi lutter contre moi, contre vous-même ? disait l’écrit mystérieux. Vous m’aimez. Vous serez à moi. La vie est courte. Pourquoi la dépenser vainement à combattre la destinée ? »
Folle de terreur je me lève et cours verrouiller toutes mes portes… Qui sait ? Peut-être que ce démon est embusqué quelque part. J’ai soufflé ma bougie et, claquant des dents, je m’habille au milieu des ténèbres. Jusqu’au matin, je reste dans mon fauteuil, le gland de ma sonnette dans ma main, l’oreille ouverte à chaque bruit…
Cet incident acheva de me donner des allures tout à fait bizarres. Si malade que fût ma pauvre tête, je repris un peu ma raison le lendemain. Je réussis à me persuader que M. de Noircombe n’avait pu pénétrer chez nous sans être vu. Mais enfin les billets n’entrent pas tout seuls chez les gens. Donc, j’étais environnée de traîtres. Je n’osai confier mon trouble à qui de droit ; cependant je fis coucher dans ma chambre mademoiselle Ordan, que je considérais comme une personne très sûre, opinion qui s’est beaucoup modifiée depuis.
Je ne sais pourquoi mes soupçons tombaient sur Bruneau. Il venait chaque matin prendre les ordres dans le cabinet de travail avoisinant ma chambre. Il était parfois debout la moitié de la nuit, quand l’Esprit le visitait. Je le surveillai, l’étudiai, lui tendis des pièges sans rien découvrir.
Moi-même j’étais étudiée, à mon insu, d’une façon encore plus sérieuse. Vers cette époque, nous vîmes débarquer à la Légation un vieux petit Allemand à lunettes, que mon père me présenta comme un collègue chargé d’une mission. Je me demandai alors quelle était cette mission ; car le chevalier — c’était son titre — passa en tiers avec nous deux la presque totalité de son séjour à Paris, qui ne fut pas long d’ailleurs. Autant divulguer tout de suite une découverte que je fis deux ans plus tard, quand l’Allemagne perdit un de ses aliénistes fameux. Une de nos Revues donna son portrait ; je le reconnus au premier coup d’œil : c’était le curieux et bavard diplomate, qui avait passé tant d’heures à causer avec moi de tous les sujets imaginables, même de l’amour, ce que son âge et son physique lui permettaient de faire sans qu’on le soupçonnât d’arrière-pensée.
Il n’est pas douteux que cet habile homme déclara que j’allais être folle à lier, si je n’épousais M. de Noircombe ; et je n’oserais vraiment prétendre qu’il n’eut pas raison.
Peu de jours après le départ du personnage « chargé d’une mission », mon pauvre père entra chez moi un matin, faisant de son mieux pour avoir l’air dégagé et souriant.
— Ton amoureux, dit-il, ne se laisse pas décourager. Il revient à la charge, si bien que je suis allé aux renseignements. Je ne peux pas dire qu’ils soient de nature à me convaincre que M. de Noircombe est un ange ; mais il paraît assez bon diable. Sa famille est des plus anciennes ; il en est le dernier rejeton. Le château et la terre de Noircombe forment un domaine superbe. Bref, ce jeune homme ne saurait être soupçonné de faire la chasse à l’héritière qui se nomme Hedwige de Tiesendorf. D’ailleurs, il ne chasse à rien, n’aime pas les chevaux, ni les voyages, ni le luxe, ni… Enfin l’on ne raconte pas d’histoires sur son compte.
Pleurez avec moi, vous toutes qui avez reconnu — plus tard — ce que valent ces renseignements recueillis sur nos futurs !
Sans une parole, sans un mouvement, je laissais parler mon père, ou plutôt je me demandais si c’était bien lui qui parlait. Pour la première fois, je le voyais revenir sur une décision. Ne pouvant soupçonner qu’il agissait alors sous l’empire d’une angoisse terrible, j’attribuais ce revirement au même pouvoir inexplicable dont j’étais devenue soudain la proie. Quatre mots, écrits en caractères longs et puissants comme des coups de griffe, me brûlaient la poitrine : Vous serez à moi ! Et, dans la déroute de ma volonté, dans le chaos de mon imagination, une phrase entendue me faisait espérer qu’il était meilleur que beaucoup d’autres : « on ne racontait pas d’histoires sur… mon fiancé. »
Mon fiancé !… Il ne l’était pas encore, cependant. On me demandait de réfléchir ; en même temps — pauvre père ! — on me proposait de recevoir M. de Noircombe, afin que je pusse le mieux connaître avant de me prononcer. Un reste d’orgueil m’empêcha de répondre que toute réflexion était inutile. Je promis de considérer la question avec maturité ; mais, chose qui étonna fort, je déclarai que, connaissant bien M. de Noircombe, je préférais me décider sans le revoir. La vérité, c’est que j’avais peur de son courroux : j’osais le faire attendre !
Je n’avais pas d’ailleurs la moindre idée de ce que pouvait durer cette attente. Si « mon maître » avait dit : je la veux demain, je n’aurais pas fait d’objection. Mais j’avais résolu de ne point reparler de lui la première. Je renonçais à combattre la destinée ; mais c’était bien le moins que la destinée prît la peine de m’emporter dans ses bras tout-puissants.
Alors je me sentis plus calme et je revins presque à la santé. Chaque matin, je me rendais en voiture au bois de Boulogne avec mademoiselle Ordan ; je marchais pendant une heure dans des allées désertes. Le printemps était à son apogée ; l’odeur des frondaisons était enivrante quand le soleil pompait leur rosée. A cette époque, les jeunes femmes et la plupart des jeunes hommes ne sortaient pas avant midi ; on s’imagine difficilement le charme de ces solitudes où, pendant des heures entières, on avait la chance de n’apercevoir aucun être humain. Aussi j’avais soin que la voiture de mon père et son valet de pied fussent toujours à portée, dissimulés derrière un taillis. Généralement, j’avais un livre avec moi et, quand la marche m’avait lassée, je m’asseyais sur un banc pour me livrer à la lecture. Poétique à sa manière, ma compagne s’enfonçait dans le fourré pour cueillir des primevères ou chercher des nids. Un jour, tandis qu’elle se livrait à cette occupation, le bruit des branches qui s’ouvraient derrière moi me fit supposer qu’elle revenait de son expédition. Je dis, sans quitter ma page des yeux :
— Il me semble qu’il est tard. Il faut rentrer.
— Pas encore, de grâce ! dit une voix d’homme derrière moi.
Je n’eus pas un mouvement, pas un cri. M. de Noircombe était là ; et je m’en étonnais à peine quoique, si j’avais été en mesure de réfléchir, la chose eût pu me paraître assez étonnante, vu l’heure et le lieu.
— Je vous adore ! murmura la même voix presque à mon oreille.
Une terreur folle, mais délicieuse, hélas ! s’était emparée de moi ; je fermai les yeux sans répondre. Le marquis, restant à la même place, continua :
— Ne voulez-vous donc pas m’aimer un peu ?
— Vous me ferez mourir ! soupirai-je enfin.
— Je le voudrais, fit le tentateur invisible. Je voudrais mourir avec vous de cette mort très douce, qui fait trouver l’existence insipide quand on revient aux réalités de la vie. Je vous attends ; je vous espère ; je vous veux ! Pourquoi me faites-vous languir dans la faim et la soif de vous ? Dites : quand pourrai-je venir vous prendre, vous emporter, ô ma douce proie ?
Je baissai la tête, vaincue, et cette réponse, faible comme un soupir d’enfant malade, s’échappa de mes lèvres :
— Quand vous voudrez !
J’entendis une sorte de grondement étouffé, puis, sur mon cou, je sentis comme une brûlure. Cette fois je poussai un cri dont les échos d’alentour furent troublés. Un instant après, mademoiselle Ordan se tenait devant moi, l’air étrangement calme.
— Vous avez appelé ? demanda-t-elle. Avez-vous eu peur ? Avez-vous aperçu quelqu’un ?
Je la regardai. Elle me dévisageait curieusement, ainsi qu’on examine un malade. On aurait dit — et je crus — qu’elle ne se doutait pas de mon aventure. Le courage me manqua pour la lui divulguer et, sans autre explication, je me dirigeai vers la voiture stationnée au tournant voisin.
Pendant le retour je n’ouvris pas la bouche. Quand mon père vint déjeuner, on l’informa que j’étais dans mon lit. Fort troublé, il accourut, me questionna. Je répondis probablement avec incohérence, car je vis dans son regard un effroi mal déguisé.
— Pourquoi, me demanda-t-il, tiens-tu la main sur ton cou ? Est-ce que tu souffres ?
— Oui, répondis-je. Quelque chose m’a brûlée.
Il voulut examiner la plaie ; mais, naturellement, il ne vit rien. Comme je restai muette sur ma rencontre du Bois, Dieu sait ce qu’il pensa de mon équilibre mental. Probablement, ce dernier incident mit fin à toute hésitation de sa part. Une semaine après, le marquis m’envoyait son premier bouquet, bientôt suivi de sa visite. Je ne l’avais pas vu depuis cette matinée… où je l’avais entendu sans le voir. Il me parut très beau, et je n’ai trouvé dans les yeux d’aucun homme cette étrange lueur qui brillait dans les siens. Pauvre Hedwige de Tiesendorf ! Tu croyais alors que c’était le feu de l’amour ! Tu devais savoir bientôt si ce fut ta personne ou ta dot qui excita l’amour de Ludovic de Noircombe !
Lorsqu’il fut parti, je me demandai à moi-même si je l’aimais. Ce calme étrange, cette sensation de repos qui régnait en moi, très douce après les orages passés, cette fatigue de mes membres alanguis, tout cela était-il l’amour ? Dans un dernier mouvement de révolte, j’essayai de me répondre à moi-même négativement. Hélas !… Pourquoi donc, alors, me sentais-je presque heureuse ?…
Peut-être que ce bonheur douteux ressemblait à l’engourdissement du vaincu sommeillant dans ses fers, quand la lutte est finie, quand il sait que l’aube du lendemain ne chargera plus ses épaules d’armes trop lourdes pour son corps épuisé… Que dis-je, malheureuse ! Un effort suprême, ineffablement douloureux, me restait à accomplir. Le marquis m’ayant laissée après une courte visite — mon père avait attiré son attention sur ma pâleur — je dus m’asseoir à ma table de travail, afin d’écrire à Otto !
Pour être véridique, je passai moins de temps à écrire qu’à pleurer, à le pleurer. Lui, si bon, si loyal, si confiant, si dévoué !… Chacune de mes lignes — j’en avais conscience — était un glaive dont je perçais le cœur de cet homme, un cœur qui ne battait que pour moi. Cependant il fallait lui apprendre que son rêve ne devait pas s’accomplir, que je ne l’avais jamais aimé, que je ne pouvais être à lui. Mon père, malgré mes supplications, s’était refusé à remplir cet office de bourreau. Enfin, l’horrible missive reposa dans son enveloppe, prête à partir, comme la balle meurtrière d’un pistolet chargé. Elle partit… Je n’ai jamais reçu la réponse. Elle partit ! Cependant je l’ai dans mon tiroir, cette lettre homicide presque effacée, toute jaunie, dans un papier qui porte mon adresse avec grande tache rouge. Le moment venu, je dirai quel chemin elle a fait pour me revenir, et ce qu’a coûté son affranchissement !
II
Une sœur de mon père, vieille fille et chanoinesse, nous arriva pour me servir de mère à l’occasion du mariage. Elle était, presque depuis sa sortie du couvent, dame d’honneur de notre reine. Aussi la considérait-on comme un des piliers de notre petite Cour moins luxueuse que la résidence d’un pair anglais, mais plus à cheval sur l’étiquette que le Versailles de Louis XIV. La comtesse Bertha, comme nous l’appelions, m’apportait un cadeau vraiment royal de la part du Roi, mon parrain. C’était une rivière de diamants que M. de Noircombe admira fort, d’autant plus qu’il n’avait, disait-il, aucuns bijoux de famille à m’offrir, ce que la comtesse Bertha, entre autres choses, ne put jamais lui pardonner. Une lettre autographe, beaucoup moins appréciée de mon futur, accompagnait la cassette. Un peu voilé d’une tristesse bienveillante, le compliment de Sa Majesté contenait cette phrase :
« Il m’en coûte, chère petite, de faire voyager mes diamants à l’étranger. De tout temps j’avais cru que ma perle précieuse reviendrait à nous. Dieu veuille qu’elle ait trouvé une monture digne d’elle ! »





























