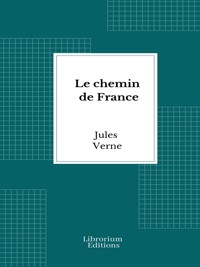
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Je me nomme Natalis Delpierre. Je suis né en 1761, à Grattepanche, un village de la Picardie. Mon père était cultivateur. Il travaillait sur les terres du marquis d’Estrelle. Ma mère l’aidait de son mieux. Mes sœurs et moi, nous faisions comme ma mère. Mon père ne possédait aucun bien et ne devait jamais avoir rien en propre. En même temps que cultivateur, il était chantre au lutrin, chantre « confiteor ». Il avait une voix forte qu’on entendait du petit cimetière attenant à l’église. Il aurait donc pu être curé – ce que nous appelons un paysan trempé dans l’encre. Sa voix, c’est tout ce que j’ai hérité de lui, à peu près.
Mon père et ma mère ont travaillé dur. Ils sont morts dans la même année, en 79. Dieu ait leur âme !
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jules Verne
Le chemin de France
Roman
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385741051
I
Je me nomme Natalis Delpierre. Je suis né en 1761, à Grattepanche, un village de la Picardie. Mon père était cultivateur. Il travaillait sur les terres du marquis d’Estrelle. Ma mère l’aidait de son mieux. Mes sœurs et moi, nous faisions comme ma mère. Mon père ne possédait aucun bien et ne devait jamais avoir rien en propre. En même temps que cultivateur, il était chantre au lutrin, chantre « confiteor ». Il avait une voix forte qu’on entendait du petit cimetière attenant à l’église. Il aurait donc pu être curé – ce que nous appelons un paysan trempé dans l’encre. Sa voix, c’est tout ce que j’ai hérité de lui, à peu près.
Mon père et ma mère ont travaillé dur. Ils sont morts dans la même année, en 79. Dieu ait leur âme !
De mes deux sœurs, l’aînée, Firminie, à l’époque où se sont passées les choses que je vais dire, avait quarante-cinq ans, la cadette, Irma, quarante, moi, trente et un. Lorsque nos parents moururent, Firminie était mariée à un homme d’Escarbotin, Bénoni Fanthomme, simple ouvrier serrurier, qui ne put jamais s’établir, quoique habile en son état. Quant aux enfants, ils en avaient déjà trois en 81, et il en est venu un quatrième quelques années plus tard. Ma sœur Irma était restée fille et l’est toujours. Je ne pouvais donc compter ni sur elle ni sur les Fanthomme pour me faire un sort. Je m’en suis fait un, tout seul. Aussi, sur mes vieux jours, ai-je pu venir en aide à ma famille.
Mon père mourut le premier, ma mère six mois après. Cela me fit beaucoup de peine. Oui ! c’est la destinée ! Il faut perdre ceux qu’on aime comme ceux qu’on n’aime pas. Cependant, tâchons d’être de ceux qui sont aimés, quand nous partirons à notre tour.
L’héritage paternel, tout payé, ne monta pas à cent cinquante livres – les économies de soixante ans de travail ! Cela fut partagé entre mes sœurs et moi. Autant dire deux fois rien.
Je me trouvais donc à dix-huit ans avec une vingtaine de pistoles. Mais j’étais robuste, fortement taillé, fait aux rudes travaux. Et puis, une belle voix ! Toutefois, je ne savais ni lire ni écrire. Je n’appris que plus tard, comme vous le verrez. Et quand on ne commence pas de bonne heure, on a bien du mal à s’y mettre. La manière d’exprimer ses idées s’en ressent toujours – ce qui ne paraîtra que trop en ce récit.
Qu’allais-je devenir ? Continuer le métier de mon père ? Suer sur le bien des autres pour récolter la misère au bout du champ ? Triste perspective, qui n’est pas pour tenter. Une circonstance vint décider de mon sort.
Un cousin au marquis d’Estrelle, le comte de Linois, arriva certain jour à Grattepanche. C’était un officier, un capitaine au régiment de la Fère. Il avait un congé de deux mois et venait le passer chez son parent. On fit de grandes chasses au sanglier, au renard, en battue, au chien courant. Il y eut des fêtes avec du beau monde, de belles personnes, sans compter la dame du marquis, qui était une belle marquise.
Moi, dans tout cela, je ne voyais que le capitaine de Linois. Un officier très franc de manières, qui vous parlait volontiers. Le goût m’était venu d’être soldat. N’est-ce pas ce qu’il y a de mieux, quand il faut vivre de ses bras, et que les bras sont emmanchés à un corps solide. D’ailleurs, de la conduite, du courage, aidé d’un peu de chance, il n’y a pas de raison pour rester en route, si l’on part du pied gauche, et si l’on marche d’un bon pas.
Avant 89, bien des gens s’imaginent qu’un simple soldat, fils de bourgeois ou de paysan, ne pouvait jamais devenir officier. C’est une erreur. D’abord, avec de la résolution et de la tenue, on arrivait sous-officier, sans trop de peine. Ensuite, quand on avait exercé cet emploi pendant dix ans en temps de paix, pendant cinq ans en temps de guerre, on se trouvait dans les conditions pour obtenir l’épaulette. De sergent on passait lieutenant, de lieutenant, capitaine. Puis... halte-là ! Défense d’aller plus loin. De fait, c’était déjà beau.
Le comte de Linois avait souvent remarqué pendant les battues, ma vigueur et mon agilité. Sans doute, je ne valais pas un chien pour le flair ou l’intelligence. Pourtant, dans les grands jours, il n’y avait pas de rabatteur capable de m’en remontrer, et je détalais comme si j’avais eu le feu aux trousses.
« Tu m’as l’air d’un garçon ardent et solide, me dit un jour le comte de Linois.
– Oui, monsieur le comte.
– Et fort des bras ?...
– Je lève trois cent vingt.
– Mes compliments ! »
Et ce fut tout. Mais ça ne devait pas en rester là, comme on va le voir.
À l’époque, il y avait dans l’armée une singulière coutume. On sait comment s’opéraient les engagements pour le métier de soldat. Chaque année, des racoleurs venaient fureter à travers le pays. Ils vous faisaient boire plus que de raison. On signait un papier, quand on savait écrire. On y mettait sa croix, quand on ne savait que croiser deux bâtons l’un sur l’autre. C’était tout aussi bon que la signature. Puis, on touchait une couple de cents livres qui étaient bues avant même d’avoir été empochées, on faisait son sac, et on allait se faire casser la tête pour le compte de l’État.
Or, cette façon de procéder n’aurait jamais pu me convenir. Si j’avais le goût de servir, je ne voulais pas me vendre. Je pense que je serai compris de tous ceux qui ont quelque dignité et le respect d’eux-mêmes.
Eh bien, en ce temps-là, lorsqu’un officier avait obtenu un congé, il devait, aux termes des règlements, ramener à son retour une ou deux recrues. Les sous-officiers, eux aussi, étaient tenus à cette obligation. Le prix de l’engagement variait alors de vingt à vingt-cinq livres.
Je n’ignorais rien de tout cela, et j’avais mon projet. Aussi, lorsque le congé du comte de Linois toucha à sa fin, j’allai hardiment lui demander de me prendre comme recrue.
« Toi ? fit-il.
– Moi, monsieur le comte.
– Quel âge as-tu ?
– Dix-huit ans.
– Et tu veux être soldat ?
– Si ça vous plaît.
– Ce n’est pas si ça me plaît, c’est si ça te plaît à toi !
– Ça me plaît.
– Ah ! l’appât des vingt livres ?...
– Non, l’envie de servir mon pays. Et, comme j’aurais honte de me vendre, je ne prendrai pas vos vingt livres.
– Comment te nommes-tu ?
– Natalis Delpierre.
– Eh bien, Natalis, tu me vas.
– Enchanté de vous aller, mon capitaine.
– Et si tu es d’humeur à me suivre, tu iras loin !
– On vous suivra tambour battant, mèche allumée.
– Je te préviens que je vais quitter le régiment de la Fère pour m’embarquer. Ça ne te répugne pas, la mer ?
– Aucunement.
– Bon ! tu la passeras. – Sais-tu que l’on fait la guerre là-bas pour chasser les Anglais de l’Amérique ? »
– Qu’est-ce que c’est, l’Amérique ? »
En vérité, je n’avais jamais entendu parler d’Amérique !
« Un pays au diable, répondit le capitaine de Linois, un pays qui se bat pour conquérir son indépendance ! C’est là que, depuis deux ans déjà, le marquis de Lafayette a fait parler de lui. Or, l’an dernier, le roi Louis XVI a promis le concours de ses soldats pour venir en aide aux Américains. Le comte de Rochambeau va partir avec l’amiral de Grasse et six mille hommes. J’ai formé le projet de m’embarquer avec lui pour le Nouveau-Monde, et, si tu veux m’accompagner, nous irons délivrer l’Amérique.
– Allons délivrer l’Amérique ! »
Voilà, comment, sans en savoir plus long, je fus engagé dans le corps expéditionnaire du comte de Rochambeau et débarquai à New-Port en 1780.
Là pendant trois années, je restai loin de France. Je vis le général Washington, – un géant de cinq pieds onze pouces, avec de grands pieds, de grandes mains, un habit bleu à revers chamois, une cocarde noire. Je vis le marin Paul Jones à bord de son navire le Bonhomme Richard. Je vis le général Anthony Wayne qu’on appelait l’Enragé. Je me battis en plusieurs rencontres, non sans avoir fait le signe de la croix avec ma première cartouche. Je pris part à la bataille de Yorktown, en Virginie, où, après une frottée mémorable, lord Cornwallis se rendit à Washington. Je revins en France en 83. Je m’en étais réchappé sans blessures, simple soldat comme devant. Que voulez-vous, je ne savais pas lire !
Le comte de Linois était rentré avec nous. Il voulait me faire engager dans le régiment de la Fère, où il allait reprendre rang. Or, j’avais comme une idée de servir dans la cavalerie. J’aimais les chevaux d’instinct, et, d’attendre à passer officier monté, il m’aurait fallu des grades, des grades !
Je sais bien qu’il est tentant, l’uniforme de fantassin, et bien avantageux, la queue, la poudre, les ailes de pigeon, les buffleteries blanches en croix. Que voulez-vous ? Le cheval, c’est le cheval, et, toutes réflexions faites, je me trouvais la vocation d’un cavalier.
Donc, je remerciai le comte de Linois, qui me recommanda à son ami, le colonel de Lostanges, et je m’enrôlai dans le régiment de Royal-Picardie.
Je l’aime, ce beau régiment, et que l’on me pardonne si j’en parle avec un attendrissement, ridicule peut-être ! J’y ai fait presque toute ma carrière, estimé de mes chefs, dont la protection ne m’a jamais manqué, et qui m’ont poussé à roue, comme on dit dans mon village.
D’ailleurs, quelques années plus tard, en 92, le régiment de la Fère devait avoir une si singulière conduite dans ses rapports avec le général autrichien Beaulieu, que je ne puis regretter d’en être sorti. Je n’en parlerai plus.
Je reviens donc au Royal-Picardie. On ne pouvait voir plus beau régiment. Il était devenu ma famille. Je lui suis resté fidèle jusqu’au moment où il a été licencié. On y était heureux. J’en sifflais toutes les fanfares et sonneries, car j’ai toujours eu la mauvaise habitude de siffler entre mes dents. Mais on me le passait. Enfin, vous voyez ça d’ici.
Pendant huit ans, je ne fis qu’aller de garnison en garnison. Pas la moindre occasion de faire le coup de feu avec l’ennemi. Bah ! cette existence n’est pas sans charmes, quand on sait la prendre par le bon côté. Et puis, de voir du pays, c’est quelque chose pour un Picard picardisant comme je l’étais. Après l’Amérique, un peu de la France, en attendant d’emboîter le pas dans les grandes étapes à travers l’Europe. Nous étions à Sarrelouis en 85, à Angers en 88, en 91, en Bretagne, à Josselin, à Pontivy, à Ploërmel, à Nantes, avec le colonel Serre de Gras, en 92, à Charleville, avec le colonel de Wardner, le colonel de Lostende, le colonel La Roque, et en 93, avec le colonel Le Comte.
Mais j’oublie de dire que, le 1er janvier 91, était intervenue une loi qui modifiait la composition de l’armée. Le Royal-Picardie fut classé 20e régiment de cavalerie de bataille. Cette organisation dura jusqu’en 1803. Toutefois, le régiment ne perdit pas son ancien titre. Il resta Royal-Picardie, quand, depuis quelques années, il n’y avait plus de roi en France.
Ce fut sous le colonel Serre de Gras que l’on me fit brigadier, à ma grande satisfaction. Sous le colonel de Wardner, on me nomma maréchal des logis, ce qui me fit plus de plaisir encore. J’avais alors treize ans de service, une campagne et pas de blessure. C’était un bel avancement, on en conviendra. Je ne pouvais m’élever plus haut, puisque, je le répète, je ne savais ni lire ni écrire. Par exemple, je sifflais toujours, et pourtant, c’est peu convenable pour un sous-officier de faire concurrence aux merles.
Le maréchal des logis Delpierre ! N’y avait-il pas de quoi tirer vanité et se mettre en frappe ! Aussi, quelle reconnaissance je gardai au colonel de Wardner, bien qu’il fût rude comme du pain d’orge et qu’il fallût, avec lui, entendre à la parole ! Ce jour-là, les soldats de ma compagnie fusillèrent mon sac, et je me fis poser sur les manches des galons qui ne devaient jamais me monter jusqu’au coude.
Nous étions en garnison à Charleville, lorsque je demandai et obtins un congé de deux mois, qui me fut accordé. C’est précisément l’histoire de ce congé que j’ai tenu à rapporter fidèlement. Voici mes raisons.
Depuis que je suis à la retraite, j’ai eu souvent à raconter mes campagnes pendant nos veillées au village de Grattepanche. Les amis m’ont compris tout de travers, ou même si peu que pas. Tantôt l’un rapportait que j’avais été à droite, quand c’était à gauche ; tantôt l’autre, que c’était à gauche, quand j’avais été à droite. Et alors, des disputes qui n’en finissaient pas entre deux verres de cidre ou deux cafés – deux petits pots. C’est surtout, ce qui m’était arrivé pendant mon congé en Allemagne sur quoi on ne s’entendait point. Or, puisque j’ai appris à écrire, c’est bien le cas de prendre la plume pour raconter l’histoire de ce congé. Je me suis donc mis à la besogne, bien que j’aie aujourd’hui soixante-dix ans. Mais ma mémoire est bonne, et, quand je me retourne en arrière, j’y vois clair assez. Ce récit est donc dédié à mes amis de Grattepanche, aux Ternisien, aux Bettembos, aux Irondart, aux Pointefer, aux Quennehen, à bien d’autres, et j’espère qu’ils ne se disputeront plus à mon sujet.
J’avais donc obtenu mon congé le 7 juin 1792. Sans doute, il circulait alors quelques bruits de guerre avec l’Allemagne, mais très vagues encore. On disait que l’Europe, bien que cela ne la regardât en aucune façon, voyait d’un mauvais œil ce qui se passait en France. Le roi était toujours aux Tuileries, si l’on veut. Cependant, le 10 août se sentait déjà, et il soufflait comme un vent de république sur le pays.
Aussi, par prudence, je ne crus pas devoir dire pourquoi je demandais un congé. En effet, j’avais affaire en Allemagne et même en Prusse. Or, au cas de guerre, j’aurais été fort empêché de me trouver à mon poste. Que voulez-vous ? On ne peut pas à la fois sonner et suivre la procession.
D’ailleurs, bien que mon congé fût de deux mois, j’étais décidé à l’abréger, s’il le fallait. Toutefois, j’espérais encore que les choses n’en viendraient pas au pire.
Maintenant, pour en finir avec ce qui me concerne et ce qui concerne mon brave régiment, voici ce que j’ai à vous raconter en peu de mots.
D’abord, on verra dans quelles circonstances je commençai d’apprendre à lire, puis à écrire – ce qui devait me mettre à même de devenir officier, général, maréchal de France, comte, duc, prince, tout comme un Ney, un Davout ou un Murat pendant les guerres de l’Empire. En réalité, je ne parvins pas à dépasser le grade de capitaine – ce qui est encore très beau pour un fils de paysan, paysan lui-même.
Quant au Royal-Picardie, il me suffira de quelques lignes pour achever son histoire.
Il avait eu en 93, comme je l’ai dit, M. Le Comte pour colonel. Et ce fut cette année-là que, par suite du décret du 21 février, de régiment il devint demi-brigade. Il fit alors les campagnes de l’armée du Nord et de l’armée de Sambre-et-Meuse jusqu’en 1797. Il se distingua aux combats de Lincelles et de Courtray, où je fus fait lieutenant. Puis, après avoir séjourné à Paris de 97 à 1800, il compta dans l’armée d’Italie et s’illustra à Marengo, en enveloppant six bataillons de grenadiers autrichiens, qui mirent bas les armes, après la déroute d’un régiment hongrois. Dans cette affaire, je fus blessé d’une balle à la hanche – ce dont je ne me plaignis pas, car cela me valut d’être nommé capitaine.
Le régiment de Royal-Picardie ayant été licencié en 1803, j’entrai dans les dragons, je fis toutes les guerres de l’Empire et pris ma retraite en 1815.
Maintenant, lorsque je parlerai de moi, ce sera uniquement pour raconter ce que j’ai vu ou fait pendant mon congé en Allemagne. Mais, qu’on ne l’oublie pas, je suis peu instruit. Je n’ai guère l’art de dire les choses. Ce ne sont que des impressions sur lesquelles je ne cherche point à raisonner. Et surtout, si, dans ce simple récit, il m’échappe des expressions ou tournures picardes, vous les excuserez : je ne saurais parler autrement. J’irai vite et vite, d’ailleurs, et ne mettrai pas deux pieds dans un soulier. Je dirai tout aussi, et, puisque je vous demande la permission de m’exprimer sans réserve, vous me répondrez, je l’espère : « Toute liberté, monsieur ! »
II
À l’époque, ainsi que je l’ai appris depuis dans les livres d’histoire, l’Allemagne était encore partagée en dix Cercles. Plus tard, de nouveaux remaniements établirent la confédération du Rhin, vers 1806, sous le protectorat de Napoléon, puis la confédération germanique en 1815. L’un de ces Cercles, comprenant les électorats de Saxe et de Brandebourg, portait alors le nom de Cercle de la Haute-Saxe.
Cet électorat de Brandebourg devait devenir plus lard une des provinces de la Prusse et se diviser en deux districts, le district de Brandebourg et le district de Postdam.
Je dis cela afin que l’on sache bien où se trouve la petite ville de Belzingen, située dans le district de Postdam, vers la partie sud-ouest, à quelques lieues de la frontière.
C’est à cette frontière que j’arrivai le 16 juin, après avoir franchi les cent cinquante lieues qui la séparent de la France. Si j’avais mis neuf jours à faire ce trajet, cela tenait à ce que les communications n’étaient pas faciles. J’avais usé plus de clous de souliers que de fers de chevaux ou de roues de voilures – de charrettes, pour mieux dire. De plus, je n’étais pas sur mes œufs, comme disent les Picards. Je ne possédais que les maigres économies de ma paye, et voulais dépenser le moins possible. Fort heureusement, pendant mon séjour de garnison à la frontière, j’avais pu retenir quelques mots d’allemand, d’où plus de facilité pour me tirer d’embarras. Toutefois, il eût été difficile de cacher que j’étais Français. Aussi, plus d’un regard de travers me fut-il envoyé au passage. Par exemple, je m’étais bien gardé de dire que je fusse le maréchal des logis Natalis Delpierre. On approuvera ma sagesse dans ces circonstances, puisque l’on pouvait craindre une guerre avec la Prusse et l’Autriche, – l’Allemagne tout entière, quoi !
À la frontière du district, j’eus une bonne surprise.
J’étais à pied. Je me dirigeais vers une auberge pour y déjeuner, l’auberge du Ecktvende, – en français le Tourne-Coin. Après une nuit assez fraîche, un beau matin se levait. Joli temps. Le soleil de sept heures buvait la rosée des prairies. Tout un fourmillement d’oiseaux sur les hêtres, les chênes, les ormes, les bouleaux. Peu de culture dans la campagne. Bien des champs en friche. D’ailleurs, le climat est dur en ce pays.
À la porte du Ecktvende attendait une petite carriole, attelée d’un maigre bidet, capable, tout juste, de faire ses deux petites lieues à l’heure, si on ne lui donnait pas trop de côtes à monter.
Une femme se trouvait là, une femme grande, forte, bien constituée, corsage avec des bretelles enjolivées de passements, chapeau de paille orné de rubans jaunes, jupe à bandes rouges et violettes – le tout bien ajusté, très propre, comme l’eut été un vêtement de dimanche ou de jour de fête.
Et, en vérité, c’était bien jour de fête pour cette femme, si ce n’était pas dimanche !
Elle me regardait, et je la regardais me regarder.
Tout à coup, elle ouvre les bras, ne fait ni une ni deux, court à moi et s’écrie :
« Natalis !
– Irma ! »
C’était elle, c’était ma sœur. Elle m’avait reconnu. Véritablement, les femmes ont plus d’œil que nous pour ces reconnaissances qui viennent du cœur – ou tout au moins, un œil plus prompt. C’est qu’il y avait treize ans bientôt que nous ne nous étions vus, et l’on comprend si je m’ennuyais d’elle !
Comme elle était conservée encore, et bien allante ! Elle me rappelait notre mère, avec ses yeux grands et vifs, et aussi ses cheveux noirs, qui commençaient à blanchir aux tempes.
Je l’embrassai à bouche que veux-tu sur ses deux bonnes joues, rougies par le hâle de la campagne, et je vous prie de croire qu’à son tour, elle fit claquer les miennes !
C’était pour elle, pour la voir que j’avais demandé un congé. Je commençais à m’inquiéter qu’elle fût hors de France, au moment où les cartes menaçaient de se brouiller. Une Française au milieu de ces Allemands, si la guerre venait à être déclarée, cela pouvait causer de grands embarras. En pareil cas, mieux vaut être dans son pays. Et, si ma sœur le voulait, je la ramènerais avec moi. Pour cela, il lui faudrait quitter sa maîtresse, Mme Keller, et je doutais qu’elle y consentît. Enfin, ce serait à examiner.
« Quelle joie de nous revoir, Natalis, me dit-elle, de nous retrouver, et si loin de notre Picardie ! Il me semble que tu m’apportes un peu du bon air de là-bas ! Que nous aurons été de temps sans nous rencontrer !
– Treize ans, Irma !
– Oui, treize ans ! Treize ans de séparation ! Que c’est long, Natalis !
– Chère Irma ! » répondis-je.
Et nous voilà, nous deux ma sœur, allant et venant, bras dessus bras dessous, le long de la route.
« Et comment va ? lui dis-je.
– Toujours à peu près, Natalis. Et toi ?...
– Tout de même !
– Et puis, maréchal des logis ! En voilà un, d’honneur, pour la famille !
– Oui, Irma, et un grand ! Qui aurait jamais pensé que le petit gardeur d’oies de Grattepanche deviendrait maréchal des logis ! Mais il ne faut pas le crier trop haut.
– Pourquoi ?... Dis un peu pour voir !...
– Parce que, de raconter que je suis soldat, ce ne serait pas sans inconvénients dans ce pays. Au moment où il court des bruits de guerre, c’est déjà grave pour un Français de se trouver en Allemagne. Non ! Je suis ton frère, monsieur Rien du tout, qui est venu voir sa sœur.
– Bien, Natalis, on sera muette là-dessus, je te le promets.
– Ce sera prudent, car les espions allemands ont de bonnes oreilles !
– Sois tranquille !
– Et même, si tu veux suivre mon conseil, Irma, je te ramènerai avec moi en France ! »
Les yeux de ma sœur marquèrent un gros chagrin, et elle me fit la réponse que je prévoyais.
« Quitter madame Keller, Natalis ! Quand tu l’auras vue, tu comprendras que je ne peux pas la laisser seule ! »
Je le comprenais déjà, et je remis cette affaire à plus tard.
Cela dit, Irma avait repris ses bons yeux, sa bonne voix. Elle n’arrêtait plus de me demander des renseignements sur le pays, sur les personnes.
« Et notre sœur Firminie ?...
– En parfaite santé. J’ai eu de ses nouvelles par notre voisin Létocard, qui est venu, il y a deux mois, à Charleville. Tu te rappelles bien Létocard ?
– Le fils du charron !
– Oui ! Tu sais ou tu ne sais pas, Irma, qu’il est marié à une Matifas !
– La fille de ce vieux pépère de Fouencamps ?
– Lui-même. Il m’a dit que notre sœur ne se plaignait pas de la santé. Ah ! on a travaillé et on travaille dur à Escarbotin ! Puis, ils en ont quatre, d’enfants, et le dernier, difficile... Un hardi page ! Par bonheur, un mari honnête, bon ouvrier, et pas trop soiffard, sauf le lundi. Enfin, elle a encore bien de la peine à son âge !
– Elle est déjà ancienne !
– Dame ! cinq ans de plus que toi, Irma, et quatorze de plus que moi ! Cela compte !... Que veux-tu ? C’est une femme courageuse, comme tu l’es !
– Oh ! moi, Natalis ! Si j’ai connu le chagrin, ça n’a jamais été que le chagrin des autres ! Depuis que j’ai quitté Grattepanche, je n’ai plus eu de misère ! Mais, de voir souffrir près de soi, quand on n’y peut rien... »
Le visage de ma sœur s’était assombri de nouveau. Elle détourna la conversation.
« Et ton voyage ? me demanda-t-elle.
– Il s’est bien passé ! Du temps assez beau pour la saison ! Et comme tu le vois, j’ai de solides jambes ! D’ailleurs, qu’est-ce que la fatigue, quand on est sûr d’être bien reçu à l’arrivée !
– Comme tu dis, Natalis, et l’on te fera bon accueil, et on t’aimera dans la famille comme on m’aime !
– Excellente madame Keller ! Sais-tu bien, ma sœur, que je ne la reconnaîtrai pas ! Elle est encore pour moi la demoiselle de monsieur et madame Acloque, de braves gens de Saint-Sauflieu. Quand elle s’est mariée, il y a bientôt vingt-cinq ans de cela, je n’étais qu’un gamin à l’époque. Mais notre père et notre mère en disaient tant de bien que ça m’est resté.
– Pauvre femme, dit alors Irma, elle est bien changée, bien moyenne maintenant ! Quelle épouse elle a été, Natalis, et surtout quelle mère elle est encore !
– Et son fils ?...
– Le meilleur des fils, qui s’est courageusement mis au travail pour remplacer son père, mort il y a quinze mois.
– Brave monsieur Jean !
– Il adore sa mère, il ne vit que pour elle, comme elle ne vit que pour lui !
– Je ne l’ai jamais vu, Irma, et je brûle de le connaître. Il me semble que je l’aime déjà, ce jeune homme !
– Ça ne m’étonne pas, Natalis. C’est par moi que cette amitié te vient.
– Alors, en route, ma sœur.
– En route.
– Minute ! À quelle distance sommes-nous de Belzingen ?
– Cinq grandes lieues.
– Bah ! répondis-je, si j’étais seul, j’enlèverais cela en deux heures ! Mais il faudra...
– Bon ! Natalis, j’irai plus vite que toi !
– Avec tes jambes !
– Non, avec les jambes de mon cheval ! »
Et Irma me montrait la carriole toute attelée à la porte de l’auberge.
« C’est toi, demandai-je, qui es venue me chercher dans cette carriole ?
– Oui, Natalis, afin de te ramener à Belzingen. Je suis partie à bonne heure, ce matin, et j’étais ici à sept heures tapant. Et même, si la lettre que tu nous as fait écrire était arrivée plus tôt, je serais allée te chercher plus loin.
– Oh ! c’était inutile, ma sœur. Allons, en route ! Tu n’as rien à payer à l’auberge ? J’ai là quelques kreutzers...
– Merci, Natalis, c’est fait, et, maintenant, il ne nous reste plus qu’à partir. »
Pendant que nous parlions, l’aubergiste du Ecktvende, appuyé sur sa porte, semblait écouter, sans en avoir l’air.
Cela ne me satisfit pas autrement. Peut-être aurions-nous mieux fait d’aller bavarder plus loin ?
Ce cabaretier, un gros homme, tout en mont, avait une figure déplaisante, des yeux en trous de vrille, à paupières plissées, un nez pincé, une grande bouche, comme si, quand il était petit, on lui eût donné sa bouillie avec un sabre. Enfin la mauvaise face d’un haricotier de mauvaise race !
Après tout, nous n’avions point dit de choses compromettantes. Peut-être n’avait-il rien entendu de notre entretien ! D’ailleurs, s’il ne savait pas le français, il n’avait pu comprendre que je venais de France.
Nous montâmes dans la carriole. Le cabaretier nous regarda partir, sans avoir fait un geste.
Je pris les guides, je poussai vivement le bidet. Nous filions comme le vent de janvier. Cela ne nous empêchait pas de causer encore, et Irma put me mettre au courant de tout.
Aussi, par ce que je savais déjà et par ce qu’elle m’apprit, vous allez connaître ce qui concerne la famille Keller.
III
Mme Keller, née en 1747, avait alors quarante-cinq ans. Originaire de Saint-Sauflieu, ainsi que je l’ai dit, elle appartenait à une famille de petits propriétaires. M. et Mme Acloque, ses père et mère, d’aisance très modeste, avaient vu leur petite fortune diminuer d’année en année par suite des nécessités de la vie. Ils moururent à peu de temps l’un de l’autre, vers 1765. La jeune fille resta aux soins d’une vieille tante, dont le décès devait bientôt la laisser seule au monde.
C’est dans ces conditions qu’elle fut recherchée par M. Keller, qui était venu en Picardie pour son commerce. Il l’exerça même pendant dix-huit mois à Amiens et dans les environs, où il s’occupait des transports de marchandises. C’était un homme sérieux, de bonne tournure, intelligent, actif. À l’époque, nous n’avions pas encore pour les gens de race allemande la répulsion que devaient inspirer plus tard les haines nationales, entretenues par trente ans de guerre. M. Keller jouissait d’une certaine fortune, qui ne pouvait que s’accroître par son zèle et son entente des affaires. Il demanda donc à Mlle Acloque si elle consentirait à devenir son épouse.
Mlle Acloque hésita, parce qu’il lui faudrait quitter Saint-Sauflieu, et sa Picardie à laquelle son cœur l’attachait. Et puis, ce mariage ne devait-il pas lui faire perdre sa qualité de Française ? Mais alors elle ne possédait plus pour tout bien qu’une petite maison qu’il serait nécessaire de vendre. Que deviendrait-elle après ce dernier sacrifice ? Aussi Mme Dufrenay, la vieille tante, sentant sa fin approcher, et s’effrayant de la situation dans laquelle se trouverait sa nièce, la pressait-elle de conclure.
Mlle Acloque consentit. Le mariage fut célébré à Saint-Sauflieu. Mme Keller quitta la Picardie quelques mois plus tard, et suivit son mari au-delà de la frontière.
Mme Keller n’eut point à se repentir du choix qu’elle avait fait. Son mari fut bon pour elle comme elle fut bonne pour lui. Toujours prévenant, il s’attachait à ce qu’elle ne sentît pas trop qu’elle avait perdu sa nationalité. Ce mariage, tout de raison et de convenance, ne compta donc que des jours heureux, – ce qui, rare de notre temps, l’était déjà à cette époque.
Un an après, à Belzingen, où restait Mme Keller, un fils lui était né. Elle voulut se consacrer tout entière à l’éducation de cet enfant, dont il va être question dans notre histoire.
Ce fut quelque temps après la naissance de ce fils, vers 1771, que ma sœur Irma, âgée alors de dix-neuf ans, entra dans la famille Keller. Mme Keller l’avait connue toute enfant, lorsqu’elle-même n’était encore qu’une fillette. Notre père avait été quelquefois employé par M. Acloque. Sa dame et sa demoiselle s’intéressaient à sa situation. De Grattepanche à Saint-Sauflieu il n’y a pas loin. Mlle Acloque rencontrait souvent ma sœur, elle l’embrassait, elle lui faisait de petits cadeaux, elle l’avait prise en amitié – amitié que le plus pur dévouement devait reconnaître un jour.
Aussi, lorsqu’elle apprit la mort de notre père et de notre mère, qui nous laissaient presque sans ressources, Mme Keller eut-elle l’idée de faire venir Irma, qui s’était déjà louée chez une personne à Saint-Sauflieu. À quoi ma sœur consentit volontiers, et ce dont elle n’eut jamais à se repentir.
J’ai dit que M. Keller était de sang français par ses ancêtres. Voici comment :





























