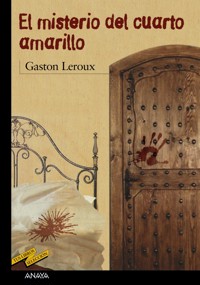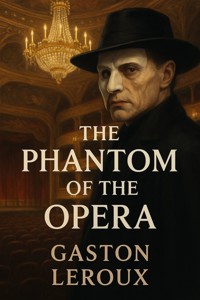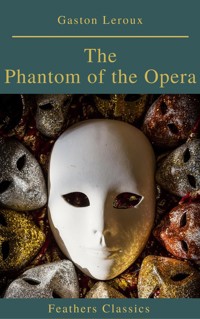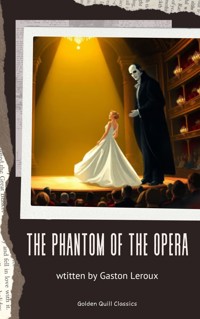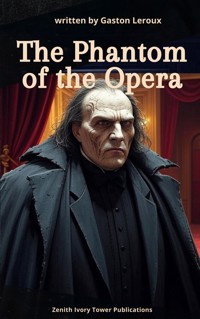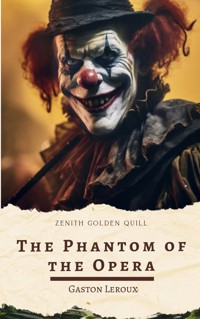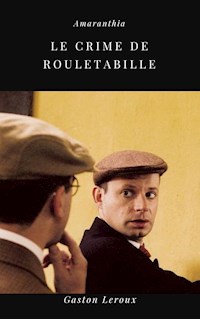
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Rouletabille se trouve accusé du meurtre d'un éminent professeur et de sa femme, Ivana, qui était la collaboratrice de ce dernier. Dans cette aventure, Leroux renoue avec les premières enquêtes de Rouletabille, surtout à la fin du livre où les révélations se déroulent au tribunal. Le narrateur de cette histoire se trouve être de nouveau Sainclair, qui racontait les premières aventures de Rouletabille.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Crime de Rouletabille
I. – Réflexions et souvenirs d’un amiII. – Masques et visagesIII. – Le baiser sur la terrasseIV. – ConfidencesV. – Théodora LuigiVI. – Le drameVII. – Où Rouletabille redevient RouletabilleVIII. – La tuerieIX. – HypothèsesX. – Nouvelles précisions et nouveaux doutesXI. – La petite maison de PassyXII. – Étrange attitude de RouletabilleXIII. – Ce qu’avait vu Rouletabille – dans la petite maison de PassyXIV. – Coup de théâtreXV. – Rouletabille en prisonXVI. – Une lettre recommandéeXVII. – Nouvelles hypothèsesXVIII. – Étrange aventure de Rouletabille – dans un sleeping-carXIX. – Où il est démontré une fois de plus – que la fortune vient en dormantXX. – Quelque chose qui brillait dans l’ombreXXI. – TénèbresXXII. – La foudreXXIII. – Le chaosXXIV. – La lumièrePage de copyrightI. – Réflexions et souvenirs d’un ami
Avec quelle émotion nouvelle, à plus de dix ans de distance, moi, Sainclair, je reprends une plume qui a tracé le sensationnel rapport du « Mystère de la chambre jaune » et les premiers hauts faits du jeune reporter de L’Époque, pour faire connaître, dans ses détails insoupçonnés, cette affaire retentissante dite : « Le Crime de Rouletabille », sombre tragédie où roulent d’effroyables ténèbres et sur le seuil de laquelle apparaît le doux monstre à la tête de sphinx : l’éternel féminin !… Pauvre Rouletabille ! Lui, à qui aucun problème jusqu’alors n’avait résisté, lui, dont l’intelligence avait sondé tous les abîmes ouverts devant la Raison, je l’ai vu, un instant, frissonner, éperdu devant deux yeux de femme comme devant le chaos !…
On a relaté autre part le drame bulgare au milieu duquel le jeune reporter était allé chercher celle qui devait devenir sa femme et qu’il avait vue pour la première fois dans la salle de garde de la Pitié, car Ivana était venue toute jeune à Paris pour y étudier la médecine.
Cette Ivana Vilitchkov, d’une étrange beauté, appartenait à l’une des plus illustres familles de Sofia, qui avait été mêlée de façon atroce aux malheurs tragiques de Stamboulof et de ses amis. Tous ces incidents sont connus. Tous les journaux ont reproduit le récit des scènes sanglantes qui, en marge du conflit des Balkans, avaient été comme le sinistre prologue d’une radieuse union consacrée à la Madeleine au milieu du Tout-Paris.
Après la grande guerre, Ivana s’était remise à ses travaux de médecine et de laboratoire. On peut dire qu’elle avait tout quitté pour se consacrer entièrement à l’Institut Roland Boulenger. À mes yeux, c’était un désastre et la faute en avait été pour beaucoup à Rouletabille qui, écœuré de la mauvaise foi avec laquelle tout ce qui était officiel essayait d’étouffer les efforts d’un homme que l’École et l’Académie affectaient de traiter comme un charlatan, se laissa trop facilement convaincre par Ivana qui avait épousé la querelle du célèbre praticien. Vous connaissez notre Rouletabille ! Il ne se donne pas à moitié. Ses articles mirent le feu aux poudres. Il affirmait audacieusement que la méthode de travail de Roland Boulenger triomphait déjà en Amérique et il faisait prévoir que, pour peu que la France se montrât, une fois de plus, ingrate envers l’un de ses enfants, celui-ci fuirait pour s’exiler comme tant d’autres, irait porter son génie à l’étranger.
En réalité, Roland Boulenger a-t-il eu du génie ? Nous le saurons peut-être prochainement. Je l’ai toujours cru un peu faiseur. Assurément il ne savait point être simple. Il était trop bel homme et avait la parole trop fleurie. Son charme était certain. Les femmes en raffolaient et ses conférences auxquelles elles ne comprenaient rien étaient le rendez-vous des élégantes, comme au temps de Caro. Avec cela, il était très mondain, ce qui ne l’empêchait pas de travailler douze heures par jour. Son esprit d’invention se répandait dans tous les domaines. C’était là son crime. Avait-on assez ri de son nouveau fusil à percussion latérale ? et de son nouveau système d’engrenage pour moteurs d’autos ? et de son nouveau procédé de champagnisation ? Cependant des sociétés s’étaient formées qui exploitaient ses brevets et qui ne paraissaient point s’être ruinées…
Après avoir fait rire, il avait fait rugir. C’était quand il avait eu la prétention sacrilège de revenir sur les travaux de Pasteur en ressuscitant la génération spontanée. Il affirmait que rien n’avait été définitivement prouvé à ce sujet et ses très curieux travaux sur la sensibilité, l’anesthésie et la génération des métaux conduisaient, il faut bien l’avouer, à des hypothèses inconnues et jamais encore envisagées. Son dernier effort portait sur le bacille de la tuberculose et il avait inauguré dans son Institut une nouvelle sérumthérapie qui avait été l’objet de tous les espoirs et de toutes les fureurs. La vérité était que les résultats avaient été contradictoires et, de lui-même, il avait suspendu les traitements, répondant aux hurleurs qu’avant la fin de l’année il aurait tué le bacille de Koch.
Ce n’était un secret pour personne que son nouveau système avait pour point de départ le singulier privilège qu’ont les poules quand on leur inocule la tuberculose humaine de former des kystes où le microbe persiste fort longtemps sans se généraliser, de sorte que l’altération tuberculeuse reste locale.
Depuis plus d’un an, les jardins de l’Institut Roland Boulenger, derrière l’Observatoire, étaient devenus un vaste poulailler. Je savais que Ivana y vivait en fermière le jour et en secrétaire du grand homme une partie de ses nuits. Rouletabille avait ce qui restait. Tant mieux pour lui s’il trouvait la vie rose. Moi ça ne m’aurait pas plu, bien que je ne doutasse point de l’amour d’Ivana pour son époux, mais je suis d’avis qu’il ne faut pas trop tenter la vertu…
Il y a quinze jours que je n’avais vu ni l’un ni l’autre – nous étions fin juillet quand, en sortant du Palais où je pensais bien ne plus retourner qu’après vacations, je me heurtai à Rouletabille.
– Mon cher Sainclair, j’allais chez toi. Nous t’emmenons à Deauville.
– À Deauville ! m’écriai-je, Ivana qui aime tant la vraie campagne… Je ne vois pas Ivana à Deauville. Elle déteste les snobs !
– Mon cher, elle s’est fait faire des robes. Je ne la reconnais plus. Ce sont les Boulenger qui nous emmènent. Ils m’ont chargé de t’inviter. Et Ivana compte sur toi.
– C’est bien vrai, ce mensonge-là ? interrogeai-je encore…
Rouletabille quitta alors son air enjoué :
– C’est moi qui te prie de venir ! viens !…
Quand je rentrai chez moi, je m’affalai devant mon bureau et, me prenant la tête dans les mains, je fermai les yeux. Ce n’était pas la figure énigmatique d’Ivana qui m’apparaissait maintenant, dans la nuit de mes paupières closes, mais une charmante tête blonde, aux yeux d’un bleu céleste, au sourire en fleur, au front virginal.
Cette pureté m’avait séduit sans qu’elle s’en doutât, la chère enfant, par un beau matin de printemps où il y avait du soleil nouveau sur les quais et dans les boîtes des bouquinistes. Elle était accompagnée de sa bonne vieille maman, qui lui cherchait je ne sais quel livre de classe dont elle avait besoin pour passer ses examens. Cela avait dix-sept ans. Cela n’avait jamais quitté les jupes de sa mère. Cela habitait dans le quartier. Cela n’était point pauvre, mais honnête. Situation modeste, excellente famille, mœurs irréprochables, un héritage de vertus. Cela ignorait toutes les horreurs de la capitale. J’épousai…
Au moins, je savais ce que je faisais, moi ! J’avais pris mes renseignements, j’avais étudié ma belle petite oie blanche de près, pendant des mois. Je n’étais pas allé chercher une fille indomptée dans les Balkans… et tout de suite, ainsi que je l’avais prévu, je fus tranquillement heureux, comme je le désirais. J’eus grand soin, du reste, d’entourer mon bonheur de toutes les précautions raisonnables. Comme j’étais fort amoureux, je me rendais parfaitement compte qu’il y avait en moi l’étoffe d’un jaloux, d’autant que je n’étais plus de la première jeunesse. Aussi ne recevais-je chez moi, en dehors de Rouletabille, que de vieux camarades qui ne pouvaient pas me porter ombrage…
Eh bien ! j’eus la preuve un beau jour (je n’ai rien à cacher, hélas ! puisque mon infortune n’a été que trop publique) que ces yeux candides, ce front de vierge, ces boucles d’enfant, cette bouche naïve, toute cette pureté me trompaient !
Après cela on s’étonnera que je ne croie plus à rien !
On s’étonnera que je termine tout par des points d’interrogation… Ah ! Rouletabille, quand tu me pris pour avocat dans cette affaire terrible, tu savais combien mon cœur avait souffert de la trahison d’un être adoré… et que le tien ne trouverait nulle part un plus sensible écho à ta douleur, dans ces moments où tu croyais tout perdu.
II. – Masques et visages
Ayant reçu une lettre de Mme Boulenger qui m’invitait à venir passer quelques jours aux Chaumes où se trouvaient déjà Rouletabille et Ivana, je partis pour Deauville…
Les Chaumes étaient une des plus belles villas du pays avec une certaine affectation de style rustique qui n’excluait point la magnificence. Les Boulenger étaient très riches. Le chirurgien encore pauvre, mais déjà célèbre par ses premiers travaux, avait épousé Mme Hugon, jeune veuve du vieux Monsieur Hugon qui avait fait une grosse fortune dans les phosphates siciliens ; ce mariage avait permis au praticien de délaisser sa clinique pour se livrer presque exclusivement à ses travaux de laboratoire.
Mme Boulenger approchait maintenant de la quarantaine, mais elle montrait encore une grande fraîcheur de visage, et elle n’était point sans une certaine coquetterie un peu sévère et qui allait bien à son genre, si j’ose dire… Quel était donc le genre de Mme Boulenger ? Il consistait surtout dans une austère amabilité, qui n’était certes point dépourvue de charme pour ceux et pour celles que son mari introduisait à son foyer.
Elle savait dépouiller la savante qu’elle était devenue à l’école de son mari, car cette femme qui n’avait qu’une éducation purement littéraire, s’était mise à la médecine et à la chimie comme une écolière, avait forcé les portes du laboratoire où Roland s’enfermait, et était devenue son premier préparateur. Les élèves du maître ne se gênaient point pour dire qu’elle avait sa grande part dans les derniers succès de l’Institut Boulenger, mais de tels propos l’horripilaient et elle fermait impatiemment la bouche aux indiscrets, et même à son mari, quand on effleurait ce sujet.
Elle n’avait d’autre joie que la gloire de Roland, d’autre plaisir que celui de lui être agréable. Elle l’entourait de soins presque maternels. Son égalité d’humeur, qui était parfaite en toutes circonstances, faisait du foyer des Boulenger quelque chose de rare. Elle en avait tout le mérite, car ce diable d’homme était doué d’une activité qui se dépensait en tous sens. On me comprendra.
Roland Boulenger, qui n’était guère plus âgé que sa femme, avait eu et continuait d’avoir les plus belles aventures du monde. Il ne perdait son temps en rien : chacun savait cela et Thérèse (c’était le nom de Mme Boulenger) n’ignorait point que son époux menait de pair le travail et le plaisir. Il n’y mettait point toujours de la discrétion. Elle était la première à en sourire et, si elle souffrait, cela ne se voyait guère. À une allusion un peu trop précise de ses amis qui tentaient de la plaindre, elle répondait :
– Oh ! moi, il y a longtemps que je ne suis plus qu’un pur esprit ! J’aime Roland pour son intelligence et pour son grand cœur d’honnête homme. Le reste n’a pas d’importance, c’est des bêtises !
De fait, elle n’était tracassée que de la santé de son mari qui se surmenait trop… L’année précédente, lors de la grande passion de Boulenger pour Théodora Luigi, elle avait été effrayée de l’état de dépérissement rapide dans lequel elle le voyait. Alors là, elle s’était révoltée :
– Je veux bien que mon mari s’amuse, avait-elle dit à Rouletabille, mais je ne veux pas qu’elles me le tuent !
Elle avait été instruite que Théodora était une grande fumeuse d’opium, et que son imagination de courtisane savait créer au plaisir des décors fameux mais redoutables. Elle se jeta aux pieds de son mari :
– Ça, lui dit-elle, tu n’as pas le droit. Ta santé ne t’appartient pas !… Elle appartient à la science, à tous ceux que tu peux sauver !… Mon Roland ! Écoute-moi !… Tu sais que je ne te dis jamais rien… je suis avec toi comme une bonne maman quand son grand enfant fait des frasques : je détourne la tête… mais regarde ton pauvre visage, tu me fais pleurer.
Elle avait été sublime, cette femme. C’était une sainte. Et comme Boulenger n’était ni un misérable, ni un sot, il avait compris qu’elle avait raison et il l’avait serrée sur son cœur.
Il s’était laissé emmener quelques semaines dans le midi. Quand Thérèse avait ramené son mari à Paris, Théodora Luigi était partie pour un long voyage avec le prince Henri d’Albanie… Roland était sauvé !…
J’arrivai à Deauville par le train de midi. Rouletabille était à la gare. Il me donna de bonnes nouvelles de tous. Nous échangeâmes quelques propos sans importance, et bientôt l’auto s’arrêtait devant la porte des Chaumes. Je fus étonné de voir que personne ne venait au-devant de nous, Rouletabille, en me conduisant à une chambre, me dit qu’on déjeunait très tard à Deauville et que le professeur travaillait jusqu’à une heure.
– Comment ? ici aussi ? Mais ta femme ne travaille pas ?…
– Le professeur, Ivana, Mme Boulenger sont enfermés tous les trois avec leur grand rapport sur le dernier état de leurs travaux relatifs à la tuberculose des gallinacés.
– Charmante villégiature !… Eh bien ! et toi, tu ne travailles pas ?
– Non, moi, je m’amuse !
– À quoi ?
– À faire des pâtés de sable !…
– On va donc à la mer, à Deauville !…
– Oui… moi ! les enfants et les nourrices !
Là-dessus, il me quitta, car il avait quelqu’un à voir qu’il était sûr de rencontrer à La Potinière, à cette heure-ci, où toute la clique du Tout-Paris s’écrasait… Quelques instants plus tard, je descendis dans le jardin, qui était vaste, avec d’admirables corbeilles de fleurs et de beaux coins d’ombrage… Les domestiques mettaient le couvert sous des arbres au lointain. Plus près, j’aperçus soudain Mme Boulanger, qui, souriante, venait au-devant de moi. Je m’avançai vers elle, en longeant le mur de la villa. Au-dessus de moi une fenêtre était ouverte et j’entendis distinctement ces mots que prononçait Ivana :
– Je vous en prie ! Je vous en prie… laissez ma main ! Oh ! maître, vous êtes insupportable.
Je n’oublierai jamais l’accent de ce « Je vous en prie ! » Certes était douce la prière, et nullement menaçante… J’étais un peu pâle quand j’abordai Mme Boulenger. Il me paraissait impossible qu’elle n’eût pas entendu. J’avais bien entendu, moi !… et Thérèse n’était guère alors plus éloignée que moi de la fenêtre… Mais sans doute me trompai-je, car sa figure ne changea point et elle me souhaita la bienvenue avec un naturel parfait.
Ivana et Boulenger ne tardèrent point, du reste, à se montrer. Il me sembla, dès l’abord, qu’ils affectaient une correction un peu exagérée, mais cette impression dura peu devant la bonne humeur charmante d’Ivana et l’entrain du professeur.
Tous deux marquèrent un grand plaisir de me revoir. Ils ne dissimulaient point que ma présence serait surtout utile à Rouletabille qui était un peu délaissé.
– C’est la faute de ce damné rapport et de ces damnées poules qui ne nous ont pas encore livré tout leur secret ! mais dans quelques jours, nous en aurons fini avec les paperasses, je l’espère, et alors quelles randonnées en auto ! nous tournons le dos à La Potinière et en route pour la Bretagne ! Première étape : une omelette chez la mère Poulard.
Il rayonnait cet homme, il y avait de la flamme dans ses yeux sombres, aux cavités inquiétantes qui donnaient parfois à réfléchir… Certains prétendaient qu’il ne s’était attaqué avec tant d’ardeur au problème de la tuberculose que parce qu’il était atteint lui-même de la terrible maladie…
Nous nous mîmes à table. Le déjeuner fut délicieux. Rouletabille était revenu de La Potinière avec les dernières histoires de la nuit. On n’avait vidé les salles de jeu qu’à quatre heures du matin et les plus enragés s’étaient vengés de l’administration qui les mettait à la porte en emportant les instruments du jazz-band et en faisant un tapage d’enfer. C’est dans cet équipage qu’ils étaient arrivés chez Léontine qui avait dû se relever, leur ouvrir la porte de son bar et leur faire à souper. Et là, ils s’étaient remis à jouer, un jeu terrible, aux dés. Le gros Berwick avait forcé un petit reporter, Ramel, de Dramatica, à jouer les cinq louis qu’il avait dans sa poche. Vers les huit heures du matin le petit Ramel gagnait vingt-cinq mille francs. Il en profitait immédiatement pour se commander une soupe à l’oignon.
Je rapporte tous ces détails pour que l’on se rende tout de suite compte du ton et de l’air des gens. Dans le moment même que nous nous égayions tous ainsi, apparemment sans arrière-pensée, Roland Boulenger qui donnait la réplique à Rouletabille, cherchait le pied d’Ivana, sous la table. J’en avais la preuve. Que les passions impétueuses rendent les hommes enfants et menteurs ! Je regardai ce masque enjoué qui, dans le moment même, était tourné sur nous, et sur lequel j’apercevais, moi, le vrai visage dionysiaque de Roland. Cet homme commettait en ce moment une action abominable et je crois pouvoir dire qu’il ne s’en doutait pas !
Plus j’y pense et plus je crois qu’il faut chercher le trait essentiel de ce caractère dans la naïveté de son égoïsme extrême. Réellement, cette insouciance un peu sauvage, cette violence aristocratique des passions, cette activité de vainqueur souriant, cet individualisme farouche, c’est ce qui m’apparaissait en Roland Boulenger, beaucoup plus que cette âme généreuse d’apôtre et de savant vouée au salut de l’humanité, qui paraissait éblouir tant de gogos, et cette pauvre Thérèse en particulier. Nous aurons l’occasion de reparler d’Ivana.
« Eh quoi ! pensai-je, serais-je seul à m’apercevoir de ce qui se passe ?… et faut-il qu’un esprit aussi délié que celui de Rouletabille ne voie rien de ces manœuvres. Et s’il s’en est aperçu, quel est mon rôle ici et que suis-je venu y faire ?… »
III. – Le baiser sur la terrasse
Le soir, après dîner, nous allâmes au Casino. On était en pleine saison. C’était une folie. Où donc tous ces gens trouvent-ils tant d’argent ? Mais vous pensez bien que je ne vais pas faire le censeur ni découvrir une salle de baccara. Dans le privé, j’ai vu, en quelques coups de cartes, passer des centaines et des centaines de mille francs. Mais ce qui me stupéfiait le plus, c’était la richesse des toilettes des femmes et leur tranquille indécence. Je sais bien que je suis vieux jeu, vieux Palais, tout ce que l’on voudra, mais il y a des limites à tout. Ces dos nus ! Enfin !…
Je constatai avec plaisir qu’Ivana avait une toilette originale dans sa simplicité, mais de fort bon goût. Bien qu’elle ne fût pas décolletée jusqu’à la ceinture, sa robe de tulle noir pailleté, garnie de cabochons noirs, n’était pas la moins regardée. Ivana avait dans les cheveux un bandeau de gros cabochons de jais, fixant une mantille. On eût dit un Goya. Le professeur ne la quittait pas. Mais ils nous quittèrent. Évidemment, on ne se promène pas comme une noce dans les salons d’un casino.
Je retrouvai Rouletabille et Mme Boulenger causant dans un coin près des portes-fenêtres ouvertes sur les terrasses. Nous nous assîmes tous trois dans des rocking-chairs et goûtâmes la fraîcheur de la nuit lunaire, ce qui n’était pas un luxe après l’étouffement des salons de jeu…
Nous étions là depuis quelques instants, rêvant chacun de notre côté, lorsque j’aperçus distinctement dans l’une des allées qui conduisent à la plage, deux silhouettes qui venaient de sortir de l’ombre, traversaient un petit espace de clarté et rentraient dans l’obscurité.
J’avais reconnu tout de suite, dans les deux promeneurs solitaires, Roland Boulenger et Ivana.
Roland tenait la main d’Ivana sur ses lèvres et y prolongeait un baiser que la brusque lumière avait surpris. Il y avait eu à ce moment un geste de retrait d’Ivana, mais Roland avait maintenu sa position et il s’était enfoncé dans l’ombre avec sa captive.
De loin, nous dominions la scène qui avait duré quelques secondes. Nous-mêmes étions dans l’ombre et, d’en bas, l’on ne pouvait nous voir. Du reste, les deux personnages qui me préoccupaient ne semblaient guère penser à nous. Ils nous avaient complètement oubliés.
Et maintenant, je dois vous dire que cette rapide vision m’avait complètement bouleversé, non pour moi assurément, mais pour les deux êtres qui étaient assis à mes côtés. Il me paraissait impossible qu’ils n’eussent point vu ce que j’avais si bien vu, moi ! Cependant, Rouletabille n’avait point bougé. Quant à Mme Boulenger, elle se leva en disant :
– Vous ne trouvez pas qu’il fait un peu frais ? Si l’on rentrait ?
Nous nous levâmes à notre tour et la suivîmes jusque dans la salle de la boule où elle s’amusa à jouer sur les numéros et où elle gagna une vingtaine de francs, avec des démonstrations de joie enfantine. Comme nous quittions la boule, en nous retournant, nous nous trouvâmes nez à nez avec Roland et Ivana qui, depuis un instant, regardaient jouer.
– Tiens, fit Mme Boulenger, vous voilà ! Où étiez-vous donc ?
– Dans la lune… répondit le professeur, si vous saviez ce qu’il fait beau dehors !
– Si l’on rentrait à pied ? » proposa Thérèse. Nous reprîmes le chemin de la villa. Roland et Ivana étaient devant nous, à une certaine distance. Nous marchions tous en silence…
IV. – Confidences
J’étais décidé à parler à Rouletabille. Un instant j’avais pensé à précipiter mon départ par le jeu de quelque télégramme me rappelant à Paris et à laisser derrière moi des choses qui ne me regardaient pas. Et puis, j’avais réfléchi que Rouletabille était un ami et que c’était agir en égoïste que ne point lui ouvrir les yeux s’il les avait fermés. Depuis ma propre aventure, rien ne m’étonne plus de l’aveuglement des hommes. Il n’est point de cire plus chaude qui, en se refroidissant, devienne plus solide que le baiser d’une femme sur deux paupières… et voilà de fameux scellés ! La dame peut se promener à l’aise dans la lumière, l’autre n’y voit plus goutte ! On a beau s’appeler Rouletabille, on a beau s’appuyer en marchant sur « le bon bout de la raison », on trébuche comme les autres dans le même fossé au fond duquel vous trouvez votre honneur en miettes et votre foyer en cendres.
Le lendemain matin, comme j’étais à ma fenêtre, en train de me faire la barbe, je vis sortir de la villa le professeur et Ivana à cheval. Ils étaient montés sur de belles bêtes impatientes et les cavaliers ne paraissaient point non plus dénués d’une certaine ardeur animale qui me les montrait déjà grisés de l’air un peu pointu du matin et de la course qu’ils allaient fournir.
Ivana montait en homme et pressait de ses cuisses nerveuses une jument demi-sang que le garçon d’écurie avait peine à retenir. Roland avait les pommettes roses et je lui trouvai un sourire un peu féroce lorsque, tourné vers la villa, il fit un signe d’adieu avant de partir. Je crus que ce signe s’adressait à Mme Boulenger, mais, en me penchant, j’aperçus à la fenêtre de sa chambre Rouletabille qui me demanda comment j’avais passé la nuit. On entendait le trot des chevaux qui s’éloignait rapidement.
– Eh bien ! et toi, tu ne fais pas de cheval ? demandai-je.
– Ma foi non ! ça ne me dit rien dans ce pays. Il y a trop d’automobiles sur les routes.
– Oh ! à cette heure-ci…
– Et puis, je vais te dire… je les ai accompagnés une fois… que ce soit à cheval, que ce soit à pied, ils ne parlent, dans leurs promenades, que de leurs poules et de la tuberculose… J’aime autant rester ici.
La journée se passa sans incidents. Je remarquai de plus en plus que nous existions de moins en moins pour le professeur et Ivana. Ils ne s’occupaient que d’eux. Je trouvai qu’en ce qui nous concernait, c’était assez mélancolique et, le lendemain, je dis à Rouletabille :
– Allons déjeuner ensemble au Havre.
– Entendu ! Je vais prévenir ici ! fit-il.
– À quoi bon ? répliquai-je. On ne s’apercevra même pas de notre absence.
Il me regarda en souriant et, me donnant une petite tape sur l’épaule :
– Allons ! je vois que tu as à me parler.
– Peut-être !…
Une heure après, nous prenions le bateau à Trouville et, au Havre, je l’emmenai déjeuner chez Frascati. Pendant la courte traversée, Rouletabille m’avait parlé, avec beaucoup de liberté d’esprit, de ses projets pour l’hiver, d’un grand voyage de reportage qu’il voulait faire en Syrie et en Mésopotamie.
– Et Ivana ? demandai-je.
– Oh ! elle ne me laissera pas partir seul…
– En es-tu sûr ?
– Que veux-tu dire ?
– Dame ! ses travaux avec Roland Boulenger…
– Oh ! je crois qu’à cette époque elle pourra prendre un congé…
– Eh bien, tant mieux… appuyai-je.
Il ne releva point ce tant mieux. Je crois même qu’il ne l’entendit point. Il me montrait les prodigieuses cheminées d’un transatlantique qui dépassaient toutes les constructions du port dans lequel nous faisions alors notre entrée et il m’entretenait déjà du plaisir qu’il prenait aux longs voyages sur mer, de l’admirable repos qu’ils procuraient. Il regrettait seulement l’installation du sans fil, qui donnait à chaque instant des nouvelles d’un monde dont on était autrefois si parfaitement coupé.
– Eh ! eh ! fis-je, je ne te croyais pas si ami de la retraite. Deviendrais-tu misanthrope ?
– Je n’ai aucune raison de le devenir ! me répondit-il nettement et en levant sur moi, un regard qui me gêna.
Si bien, qu’à Frascati, je ne savais, moi, comment engager la conversation à laquelle j’étais si bien résolu.
Ce fut lui qui me tira d’affaire en me jetant, tout à coup, dans le moment que je le croyais entièrement occupé par le dépècement d’une patte de homard :
– Eh ! bien ! voyons ! dis-moi ce qui te tracasse ?
– Tu ne le devines pas ? fis-je.
– Parle toujours ! nous verrons bien après !
– Je trouve que Roland Boulenger fait bien l’enfant gâté…
– Il l’a toujours été… ça n’est pas nouveau…
– Qu’il ait été gâté par sa femme et même par d’autres, cela m’est parfaitement indifférent, répliquai-je, mais…
– Allons ! interrompit Rouletabille, toujours en se battant avec son crustacé, je vois ce qui te chagrine. Tu trouves qu’il prend bien des libertés avec Ivana…
Je fis oui de la tête… Il continua :
– Tu trouves même qu’Ivana les lui laisse bien facilement prendre ?
Je ne répondis pas, mais mon silence était éloquent.
Sur ces entrefaites, un intrus vint serrer la main du reporter. On parla de choses et d’autres. Notre conversation ne reprit qu’au dessert.
– Tu penses bien que je n’ai pas attendu ton arrivée ici, fit-il, pour m’apercevoir du jeu qui s’y joue…
– Un jeu ? relevais-je. Il est bien dangereux !
– Non, répliqua-t-il, péremptoire, avec Ivana, je ne crains rien !
– Tu as tort !
– Qu’est-ce que tu dis ?
– Je dis que tu as tort ! En principe, tu as raison d’avoir la plus grande confiance en ta femme, qui est la plus honnête des femmes… mais en pratique, quand la plus honnête des femmes se prête à ce jeu-là, même en toute innocence… eh bien ! je te dis que son mari peut avoir tout à redouter !…
Rouletabille fronça le sourcil, resta silencieux, quelques secondes, puis laissa tomber ces mots :
– Mon bon Sainclair… tu es excusable de parler ainsi !…
Je rougis, car il venait de toucher une plaie vive… Il s’aperçut qu’il m’avait fait de la peine et m’en demanda pardon sur-le-champ.
– Hélas ! fis-je en secouant douloureusement la tête, si nous sommes de vrais amis, je crois que nous n’hésiterons pas à nous faire de la peine l’un et l’autre dans cette affaire…
– Dans cette affaire ?… Voilà un bien gros mot pour quelques galanteries mondaines auxquelles personne, jusqu’à ton arrivée ici, n’a attaché importance !
– Si ! m’écriai-je… Il y a quelqu’un qui a attaché de l’importance à ces galanteries-là !…
– Et qui ?
– Toi ! mon cher, toi ! qui m’as fait venir ici ! toi qui as été le premier à mettre la conversation sur ce sujet… parce que… parce que tu trouvais que je n’y arrivais pas assez vite !
– Eh bien ! c’est exact ! avoua Rouletabille. Tu as raison ! Je t’ai fait venir à cause de ça ! J’ai voulu que tu voies… Alors ça crève les yeux ?
– Mon pauvre ami.
Rouletabille pâlit.
– Cette fois, dit-il, tu vas trop loin ! je ne suis pas encore ton pauvre ami et j’espère bien ne jamais le devenir !… Tu vas savoir ce qui se passe… car il ne se passe rien que je ne le sache…
– Je suis heureux de t’entendre parler ainsi… Rouletabille a toujours su tout, avant tout le monde… Tu ne m’étonnes donc pas ! Cependant tu m’excuseras de te demander si tu sais qu’avant le déjeuner, dans le bureau, Roland Boulenger s’est saisi de la main d’Ivana et l’a si impatiemment pressée que ta femme a dû le supplier de cesser ces déclarations d’amitié ?
– Oui, je sais cela !
– Sais-tu que, pendant le déjeuner, la botte de Roland est allée chercher, sous la table, le soulier d’Ivana ?
– Je ne l’ignore pas.
– Et que le soir, dans les jardins, devant la terrasse du casino, Ivana a abandonné à Roland cette main qu’elle lui avait ôtée le matin et qu’il a couverte de baisers ?
– Les misérables ! s’écria Rouletabille en éclatant de rire…
Je le regardai dans l’ahurissement le plus parfait…
– Tu trouves ça risible ? balbutiai-je.
– Eh ! mon Dieu, oui ! tu ne penses pas que je vais pleurer pour des enfantillages pareils ! Si tu connaissais Roland Boulenger tu saurais qu’il ne peut pas avoir une femme à côté de lui sans se livrer à quelque manifestation plus ou moins extravagante, mais cela n’a de conséquence que pour celles qui le veulent bien…
– Tout de même, avoue que tu n’es pas tranquille, car si tu sais tout cela, c’est que tu ne cesses de surveiller ta femme…
– Je suis tout à fait tranquille et je ne surveille pas ma femme ! si je sais tout cela, c’est que c’est elle qui me renseigne ! Ah ! te voilà bien attrapé, bon Sainclair !