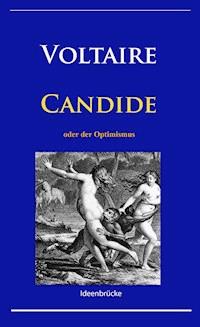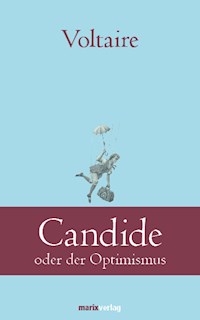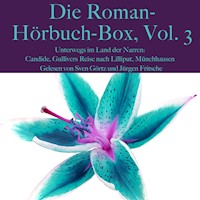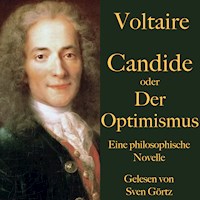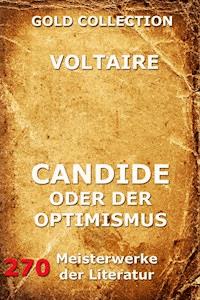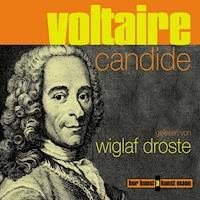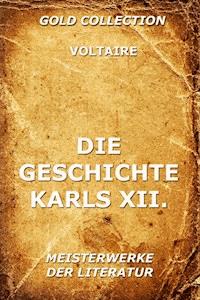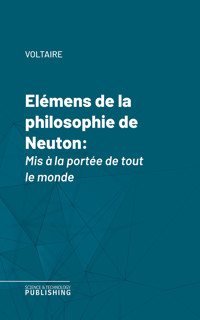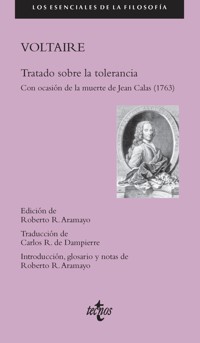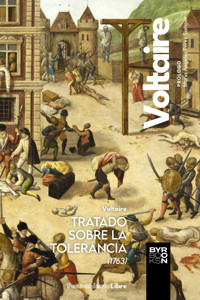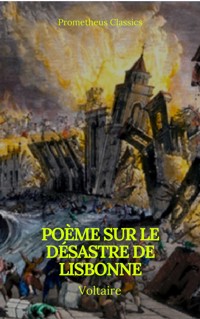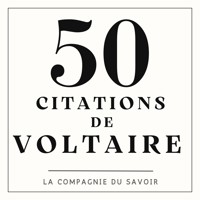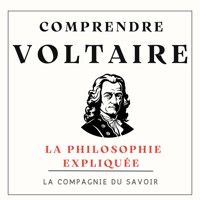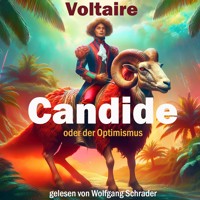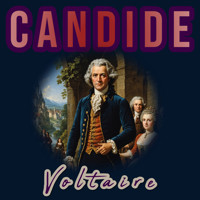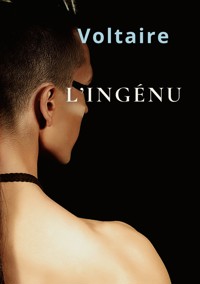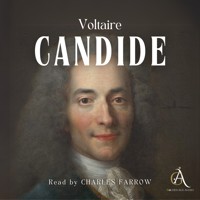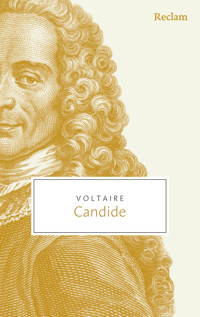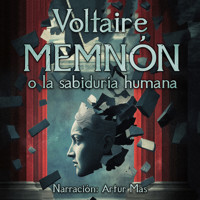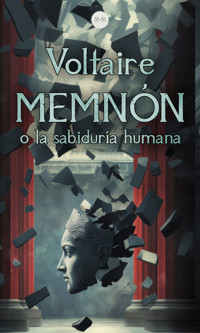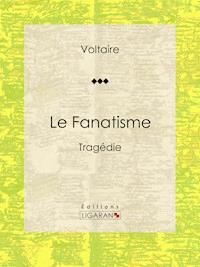
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "ZOPIRE : Qui ? moi, baisser les yeux devant ses faux prodiges ! Moi, de ce fanatique encenser les prestiges ! L'honorer dans la Mecque après l'avoir banni ! Non. Que des justes dieux Zopire soit puni Si tu vois cette main, jusqu'ici libre et pure, Caresser la révolte et flatter l'imposture ! PHANOR : Nous chérissons en vous ce zèle paternel Du chef auguste et saint du sénat d'Ismaël ; Mais ce zèle est funeste ; et tant de résistance, Sans lasser Mahomet, irrite..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335067361
©Ligaran 2015
L’historique des destinées de cette pièce fameuse est exposé dans l’Avis de l’éditeur. Nous n’avons que quelques détails à y ajouter. La troupe qui représenta Mahomet à Lille est celle de l’acteur et auteur tragique Lanoue. Le mari de la nièce de Voltaire, Mme Denis, avait été envoyé à Lille en qualité de commissaire-ordonnateur des guerres. Voltaire et Mme du Châtelet allèrent passer quelques jours auprès du jeune ménage. Le théâtre de Lille était alors dirigé par Lanoue, avec qui Voltaire avait été en relations lorsque le roi de Prusse lui avait demandé de lui recruter une troupe de comédiens. Quand ils se retrouvèrent à Lille, au commencement de l’année 1741, Lanoue proposa à Voltaire de jouer Mahomet sur son théâtre. Voltaire s’empressa d’accepter. « On dira que je ne suis plus qu’un auteur de province, écrit-il à d’Argental ; mais j’aime encore mieux juger moi-même de l’effet que fera cet ouvrage dans une ville où je n’ai point de cabale à craindre, que d’essuyer encore les orages de Paris. »
La représentation eut lieu au mois d’avril, avec un tel succès qu’il fallut jouer la pièce quatre fois. « Et de ces quatre représentations, écrit l’auteur, il y en a eu une chez l’intendant, en faveur du clergé qui a voulu absolument voir un fondateur de religion. »
Pendant la première représentation, Voltaire se leva tout à coup dans sa loge, et, une dépêche à la main qu’il venait de recevoir du roi de Prusse, il demanda le silence et annonça la victoire que Frédéric venait de remporter à Molwitz. L’assemblée battit des mains.
Voltaire parut enchanté de ses interprètes : « Lanoue, avec sa physionomie de singe, a joué le rôle de Mahomet bien mieux que n’eût fait Dufresne. Cela n’est pas vraisemblable, mais cela est très vrai. Le petit Baron s’est tellement perfectionné, a eu un jeu si naturel, des mouvements si passionnés, si vrais et si tendres, qu’il faisait pleurer tout le monde comme on saigne du nez. »
Voltaire fit grand bruit de ce succès, qui devint aussitôt la nouvelle de l’Europe.
De retour à Paris au commencement de l’année suivante, il lut sa pièce aux grands seigneurs, aux dames illustres, aux ministres, à tout le monde. Il en communiqua le manuscrit au cardinal de Fleury, qui n’y trouva rien à relever que quelques fautes de style. Enfin Mahomet parut à la Comédie-Française, le 29 août 1742, devant une brillante assemblée. Mais les protestations furent vives, et l’auteur, un peu à l’invitation du cardinal, crut devoir retirer son ouvrage après trois représentations. Le 22 août, en partant de Paris, il écrit à d’Argental : « Que dit M. de la Marche de ses confrères de Paris qui ont instrumenté si pédantesquement contre mon prophète ? Que dira M. le cardinal de Tencin ? Que dira madame sa sœur de nos convulsionnaires en robe longue qui ne veulent pas qu’on joue le Fanatisme, comme on dit qu’un premier président ne voulait pas qu’on jouât Tartuffe ? Puisque, me voilà la victime des jansénistes, je dédierai Mahomet au pape, et je compte être évêque in partibus infidelium, attendu que c’est là mon véritable diocèse. »
On sait qu’il mit à exécution ce singulier projet, et qu’en flattant l’amour-propre littéraire de Benoît XIV, il obtint la lettre papale qui est en tête de toutes les éditions de sa tragédie.
« Lambertini, dit M. G. Desnoiresterres, n’ignorait pas quel esprit était Voltaire, et il n’était pas dupe de ses protestations d’orthodoxie. En somme, ces avances de l’auteur des Lettres philosophiques ne pouvaient déplaire ; elles le condamnaient à plus de réserve : qui savait même si cet échange de bons procédés n’aurait pas d’action, sinon sur ses idées, du moins sur sa conduite ? On crut en France qu’en proclamant Mahomet une admirable tragédie, Benoît XIV était tombé dans un piège grossier, et il fut traité de pauvre homme par un clergé peu au fait de ces finesses italiennes. En réalité, c’était du savoir-vivre, de la bienveillance, un atticisme souriant… Benoît XIV n’avait cru qu’échanger des politesses avec le plus bel esprit de France. Mais Voltaire songeait à tirer le plus honnête profit d’un document qui était un argument triomphant à opposer aux attaques de ses ennemis.
Vraiment, écrivait-il à d’Argental (5 octobre 1745), les grâces célestes ne peuvent trop se répandre, et la lettre du saint-père est faite pour être publique. Il est bon, mon respectable ami, que les persécuteurs des gens de bien sachent que je suis couvert contre eux de l’étole du vicaire de Dieu. »
Mahomet n’en restait pas moins interdit en France ; mais, au milieu des querelles qui s’élevèrent entre le parlement et le clergé à quelques années de là cette interdiction fut levée, et Mahomet fut repris à la scène le 30 septembre 1751, pendant que le poète était à Berlin.
Ce fut Lekain qui joua le rôle de Séide. Lekain n’avait que vingt et un ans. Il en était encore à ses débuts difficiles ; mais il impressionna vivement la salle entière, et aida par la force de son jeu au succès définitif de la tragédie.
On trouvera des détails historiques sur Mahomet dans l’avis de l’éditeur. On y reconnaît la main de M. de Voltaire. Nous ajouterons ici qu’en 1741 Crébillon refusa d’approuver la tragédie de Mahomet, non qu’il aimât les hommes qui avaient intérêt à faire supprimer la pièce, ni même qu’il les craignît, mais uniquement parce qu’on lui avait persuadé que Mahomet était le rival d’Atrée. M. d’Alembert fut chargé d’examiner la pièce, et il jugea quelle devait être jouée : c’est un de ses premiers droits à la reconnaissance des hommes et à la haine des fanatiques, qui n’ont cessé depuis de le faire déchirer dans des libelles périodiques. La pièce fut jouée alors telle qu’elle est ici. Quelque temps après, les comédiens supprimèrent le délire de Séide, parce qu’il leur paraissait difficile à bien rendre, et la police trouva mauvais que Mahomet dit à Zopire :
En conséquence, on a dit pendant longtemps :
ce qui faisait un sens ridicule.
Le quatrième acte de Mahomet est imité du Marchand de Londres de Lillo ; ou plutôt le moment où Zopire prie pour ses enfants, celui où Zopire mourant les embrasse et leur pardonne, sont imités de la pièce anglaise. Mais qu’un homme qui assassine sans défense un vieillard vertueux et son bienfaiteur soit toujours intéressant et noble, c’est ce qu’on voit dans Mahomet, et qu’on ne voit que dans cette pièce. Le fanatisme est le seul sentiment qui puisse ôter l’horreur d’un tel crime, et la faire tomber tout entière sur les instigateurs.
J’ai cru rendre service aux amateurs des belles-lettres de publier une tragédie du Fanatisme, si défigurée en France par deux éditions subreptices. Je sais très certainement qu’elle fut composée par l’auteur en 1736, et que dès lors il en envoya une copie au prince royal, depuis roi de Prusse, qui cultivait les lettres avec des succès surprenants, et qui en fait encore son délassement principal.
J’étais à Lille en 1741, quand M. de Voltaire y vint passer quelques jours ; il y avait la meilleure troupe d’acteurs qui n’ait jamais été en province. Elle représenta cet ouvrage d’une manière qui satisfit beaucoup une très nombreuse assemblée : le gouverneur de la province et l’intendant y assistèrent plusieurs fois. On trouva que cette pièce était d’un goût si nouveau, et ce sujet si délicat parut traité avec tant de sagesse, que plusieurs prélats voulurent en voir une représentation par les mêmes acteurs dans une maison particulière. Ils jugèrent comme le public.
L’auteur fut encore assez heureux pour faire parvenir son manuscrit entre les mains d’un des premiers hommes de l’Europe et de l’Église, qui soutenait le poids des affaires avec fermeté, et qui jugeait des ouvrages d’esprit avec un goût très sûr dans un âge où les hommes parviennent rarement, et où l’on conserve encore plus rarement son esprit et sa délicatesse. Il dit que la pièce était écrite avec toute la circonspection convenable, et qu’on ne pouvait éviter plus sagement les écueils du sujet ; mais que, pour ce qui regardait la poésie, il y avait encore des choses à corriger. Je sais en effet que l’auteur les a retouchées avec beaucoup de soin. Ce fut aussi le sentiment d’un homme qui tient le même rang, et qui n’a pas moins de lumières.
Enfin l’ouvrage, approuvé d’ailleurs selon toutes les formes ordinaires, fut représenté à Paris le 9 d’août 1742. Il y avait une loge entière remplie des premiers magistrats de cette ville ; des ministres même y furent présents. Ils pensèrent tous comme les hommes éclairés que j’ai déjà cités.
Il se trouva à cette première représentation quelques personnes qui ne furent pas de ce sentiment unanime. Soit que, dans la rapidité de la représentation, ils n’eussent pas suivi assez le fil de l’ouvrage, soit qu’ils fussent peu accoutumés au théâtre, ils furent blessés que Mahomet ordonnât un meurtre, et se servît de sa religion pour encourager à l’assassinat un jeune homme qu’il fait l’instrument de son crime. Ces personnes, frappées de cette atrocité, ne firent pas assez réflexion qu’elle est donnée dans la pièce comme le plus horrible de tous les crimes, et que même il est moralement impossible qu’elle puisse être donnée autrement. En un mot, ils ne virent qu’un côté ; ce qui est la manière la plus ordinaire de se tromper. Ils avaient raison assurément d’être scandalisés, en ne considérant que ce côté qui les révoltait. Un peu plus d’attention les aurait aisément ramenés ; mais, dans la première chaleur de leur zèle, ils dirent que la pièce était un ouvrage très dangereux, fait pour former des Ravaillac et des Jacques Clément.
On est bien surpris d’un tel jugement, et ces messieurs l’ont désavoué sans doute. Ce serait dire qu’Hermione enseigne à assassiner un roi, qu’Électre apprend à tuer sa mère, que Cléopâtre et Médée montrent à tuer leurs enfants ; ce serait dire qu’Harpagon forme des avares ; le Joueur, des joueurs ; Tartuffe, des hypocrites. L’injustice même contre Mahomet