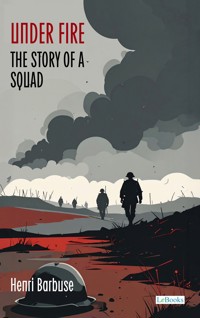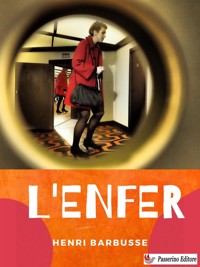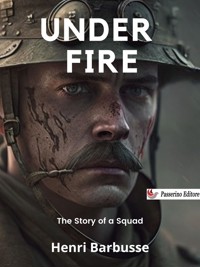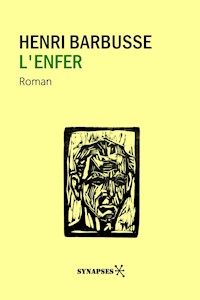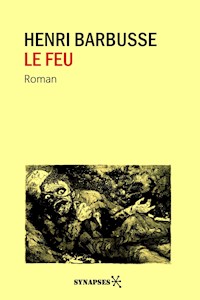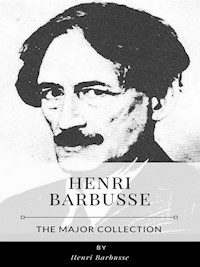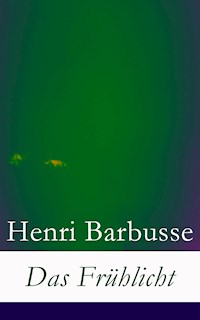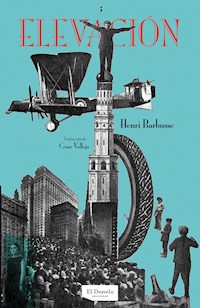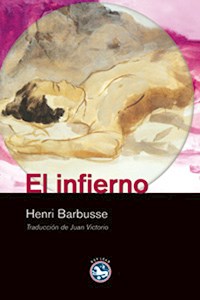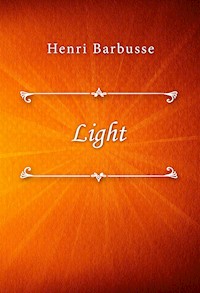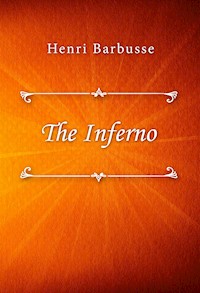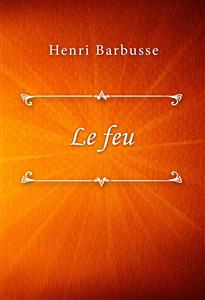
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les années 1915 et 1916 ont marqué, pour Henri Barbusse, des dates décisives. C’est en 1915 qu’il a vécu Le Feu dans les tranchées du Soissonnais, de l’Argonne et de l’Artois, comme soldat d’escouade, puis comme brancardier au 231e régiment d’infanterie où à s’était engagé. C’est en 1916, au cours de son évacuation dans les hôpitaux, qu’il a écrit son livre. Celui-ci, publié par les Editions Flammarion à la fin de novembre, remportera aussitôt après le prix Goncourt. Le Feu est considéré depuis près de trois quarts de siècle dans le monde entier comme un des chefs-d’œuvre de la littérature de guerre, un des témoignages les plus vrais et les plus pathétiques des combattants de première ligne. Le Feu est suivi du Carnet de guerre qui permet de remonter aux sources mêmes de la création du roman épique d’Henri Barbusse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Henri Barbusse
LE FEU
Journal d’une Escouade
Copyright
First published in 1915
Copyright © 2019 Classica Libris
Dédicace
À la mémoire des camarades tombés
à côté de moi à Crouy et sur la cote 119
Chapitre 1
LA VISION
La Dent-du-Midi, l’Aiguille-Verte et le Mont-Blanc font face aux figures exsangues émergeant des couvertures alignées sur la galerie du sanatorium.
Au premier étage de l’hôpital-palais, cette terrasse à balcon de bois découpé, que garantit une véranda, est isolée dans l’espace, et surplombe le monde.
Les couvertures de laine fine – rouges, vertes, havane ou blanches – d’où sortent des visages affinés aux jeux rayonnants, sont tranquilles. Le silence règne sur les chaises longues. Quelqu’un a toussé. Puis, on n’entend plus que de loin en loin le bruit des pages d’un livre, tournées à intervalles réguliers, ou le murmure d’une demande et d’une réponse discrète, de voisin à voisin, ou parfois, sur la balustrade, le tumulte d’éventail d’une corneille hardie échappée aux bandes qui font, dans l’immensité transparente, des chapelets de perles noires.
Le silence est la loi. Au reste, ceux qui, riches, indépendants, sont venus ici de tous les points de la terre, frappés du même malheur, ont perdu l’habitude de parler. Ils sont repliés sur eux-mêmes, et pensent à leur vie et à leur mort.
Une servante parait sur la galerie ; elle marche doucement et est habillée de blanc. Elle apporte des journaux, les distribue.
– C’est chose faite, dit celui qui a déployé le premier son journal, la guerre est déclarée.
Si attendue qu’elle soit, la nouvelle cause une sorte d’éblouissement, car les assistants en sentent les proportions démesurées.
Ces hommes intelligents et instruits, approfondis par la souffrance et la réflexion, détachés des choses et presque de la vie, aussi éloignés du reste du genre humain que s’ils étaient déjà la postérité, regardent au loin, devant eux, vers le pays incompréhensible des vivants et des fous.
– C’est un crime que commet l’Autriche, dit l’Autrichien.
– Il faut que la France soit victorieuse, dit l’Anglais.
– J’espère que l’Allemagne sera vaincue, dit l’Allemand.
Ils se réinstallent sous les couvertures, sur l’oreiller, en face des sommets et du ciel. Mais, malgré la pureté de l’espace, le silence est plein de la révélation qui vient d’être apportée.
– La guerre !
Quelques-uns de ceux qui sont couchés là rompent le silence, et répètent à mi-voix ces mots, et réfléchissent que c’est le plus grand événement des temps modernes et peut-être de tous les temps.
Et même cette annonciation crée sur le paysage limpide qu’ils fixent, comme un confus et ténébreux mirage.
Les étendues calmes du vallon orné de villages roses comme des roses et de pâturages veloutés, les taches magnifiques des montagnes, la dentelle noire des sapins et la dentelle blanche des neiges éternelles, se peuplent d’un remuement humain.
Des multitudes fourmillent par masses distinctes. Sur des champs, des assauts, vague par vague, se propagent, puis s’immobilisent ; des maisons sont éventrées comme des hommes, et des villes comme des maisons, des villages apparaissent en blancheurs émiettées, comme s’ils étaient tombés du ciel sur la terre, des chargements de morts et des blessés épouvantables changent la forme des plaines.
On voit chaque nation dont le bord est rongé de massacres, qui s’arrache sans cesse du cœur de nouveaux soldats pleins de force et pleins de sang ; on suit des yeux ces affluents vivants d’un fleuve de mort.
Au Nord, au Sud, à l’Ouest, ce sont des batailles, de tous côtés, dans la distance. On peut se tourner dans un sens ou l’autre de l’étendue : il n’y en a pas un seul au bout duquel la guerre ne soit pas.
Un des voyants pâles, se soulevant sur son coude, énumère et dénombre les belligérants actuels et futurs : trente millions de soldats. Un autre balbutie, les jeux pleins de tueries :
– Deux armées aux prises, c’est une grande armée qui se suicide.
– On n’aurait pas dû, dit la voix profonde et caverneuse du premier de la rangée.
Mais un autre dit :
– C’est la Révolution française qui recommence.
– Gare aux trônes ! annonce le murmure d’un autre.
Le troisième ajoute :
– C’est peut-être la guerre suprême.
Il y a un silence, puis quelques fronts, encore blanchis par la fade tragédie de la nuit où transpire l’insomnie, se secouent.
– Arrêter les guerres ! Est-ce possible ! Arrêter les guerres ! La plaie du monde est inguérissable.
Quelqu’un tousse. Ensuite, le calme immense au soleil des somptueuses prairies où luisent doucement les vaches vernissées, et les bois noirs, et les champs verts et les distances bleues, submergent cette vision, éteignent le reflet du feu dont s’embrase et se fracasse le vieux monde. Le silence infini efface la rumeur de haine et de souffrance du noir grouillement universel. Les parleurs rentrent, un à un, en eux-mêmes, préoccupés du mystère de leurs poumons, du salut de leurs corps.
Mais quand le soir se prépare à venir dans la vallée, un orage éclate sur le massif du Mont-Blanc.
Il est défendu de sortir, par ce soir dangereux où l’on sent parvenir jusque sous la vaste véranda – jusqu’au port où ils sont réfugiés – les dernières ondes du vent.
Ces grands blessés que creuse une plaie intérieure embrassent des yeux ce bouleversement des éléments : ils regardent sur la montagne éclater les coups de tonnerre qui soulèvent les nuages horizontaux comme une mer, et dont chacun jette à la fois dans le crépuscule une colonne de feu et une colonne de nuée, et bougent leurs faces blêmes aux joues écorchées pour suivre les aigles qui font des cercles dans le ciel et qui regardent la terre d’en haut, à travers les cirques de brume.
– Arrêter la guerre ! disent-ils. Arrêter les orages !
Mais les contemplateurs placés au seuil du monde, lavés des passions des partis, délivrés des notions acquises, des aveuglements, de l’emprise des traditions, éprouvent vaguement la simplicité des choses et les possibilités béantes…
Celui qui est au bout de la rangée s’écrie :
– On voit, en bas, des choses qui rampent.
– Oui… c’est comme des choses vivantes.
– Des espèces de plantes…
– Des espèces d’hommes.
Voilà que dans les lueurs sinistres de l’orage, au-dessous des nuages noirs échevelés, étirés et déployés sur la terre comme de mauvais anges, il leur semble voir s’étendre une grande plaine livide. Dans leur vision, des formes sortent de la plaine, qui est faite de boue et d’eau, et se cramponnent à la surface du sol, aveuglées et écrasées de fange, comme des naufragés monstrueux. Et il leur semble que ce sont des soldats. La plaine, qui ruisselle, striée de longs canaux parallèles, creusée de trous d’eau, est immense, et ces naufragés qui cherchent à se déterrer d’elle sont une multitude… Mais les trente millions d’esclaves jetés les uns sur les autres par le crime et l’erreur, dans la guerre de la boue, lèvent leurs faces humaines où germe enfin une volonté. L’avenir est dans les mains des esclaves, et on voit bien que le vieux monde sera changé par l’alliance que bâtiront un jour entre eux ceux dont le nombre et la misère sont infinis.
Chapitre 2
DANS LA TERRE
Le grand ciel pâle se peuple de coups de tonnerre : chaque explosion montre à la fois, tombant d’un éclair roux, une colonne de feu dans le reste de nuit et une colonne de nuée dans ce qu’il y a déjà de jour.
Là-haut, très haut, très loin, un vol d’oiseaux terribles, à l’haleine puissante et saccadée, qu’on entend sans les voir, monte en cercle pour regarder la terre.
La terre ! Le désert commence à apparaître, immense et plein d’eau, sous la longue désolation de l’aube. Des mares, des entonnoirs, dont la bise aiguë de l’extrême matin pince et fait frissonner l’eau ; des pistes tracées par les troupes et les convois nocturnes dans ces champs de stérilité et qui sont striées d’ornières luisant comme des rails d’acier dans la clarté pauvre ; des amas de boue où se dressent çà et là quelques piquets cassés, des chevalets en X, disloqués, des paquets de fil de fer roulés, tortillés, en buissons. Avec ses bancs de vase et ses flaques, on dirait une toile grise démesurée qui flotte sur la mer, immergée par endroits. Il ne pleut pas, mais tout est mouillé, suintant, lavé, naufragé, et la lumière blafarde a l’air de couler.
On distingue de longs fossés en lacis où le résidu de nuit s’accumule. C’est la tranchée. Le fond en est tapissé d’une couche visqueuse d’où le pied se décolle à chaque pas avec bruit, et qui sent mauvais autour de chaque abri, à cause de l’urine de la nuit. Les trous eux-mêmes, si on s’y penche en passant, puent aussi, comme des bouches.
Je vois des ombres émerger de ces puits latéraux, et se mouvoir, masses énormes et difformes : des espèces d’ours qui pataugent et grognent. C’est nous.
Nous sommes emmitouflés à la manière des populations arctiques. Lainages, couvertures, toiles à sac, nous empaquettent, nous surmontent, nous arrondissent étrangement. Quelques-uns s’étirent, vomissent des bâillements. On perçoit des figures, rougeoyantes ou livides, avec des salissures qui les balafrent, trouées par les veilleuses d’yeux brouillés et collés au bord, embroussaillées de barbes non taillées ou encrassées de poils non rasés.
Tac ! Tac ! Pan ! Les coups de fusil, la canonnade. Au-dessus de nous, partout, ça crépite ou ça roule, par longues rafales ou par coups séparés. Le sombre et flamboyant orage ne cesse jamais, jamais. Depuis plus de quinze mois, depuis cinq cents jours, en ce lieu du monde où nous sommes, la fusillade et le bombardement ne se sont pas arrêtés du matin au soir et du soir au matin. On est enterré au fond d’un éternel champ de bataille ; mais comme le tic-tac des horloges de nos maisons, aux temps d’autrefois, dans le passé quasi légendaire, on n’entend cela que lorsqu’on écoute.
Une face de poupard, aux paupières bouffies, aux pommettes si carminées qu’on dirait qu’on y a collé de petits losanges de papier rouge, sort de terre, ouvre un œil, les deux ; c’est Paradis. La peau de ses grosses joues est striée par la trace des plis de la toile de tente dans laquelle il a dormi la tête enveloppée.
Il promène les regards de ses petits yeux autour de lui, me voit, me fait signe et me dit :
– Encore une nuit de passée, mon pauv’ vieux.
– Oui, fils, combien de pareilles en passerons-nous encore ?
Il lève au ciel ses deux bras boulus. Il s’est extrait, à grand frottement, de l’escalier de la guitoune, et le voilà à côté de moi. Après avoir trébuché sur le tas obscur d’un bonhomme assis par terre, dans la pénombre, et qui se gratte énergiquement avec des soupirs rauques, Paradis s’éloigne, clapotant, cahin-caha, comme un pingouin, dans le décor diluvien.
Peu à peu, les hommes se détachent des profondeurs. Dans les coins, on voit de l’ombre dense se former, puis ces nuages humains se remuent, se fragmentent… On les reconnaît un à un.
En voilà un qui se montre, avec sa couverture formant capuchon. On dirait un sauvage ou plutôt la tente d’un sauvage, qui se balance de droite à gauche et se promène. De près, on découvre, au milieu d’une épaisse bordure de laine tricotée un carré de figure jaune, iodée, peinte de plaques noirâtres, le nez cassé, les yeux bridés, chinois, et encadrés de rose, une petite moustache rêche et humide comme une brosse à graisse.
– V’là Volpatte. Ça ira-t-il, Firmin ?
– Ça va, ça va t’et ça vient, dit Volpatte.
Il a un accent lourd et traînant qu’un enrouement aggrave. Il tousse.
– J’ai attrapé la crève, c’coup-ci. Dis donc, t’as entendu, c’te nuit, l’attaque ? Mon vieux, tu parles d’un bombardement qu’ils ont balancé. Quelque chose de soigné comme décoction !
Il renifle, passe sa manche sous son nez concave. Il fourre sa main dans sa capote et sa veste, cherchant sa peau, et se gratte.
– À la chandelle, j’en ai tué trente ! grommelle-t-il. Dans la grande guitoune, à côté du passage souterrain, mon vieux, tu parles s’il y a quelque chose comme mie de pain mécanique ! On les voit courir dans la paille comme je te vois.
– Qui ça a attaqué, les Boches ?
– Les Boches et nous aussi. C’était du côté de Vimy. Une contre-attaque. T’as pas entendu ?
– Non, répond pour moi le gros Lamuse, l’homme-bœuf. J’ronflais. Faut dire que j’ai été de travaux de nuit, l’autre nuit.
– Moi, j’ai entendu, déclare le petit Breton Biquet. J’ai mal dormi, pas dormi pour mieux dire. J’ai une guitoune individuelle. Ben, tenez, la v’là, c’te putain-là.
Il désigne une fosse qui s’allonge à fleur du sol, et où, sur une mince couche de fumier, il y a juste la place d’un corps.
– Tu parles d’une installation à la noix, constate-t-il en hochant sa rude petite tête pierreuse qui a l’air pas finie, j’ai presque point roupillé : j’étais parti pour, mais j’ai été réveillé par la relève du 129e qui a passé par là. Pas par le bruit, par l’odeur. Ah ! tous ces gars avec leurs pieds à hauteur de ma gueule. Ça m’a réveillé, tellement ça me faisait mal au nez.
Je connais cela. J’ai souvent été réveillé, moi, dans la tranchée, par le sillage de senteur épaisse qu’une troupe en marche traîne avec elle.
– Si ça tuait les gos, seulement, dit Tirette.
– Au contraire, ça les excite, observe Lamuse. Plus t’es dégueulasse, plus tu cocotes, plus t’en as !
– Et c’est heureux, poursuivit Biquet, qu’ils m’ont réveillé en m’emboucanant. Comme je l’racontais tout à l’heure à c’gros presse-papier, j’ai ouvert les carreaux juste à temps pour me cramponner à ma toile de tente qui fermait mon trou et qu’un de ces fumiers-là parlait de m’grouper.
– C’est des crapules dans c’129-là.
On distinguait, au fond, à nos pieds, une forme humaine que le matin n’éclaircissait pas et qui, accroupie, empoignant à pleines mains la carapace de ses vêtements, se trémoussait ; c’était le père Blaire.
Ses petits yeux clignotaient dans une face où végétait largement la poussière. Au-dessus du trou de sa bouche édentée, sa moustache formait un gros paquet jaunâtre. Ses mains étaient sombres, terriblement : le dessus si encrassé qu’il paraissait velu, la paume plaquée d’une dure grisaille. Son individu, recroquevillé et velouté de terre, exhalait un relent de vieille casserole.
Affairé à se gratter, il causait néanmoins avec le grand Barque qui, un peu écarté, se penchait sur lui.
– J’suis pas sale comme ça dans l’civil, disait-il.
– Ben, mon pauv’ vieux, ça doit salement t’changer ! dit Barque.
– Heureusement, renchérit Tirette, parce qu’alors, en fait de gosses, tu f’rais des petits nègres à ta femme !
Blaire se fâcha. Ses sourcils se froncèrent sous son front où s’accumulait la noirceur.
– Qu’est-c’ que tu m’embêtes, toi ? Et pis après ? C’est la guerre. Et toi, face d’haricot, tu crois p’t’être que ça n’te change pas la trompette et les manières la guerre ? Ben, r’garde-toi, bec de singe, peau d’fesse ! Faut-il qu’un homme soye bête pour sortir des choses comme v’là toi !
Il passa la main sur la couche ténébreuse qui garnissait sa figure et qui, après les pluies de ces jours-ci, se révélait réellement indélébile, et il ajouta :
– Et pis, si j’suis comme je suis, c’est que j’le veux bien. D’abord, j’ai pas d’dents. Le major m’a dit d’puis longtemps : « T’as pus une seule piloche. C’est pas assez. Au prochain repos, qu’il m’a dit, va donc faire un tour à la voiture estomalogique. »
– La voiture tomatologique, corrigea Barque.
– Stomatologique, rectifia Bertrand.
– C’est parce que je l’veux bien que j’y suis pas t’été, continua Blaire, pisque c’est à l’œil.
– Alors pourquoi ?
– Pour rien, à cause du changement, répondit-il.
– T’as tout du cuistancier, dit Barque. Tu devrais l’être.
– C’est mon idée, aussi, repartit Blaire, naïvement.
On rit. L’homme noir s’en offusqua. Il se leva.
– Vous m’faites mal au ventre, articula-t-il avec mépris. J’vas aux feuillées.
Quand sa silhouette trop obscurcie eut disparu, les autres ressassèrent une fois de plus cette vérité qu’ici-bas les cuisiniers sont les plus sales des hommes.
– Si tu vois un bonhomme barbouillé et taché de la peau et des frusques, à ne le toucher qu’avec des outils, tu peux t’dire : c’est un cuistot, probab’ ! Et tant plus il est sale, tant plus il est cuistot.
– C’est vrai et véritable, tout de même, dit Marthereau.
– Tiens, v’là Tirloir. Eh ! Tirloir !
Il approche affairé, flairant de-ci, de-là ; sa mince tête, pâle comme le chlore, danse au milieu du bourrelet de son col de capote beaucoup trop épais et large. Il a le menton taillé en pointe, les dents de dessus proéminentes ; une ride, autour de la bouche, profondément encrassée, a l’air d’une muselière. Il est, selon son ordinaire, furieux, et, comme toujours, il rousse :
– On m’a fauché ma musette, c’te nuit !
– C’est la relève du 129. Où c’que tu l’avais mise ?
Il désigne une baïonnette fichée dans la paroi, près d’une entrée de cagna :
– Là, pendue à c’cure-dents qu’est planté ici là.
– Ballot ! s’écrie le chœur. À la portée de la main des soldats qui passent ! T’es pas dingue, non ?
– C’est malheureux, tout de même, gémit Tirloir.
Puis, tout d’un coup, il est pris d’une crise de rage ; sa face se chiffonne, furibonde, ses petits poings se serrent, se serrent, comme des nœuds de ficelle. Il les brandit.
– Alors quoi ? Ah ! si je tenais la carne qui me l’a faite ! Tu parles que j’y casserais la gueule, que j’y défoncerais le bide, que j’y… Y avait dedans un camembert pas entamé. J’vas encore chercher.
Il se frictionne le ventre du poing, à petits coups secs, comme un guitariste, et il s’enfonce dans le gris du matin, à la fois digne et grimaçant, avec sa silhouette engoncée de malade en robe de chambre. On l’entend roussoter jusqu’à disparition.
– C’con-là, dit Pépin.
Les autres ricanent.
– Il est fou et loufoque, déclare Marthereau, qui a coutume de renforcer l’expression de sa pensée par l’emploi simultané de deux synonymes.
– Tiens, p’tit père, dit Tulacque, qui arrive, vise-moi ça ?
Tulacque est magnifique. Il porte une casaque jaune citron, faite au moyen d’un sac de couchage en toile huilée. Il a pratiqué un trou au milieu pour passer la tête et a assujetti, par-dessus cette carapace, ses bretelles de suspension et son ceinturon. Il est grand, osseux. Il tend en avant, lorsqu’il marche, une énergique figure aux yeux louches. Il tient quelque chose à la main.
– J’ai trouvé ça en creusant la terre, cette nuit, au bout du Boyau Neuf, quand on a changé les caillebotis pourris. Ça m’a plu tout de suite, c’t’affutiau. C’est une hache ancien modèle.
Pour un ancien modèle, c’en est un : une pierre pointue emmanchée dans un os bruni. Ça m’a tout l’air d’un outil préhistorique.
– C’est bien en mains, dit Tulacque en maniant l’objet. Mais oui. C’est pas si mal compris que ça. Plus équilibré que la hachette réglementaire. C’est épatant pour tout dire. Tiens, essaye voir… Hein ? Rends-la-moi. J’la garde. Ça m’servira bien ; tu voiras…
Il brandit sa hache d’homme quaternaire et semble lui-même un pithécanthrope affublé d’oripeaux, embusqué dans les entrailles de la terre.
On s’est, un à un, groupés, ceux de l’escouade de Bertrand et de la demi-section, à un coude de la tranchée. En ce point, elle est un peu plus large que dans sa partie droite, où, lorsqu’on se croise, il faut, pour passer, se jeter contre la paroi et frotter son dos à la terre et son ventre au ventre du camarade.
Notre compagnie occupe, en réserve, une parallèle de deuxième ligne. Ici, pas de service de veilleurs. La nuit, nous sommes bons pour les travaux de terrassement à l’avant, mais tant que le jour durera, nous n’aurons rien à faire. Entassés les uns contre les autres et enchaînés coude à coude, il ne nous reste plus qu’à atteindre le soir comme nous pourrons.
La lumière du jour a fini par s’infiltrer dans les crevasses sans fin qui sillonnent cette région de la terre ; elle affleure aux seuils de nos trous. Lumière triste du Nord, ciel étroit et vaseux, lui aussi, chargé, dirait-on, d’une fumée et d’une odeur d’usine. Dans cet éclairement blême, les mises hétéroclites des habitants des bas-fonds apparaissent à cru, dans la pauvreté immense et désespérée qui les créa. Mais c’est comme le tic-tac monotone des coups de fusil et le ronron des coups de canon : il y a trop longtemps que dure le grand drame que nous jouons, et on ne s’étonne plus de la tête qu’on y a prise et de l’accoutrement qu’on s’y est inventé, pour se défendre contre la pluie qui vient d’en haut, contre la boue qui vient d’en bas, contre le froid, cette espèce d’infini qui est partout.
Peaux de bêtes, paquets de couvertures, toiles, passe-montagnes, bonnets de laine, de fourrure, cache-nez enflés, ou remontés en turbans, capitonnages de tricots et surtricots, revêtements et toitures de capuchons goudronnés, gommés, caoutchoutés, noirs, ou de toutes les couleurs – passées – de l’arc-en-ciel, recouvrent les hommes, effacent leurs uniformes presque autant que leur peau, et les immensifient. L’un s’est accroché dans le dos un carré de toile cirée à gros damiers blancs et rouges, trouvé au milieu de la salle à manger de quelque asile de passage : c’est Pépin, et on le reconnaît de loin à cette pancarte d’arlequin plus qu’à sa blême figure d’apache. Ici se bombe le plastron de Barque, taillé dans un édredon piqué, qui fut rose, mais que la poussière et la nuit ont irrégulièrement décoloré et moiré. Là, l’énorme Lamuse semble une tour en ruine avec des restants d’affiches. De la moleskine, appliquée en cuirasse, fait au petit Eudore un dos ciré de coléoptère ; et, parmi tous, Tulacque brille, avec son thorax orange de Grand Chef.
Le casque donne une certaine uniformité aux sommets des êtres qui sont là, et encore ! L’habitude prise par quelques-uns de le mettre soit sur le képi, comme Biquet, soit sur le passe-montagne, comme Cadilhac, soit sur le bonnet de coton, comme Barque, produit des complications et des variétés d’aspect.
Et nos jambes !… Tout à l’heure, je suis descendu, plié en deux, dans notre guitoune, petite cave basse, sentant le moisi et l’humidité, où l’on trébuche sur des boîtes de conserves vides et des chiffons sales et où deux longs paquets gisaient endormis, tandis que dans le coin, à la lueur d’une chandelle, une forme agenouillée fouillait dans une musette… En remontant, j’ai, par le rectangle de l’ouverture, aperçu les jambes. Horizontales, verticales ou obliques, étalées, repliées, mêlées obstruant le passage et maudites par les passants – elles offrent une collection multicolore et multiforme : guêtres, jambières noires et jaunes, hautes et basses, en cuir, en toile tannée, en un quelconque tissu imperméable : bandes molletières bleu foncé, bleu clair, noires, réséda, kaki, beiges… Seul de son espèce, Volpatte a gardé ses petites jambières de la mobilisation. Mesnil André exhibe depuis quinze jours une paire de bas de grosse laine verte à côtes, et on a toujours connu Tirette avec des bandes de drap gris à rayures blanches, prélevées sur un pantalon civil qui pendait on ne sait où, au commencement de la guerre… Marthereau, lui, en a qui ne sont pas du même ton toutes deux, car il n’a pu trouver pour les débiter en lanières deux bouts de capote aussi usés et aussi sales l’un que l’autre. Et il est des jambes emballées dans des chiffons, voire des journaux, maintenues par des spirales de ficelles, ou, ce qui est plus pratique, de fils téléphoniques. Pépin éblouit les copains et les passants avec une paire de guêtres fauves, empruntées à un mort… Barque qui a la prétention (et Dieu sait s’il en devient parfois embêtant, le frère !) d’être un gars débrouillard, riche en idées, a les mollets blancs : il a disposé des bandes de pansement autour de ses houseaux, pour les préserver ; ce blanc forme, au bas de sa personne, un rappel de son bonnet de coton, qui dépasse de son casque et d’où dépasse sa mèche rousse de clown. Poterloo marche depuis un mois dans des bottes de fantassin allemand, de belles bottes quasi neuves avec leurs fers à cheval aux talons. Caron les lui a confiées lorsqu’il a été évacué pour son bras. Caron les avait prises lui-même à un mitrailleur bavarois abattu près de la route des Pylônes. J’entends encore Caron raconter l’affaire :
– Mon vieux, le frère Miroton, il était là, le derrière dans un trou, plié ; i’zyeutait l’ciel, les jambes en l’air. I’ m’présentait ses pompes d’un air de dire qu’elles valaient l’coup. « Ça colloche », que j’m’ai dit. Mais tu parles d’un business pour lui reprendre ses ribouis : j’ai travaillé dessus, à tirer, à tourner, à secouer, pendant une demi-heure, j’attige pas : avec ses pattes toutes raides, il ne m’aidait pas, le client. Puis, finalement, à force d’être tirées, les jambes du macchab se sont décollées aux genoux, son froc s’est déchiré, et le tout est venu, v’lan ! J’m’ai vu, tout d’un coup, avec une botte pleine dans chaque grappin. Il a fallu vider les jambes et les pieds de d’dans.
– Tu vas fort !…
– Demande au cycliste Euterpe si c’est pas vrai. J’te dis qu’il l’a fait avec moi, lui : on enfonçait notre abattis dans la botte et on retirait de l’os, des bouts de chaussettes et des morceaux de pied. Mais regarde si elles en valaient l’coup !
… Et en attendant que Caron revienne, Poterloo use à sa place les bottes que n’a pas usées le mitrailleur bavarois.
C’est ainsi que l’on s’ingénie, selon son intelligence, son activité, ses ressources et son audace, à se débattre contre l’inconfort effrayant. Chacun semble, en se montrant, avouer : « Voilà tout ce que j’ai su, j’ai pu, j’ai osé faire, dans la grande misère où je suis tombé. »
Mesnil Joseph somnole, Blaire bâille, Marthereau fume, l’œil fixe. Lamuse se gratte comme un gorille et Ludore comme un ouistiti. Volpatte tousse et dit : « J’vas crever. » Mesnil André a sorti sa glace et son peigne, et cultive comme une plante rare sa belle barbe châtain. Le calme monotone est interrompu, de-ci, de-là, par les accès d’agitation acharnée que provoque la présence endémique, chronique et contagieuse des parasites.
Barque, qui est observateur, promène un regard circulaire, retire sa pipe de sa bouche, crache, cligne de l’œil et dit :
– Tout de même, c’qu’on ne se ressemble pas !
– Pourquoi se ressemblerait-on ? dit Lamuse. Ça serait un miracle.
Nos âges ? Nous avons tous les âges. Notre régiment est un régiment de réserve que des renforts successifs ont renouvelé en partie avec de l’active, en partie avec de la territoriale. Dans la demi-section, il y a des R.A.T., des bleus et des demi-poils. Fouillade a quarante ans. Blaire pourrait être le père de Biquet, qui est un duvetier de la classe 13. Le caporal appelle Marthereau « grand-père » ou « vieux détritus » selon qu’il plaisante ou qu’il parle sérieusement. Mesnil Joseph serait à la caserne s’il n’y avait pas eu la guerre. Cela fait un drôle d’effet quand nous sommes conduits par notre sergent Vigile, un gentil petit garçon qui a un peu de moustache peinte sur la lèvre, et qui, l’autre jour, au cantonnement, sautait à la corde, avec des gosses. Dans notre groupe disparate, dans cette famille sans famille, dans ce foyer sans foyer qui nous groupe, il y a, côte à côte, trois générations qui sont là, à vivre, à attendre, à s’immobiliser, comme des statues informes, comme des bornes.
Nos races ? Nous sommes toutes les races. Nous sommes venus de partout. Je considère les deux hommes qui me touchent : Poterloo, le mineur de la fosse Calonne, est rose ; ses sourcils sont jaune paille, ses yeux bleu de lin ; pour sa grosse tête dorée, il a fallu chercher longtemps dans les magasins la vaste soupière bleue qui le casque ; Fouillade, le batelier de Cette, roule des yeux de diable dans une longue maigre face de mousquetaire creusée aux joues et couleur de violon. Mes deux voisins diffèrent, en vérité, comme le jour et la nuit.
Et non moins, Cocon, le mince personnage sec, à lunettes, au teint chimiquement corrodé par les miasmes des grandes villes, fait contraste avec Biquet, le Breton pas équarri, à peau grise, à mâchoire de pavé ; et André Mesnil, le confortable pharmacien de sous-préfecture normande, à la jolie barbe fine, qui parle tant et si bien, n’a pas grand rapport avec Lamuse, le gras paysan du Poitou, aux joues et à la nuque de rosbif. L’accent faubourien de Barque, dont les grandes jambes ont battu dans tous les sens les rues de Paris, se croise avec l’accent quasi belge et chantant de ceux de « ch’Nord » venus du 8e territorial, avec le parler sonore, roulant sur les syllabes comme sur des pavés, que nous versa le 144e, avec le patois s’exhalant des groupes que forment entre eux, obstinément, au milieu des autres, comme des fourmis qui s’attirent, les Auvergnats du 124… Je me rappelle la première phrase de ce loustic de Tirette, quand il se présenta : « Moi, mes enfants, j’suis d’Clichy-la-Garenne ! Qui dit mieux ? », et la première doléance qui rapprocha Paradis de moi : « I s’foutions d’moi parce que j’sommes Morvandiau… »
Nos métiers ? Un peu de tout, dans le tas. Aux époques abolies où on avait une condition sociale, avant de venir enfouir sa destinée dans des taupinières qu’écrasent la pluie et la mitraille, et qu’il faut toujours recommencer, qu’étions-nous ? Laboureurs et ouvriers pour la plupart. Lamuse fut valet de ferme, Paradis, charretier. Cadilhac, dont le casque d’enfant surmonte en branlant un crâne pointu – effet de dôme sur un clocher, dit Tirette – a des terres à lui. Le père Blaire était métayer dans la Brie. De son triporteur, Barque, garçon livreur, faisait des acrobaties entre les tramways et les taxis parisiens, en invectivant magistralement, à ce qu’il dit, dans les avenues et les places, le poulailler effaré des piétons. Le caporal Bertrand, qui se tient toujours un peu à l’écart, taciturne et correct, avec une belle figure mâle, bien droite, le regard horizontal, était contremaître dans une manufacture de gainerie. Tirloir peinturlurait des voitures, sans ronchonner, affirme-t-on. Tulacque était bistrot à la barrière du Trône, et Eudore, avec sa figure douce et pâlotte, tenait sur le bord d’une route, pas très loin du front actuel, un estaminet ; l’établissement a été malmené par les obus – naturellement, car Eudore n’a pas de chance, c’est connu. Mesnil André, l’homme encore vaguement distingué et peigné, vendait du bicarbonate et des spécialités infaillibles sur une grand-place ; son frère Joseph vendait des journaux et des romans illustrés dans une gare du réseau de l’État, tandis que, loin de là, à Lyon, Cocon, le binoclard, l’homme-chiffre, s’empressait, revêtu d’une blouse noire, les mains plombées et brillantes, derrière les comptoirs d’une quincaillerie, et que Bécuwe Adolphe et Poterloo, dès l’aube, traînant la pauvre étoile de leur lampe, hantaient les charbonnages du Nord.
Et il y en a d’autres dont on ne se rappelle jamais le métier et qu’on confond les uns avec les autres, et les bricoleurs de campagne qui colportaient dix métiers à la fois dans leur bissac, sans compter l’équivoque Pépin qui ne devait pas en avoir du tout : (ce qu’on sait c’est qu’il y a trois mois, au dépôt, après sa convalescence, il s’est marié… pour toucher l’allocation des femmes de mobilisés…)
Pas de profession libérale parmi ceux qui m’entourent. Des instituteurs sont sous-officiers à la compagnie ou infirmiers. Dans le régiment, un frère mariste est sergent au service de santé ; un ténor, cycliste du major ; un avocat, secrétaire du colonel ; un rentier, caporal d’ordinaire à la Compagnie Hors Rang. Ici, rien de tout cela. Nous sommes des soldats combattants, nous autres, et il n’y a presque pas d’intellectuels, d’artistes ou de riches qui, pendant cette guerre, auront risqué leurs figures aux créneaux, sinon en passant, ou sous des képis galonnés.
Oui, c’est vrai, on diffère profondément.
Mais pourtant on se ressemble.
Malgré les diversités d’âge, d’origine, de culture, de situation, et de tout ce qui fut, malgré les abîmes qui nous séparaient jadis, nous sommes en grandes lignes les mêmes. À travers la même silhouette grossière, on cache et on montre les mêmes mœurs, les mêmes habitudes, le même caractère simplifié d’hommes revenus à l’état primitif.
Le même parler, fait d’un mélange d’argots d’atelier et de caserne, et de patois, assaisonné de quelques néologismes, nous amalgame, comme une sauce, à la multitude compacte d’hommes qui, depuis des saisons, vide la France pour s’accumuler au Nord-Est.
Et puis, ici, attachés ensemble par un destin irrémédiable, emportés malgré nous sur le même rang, par l’immense aventure, on est bien forcé, avec les semaines et les nuits, d’aller se ressemblant. L’étroitesse terrible de la vie commune nous serre, nous adapte, nous efface les uns dans les autres. C’est une espèce de contagion fatale. Si bien qu’un soldat apparaît pareil à un autre sans qu’il soit nécessaire, pour voir cette similitude, de les regarder de loin, aux distances où nous ne sommes que des grains de la poussière qui roule dans la plaine.
On attend. On se fatigue d’être assis : on se lève. Les articulations s’étirent avec des crissements de bois qui joue et de vieux gonds : l’humidité rouille les hommes comme les fusils, plus lentement mais plus à fond. Et on recommence, autrement, à attendre.
On attend toujours, dans l’état de guerre. On est devenu des machines à attendre.
Pour le moment, c’est la soupe qu’on attend. Après, ce seront les lettres. Mais chaque chose en son temps : lorsqu’on aura fini avec la soupe, on songera aux lettres. Ensuite, on se mettra à attendre autre chose.
La faim et la soif sont des instincts intenses qui agissent puissamment sur l’esprit de mes compagnons. Comme la soupe tarde, ils commencent à se plaindre et à s’irriter. Le besoin de la nourriture et de boisson leur sort de la bouche en grognements :
– V’là huit plombes. Tout d’même, cette croûte, qu’est-ce qu’elle fout, qu’elle radine pas ?
– Justement, moi qui ai la dent depuis hier midi, rechigne Lamuse, dont l’œil est humide de désir et dont les joues présentent de gros coups de badigeon de la couleur du vin.
Le mécontentement s’aigrit de minute en minute :
– Plumet a dû s’envoyer dans l’entonnoir mon bidon d’réglisse qu’i’ d’vait m’apporter, et d’autres avec, et il est tombé saoul qué’qu’part par là.
– C’est sûr et certain, appuie Marthereau.
– Ah ! les malfaisants, les vermines, que ces hommes de corvée ! beugle Tirloir. Quelle race dégoûtante ! Tous, becs-salés et cossards ! Ils se les roulent toute la journée à l’arrière, et ils ne sont pas fichus de monter à l’heure. Ah ! si j’étais le maître, ce que je les ferais venir aux tranchées à la place de nous, et il faudrait qu’ils bossent ! D’abord, je dirais : chacun dans la section sera graisseux et soupier à tour de rôle. Ceux qui veulent, bien entendu… et alors…
– Moi, j’suis sûr, crie Cocon, que c’est c’cochon de Pépère qui met les autres en retard. Il le fait exprès, d’abord, et aussi, il ne peut pas s’déplumer, l’matin, l’pauv’ petit. Il lui faut ses dix heures de pucier, tout comme à un mignard. Sans ça, monsieur a la cosse toute la journée.
– J’t’en foutrai, moi ! gronde Lamuse. Attends voir comme j’le f’rais décaniller du pajot, si seulement j’étais là. J’te l’réveillerais à coups d’tartine sur la tétère, et j’te l’poîsserais par un abattis…
– L’autre jour, poursuit Cocon, j’ai compté : il a mis sept heures quarante-sept minutes pour venir du 31-Abri. Il faut cinq heures bien tassées, mais pas plus.
Cocon est l’homme-chiffre. Il a l’amour, l’avarice de la documentation précise. À propos de tout, il fouine pour trouver des statistiques qu’il amasse avec une patience d’insecte, et sert à qui veut l’entendre. Pour le moment, où il manie ses chiffres comme des armes, sa figure chétive, faite de sèches arêtes, de triangles et d’angles sur lesquels se pose le double rond des lunettes, est crispée de rancune.
Il monte sur la banquette de tir, pratiquée du temps ou c’était ici la première ligne, érige la tête, rageusement, par-dessus le parapet. Dans la lumière frisante d’un petit rayon froid qui traîne sur la terre, on voit briller les verres de ses binocles et aussi la goutte qui lui pend au nez, comme un diamant.
– Et puis, c’Pépère, tu parles aussi d’un quart à trous ! C’est à ne pas y croire c’qu’i’s’laisse tomber de kilos dans l’étui, dans l’espace seulement d’une journée.
Le père Blaire « fume » dans son coin. On voit trembler sa grosse moustache, blanchâtre et tombante comme un peigne en os :
– Veux-tu que j’te dise ? Les hommes de soupe, c’est le type des sales types. C’est : J’fous rien, J’m’en fous, Jean-Foutre et Compagnie.
– Ils ont tout du fumier, soupire avec conviction Eudore, qui, affalé par terre, la bouche entrouverte, a l’air d’un martyr et suit d’un œil atone Pépin qui va et vient, telle une hyène.
L’irritation haineuse contre les retardataires monte, monte.
Tirloir le roussoteur s’empresse et se multiplie. Il est à son affaire. Il aiguillonne la colère ambiante avec ses petits gestes pointus :
– Si on disait : « Ça s’ra bon ! », mais ça va être encore de la vacherie qu’il va falloir que tu t’enfonces dans la lampe.
– Ah ! les potes, hein, la barbaque qu’on nous a balancée hier, tu parles d’une pierre à couteaux ! Du bifteck de bœuf, ça ? Du bifteck de bicyclette, oui, plutôt. J’ai dit aux gars : « Attention, vous autres ! N’mâchez pas trop vite : vous vous casseriez les dominos ; des fois que l’bouif aurait oublié de r’tirer tous les clous ! »
Le boniment, lancé par Tirette, ex-régisseur, paraît-il, de tournées cinématographiques, aurait, en d’autres moments, fait rire ; mais les esprits sont excités et cette déclaration a pour écho un grondement circulaire.
– D’aut’ fois, pour que tu t’plaignes pas qu’c’soit dur, i’t’collent en fait d’bidoche, qué’qu’chose de mou : d’l’éponge qui n’a point de goût, du cataplasme. Quand tu croûtes ça, c’est comme si tu boives un quart d’eau, ni plus ni moins.
– Tout ça, dit Lamuse, ça n’a pas d’consistance, ça n’tient pas au bide. Tu crois qu’t’es rempli, mais au fond d’ta caisse, t’es vide. Aussi, p’tît à p’tit, tu tournes de l’œil, empoisonné par le manque de nourriture.
– La prochaine fois, clame Biquet exaspéré, j’demande à parler au vieux, j’y dirai : « Mon capitaine… »
– Moi, dit Barque, je m’fais porter pâle. J’y dirai : « Monsieur le major… »
– C’que tu y casseras ou rien, c’est du pareil au même. Ils s’entendent tous pour exploiter l’troufion.
– J’te dis, moi, qui veul’tent not’ peau !
– C’est comme la gniole. On a droit qu’on nous en distribue aux tranchées – vu qu’ça a été voté qué’q’ part, j’sais pas quand, ni où, mais je l’sais – et d’puis trois jours qu’on est ici, v’là trois jours qu’on nous en sert au bout d’une fourche.
– Ah, malheur !
– V’là la bectance ! annonce un poilu qui guettait au tournant.
– I’ n’est qu’temps !
Et l’orage des récriminations violentes tombe net, comme par enchantement. Et on voit leur fureur se changer, subitement, en satisfaction.
Trois hommes de corvée, essoufflés, la face larmoyante de sueur, déposent par terre des bouteillons, un bidon à pétrole, deux seaux de toile et une brochette de boules traversées par un bâton. Adossés au mur de la tranchée, ils s’essuient la figure avec leurs mouchoirs ou leurs manches. Et je vois Cocon s’approcher de Pépère, avec le sourire, et, oublieux des outrages dont il a couvert sa réputation, tendre la main, cordialement, vers un des bidons de la collection qui gonfle circulairement Pépère d’une manière de ceinture de sauvetage.
– Qu’est-ce qu’il y a à becqueter ?
– C’est là, répond évasivement le deuxième homme de corvée.
L’expérience lui a appris que l’énoncé du menu provoque toujours des désillusions acrimonieuses…
Et il se met à déblatérer, en haletant encore, sur la longueur et les difficultés du trajet qu’il vient d’accomplir : « Y en a, tout partout, du populo ! c’est un fourbi arabe pour passer. À des moments, faut s’déguiser en feuille de papier à cigarette »… « Ah ! y en a qui disent qu’à la cuistance, on est embusqué ! »… Eh bien, il aimerait cent mille fois mieux, quant à lui, être avec la compagnie dans les tranchées pour la garde et les travaux, que de s’appuyer un pareil métier deux fois par jour pendant la nuit ! Paradis a soulevé les couvercles des bouteillons et inspecté les récipients :
– Des fayots à l’huile, de la dure, bouillie, et du jus. C’est tout.
– Nom de Dieu ! Et du pinard ? braille Tulacque. Il ameute les camarades.
– V’nez voir par ici, eh, vous autres ! Ça, ça dépasse tout ! V’là qu’on s’bombe de pinard !
Les assoiffés accourent en grimaçant.
– Ah ! merde alors ! s’écrient ces hommes désillusionnés jusqu’au fond de leurs entrailles.
– Et ça, qu’est-ce qu’y a dans c’siau-là ? dit l’homme de corvée, toujours rouge et suant, en montrant du pied un seau.
– Oui, dit Paradis. J’m’ai trompé, y a du pinard.
– C’t’emmanché-là ! fait l’homme de corvée en haussant les épaules et en lui lançant un regard d’indicible mépris. Mets tes lunettes à vache, si tu n’y vois pas clair !
Il ajoute :
– Un quart par homme… Un peu moins, peut-être, parce qu’il y a un fourneau qui m’a cogné en passant dans le Boyau du Bois, et il y en a eu eun’ goutte e’d’renversée… Ah ! s’empresse-t-il d’ajouter en élevant le ton, si je n’avais pas été chargé, tu parles d’un coup de trottinant qu’il aurait reçu dans le croupion ! Mais il a ripé à la quatrième vitesse, l’animau !
Et nonobstant cette ferme déclaration, il s’esquive lui-même, rattrapé par les malédictions – pleines d’allusions désobligeantes pour sa sincérité et sa tempérance – que fait naître cet aveu de ration diminuée.
Cependant, ils se jettent sur la nourriture et mangent, debout, accroupis, à genoux, assis sur un bouteillon ou un havresac tiré du puits où on couche, ou écroulés à même le sol, le dos enfoncé dans la terre, dérangés par les passants, invectivés et invectivant. À part ces quelques injures ou quolibets courants, ils ne disent rien, d’abord occupés tout entiers à avaler, la bouche et le tour de la bouche graisseux comme des culasses.
Ils sont contents.
Au premier arrêt des mâchoires, on sert des plaisanteries obscènes. Ils se bousculent tous et criaillent à qui mieux mieux pour placer leur mot. On voit sourire Farfadet, le fragile employé de mairie qui, les premiers temps, se maintenait au milieu de nous, si convenable et aussi si propre qu’il passait pour un étranger ou un convalescent. On voit se dilater et se fendre, sous le nez, la tomate de Lamuse, dont la joie suinte en larmes, s’épanouir et se réépanouir la pivoine rose de Poterloo, se trémousser de liesse les rides du père Blaire, qui s’est levé, pointe la tête en avant et fait gesticuler le bref corps mince qui sert de manche à son énorme moustache tombante, et on aperçoit même s’éclairer le petit faciès plissé et pauvre de Cocon.
– Sin jus, on va-t-i’ pas l’fouaire recauffir ? demande Bécuwe.
– Avec quoi, en soufflant d’ssus ?
Bécuwe, qui aime le café chaud, dit :
– Laissez-mi bric’ler cha. Ch’n’est point n’n’affouaire. Arrangez cheul’ment ilà in ch’tiot foyer et ine grille avec d’fourreaux d’baïonnettes. J’sais où c’qu’y a d’bau. J’allau en fouaire des copeaux avec min couteau assez pour cauffer l’marmite. V’s allez vir…
Il part à la chasse au bois.
En attendant le caoua, on roule la cigarette, on bourre la pipe.
On tire les blagues. Quelques-uns ont des blagues en cuir ou en caoutchouc achetées chez le marchand. C’est la minorité. Biquet extrait son tabac d’une chaussette dont une ficelle étrangle le haut. La plupart des autres utilisent le sachet à tampon antiasphyxiant, fait d’un tissu imperméable, excellent pour la conservation du perlot ou du fin. Mais il y en a qui ramonent tout bonnement le fond de leur poche de capote.
Les fumeurs crachent en cercle, juste à l’entrée de la guitoune où loge le gros de la semi-section et inondent d’une salive jaunie par la nicotine la place où l’on pose les mains et les genoux quand on s’aplatit pour entrer ou sortir.
Mais qui s’aperçoit de ce détail ?
Voici qu’on parle denrées, à propos d’une lettre de la femme de Marthereau.
– La mère Marthereau m’a écrit, dit Marthereau. Le cochon gras, tout vif, vous ne savez pas combien i’vaut chez nous, m’tenant.
… La question économique a dégénéré soudain en une violente dispute entre Pépin et Tulacque.
Les vocables les plus définitifs ont été échangés, puis :
– Je m’fous pas mal de c’que tu dis ou d’c’que tu n’dis pas. La ferme !
– J’la fermerai si j’veux, saleté !
– Un trois kilos te la fermerait vite !
– Non, mais chez qui ?
– Viens-y voir, mais viens-y donc !
Ils écument et grincent et s’avancent l’un vers l’autre. Tulacque étreint sa hache préhistorique et ses yeux louches lancent deux éclairs. L’autre, blême, l’œil verdâtre, la face voyou, pense visiblement à son couteau.
Lamuse interpose sa main pacifique grosse comme une tête d’enfant et sa face tapissée de sang, entre ces deux hommes qui s’empoignent du regard et se déchirent en paroles.
– Allons, allons, vous n’allez pas vous abîmer. Ce s’rait dommage !
Les autres interviennent aussi et on sépare les adversaires. Ils continuent à se jeter, à travers les camarades, des regards féroces.
Pépin mâche des restants d’injures avec un accent fielleux et frémissant :
– L’apache, la frappe, le crapulard ! Mais, attends, me revaudra ça !
De son côté, Tulacque confie au poilu qui est à côté de lui :
– C’morpion-là ! Non, mais tu l’as vu ! Tu sais, y a pas à dire : ici on fréquente un tas d’individus qu’on sait pas qui c’est. On s’connaît et pourtant on s’connait pas. Mais ç’ui-là, s’il a voulu zouaviller, il est tombé sur le manche. Minute : je le démolirai bien un de ces jours, tu voiras.
Pendant que les conversations reprennent et couvrent les derniers doubles échos de l’altercation :
– Tous les jours, alors ! me dit Paradis. Hier, c’était Plaisance qui voulait à toute force fout’ sur la gueule à Fumex à propos de je n’sais quoi, une affaire de pilules d’opium, j’pense. Pis c’est l’un, pis c’est l’autre, qui parle de s’crever. C’est-i’ qu’on devient pareil à des bêtes, à force de leur ressembler ?
– C’est pas sérieux, ces hommes-là, constate Lamuse, c’est des gosses.
– Ben sûr, pis que c’est des hommes.
La journée s’avance. Un peu plus de lumière a filtré des brumes qui enveloppent la terre. Mais le temps est resté couvert, et voilà qu’il se résout en eau. La vapeur d’eau s’effiloche et descend. Il bruine. Le vent ramène sur nous son grand vide mouillé, avec une lenteur désespérante. Le brouillard et les gouttes empâtent et ternissent tout : jusqu’à l’andrinople tendue sur les joues de Lamuse, jusqu’à l’écorce d’orange dont Tulacque est caparaçonné, et l’eau éteint au fond de nous la joie dense dont le repas nous a remplis. L’espace s’est rapetissé. Sur la terre, champ de mort, se juxtapose étroitement le champ de tristesse du ciel.
On est là, implantés, oisifs. Ce sera dur, aujourd’hui, de venir à bout de la journée, de se débarrasser de l’après-midi. On grelotte, on est mal ; on change de place sur place, comme un bétail parqué.
Cocon explique à son voisin la disposition de l’enchevêtrement de nos tranchées. Il a vu un plan directeur et il a fait des calculs. Il y a dans le secteur du régiment quinze lignes de tranchées françaises, les unes abandonnées, envahies par l’herbe et quasi nivelées, les autres entretenues à vif et hérissées d’hommes. Ces parallèles sont réunies par des boyaux innombrables qui tournent et font des crochets comme de vieilles rues. Le réseau est plus compact encore que nous le croyons, nous qui vivons dedans. Sur les vingt-cinq kilomètres de largeur qui forment le front de l’armée, il faut compter mille kilomètres de lignes creuses : tranchées, boyaux, sapes. Et l’armée française a dix armées. Il y a donc, du côté français, environ dix mille kilomètres de tranchées et autant du côté allemand… Et le front français n’est à peu près que la huitième partie du front de la guerre sur la surface du monde.
Ainsi parle Cocon, qui conclut en s’adressant à son voisin :
– Dans tout ça, tu vois ce qu’on est, nous autres…
Le pauvre Barque – face anémique d’enfant des faubourgs que souligne un bouc de poils roux, et que ponctue, comme une apostrophe, sa mèche de cheveux – baisse la tête :
– C’est vrai, quand on y pense, qu’un soldat – ou même plusieurs soldats – ce n’est rien, c’est moins que rien dans la multitude, et alors on se trouve tout perdu, noyé, comme quelques gouttes de sang qu’on est, parmi ce déluge d’hommes et de choses.
Barque soupire et se tait – et, à la faveur de l’arrêt de ce colloque, on entend résonner un morceau d’histoire racontée à demi-voix :
– Il était v’nu avec deux chevaux. Pssiii… un obus. I n’lui reste plus qu’un chevau…
– On s’embête, dit Volpatte.
– On tient ! ronchonne Barque.
– Faut bien, dit Paradis.
– Pourquoi ? interroge Marthereau, sans conviction.
– Y a pas besoin d’raison, pis qu’il le faut.
– Y a pas d’raison, affirme Lamuse.
– Si, y en a, dit Cocon. C’est… Y en a plusieurs, plutôt.
– La ferme ! C’est bien mieux qu’y en aye pas, pis qu’i’ faut t’nir.
– Tout d’même, fait sourdement Blaire, qui ne perd jamais une occasion de réciter cette phrase, tout d’même, i’s veul’nt not’ peau !
– Au commencement, dit Tirette, j’pensais à un tas d’choses, j’réfléchissais, j’calculais ; maintenant, j’pense plus.
– Moi non plus.
– Moi non plus.
– Moi, j’ai jamais essayé.
– T’es pas si bête que t’en as l’air, bec de puce, dit Mesnil André de sa voix aiguë et gouailleuse.
L’autre, obscurément flatté, complète son idée :
– D’abord, tu peux rien savoir de rien.
– On n’a besoin de savoir qu’une chose, et cette seule chose, c’est que les Boches sont chez nous, enracinés, et qu’il ne faut pas qu’ils passent et qu’il faut même qu’ils les mettent un jour ou l’autre – le plus tôt possible, dit le caporal Bertrand.
– Oui, oui, faut qu’ils en jouent un air : y a pas d’erreur ; autrement, quoi ? C’est pas la peine de se fatiguer le ciboulot à penser à aut’ chose. Seul’ment, c’est long.
– Ah ! bougre de bagasse ! exclame Fouillade, eunn peu !
– Moi, dit Barque, je ne rouspète plus. Au commencement, je rouspétais contre tout le monde, contre ceux de l’arrière, contre les civils, contre l’habitant, contre les embusqués. Oui, j’rouspétais, mais c’était au commencement de la guerre, j’étais jeune. Maint’nant, j’prends mieux les choses.
– Y a qu’une façon de les prendre : comme elles viennent !
– Pardi ! Autrement tu deviendrais fou. On est déjà assez dingo comme ça, pas, Firmin ?
Volpatte fait oui de la tête, profondément convaincu, crache, puis contemple son crachat d’un œil fixe et absorbé.
– Tu parles, appuie Barque.
– Ici, faut pas chercher loin devant toi. Faut vivre au jour le jour, heure par heure même, si tu peux.
– Pour sûr, face de noix. Faut faire ce qu’on nous dit de faire, en attendant qu’on nous dise de nous en aller.
– Et voilà, bâille Mesnil Joseph.
Les faces cuites, tannées, incrustées de poussière, opinent, se taisent. Évidemment, c’est là l’idée de ces hommes qui ont, il y a un an et demi, quitté tous les coins du pays pour se masser sur la frontière : renoncement à comprendre, et renoncement à être soi-même ; espérance de ne pas mourir et lutte pour vivre le mieux possible.
– Faut faire ce qu’on doit, oui, mais faut s’démerder, dit Barque, qui, lentement, de long en large, triture la boue.
– Il l’faut, souligne Tulacque. Si tu t’démerdes pas, on l’fera pas pour toi, t’en fais pas !
– I’ n’est pas encore fondu, c’ui qui s’occupera de l’autre.
– Chacun pour soi, à la guerre !
– Videmment, videmment.
Un silence. Puis, du fond de leur dénuement, ces hommes évoquent des images savoureuses.
– Tout ça, reprend Barque, ça n’vaut pas la bonne vie qu’on a eue, un temps, à Soissons.
– Ah ! foutre !
Un reflet de paradis perdu illumine les yeux et, semble-t-il, les trognes, déjà attisées par le froid.
– Tu parles d’un louba, soupire Tirloir, qui s’arrête, pensivement, de se gratter, et regarde au loin, à travers la terre de la tranchée.
– Ah ! nom de Dieu, toute cette ville quasi évacuée et qui, en somme, était à nous ! Les maisons, avec les lits…
– Les armoires !
– Les caves !
Lamuse en a les yeux mouillés, la face en bouquet, et le cœur gros.
– Vous y êtes restés longtemps ? demande Cadilhac, qui est venu depuis, avec le renfort des Auvergnats.
– Plusieurs mois…
La conversation, presque éteinte, se ranime en flammes vives, à l’évocation de l’époque d’abondance.
– On voyait, dit Paradis, comme dans un rêve, des poilus s’couler à l’long et à derrière les piaules, en rentrant au cantonnement, avec des poules autour du cylindre et, sous chaque abattis, un lapin emprunté à un bonhomme ou à une bonne femme qu’on n’avait pas vu, et qu’on n’reverra pas.
Et on pense au goût lointain du poulet et du lapin.
– Y avait des choses qu’on payait. L’pognon, i’ dansait aussi, va. On était encore aux as, en c’temps-là.
– C’est des cent mille francs qui ont roulé dans les boutiques.
– Des millions, oui. C’était toute la journée un gaspillage dont t’as pas une idée d’ssus, une espèce de fête surnaturelle.
– Crois-moi ou crois-moi pas, dit Blaire à Cadilhac, mais au milieu de tout ça, comme ici et comme partout où c’qu’on passe, ce qu’on avait le moins, c’était le feu. Il fallait courir après, l’trouver, l’gagner, quoi. Ah ! mon vieux, c’qu’on a couru après le feu !…
– Nous, nous étions dans le cantonnement de la C.H.R. Là, l’cuistot, c’était le grand Martin César. Il était à la hauteur, lui, pour dégoter du bois.
– Ah ! oui, lui, c’était un as. Y a pas à tortiller du croupion, i’ savait y faire !
– Toujours du feu dans sa cuistance, toujours, ma vieille cloche. Tu rechassais des cuistots qui bagotaient dans les rues en tous sens, en chialant parce qu’ils n’avaient pas d’bois ni d’charbon ; lui, il avait du feu. Quand i’ n’avait pas rien, i’ disait : « T’occupe pas, j’vas m’démieller. » Et c’était pas long.
– Il attigeait même, on peut l’dire. La première fois que j’l’ai zévu dans sa cuisine, tu sais avec quoi i’ f’sait mijoter la tambouille ? Avec un violon qu’il avait trouvé dans la maison.
– C’est vache, tout de même, dit Mesnil André. J’sais bien qu’un violon, ça sert pas à grand-chose pour l’utilité, mais, tout d’même…
– D’autres fois, il s’est servi des queues de billard. Zizi a tout juste pu en grouper une pour se faire une canne. Le reste, au feu. Après, les fauteuils du salon, qui étaient en acajou, y ont passé en douce. I’ les zigouillait et les découpait pendant la nuit, parce qu’un gradé aurait pu trouver à redire.
– Il allait fort, dit Pépin… Nous, on s’est occupé avec un vieux meuble qui nous a fait quinze jours.
– Pourquoi aussi qu’on n’a rien de rien ? Faut faire la soupe, zéro bois, zéro charbon. Après la distribution, t’es là avec tes croches vides devant l’tas de bidoche, au milieu des copains qui s’fichent de toi en attendant qu’ils t’engueulent. Alors quoi ?
– C’est l’métier qui veut ça. C’est pas nous.
– Les officiers ne disaient trop rien quand on chapardait ?
– I’ s’en foutaient eux-mêmes plein la lampe, et comment ! Tu t’rappelles, Desmaisons, le coup du lieutenant Virvin défonçant la porte d’une cave d’un coup de hache ? Même qu’un poilu l’a vu et qu’il lui a donné la porte pour en faire du bois à brûler, à cette fin que l’copain i’ n’aille pas ébruéter la chose.
– Et c’pauv’ Saladin, l’officier de ravitaillement : on l’a rencontré entre chien et loup, sortant d’un sous-sol avec deux bouteilles de blanc dans chaque bras, le frère. On aurait dit une nourrice portant quatre lardons. Comme il a été repéré, il a été obligé de redescendre dans la mine aux bouteilles et d’en distribuer à tout le monde. Même que l’caporal Bertrand, qu’a des principes, n’as pas voulu en boire. Ah ! tu t’rappelles, saucisse à pattes !
– Où c’qu’il est maintenant le cuisinier qui trouvait toujours du feu ? demanda Cadilhac.
– Il est mort. Une marmite est tombée dans sa marmite. Il n’a rien eu, mais il est tout de même mort d’saisissement quand il a vu son macaroni les jambes en l’air ; un spasme du cœur, qu’a dit le toubi. Il avait l’cœur faible ; i’ n’était fort que pour trouver du bois. On l’a enterré proprement. On lui a fait un cercueil avec le parquet d’une chambre ; on a ajusté ensemble les planches avec les clous des tableaux de la maison, et on se servait de briques pour les enfoncer. Pendant qu’on l’transportait, je m’disais : « Heureusement pour lui, qu’il est mort : s’i’ voyait ça, i’ pourrait jamais s’consoler d’avoir pas pensé aux planches du parquet pour son feu. » Ah ! l’sacré numéro, l’enfant de cochon !
– L’troufion se démerde bien sur le dos du copain. Quand tu filoches devant une corvée ou qu’tu prends l’bon morceau ou la bonne place, c’est les autres qui écopent, philosopha Volpatte.
– Moi, dit Lamuse, je m’suis souvent démerdé pour ne pas monter aux tranchées, et j’compte pas les fois qu’j’y ai coupé. Ça, je l’avoue. Mais, quand des copains sont en danger, j’suis pus chercheur de filon, j’suis pus démerdard. J’oublie mon uniforme, j’oublie tout. J’vois des hommes et j’marche. Mais, autrement, mon vieux, j’pense à bibi.
Les affirmations de Lamuse ne sont pas de vains mots. C’est un virtuose du tirage au flanc, en effet ; néanmoins, il a sauvé la vie à des blessés en allant les chercher sous la fusillade.
Il explique le fait sans forfanterie :
– On était couchés tous dans l’herbe. Ça buquait. Pan ! pan ! Zim, zim… Quand j’les ai vus attigés, je me suis levé – malgré qu’on m’gueulait : « Couche-toi ! » J’pouvais pas les laisser comme ça. J’n’ai pas d’mérite, pisque je n’pouvais pas faire autrement.
Presque tous les gars de l’escouade ont quelque haut fait militaire à leur actif et, successivement, les croix de guerre se sont alignées sur leurs poitrines.
– Moi, dit Biquet, j’ai pas sauvé des Français, mais j’ai poiré des Boches.
Aux attaques de mai, il a filé en avant ; on l’a vu disparaître comme un point, et il est revenu avec quatre gaillards à casquette.
– Moi, j’en ai tué, dit Tulacque.
Il y a deux mois, il en a aligné neuf, avec une coquetterie orgueilleuse, devant la tranchée prise.
– Mais, ajoute-t-il, c’est surtout après l’officier boche que j’en ai.
– Ah ! les vaches !
Ils ont crié cela plusieurs à la fois, du fond d’eux-mêmes.
Ah ! mon vieux, dit Tirloir, on parle de la sale race boche. Les hommes de troupe, j’sais pas si c’est vrai ou si on nous monte le coup là-dessus aussi, et si, au fond, ce ne sont pas des hommes à peu près comme nous.
– C’est probablement des hommes comme nous, fait Eudore.
– Savoir ! s’écrie Cocon.
– En tous les cas, on n’est pas fixé pour les hommes, reprend Tirloir, mais les officiers allemands, non, non, non : pas des hommes, des monstres. Mon vieux, c’est vraiment une sale vermine spéciale. Tu peux dire que c’est les microbes de la guerre. Il faut les avoir vus de près, ces affreux grands raides, maigres comme des clous, et qui ont tout de même des têtes de veaux.
– Ou bien des tas qui ont tout de même des gueules de serpent.
Tirloir poursuit :