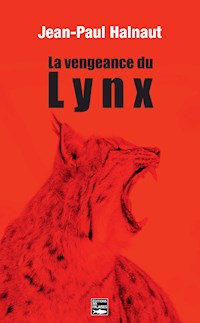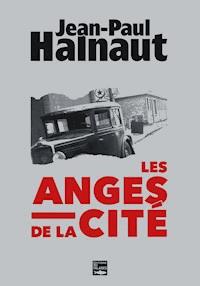Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Le fils de Hans Serge Rich, enfant illégitime d'une Normande et d'un soldat de la Wehrmacht, possède le don de faire des rêves prémonitoires. Nous sommes en 1973. Durant cette période des "années de plomb" les pays européens sont confrontés à des mouvements anticapitalistes pratiquant la lutte armée. Le commissaire Henri Poirier est chargé d'enquêter sur une série de braquages qui pourraient avoir été perpétrés par un de ces mouvements. Cette enquête entre en résonnance avec l'histoire personnelle du "fils du Boche" et celle de sa grande amie Margaret, la fille de son patron.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur :
2012 : GI’s Blues aux Éditions des Falaises (Prix du Lions Club de Normandie 2013) (Prix National Lions de littérature 2013)
2014 : Les Anges de la Cité aux Éditions des Falaises (Prix Octave Mirbeau 2015)
2019 : La Vengeance du Lynx aux Éditions des Falaises
Sommaire
Prémonitions
1944 : La dévergondée
1973 : Central Park
Petite mort
Éducation ouvrière
DS Pallas
Brochette de poulets
Kurt Steiner
L’homme au loup rouge
Sabotage
1944 : Le bar des cyclistes
1973 : Leclerc and C°
Le jeu du pendu
Héroïque fantaisie
Le fils du Boche
Le Mouvement du 15 Janvier
Diégo Kaldéra
Le grand blond
Jean Seberg
Les tuyaux d’Helmut
L’homme et l’enfant
La belle Natacha
Braquage au Val Églantier
Carl Gustav Jung
1945 : Apocalypse
Révolution
1967 : Subversive Aktion
1968 : Le dandy
1970 : Gammlers
1972 : Der Wikinger
Crime et Châtiment
1973 : Larozépam
Puzzle
L’oncle
Scène de ménage
Les vampires
1945 : L’infirmière
1973 : La sente du pain de sucre
Frérot
Hypochondre
La rue des Canadiens
Liste noire
État grippal
Hohenschwangau
La danse des chaises
Le début de la fin
Margaret, le retour
L’aquarium
Le grand saut
Portraits de famille
Fin de contrat
Prémonitions
1944 : La dévergondée
Victor Malavoix et son beau-frère Ernest Grandon exhibèrent leur brassard FFI quand les GI’s investirent la rue principale du village de Bérangeville. Dans la foulée ils s’emparèrent de trois femmes accusées d’avoir fricoté avec les Allemands et les tondirent sans autre forme de procès. Parmi elles Suzanne Rich eut droit à l’option « finition au rasoir » qui rendit son crâne aussi lisse qu’un pain de glace, il faut dire qu’Ernest, le maître barbier du village, tenait le manche du « coupe-choux ».
Avant-guerre Suzanne Rich traînait déjà une réputation de dévergondée absolument injustifiée. Elle faisait la serveuse au bar des cyclistes, une gentille ginguette-pension tenue par monsieur et madame Schmidt. Les cultivateurs célibataires dépressifs qui approchaient Suzanne devaient se contenter de la tenir dans leurs bras le temps d’une valse au bal du samedi soir. Le flirt à peine esquissé elle se dérobait. Par dépit les soupirants éconduits se vantaient de l’avoir culbutée dans un fossé et faisaient courir sur son compte des rumeurs désobligeantes. En réalité Suzanne refusait leurs avances parce qu’elle ne voulait pas passer sa vie mariée à un cultivateur, collée au cul des vaches, à l’exemple de ses défunts parents.
Les Schmidt, d’origine juive, considéraient Suzanne comme leur fille. Ils prirent le risque de ne jamais se faire inscrire, pendant l’occupation, sur les registres du commissariat aux questions juives car ils n’avaient aucune confiance dans l’administration du Maréchal qu’ils jugeaient passablement gâteux. Certains juifs cherchaient à se procurer de faux certificats de baptême pour passer inaperçus, les Schmidt au contraire, affichaient auprès de la clientèle leurs convictions de libres penseurs :
- La religion est l’opium du peuple ! Assénaient-ils dans les conversations de comptoirs. Ils mettaient sincèrement dans le même sac, rabbins curés et pasteurs pensant à tort que ces propos athées pourraient leur servir de couverture… Pourtant les Schmidt échappèrent de peu à la déportation ; ils avaient sous-estimé la capacité de nuisance des fouineurs de la Gestapo...
***
À la fin du printemps 1944 Hans Dieter, un simple soldat de la deuxième compagnie de marche de la Wehrmacht, fut le premier à profiter des faveurs de Suzanne. Il était beau, bien éduqué, mais c’est surtout parce qu’il avait prouvé à Suzanne sa détestation des Nazis qu’elle s’était laissé faire sur l’épais tapis de luzerne de la clairière au bord de la rivière. Il faisait chaud. Après l’amour les tourtereaux s’étaient baignés avant de s’allonger à l’ombre des peupliers. Tout le village avait été informé de l’évènement le jour même par Victor Malavoix qui avait observé la scène dans un état de profonde excitation, tapi derrière un bosquet.
La compagnie de Hans dut déguerpir en août 1944 chassée par le rouleau compresseur allié. Hans savait Suzanne enceinte et l’avait assurée qu’il reviendrait la chercher après la guerre. Neuf mois plus tard l’Armée Rouge et les alliés déferlaient sur l’Allemagne, Hans disparut dans la tourmente. En février 1945 Suzanne donna naissance à un garçon de près de quatre kilos qu’elle prénomma Serge. Beau nourrisson à la peau mate, Serge avait hérité du type méditerranéen de sa mère et ne possédait aucune des pseudos caractéristiques du bébé arien.
***
Victor Malavoix, à la mort de son père, avait hérité d’un des plus gros domaines du canton. Quand, rongé par la solitude - les femmes célibataires étaient rares dans ce coin de campagne - il proposa à Suzanne de l’épouser et de s’occuper de son « bâtard de fils », comme disait Ernest, elle refusa tout net. Ne l’avait-il pas dénoncée ? N’était-ce pas à cause de lui que tout Bérangeville la considérait comme une traînée ? Victor, à bout d’arguments, finit par surenchérir ; si la belle Suzanne consentait à l’épouser, le mariage se ferait sous le régime de la communauté. Elle avait quinze ans de moins que lui. Un jour elle serait à la tête du « domaine de Virville » et le fils du Boche aurait sa part. De toute évidence Hans ne reviendrait jamais. Suzanne décida d’accepter la proposition de Victor dans l’intérêt de son fils. Seuls les Schmidt l’avaient mise en garde sur la déplorable mentalité de Victor Malavoix. Odile, la sœur de Victor et l’épouse d’Ernest eut beau crier à la mésalliance, l’attirance physique qu’éprouvait Victor pour Suzanne fut plus forte que toute autre considération. On célébra la cérémonie de mariage en grande pompe. Ernest fit danser la mariée, vantant la qualité de sa mise en plis sous les quolibets des « patriotes » présents au banquet : On a bien fait de la tondre balança-t-il à l’assemblée ça fortifie le cheveu ! Le principal fait d’armes de cette clique de résistants de la dernière heure avait été de pendre haut et court un gitan sous les yeux de sa famille, sous prétexte qu’il tirait les cartes aux trouffions de la Wehrmacht et leur fourguait des bas de soie pour leurs femmes contre quelques billets.
***
Deux années de mariage plus tard Victor se partageait avec Ernest les faveurs de Perrine, une crémière peu farouche de Criquetot l’Esneval. De plus en plus dépendant de la bouteille, Victor préférait les concours de manille et les parties de chasse avec sa clique au travail de la terre. Il fallait bien faire tourner l’exploitation. Les métayers se succédaient au domaine car Victor, la plupart du temps entre deux vins, ne supportait pas la contradiction. Peu à peu une rumeur se répandit au village, colportée par le barbier et sa bourgeoise : Suzanne faisait subir un « examen de passage » aux métayers avant de les embaucher… Elle devenait plus que jamais « la pute à Boches de Virville ». Hormis les Schmidt chacun au village trouvait normal que Victor aille voir ailleurs et lui administre de temps en temps une bonne correction.
Le corps sans vie de Suzanne fut retrouvé en décembre 1947, à la lisière d’un bois, sur le chemin vicinal 18 qu’elle empruntait deux fois par semaine à bicyclette pour rejoindre le marché de Goderville…Apparemment elle avait fait une chute et s’était fracturé le crâne contre une borne kilométrique.
La loi française interdit de déshériter son enfant mais Victor Malavoix, malgré sa promesse, n’avait pas reconnu le fils du Boche. Il avait pris soin, sans en informer sa femme, d’exclure l’enfant de sa succession. À la mort de Suzanne, Serge, inscrit dans les registres sous le nom de jeune fille de sa mère, fut confié aux services sociaux, puis au couple Schmidt, compatissant et désintéressé.
1973 : Central Park
Je rêve que je rêve. Je suis dans l’entre-deux, je me laisse aller, flottement ouaté du pré-réveil. Une sensation de chaleur à la base de la nuque m’indique que je vais me réveiller ; les rayons du soleil passent entre les double-rideaux de la chambre. Je m’accroche à mon rêve. J’ai lu quelque-part qu’il était possible de le prolonger, encore fallait-il le vouloir de toutes ses forces…
Monsieur et madame Leclerc, leur fille Margaret et Édouard son grand benêt de frère ont fait péter une « roteuse » sur la pelouse d’un jardin public près d’une Diane chasseresse en marbre blanc. Coupe de champagne à la main ils posent sur ma personne un regard admiratif ; je suis en smoking. Un homme masqué d’un loup rouge, assis sur un banc voisin nous lance : à la vôtre ! Une légion d’honneur orne le revers de ma jaquette. Ébloui par un rayon de soleil se reflétant sur ma médaille, Édouard chausse ses Ray Ban teintées vert foncé. Madame Leclerc, après avoir gentiment réajusté mon nœud papillon, me serre dans ses bras. Je réalise soudain que seule Margaret et moi sommes habillés. Vêtue d’une robe de mariée un peu trop chargée en dentelles elle se dirige vers moi, souriante. Au loin les cloches sonnent. On nous attend à l’église pour la cérémonie. Je ne sais pourquoi c’est le moment que choisit Vivaldi pour balancer ses Quatre Saisons dans le désordre ; un soupçon de printemps, allégro vivace suivi d’un bout d’hiver déprimant. Séquence Walt Disney en couleur, nous sommes tous transformés, hommes et bêtes, en personnages de bande dessinée. En rythme, nus comme des vers, la famille entame une grotesque farandole applaudie par une bande d’écureuils jaillissant des bannettes à papier du parc. Ma part de conscient réalise que j’ai vu la scène des écureuils à la télé dans un documentaire sur Central Park. Venant de la rue, un bruit d’enfer couvre la bouillie de concerto. Effrayés les écureuils se bouchent les oreilles, sautent sur le dos d’une escadrille de flamants roses qui passent par là en rase-motte. Monsieur Leclerc et Edouard, satyres improbables, s’égayent dans la nature en cachant leurs attributs derrière une feuille de chêne, madame Leclerc surprise s’affale sur le gazon victime d’une syncope.
Margaret s’impatiente. Elle déboutonne sa robe :
-Emmène-moi à l’hôtel Serge, on sera plus tranquille…
Je suis heureux, je m’empresse de la rejoindre mais Vivaldi augmente le volume de son amplificateur haute-fidélité, Margaret se bouche les oreilles et s’enfuit à son tour, je cours après elle dans la rue encombrée de taxis jaunes, l’homme au loup rouge nous suit ; ça se confirme, mon rêve se passe bien à New York, qu’est-ce qu’on fout à New York ? Margaret saute d’un toit de taxi à l’autre avant de disparaitre entre deux enseignes publicitaires de shampoing hypoallergénique au dixième étage d’un building. Les enseignes ont la forme d’arbres de Noël, des flacons de shampoing sont accrochés aux branches. Margaret accompagnée de son frère ressort par l’entrée principale de l’immeuble dont le fronton est orné de l’aigle étasunien. L’homme au loup rouge tient la porte de l’immeuble, démarrage en trombe de la DS gris-métallisée.
J’ouvre les yeux. Le visage de Margaret apparait au milieu des fleurs exotiques du papier peint. Elle sourit comme si elle se fichait de moi. Si je garde ce papier peint de mauvais goût, c’est qu’il me permet, quand je suis allongé les yeux grands ouverts, d’illustrer mes rêvasseries de phantasmagories personnelles en fixant les dessins ; ils s’animent, se transforment le plus souvent en portraits saisissants.
Je me lève, transpiration excessive, je sens poindre le malaise. J’enlève ma veste de pyjama qui me colle à la peau. Titubant je vais ouvrir la fenêtre, le pont de Brooklyn se gondole, les gratte-ciels tanguent… Je vis au Havre, contrairement à ce que je croyais je ne suis toujours pas sorti de mon rêve…Quelque part ça me rassure, j’ai rêvé de mon réveil…Je croise le regard d’un noir athlétique culotté d’un bleu de travail, torse serré dans un « marcel » de réclame John Deer d’un jaune éclatant, ses muscles saillants tressautent sous les folles embardées d’un marteau piqueur. De l’eau jusqu’à mi bottes, le noir massacre le trottoir sous mes fenêtres. Les services publics de « la Grosse Pomme » sont moribonds, il faut vraiment qu’une canalisation dégueule à gros bouillon pour que la municipalité se décide à intervenir, ça aussi je l’ai appris dans le documentaire à la télé. Un coucou sort d’une horloge murale et m’indique qu’il est 7 heures. Un arrêté municipal stipule qu’on ne peut entamer de travaux bruyants sur la voie publique le matin avant 8h30. Je sens que le noir n’attend qu’une remarque de ma part pour se défouler ; il est obligé de faire ce boulot pour un salaire de misère ; casser la figure d’un petit blanc en début de journée lui apporterait sûrement un peu de réconfort. Je souris bêtement au colosse et referme prudemment la fenêtre.
J’ai besoin d’uriner, peut être que ça va me réveiller pour de bon mais je veux connaître la fin, Margaret est impliquée dans l’histoire… Hurlements, crissement de pneus, les barrières de chantier sautent, un premier choc plutôt mou, suivi d’un autre, énorme, mes vitres explosent, au loin un enfant pleure, ça hurle de plus belle. Une poussière épaisse pénètre dans l’appartement. Je me précipite dehors saisissant au passage un dérisoire nécessaire de première urgence gagné à une tombola au profit des vieux du quartier de Sanvic. L’ouvrier noir est à terre. Une large fissure sanglante bien nette suit l’arête de son nez et partage son crâne en deux morceaux. Un pied arraché, encore chaussé d’un godillot a volé jusque sur le trottoir d’en face. Le nécessaire à couture de ma trousse de secours est insuffisant pour le raccommoder. Le marteau piqueur déglingué posé en travers de son ventre, émet encore quelques soubresauts. La DS Pallas a tout balayé sur son passage et s’est écrasée de l’autre côté du chantier contre la remorque d’un Caterpillar.
-Margaret, Margaret, je suis là ! Je retiens ma respiration, ouvre la portière arrière gauche et m’introduis dans l’habitacle du véhicule éventré. Vision d’horreur…Edouard les mains posées sur le volant n’a plus de tête. Sous le choc les tuyauteries se sont détachées de la remorque, ont défoncé le pare-brise et l’ont décapité. Margaret, sortie d’on ne sait où, remet la tête d’Edouard en place, pas une goutte de sang ne souille sa robe de mariée, sa coiffure et son maquillage sont restés impeccables
- Margaret, tu n’as rien ?
-Bien sûr que non…Au dernier moment je ne suis pas montée dans la voiture. Enfin tu es là, ce n’est pas trop !
Une Coccinelle s’arrête près de nous, l’homme au loup rouge est au volant, Margaret s’engouffre dans l’auto…crissement de pneus…
-Sors de ton lit Serge ! M’ordonne madame Leclerc remise de son malaise, tu n’entends pas le réveil ?
La sonnerie me fait sursauter, mon cœur bat au moins à 120. Je jette un coup d’œil au papier peint, cette fois aucun visage n’émerge des fleurs exotiques. Je saute dans mes chaussons et me dirige vers la salle de bains d’un pas hésitant.
-Nom de Dieu ! Ça me reprend…
Petite mort
-Ne pose pas ta pipe chaude sur la table basse, tu vas faire craquer le vernis !
Henri Poirier venait à peine de s’installer dans le voltaire en velours grenat avec son journal qu’il subissait une attaque frontale de son épouse. Il fut soudain envahi par une sourde angoisse ; il n’avait aucun projet pour la journée au-delà de la prochaine demi-heure consacrée à la lecture détaillée du « Havre Libre ». Après une nuit perturbée, les doigts de pieds en éventail dans ses charentaises il avait investi la cuisine. Une fois ses biscottes beurrées avec un soin maniaque il s’était penché sur le mode d’emploi de sa nouvelle cafetière italienne, puis, les mots-croisés achevés, s’était acharné sur son transistor afin de trouver le résultat des matchs de foot du week-end. Tout ça pour faire durer le plus longtemps possible la cérémonie du petit déjeuner. Et maintenant, qu’allait-il pouvoir faire de sa journée ?
Faute de mieux, la remarque acide d’Adélaïde lui donna une idée :
-Si tu veux Cocotte je vais décaper la table du salon et appliquer une double couche de vernis…
-C’est une bonne idée mon chéri mais tu devras choisir les bons produits. Demande conseil au droguiste sinon nous risquons d’être obligés d’en acheter une neuve… je te rappelle que ta pension ne s’élève qu’à 50% de ton dernier salaire de commissaire...
Cette pointe de sarcasme et ce doute objectif sur ses capacités de bricoleur ne le contrarièrent même pas. La remarque était parfaitement justifiée.
-T’inquiète pas. Je finis de lire mon canard, je file chez le droguiste et je m’y mets.
Henri se leva, fit trois fois le tour du salon le journal sous le bras, s’arrêta devant la fenêtre et observa le jardin. Il n’y avait plus rien à faire là-dedans après une semaine consacrée à l’arrachage des mauvaises herbes, taillage des haies, binage et autres travaux ingrats qui faute d’intérêt lui évitaient de penser à l’avenir. Le tic-tac de l’horloge du salon, synchrone avec les battements de son palpitant, résonnait dans la maison silencieuse, impression inédite, vagues d’ondes négatives qui refluaient par bouffées successives ; il fallait vraiment n’avoir rien à faire pour se concentrer sur ce bruit mécanique incongru ; Clock, clock, clock… Les heures s’égrenaient au rythme du balancier, annonciatrices d’une petite mort programmée en attendant le grand saut…
Le carillon endiablé sonna neuf heures, ce tintamarre eut le mérite de sortir Henri de sa torpeur, conscient qu’une dérive fâcheuse était possible si sa tendance à l’ennui s’avérait chronique vu son gout immodéré pour les vins de Bourgogne dont il possédait un stock conséquent à la cave.
Henri s’était déjà entretenu avec Adélaïde de sa tendance dépressive due à son nouveau statut de fonctionnaire inactif, médaillé du travail, entretenu par l’état. Ils étaient arrivés à la même conclusion : en retraite il devrait s’atteler à de vrais projets personnels, constructifs et valorisants. Seule l’écriture le tentait. Il avait déjà réussi à faire éditer ses souvenirs de la guerre d’Espagne à 2000 exemplaires, score modeste certes, mais plutôt encourageants. Pouvait-il envisager une suite ? Henri avait un temps songé à s’essayer au roman ; il avait souvent élaboré des scénarios judicieux dans le cadre de ses enquêtes pourtant, devant la page blanche, dès qu’il s’agissait de tout inventer l’imagination romanesque lui faisait défaut. Il avait abandonné cette piste et s’était orienté vers l’essai avec une intention précise. Henri avait été passablement énervé par le film Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls sorti en 1971 qui comparait implicitement l’immense majorité des Français à des veaux subissant sans rechigner l’occupation allemande. Il se sentait capable, compte tenu de son parcours, d’apporter quelques démentis à cette affirmation. Sans porter une vision complaisante sur le comportement collectif des Français durant la dernière guerre, il convenait d’après lui, de nuancer le propos. Il en voulait pour preuve l’attitude de ses propres hommes durant l’occupation, simples flics en pèlerine qui l’avaient maintes fois prévenu, lui le patron d’un réseau FTP, des intentions malveillantes du chef de service notoirement collaborateur. En quatre années de Résistance jamais l’inspecteur Henri Poirier ne fut trahi par ses collègues. Mais pour aborder ce sujet, se mêler au débat, encore fallait-il être en possession de tous ses moyens ce qui, pour l’instant, n’était pas son cas.
***
Henri Poirier était de la classe 34, une chance ! Il ne fut appelé que 12 mois sous les drapeaux grâce à la loi Paul Painlevé de 1928. Cet incorrigible optimiste avait ramené la durée du service militaire de 18 mois à un an, mais en mars 1935, en raison des tensions politiques intra-européennes dues à la montée du fascisme cette durée repassa à deux ans. Henri Poirier remplit ses obligations militaires au 74ème RI du Havre en qualité de secrétaire du colonel ce qui lui laissa pas mal de temps libre. Il en profita pour préparer le concours d’entrée à l’école de police. Sorti major de sa promotion, diplôme en poche, il prit un congé sabbatique de longue durée et participa à la lutte antifasciste, s’engageant en Espagne dans les rangs de la 11ème Brigade internationale. En fin de carrière, grâce à ses états de service d’officier de la police judiciaire, à son rôle éminent dans la Résistance, l’administration consentit à inclure dans son décompte de retraite l’épopée espagnole de huit mois durant laquelle ses cotisations aux caisses n’avaient pas été versées. À compter du 11 septembre 1973 il pouvait donc prétendre avec 37 annuités et demie à une retraite bien méritée. Henri Poirier, lesté d’un petit éclat d’obus franquiste dans la couenne, n’avait sollicité aucun avantage. Ce départ anticipé présenté comme une bonne nouvelle par le sous-préfet l’avait surpris et désorienté…Son premier adjoint l’inspecteur principal Charles Roussel recommandé par Henri fut nommé au grade de commissaire pour le remplacer puisque Lucien Porto, l’autre adjoint historique d’Henri avait été attiré à Paris par les sirènes du contre-espionnage plus conforme à ses goûts d’aventurier, la sirène en chef ayant emprunté pour l’occasion les formes graciles d’Hervé Dumouriez, patron de la DST et ancien compagnon d’armes brigadiste d’Henri Poirier.
***
Henri parcourait en premier les faits divers quand il lisait le Havre Libre, puis, attaquait dans l’ordre : la politique internationale, la rubrique nécrologique, les petites annonces, les programmes de cinéma et enfin les pages consacrées aux sports.
Edouard Leclerc, fils du célèbre homme d’affaire havrais Julien Leclerc a trouvé la mort en plein centre-ville dans un tragique accident de la circulation.
Ce titre écrit en gros caractères retint son attention. Cette présentation racoleuse était inhabituelle dans les colonnes faits-divers qui relataient plutôt de modestes histoires de trafic à la petite semaine, de cambriolages ou de procès divers en incivilités. Henri connaissait personnellement le père de la victime Julien Leclerc, le magnat des industries pharmaceutiques. Il avait enquêté dans son entreprise en 1969 après la plainte déposée par un collectif de cultivateurs normands en colère qui accusait l’industriel d’avoir pollué par négligence une immense zone agricole.
Edouard Leclerc a trouvé la mort au volant de sa DS Pallas. Pour une raison à ce jour inconnue il a perdu le contrôle de son véhicule dans la rue de Verdun en direction du centre-ville, juste avant le carrefour de Montmorency. Des travaux d’entretien sur le réseau d’eau potable, correctement signalés, étaient en cours de réalisation depuis plusieurs jours. Monsieur Edouard Leclerc a défoncé les barrières de sécurité du chantier, percutant au passage un ouvrier, monsieur Moussa Diallo qui fut tué sur le coup. Le véhicule a terminé sa course mortelle en s’écrasant contre la remorque d’un Caterpillar stationné dans la zone. Le corps d’Édouard Leclerc, atrocement mutilé a été extrait de la carcasse de la DS par la 3ème brigade des pompiers du Havre.
-Adélaïde, tu as lu l’article sur l’accident du fils Leclerc ?
Contrairement à son mari, Adélaïde avait un programme chargé. Elle se méfiait des commentaires d’Henri après la lecture du journal ; les échanges pouvaient prendre, s’il s’ennuyait, des allures de réunions militantes interminables où l’on évoquait pêlemêle la politique municipale, les affaires sociales et les derniers potins.
-Oui, je l’ai lu… Charles va avoir du boulot…2 morts…Quand un fait divers commence par : pour une raison inconnue cela sous-entend qu’il y aura une enquête de police. Excuse-moi, je suis sur le départ, j’ai beaucoup de courses à faire. Je prends les clés de la maison si tu vas chez le droguiste…
La porte d’entrée claqua. Henri prit la décision radicale de bloquer le balancier de l’horloge au risque d’être confronté à une scène de ménage ; Adélaïde trouvait le bruit du tic-tac apaisant. Il posa sur le phono un 78 tour daté de 1931 I’m just a gigolo de Bing Crosby avant d’attaquer les dépêches de l’AFP dans la rubrique « nouvelles du monde ».
Mardi 5 septembre 1973, un commando palestinien prend 13 otages à l’ambassade d’Arabie Saoudite à Paris…
…Grenades dégoupillées en main les quatre membres du commando encadrent les otages et les conduisent vers le minibus aux vitres occultées par des bâches… Ils exigent un avion et la libération d’Abou Daoud l’ancien chef de la milice palestinienne enfermé dans les geôles du roi Hussein de Jordanie. Place Beauvau Raymond Marcellin réunit son conseil de guerre pour tenter de faire face à ce nouvel acte de terrorisme qui frappe le territoire français.
Henri reposa le journal d’un air songeur. Il partait en retraite alors que, pour la première fois depuis la fin de la guerre d’Algérie et les attentats de l’OAS, la sécurité du territoire était menacée. Il n’aurait certainement pas refusé de signer pour un ou deux ans supplémentaires afin de tester de nouvelles méthodes de travail dans la lutte contre le terrorisme. Sa récente conférence, devant un parterre de jeunes diplômés, ayant pour thème : Montée des mouvements activistes extrémistes en Europe, comment la PJ peut-elle faire face aux risques d’attentat ? lui revint en mémoire. Il relut le préambule :
Tous les pays européens sont touchés par la prolifération des groupes armés. L'Italie est durement frappée par des actions terroristes revendiquées par les Brigades Rouges d’inspiration marxiste-léniniste. Ces dernières exercent un important pouvoir d’attraction sur une certaine jeunesse prête à en découdre, imprégnée par les soulèvements étudiants et ouvriers de 1968, engagée dans la lutte anticapitaliste contre l’impérialisme américain et meurtrie par l’injustice faite aux Palestiniens. Les Brigades Rouges implantées dans les usines italiennes adoptent la lutte armée et servent de référence aux Cellules Communistes Combattantes en Belgique. En Allemagne un conflit générationnel s’installe entre cette même jeunesse anticapitaliste et la classe politique qui ne s’est pas complètement débarrassée des anciens Nazis souvent installés à des postes importants de la République Fédérale. La Fraction Armée Rouge entame une guérilla urbaine contre le système, bientôt suivie par d’autres groupes marxistes et anarchistes armés. La France n’est pas épargnée. La Gauche Prolétarienne d’inspiration maoïste prône la lutte armée après la condamnation à mort d’un militant anarchiste catalan. Les GARI, anarchistes antifranquistes exilés en France, passent à l’action.
Le décor est planté messieurs, il n’est pas réjouissant, il va falloir protéger nos concitoyens de cette chienlit. Je vais commencer par énoncer les directives du ministère de l’intérieur…
Henri Poirier s’entendit dire à voix haute :
-Faudrait que tu fasses du tri dans tes paperasses, ça te sert à quoi de garder tous ces dossiers ?
Ne disait-on pas que parler tout seul était un des premiers signes annonçant une sénilité précoce ?
…Autrefois Henri Poirier s’était souvent retrouvé du côté des manifestants : ouvriers revendiquant plus de justice sociale, antifascistes en lutte contre les ligues d’extrême droite mais il avait toujours condamné la violence susceptible d’ébranler les fondements de la République. Bien qu’il puisse comprendre les motivations des révoltés en guerre contre la dérégulation d’un système capitaliste tout puissant, contre l’impérialisme américain, il savait que la guérilla urbaine et l’assassinat n’était pas une réponse appropriée. Seule une politique de gauche raisonnable et réformatrice sur le long terme, appliquée au plus haut niveau des instances européennes, pourrait favorablement peser sur le sort du monde…
Sa voix résonna une nouvelle fois dans la maison vide…
-En y regardant de plus près, ce que tu aimerais c’est que le préfet te demande de rempiler…Pauvre idiot personne n’est indispensable ! La relève est assurée. Occupe-toi plutôt de refaire la table du salon…
Éducation ouvrière
Robert Schmidt s’éteignit en 1963 un mois après sa femme Émilienne. La vente de leur bar-tabac du quartier de l’Eure, le Rialto, servit essentiellement à éponger les dettes du couple. Serge, âgé de 18 ans, se retrouva livré à lui-même avec pour seul pécule un modeste livret de Caisse d’Épargne ouvert par les Schmidt à son nom. Serge, qui venait de décrocher son bac philo, fut contraint d’abandonner ses études et de faire son service militaire. À son retour, en attendant des jours meilleurs, il décrocha grâce à ses mollets musclés un poste de coursier à vélo dont personne ne voulait dans une maison de transit du centre-ville. Plus tard le port recruta des dockers occasionnels. Il saisit l’occasion attiré par une paye plus conséquente. Trois années durant Serge Rich vécut sans aucune sécurité de l’emploi mais en osmose avec un milieu ouvrier qu’il apprit à connaître. Il se syndiqua à la CGT. « Acheter son timbre » était quasi obligatoire si on voulait faire partie de la « grande famille ». Serge était proche de Mathieu Bertin, chef d’équipe et délégué du syndicat. L’homme, un grand rouquin baraqué avait été ému par son parcours, par sa volonté de s’en sortir. Avec son bac philo en poche Serge avait un niveau d’études supérieur à tous ses collègues et pourtant il ne la ramenait pas. Il respectait les gens, se soumettait à l’autorité de ceux qui connaissaient le travail. Dans la bordée de Serge on discutait beaucoup de politique pendant les pauses ou les quarts de nuit pour passer le temps en attendant les bateaux. À la lueur d’un réverbère, au bout du quai, les dockers grillaient cigarette sur cigarette et refaisaient le monde, le nez au vent. Mathieu savait transformer les discussions informelles en petits meetings politiques où l’on s’interpelait, toujours dans la bonne humeur. Au début Serge avait eu du mal à participer aux conversations. Il ne comprenait pas tout à cause de l’accent havrais de ses collègues, mais petit à petit il maîtrisa les subtilités du langage et finit lui-même par choper l’accent. L’assassinat de John Fitzgerald Kennedy alimenta les conversations pendant un bon bout de temps. Mathieu, marqué par un article de l’Humanité, affirmait que JFK avait été éliminé par un lobi militaro-industriel qui reprochait au président de ne pas vouloir s’engager dans une guerre totale au Vietnam ; pour ces va-t-en-guerre Kennedy avait dépassé les bornes, d’ailleurs en 61 il s’était déjà aplati devant les communistes après l’échec du débarquement des exilés anticastristes dans la baie des Cochons.
- Vous verrez ! Clamait Mathieu, Un jour on aura la preuve que ce faux cul de Johnson et la CIA étaient les commanditaires du meurtre de JFK !
- Vivement que le grand Charles nous sorte de l’OTAN, répliqua Gaby Chotard, ancien FFI, seul docker au Havre se définissant « Gaulliste de Gauche » -un non-sens absolu pour tous ses collègues cégétistes-Ces fouteurs de merde de Ricains sont partout, on se fait bouffer. À part le cinoche et le rock n’roll chez eux tout est à jeter !
- Gaby, Ce n’est pas le tout d’avoir une grande gueule, faut agir, commence par nous confectionner une banderole « US go home, application des accords de Paris1, la France doit sortir de l’OTAN » lettres noires sur fond rouge pour la manif de samedi…Au moins làdessus on est d’accord ! Crois-moi l’ancien, les Ricains, face aux Viets ne peuvent pas gagner, on est bien placés pour le savoir, tu as vu l’état de nos troupes au retour d’Indochine ?
Serge développa sa fibre politique et syndicale au contact de ses copains dockers. Souvent il passait à la bibliothèque municipale pour enrichir ses connaissances sur l’histoire de la classe ouvrière au Havre, de Jules Durand au front populaire en passant par la grève des métallos de 1922. Il avait attaqué la lecture du Capital et du Manifeste du Parti Communiste et, même si certaines choses lui échappaient, il s’engagerait avec un bon bagage. Recommandé par Mathieu, Serge aurait pu décrocher un contrat de docker à temps plein mais le sort en décida autrement. En avril 1968, à la bibliothèque, il se retrouva nez à nez avec son amie de lycée Margaret Leclerc qui lui proposa de le faire entrer chez Leclerc and C°, l’un des plus gros consortiums pharmaceutiques de France. Son patron de père n’avait rien à lui refuser et elle se faisait fort de le convaincre. L’entreprise recrutait à tous les postes depuis le succès d’un nouveau médicament antihypertenseur mis au point dans ses laboratoires.
Serge avait fait la connaissance de Margaret en seconde. Cette petite jeune fille blonde et fluette était la vedette d’un corps de ballet privé qui se produisait régulièrement dans les spectacles de comédies musicales dont les Havrais étaient si friands. Elle ne se contentait pas de faire preuve de grâce et d’élégance sur scène, elle était comme cela dans la vie. On avait l’impression qu’elle effleurait le sol quand elle se déplaçait, chacun de ses gestes était harmonieux. La bande de garçons boutonneux du collège Porte Océane dont faisait partie Serge se retrouvait deux fois par semaine au bar Le Caïd avec les filles du lycée pour converser à bâtons rompus devant un verre de lait grenadine. Ils parlaient surtout de pop music, des aléas de la vie de collégien et de leurs profs qu’ils jugeaient conventionnels et ennuyeux. Comme tous ses copains Serge était amoureux de Margaret. Il ne se lassait pas de la voir réajuster son petit chignon blond perché sur le dessus de son crâne, découvrant sa nuque ravissante. Elle serrait sa pince à cheveux entre ses dents le temps de remettre sa chevelure en forme, ses lèvres roses et humides se contractaient légèrement. Serge attendait cet instant fugace avec impatience le trouvant particulièrement érotique. Inspiré par Margaret il s’était lancé dans un exposé sur Edgard Degas, la classe s’esclaffait quand il s’attardait sur la grâce des ballerines du maître qu’elles soient croquées au fusain ou peintes à l’huile.
-Eh Rich ! Toi aussi tu aimerais bien la croquer la Margaret ! S’était exclamé Postel le balourd depuis le fond de la classe, ce qui lui avait valu deux heures de colle.
Margaret et Serge partageaient un secret. Ils étaient tous les deux convaincus que la science n’expliquait pas tout. Leur premier échange sur ce sujet avait eu lieu au Caïd à la suite de la lecture du Matin des Magiciens de Louis Pauwels et Jacques Bergier. Ce livre, véritable phénomène éditorial consacré à des domaines de connaissance à peine explorés par les scientifiques remettait au goût du jour l’irrationnel comme dans les années 20. Un chapitre consacré aux capacités mentales de l’homme, pressenties mais jamais démontrées, les avait particulièrement frappés. Parapsychologie, télépathie et autres étrangetés les fascinaient. Malgré leur jeune âge, ils avaient vécu de bien curieuses expériences.
L’année de ses treize ans Margaret était allée rejoindre ses cousins dans une maison de vacances à Lancieux, une petite bourgade des Côtes du Nord. Arrivés à destination la 403 du paternel avait franchi une haute grille en fer forgé et s’était engagée sur une allée bordée de platanes. Au détour d’un virage Margaret avait découvert au fond du parc la belle bâtisse du siècle dernier dans laquelle elle allait passer de joyeuses vacances. À ce moment précis elle avait ressenti une impression étrange : elle était déjà venue ici, mieux elle aurait pu décrire l’intérieur de la maison : le hall d’entrée carrelé de noir et blanc, l’immense miroir au cadre baroque, le salon aux tentures bleues meublé d’un canapé de type chesterfield en velours. Avant d’entrer dans sa chambre Margaret savait que les murs seraient décorés d’estampes japonaises et qu’un globe terrestre lumineux, posé sur la table de nuit, ferait office de lampe de chevet.
Margaret craignait de passer pour une folle si elle racontait cette histoire à son père, chercheur chimiste de formation, pragmatique, habitué à mettre tous les problèmes en équations, ou à son frère Edouard engagé dans une filière scientifique. Margaret pressentait qu’elle avait déjà vécu ce moment à Lancieux dans une autre vie et la lecture du chapitre du Matin des Magiciensconsacré à la métempsychose acheva de la troubler. Elle attendit durant de longues années que le phénomène se reproduise mais cela n’arriva jamais. Seul Serge pouvait comprendre son désarroi car lui aussi, sous une forme différente, avait été confronté à l’inexplicable…Son expérience était encore plus troublante…
1 Traité de cessez-le-feu signé le 27 janvier 1973 entre les E-U et le Vietnam
DS Pallas
Pendant longtemps Serge n’eut aucun souvenir de sa petite enfance. Quelques bribes de mémoire lui revinrent cependant à partir de l’âge de sept ans, quand il eut la chance d’être confié aux Schmidt. Paradoxalement, alors qu’il se reconstruisait, une force obscure l’agressa, déchaînant contre lui une arme puissante : le cauchemar récurrent. Cauchemar terrifiant qui le fit hurler la nuit pendant des années le rendant énurétique au point que les Schmidt consultèrent sans succès médecins, rebouteux et exorcistes, ce qui allait à l’encontre de leurs convictions de libres penseurs. Serge voyait dans ce songe délirant le visage d’une jeune femme allongée par terre. Sa joue reposait sur un tapis aux motifs chatoyants. Ses yeux noirs exprimaient la terreur. Elle regardait Serge fixement, un mince filet de sang s’écoulait de sa bouche entrouverte. Soudain un énorme bâton cerclé de métal s’abattait sur sa tempe, son visage se disloquait. La deuxième partie du rêve se déroulait aux abords d’une forêt, le soleil levant éclairait la scène, deux hommes habillés de noir, tiraient par les pieds le cadavre d’une femme dont la tête tressautait sur le chemin empierré… C’était elle, il en était sûr, bien qu’il ne puisse distinguer ses traits. Les deux assassins précipitaient le cadavre la tête la première sur une borne blanche d’origine indéterminée. Ces rêves terrifiants cessèrent lorsque Serge fut assez grand pour maîtriser ses émotions et qu’il réussit, selon ses propres termes, à ranger ce cauchemar dans un tiroir qu’il ferma à clé. L’énurésie cessa. Serge n’arriva jamais à décrypter la signification de ce premier rêve « réaliste ». Souvent il fut tenté d’ouvrir le tiroir pour essayer d’en savoir plus sur la femme martyrisée mais à chaque fois le courage lui manquait.
Il y eut régulièrement d’autres songes, qui le mettaient en garde quand une forme de danger s’annonçait. Il fallait alors les décrypter, extraire le vrai message des phantasmagories qui l’enrobaient, comprendre la nature de la menace. Si Serge arrivait un jour à maîtriser ce don singulier, il disposerait d’un formidable outil à forcer le destin.
La première vraie prémonition ressentie par Serge eut lieu en décembre 1955, il venait d’avoir 11 ans. Il avait eu du mal à s’endormir ce soir-là, Émilienne avait mis une bouillote au fond de son lit, malgré cela Serge n’arrivait pas à se réchauffer. Il eut soudain l’impression de plonger directement dans son rêve sans avoir au préalable ressenti la sensation d’endormissement. La vision fut soudaine et d’une netteté hallucinante. Un grand singe chaussé de bottes en caoutchouc dégueulasses apparut en haut de sa rue, poussé au train à coups de balai par une harpie échevelée. L’animal venait à sa rencontre en claudiquant. Cloué au sol Serge n’arrivait pas à bouger. Il hurla au secours.
-N’aie pas peur mon garçon lui dit le primate, je suis obligé de commettre une mauvaise action, mais tu n’as rien à craindre.
Le grand singe au regard doux prit Serge par la main. Tels des fantômes ils passèrent à travers la porte de service du bistrot. Serge se retrouva assis sur un tabouret de bar à observer son nouvel ami s’exercer au jeu de fléchettes. La partie terminée le singe piqua la caisse et s’enfuit. Serge par la fenêtre aperçut la harpie qui brandissait un balai. Elle se calma quand le singe lui montra les billets de banque. Bras dessus bras dessous, ils disparurent dans la brume.
Deux jours après Robert Schmidt portait plainte pour le cambriolage de son bar. On lui avait dérobé sa recette de la semaine et deux bouteilles de rhum. L’individu avait forcé la porte de derrière. Après une courte enquête la police appréhenda un certain Gaspard Ferrand, égoutier de son état, un fidèle client. Il avait joué au 4/21 accoudé au bar avec le patron, avait vu le tiroir-caisse bien garni et était revenu cambrioler l’établissement dans la nuit. Robert ne porta pas plainte. Le cambrioleur lui demanda pardon et n’invoqua qu’une seule excuse : sa femme le harcelait parce que sa paie d’égoutier ne suffisait pas et « qu’elle ne pouvait même pas s’acheter une robe neuve ».
Malgré son jeune âge Serge fit tout de suite le rapprochement. Gaspard était souvent mis en boîte par ses copains de boisson à cause de son système pileux développé, Serge l’avait transformé en singe dans son rêve. Le singe portait des bottes d’égoutier, il était poursuivi par une mégère, sans doute sa femme. De plus Gaspard était le seul client qui jouait aux fléchettes avec lui. Serge ne parla même pas de son rêve à ses parents adoptifs, ils ne le croiraient pas. Pourtant cette première expérience bouleversa sa vie.
***
-Margaret, c’est Serge à l’appareil…
-Ça me fait plaisir de t’entendre…
-Ça recommence… Il faut qu’on parle…Tu dois te rendre quelque part en voiture avec ton frère ces jours-ci ?
-Édouard doit passer me prendre samedi pour aller au Concorde, c’est dans ce cinéma que mon père organise l’Arbre de Noël pour les enfants de ses employés, il tient à ce que nous soyons présents…
-Irez-vous dans un parc ? S’inquiéta Serge.
-Avant d’aller au Concorde on passe par le square Saint Roch. Mon père a demandé à un photographe de faire une photo de famille dans un environnement champêtre à l’intention de la presse.
-Pour quel motif ?
-Illustrer un article sur son action en faveur d’un jumelage entre Le Havre et New-York, si ça marchait ce serait bon pour ses affaires…
-Ton frère roule en DS Pallas ?
-Oui…Encore tes foutus rêves ?
-Ils sont de plus en plus délirants. En tout cas promets-moi que samedi ton frère ne sortira pas sa bagnole du garage…
Les arguments de Margaret n’arrivèrent pas à convaincre Édouard, décidemment sa sœur était complètement piquée avec ses histoires de quatrième dimension. Il fit semblant d’accepter de rester chez lui pour qu’elle lui fiche la paix, sachant très bien qu’il se rendrait au Concorde comme prévu pour faire plaisir à son père…
Brochette de poulets
Depuis sa mise à la retraite Henri Poirier retrouvait chaque vendredi midi le commissaire Charles Roussel et sa bande de flics au Pépito. Henri attendait ce moment avec impatience, prolongeant ainsi une vieille habitude ; pendant 10 ans son équipe et lui étaient venus déguster une fois par semaine le meilleur frichti du quartier de l’Eure chez Simone et Georges. Henri avait parfois l’impression de s’incruster dans le monde des actifs même si ses anciens collègues étaient ravis de sa présence. Un jour il devrait rompre définitivement le cordon le reliant à la « maison poulaga ». Ce n’était pas en retrouvant chaque semaine une brochette de poulets autour d’un plat en sauce qu’il y arriverait. Quand les flics parlaient boulot, Henri prenait garde de ne se montrer ni intrusif ni donneur de leçons. Jamais il ne prenait l’initiative d’en parler lui-même sauf si on lui demandait son avis. Adélaïde était consciente de l’affection qu’éprouvait son mari pour ses ex-collègues. Plutôt que de les retrouver au bistrot, elle lui suggéra de les inviter régulièrement au 21 bis rue de la Forêt avec épouses ou concubines, progénitures, parents, animaux domestiques acceptés. Dans ce cadre familial les rencontres ne se transformeraient sans doute pas en réunion d’anciens combattants de la PJ. Henri entendait l’argument, Adélaïde avait raison mais il retardait l’échéance.
***
Le retraité claqua la bise à Simone et à Georges en pleine préparation d’un savoureux cocktail à base de Bénédictine, curaçao et Clairette de Die. Simone assurait les dosages et secouait le shaker, Georges se contentait de goûter la mixture et de donner des directives.
-Le commissaire Roussel paie l’apéro pour arroser sa promotion, je t’en prépare un petit ?
-Non merci mon bon Georges, tu me sers la Clairette, sans ornement ni autre fioriture, j’évite les alcools forts…
-Tu t’engages sur une mauvaise pente Henri, t’es moins marrant quand t’es sobre ! Persifla Simone. Tu te fais du mal pour rien, je suis sûr que tu as un foie de jeune homme ! Charles t’attend à la table du fond, il te réserve une surprise !