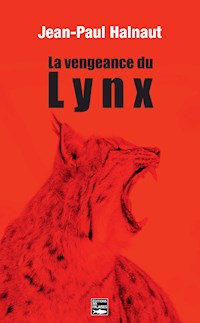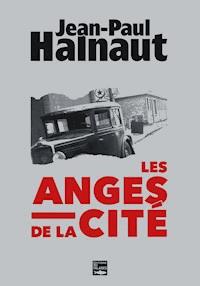Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions des Falaises
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le Havre 1944. Parcours d’un truand américain poursuivi par un commissaire avant-gardiste et haut en couleur.
Dans une ville qui se remet à grand-peine des bombardements de septembre 1944, le truculent commissaire Henri Poirier, adepte des nouvelles méthodes d'investigations policières, enquête sur une série d'agressions criminelles commises à l'encontre de jeunes femmes. Le parcours chaotique de Tony, un truand américain maigre comme un clou mais non dénué de charme, fruit des amours entre une cauchoise et un ouvrier des abattoirs de Chicago vétéran de la Première Guerre mondiale, passe par les camps "cigarette" installés au pourtour du Havre. Les destins du flic atypique et du voyou devenu soldat d'élite par obligation se croisent au Havre.
Un roman piquant qui nous plonge dans une enquête sur une série d’agressions commises à l’encontre de jeunes femmes dans les années d’après-guerre.
EXTRAIT
Au Havre, si l’on pousse la promenade jusqu’au bout de la digue du sémaphore, on découvre, face à l’entrée du port, une stèle en cuivre, noircie par les embruns, sur laquelle on peut lire. Cette stèle a été érigée pour rappeler que Le Havre fut le principal port de débarquement, puis de rapatriement des armées américaines de libération : entre septembre 1944 et août 1946, 3 675 000 Américains sont passés par ce port. En mars 1945, Henri Poirier, commissaire de police méthodique et pugnace enquêtait sur une série d’agressions perpétrées au Havre à l’encontre de jeunes et jolies femmes. C’est à cette occasion qu’il entendit parler pour la première fois du GI Tony Cascarino, un grand escogriffe sorti des bas-fonds de Chicago pour venir libérer la France.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Jean-Paul Halnaut, Havrais, est également l´auteur du roman
Le Havre 41 ou les déboires d´un Sénégalais, publié en 2009 aux Editions Publibook. Pour son livre
GI's Blues, il s'est vu remettre officiellement le Prix normand de littérature 2013 au Neubourg, décerné par le district Normandie du Lions Club international.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Merci à Annie et à François pour l’aide qu’ils m’ont apportée
Au Havre, si l’on pousse la promenade jusqu’au bout de la digue du sémaphore, on découvre, face à l’entrée du port, une stèle en cuivre, noircie par les embruns, sur laquelle on peut lire : Cette stèle a été érigée pour rappeler que Le Havre fut le principal port de débarquement, puis de rapatriement des armées américaines de libération : entre septembre 1944 et août 1946, 3 675 000 Américains sont passés par ce port.
En mars 1945, Henri Poirier, commissaire de police méthodique et pugnace enquêtait sur une série d’agressions perpétrées au Havre à l’encontre de jeunes et jolies femmes. C’est à cette occasion qu’il entendit parler pour la première fois du GI Tony Cascarino, un grand escogriffe sorti des bas-fonds de Chicago pour venir libérer la France. La fiche d’informations le concernant était libellée ainsi : Cascarino Tony : sergent à la deuxième section de combat du 89th US Infantry Division basée au camp Herbert Tareyton au Havre, domicilié à Chicago, est né à Étretat d’une mère française et d’un père américain ayant servi en France pendant la Première Guerre mondiale. Ce soldat bénéficie de remarquables états de service aux armées, mais dans la vie civile, Cascarino surnommé Tony la gâchette a été condamné à plusieurs reprises pour gangstérisme par le procureur de l’état du Michigan.
Vittorio
Tony Cascarino connaissait bien l’odeur du sang. Son père Vittorio exerçait la profession de découpeur de porcs, en trois-huit chez Swift and Company, le plus grand abattoir de Chicago. Il traînait sa misère dans ce lieu immonde depuis le début du siècle. Son job consistait à asséner un grand coup de hache au niveau de la quatrième vertèbre de l’animal encore chaud afin de le disloquer. Il disposait de cinq secondes pour saisir sa lame à découper, retourner la masse de bidoche et l’éventrer. Ensuite, après avoir sectionné la base de l’œsophage, il devait enfouir la main au plus profond des entrailles de l’animal afin d’en extirper les viscères d’un seul geste. Quand il entendait l’impact mou des boyaux qui s’éparpillaient sur le tapis roulant, il appuyait sur le bouton jaune et agrippait une autre bête.
Dix minutes après le début de sa prise de poste, Vittorio éclaboussé d’un rouge épais, son surin à la main, ressemblait déjà à un monstre effrayant.
Ce n’était pas G.-H. Ford qui avait inventé le travail à la chaîne pour produire la fameuse Ford T mais bel et bien le cartel des bouchers de Chicago. Depuis l’ouverture du premier abattoir de l’Union Stockyards en 1865, leurs gros bonnets avaient régulièrement progressé dans l’art d’exploiter à moindre frais leur misérable main d’œuvre.
Au premier jour d’embauche, la direction fournissait une fois pour toutes les outils tranchants à l’employé qui devenait responsable de leur bon aiguisage, deux longs tabliers blancs descendant jusqu’au sol et une paire de godillots usagés. Le matin, les « cols blancs » vérifiaient régulièrement l’état des lames et la propreté des tabliers. En cas de négligence, la mauvaise graine écopait d’une retenue sur salaire.
À la fin de son quart, Vittorio jouait des coudes pour essayer d’atteindre un des cinq robinets disponibles en bout de chaîne pour se laver les mains puis il fourrait son tablier écarlate et ses godasses dans son sac avant de foutre le camp en claquant la porte.
Il n’avait pas desserré les dents de toute la journée et rentrait chez lui débordant de haine.
Chicago 26 mai 1930, au petit matin
Réflexion sur la mort des cochons
Le patron du Crazy Devil jeta Vittorio Cascarino dehors à grands coups de pompes dans le train. Il faut dire que l’ivrogne l’avait bien cherché.
À cinq heures du matin, alors que tous les clients prenaient leur petit-déjeuner dans le seul établissement ouvert au sud de Carmel Street, Vittorio avait surgi côté bar en poussant la porte du pied. Il réclamait à boire, il réclamait justice contre ces fumiers de patrons, apostrophant les clients à peine réveillés, pour la plupart des employés travaillant chez Mac Cormick en trois-huit. Titubant d’une table à l’autre, Vittorio avait fini par s’écrouler sur les genoux d’un vieil homme en bleu de chauffe dont il avait renversé la tasse de café. Bon gars, l’ancien l’avait remis debout et accompagné jusqu’à une banquette située à côté du billard. Au début, par solidarité ouvrière, l’ivrogne attirait la sympathie. Par les temps qui couraient on avait de bonnes raisons de se saouler.
Toutes les semaines en ce mois de mai 1930, à cause de la crise, les émeutes éclataient un peu partout dans Chicago ; licenciements, baisse des salaires, inflation, expropriations. Inexorablement la misère s’installait. Piétinés par les sabots des canassons de la police montée, frappés à mort à coups de gourdins ou de barres de fer par les nervis du patronat, les ouvriers laissaient éclater leur colère. Des deux côtés, on comptait les morts.
– Ben qu’est-ce qui t’arrive ? demanda le vieux tout en laissant choir malencontreusement Vittorio au milieu de la banquette défoncée, juste sur un ressort à boudin qui avait fini par percer le tissu molletonné.
– Aïe ! fit l’autre en se frottant les fesses. Paie-moi à boire et j’te raconte !
– T’as ton compte ! reprit le patron derrière son bar. Un café si tu veux à condition qu’après tu dégages et que t’ailles te coucher.
Les clients, un moment distraits par le spectacle, replongèrent le nez dans leur bol. Ils étaient pressés, la pointeuse ne leur ferait pas cadeau du temps perdu.
– Vous m’emmerdez, tas de cons !
Le vieux posa la main sur l’épaule de Vittorio.
– Qu’est-ce qu’ils t’ont fait mon gars ?
– Ils ont baissé mon salaire de dix pour cent, les fumiers ! À moi, tu te rends compte, vingt-cinq ans d’ancienneté aux abattoirs à découper de la bidoche, on me donne un boulot moins qualifié et j’accepte ou je prends la porte. Moi j’suis boucher de métier et on me confisque mon couteau !
– Pourquoi ?
– Faut aller plus vite qu’ils disent, pour que les abattoirs restent rentables, gagner du temps sur la mise à mort en supprimant l’assommage et en plus la bidoche, plus fraîche, sera de meilleure qualité. Faut repenser l’organisation.
– Comment tu fais maintenant ?
– Avec un autre, je saisis le porc à bras-le-corps et on lui passe un collier de cuir autour du cou. Le collier est fixé à une chaîne reliée au palan. Après on tire comme des sourds. Pendu le cochon ! Il n’est pas mort quand il arrive à l’autre bout de l’atelier. C’est au saigneur de lui planter son couteau dans la gorge !
– Pas marrant comme boulot !
– Non pas marrant ! Surtout que le cochon, on s’imagine pas, il ne sait pas pourquoi on lui fait ça, mais il sait qu’il va crever ! Il tremble de tout son corps, il tient plus sur ses pattes, il te chie dessus, il te regarde comme s’il te suppliait de lui foutre la paix, il grogne faiblement et d’un seul coup je comprends ce qu’il me dit : Arrête, arrête, il me dit, laisse-moi partir. À chaque fois je lui réponds : Ta gueule ! avant de l’empoigner. Il est chaud, il transpire, comme nous il transpire. Toute ma vie, je vais faire ça. Tu te rends compte ? Pourtant y’a de bons côtés. Il sortit de sa poche des côtes de porc entourées de papier journal et les exhiba avec fierté, devant l’assistance médusée.
– Cadeau du contremaître en chef !
Vittorio roulait des yeux comme un fou. Il se leva d’un bon, passa derrière le bar, s’empara d’une bouteille de bourbon et but à même le goulot. Le patron essaya de récupérer sa bouteille. Vittorio le gifla et se mit à vomir sur le billard. C’est à ce moment-là que tous les clients décidèrent de le jeter dehors.
Tony fut réveillé en sursaut par le claquement de la porte de la cuisine comme à chaque fois que son père rentrait d’un quart de nuit. À douze ans, on n’a pas de problème de sommeil. Il disposait encore d’une heure avant de se lever. D’habitude il se rendormait sans difficulté. Mais cette fois, les cris et les pleurs de sa mère le tinrent éveillé. Pour une raison qu’il ignorait, Vittorio était en train de se venger sur elle. Tony n’osait même pas imaginer ce qu’il était en train de lui faire subir.
Au bout d’un quart d’heure, maîtrisant son angoisse, il se décida à intervenir. Dans la cuisine, il se mit à grelotter. Était-ce à cause du contact de ses pieds nus sur le carrelage ou de la peur qui lui tordait les entrailles ? Il ne savait plus. Il posa son oreille contre la porte de la chambre des parents. Sa mère sanglotait, il entendait le sommier grincer et, de temps en temps, le bruit sec d’une claque qu’on assène avec rage, suivi d’un cri de douleur vite étouffé.
– Papa, fous-lui la paix, cria Tony à travers la porte.
– Ah t’es là toi l’avorton ! Ça ne te regarde pas, retourne dans ta chambre !
– Papa, fous-lui la paix ou j’appelle les flics !
Instinctivement Tony rentra la tête dans les épaules. Il s’attendait à voir son père surgir de la chambre pour le battre, mais curieusement la porte s’ouvrit lentement. Vittorio passa devant lui sans même le regarder et s’enferma dans la salle d’eau pour pisser.
Tony ne risquait rien tant qu’il entendait le jet d’urine tombant dans le seau. Il se précipita dans la chambre. Adélaïde, le visage tuméfié, était allongée sur le dos. Sa chemise de nuit était déchirée.
– Maman, je vais chercher le docteur !
– Reste-là, je t’en prie, sinon il va recommencer. Ça va, je vais me reposer maintenant. On va être tranquilles. Il va bientôt dormir d’un sommeil de brute.
Tony sortit rapidement de la chambre et se posta en travers de la porte, prêt à en découdre, ce qui fit doucement rigoler Vittorio qui alla s’asseoir à la table de la cuisine.
– Rends-toi utile plutôt, p’tit crétin. Fais-moi du café. J’ai travaillé toute la nuit pour te nourrir.
Tony s’exécuta, tout heureux d’éviter la correction. Il actionna la manivelle du moulin à café en surveillant son père du coin de l’œil. Vittorio lui tournait le dos. Tony ne comprit pas tout de suite pourquoi il remuait les épaules de manière désordonnée ni pourquoi un râlement sourd lui sortait de la bouche. Il décida d’en avoir le cœur net et prit le risque de le regarder en face. Vittorio toujours en position assise s’était transformé en statue de pierre. Muscles des bras tétanisés, mains recroquevillées en sinistres pinces, tendons du cou saillant à la limite de la rupture, il fixait stupidement le seau d’urine visible par la porte entrebâillée. Peu à peu, sa bouche tordue se paralysa jusqu’à se figer entièrement, grimaçante et grotesque. Vittorio, narines dilatées, cherchait désespérément de l’oxygène. Son front commença à rougir, puis peu à peu, la congestion gagna tout son visage. Il se mit à saigner du nez. Quand Vittorio s’effondra la tête la première, les côtes de porc qu’il avait ramenées des abattoirs amortirent le choc de son front contre la table en formica, provoquant un bruit sourd et inattendu.
D’abord Tony se précipita vers la chambre pour prévenir sa mère, puis il s’arrêta en plein élan, s’assurant simplement qu’elle était bien endormie. Il se dirigea ensuite vers la porte d’entrée pour chercher du secours et se ravisa. Après deux minutes d’agitation, il finit par s’asseoir. Insidieusement, presque malgré lui, s’imposait l’idée que sa mère et lui bénéficiaient d’un coup de pouce du destin. Certes, le misérable salaire de Vittorio assurait le quotidien, mais à quel prix ! Un jour, les coups portés par Vittorio les laisseraient sur le carreau Adélaïde ou lui. Après tout il se débrouillerait toujours pour ramener de l’argent à la maison. Il devait se montrer fort, inflexible.
Vittorio remuait faiblement le bout des doigts, il gémissait encore, la figure enfouie dans la barbaque fraîche. Il eut la force de mettre la tête sur le côté pour mieux respirer. Tony croisa son regard de mourant. Il se concentra afin de ne manifester aucune émotion, ressentant même une certaine jouissance. Du haut de ses douze ans, il savourait l’instant, comme une juste récompense.
Tony resta tranquillement assis pendant une demi-heure, les deux pieds posés sur la table. Il grignota un quignon de pain noir, but un verre de lait. Vittorio ne bougeait plus du tout. Tony toucha sa joue glacée et plaça un bout de miroir ébréché sous ses narines. Rassuré, il remonta dans sa chambre et s’allongea sur son lit. Il commençait à s’assoupir quand il entendit le hurlement strident d’Adélaïde découvrant le corps de son mari.
Chicago 15 février 1943
Piège au hangar 22
Tony, accroupi dans la pénombre derrière les caisses, renifla sa main sanglante. L’odeur douceâtre eut pour effet immédiat de faire monter son taux d’adrénaline. Il n’osait pas se pencher pour voir l’ampleur de la blessure. Les deux types qui voulaient sa peau ne devaient pas être loin. La seule chose à faire était de les affronter. Il lui restait quatre pruneaux dans son Beretta, deux pour chaque salopard qui le poursuivait. Il empoigna une vieille pelle enduite de ciment qui traînait dans un coin et la plaça à portée de main. Elle pourrait lui servir s’il manquait de munitions. La balle lui avait traversé le mollet. Il avait pourtant tiré le premier sur le Jamaïcain. Le type, salement touché au ventre, avait pivoté sur lui-même avant de tomber à genoux. Tony commit alors une faute de débutant. Il tourna le dos à l’ennemi sans l’avoir achevé. Le fils de pute s’était bien affalé au sol comme une chiffe molle, sauf qu’il avait fait cracher son colt une dernière fois avant de « rendre ses clés ».
Le long couinement des roulettes sur le rail en ferraille résonna dans le hangar. Les guignols l’avaient vu entrer. Ils ouvraient la porte. Tony se protégea les yeux pour atténuer les effets de la violente lumière qui inondait les lieux. Il eut le temps de reconnaître les silhouettes du rouquin et de Fat Patty se détachant sur un fond de ciel gris et pluvieux. Croyant l’impressionner, les deux terreurs déclenchèrent un tir croisé au jugé. Une balle se logea dans le mur à cinquante centimètres au-dessus de sa tête, puis le calme revint. Des frôlements, le léger bruit des semelles de cuir sur le sol bétonné, firent comprendre à Tony que les affreux tentaient une manœuvre d’encerclement. L’autre porte, dotée d’un système à roulettes identique, lui semblait inaccessible. De toute façon, même sans avoir perdu de sang, avec ses soixante-trois kilos tout mouillé, il n’aurait jamais eu la force de l’ouvrir.
La tension monta d’un cran : le rouquin suffisamment agile, commençait à escalader une pile de caisses. Tony l’entendit réprimer des jurons ignobles et imagina avec plaisir les ravages provoqués par les échardes qui lui déchiraient la peau du cul. La partie de cache-cache durait depuis un bon quart d’heure. Maintenant le sang s’écoulait de son mollet par petites giclées régulières. Au sol, la flaque s’élargissait, s’infiltrant sous les caisses de bois. Quand elle atteindrait la travée, il se ferait repérer.
Tony posa son flingue par terre et plaqua ses deux paumes sur la blessure afin de la comprimer. Si l’artère était touchée, il lui restait dix minutes à vivre. Assis sur ses talons, il examina ses mains rougies et ne put s’empêcher de penser à celles de Vittorio, mal lavées du sang des porcs, quand elles s’abattaient sur lui, sans pitié. Depuis, il avait appris à parer les coups, à anticiper, à frapper plus vite, plus fort que l’autre pour ne pas qu’on lui fasse de mal.
Maintenant que la porte était ouverte, il avait beau se recroqueviller, l’ombre de sa jambe gauche se détachait sur l’allée. Elle prit soudain une forme bizarre, sans raison apparente, ce qui incita Tony à regarder au-dessus de lui. Il aperçut tout en haut d’une pile de caisses, la gueule en biais au regard de hyène du rouquin et l’éclat de son incisive en or. Ce con était en train de rigoler. Équipé d’une mitraillette Sten, efficace mais moins maniable qu’un revolver, l’agresseur eut besoin de trois secondes pour se mettre à genoux, prendre du recul afin de tenir l’arme à la verticale. Tony, allongé sur le dos, visa les ratiches et tira trois fois. Le rouquin s’effondra comme une masse entraînant avec lui les caisses pleines de bouteilles d’alcool. Le tout dégringola sur Tony qui se mit en boule, se protégeant le crâne de ses deux bras. Il eut le temps d’entendre l’épouvantable vacarme des fioles explosant au sol avant de ressentir une violente douleur dans le dos, puis ce fut le trou noir.
Le bourbon devait être de mauvaise qualité car son odeur âcre lui provoqua un haut-le-cœur. Combien de temps était-il resté inanimé ? Sûrement pas longtemps parce que le gros ne l’avait pas encore trouvé. Les mètres cubes de planches qui lui étaient tombés dessus, les tessons de bouteilles éparpillés au sol et le corps du rouquin derrière lequel il se planquait le protégeaient provisoirement. Tony reprit silencieusement appui sur ses jambes. À deux mètres de lui, entre les caisses, il distingua deux pieds chaussés de pompes en croco. Le goût de chiotte de Fat Patty était devenu légendaire dans le milieu de Chicago.
Il ne me voit pas. Il n’ose pas encore approcher, se dit Tony. Il pense que je suis assommé mais il n’en est pas sûr : il va tirer dans le tas par sécurité avant d’essayer de me sortir. Il pense que j’ai le pognon sur moi.
Tony se rappelait que le gros avait brandi un Colt 45 : un six coups qui fait d’énormes trous mais dont le barillet est assez long à recharger. Le Beretta était perdu, mais pas la vieille pelle. Il serra nerveusement le manche de l’outil, ses muscles fins tendus comme des cordes à piano. Son faible gabarit l’obligeait à éviter tous les affrontements directs, mais s’il se sentait menacé, son corps malingre était capable de performances étonnantes.
Tony ne savait pas prier, mais il savait compter : les deux premières balles transpercèrent toutes les caisses et vinrent se loger dans le mur, de chaque côté de lui. Le choc de l’impact des deux autres balles fut amorti par un obstacle mou : le corps du rouquin. La cinquième et la sixième percutèrent le sol soulevant des éclats de ciment acérés, dont un lui taillada la joue. Maintenant le barillet était vide.
Dans la seconde qui suivit, Tony, l’air féroce, couvert de raisinet, jaillit des débris en brandissant l’outil tel un sabre de samouraï.
En se baissant, Fat Patty évita de justesse le premier moulinet qui arrivait par la gauche. Pour un peu, il finissait décapité par le tranchant de la pelle. Il reprit vaguement confiance en voyant la carrure du diablotin face à lui. S’il l’attrapait, il lui casserait les reins d’un seul coup. Il pensa même avoir le temps de glisser au moins une balle dans le barillet de son colt et fouilla le fond de sa poche gauche, mais l’autre, par un superbe moulinet inversé, lui avait déjà écrabouillé la main qui tenait l’arme. Les bagouses de Fat Patty volèrent dans tous les sens. Phalanges brisées, il se mit à hurler de douleur. Tony se jeta sur lui, bien décidé à l’achever d’un méchant coup sur la nuque.
L’entrée en scène des flics sauva le gros homme. Ils arrivèrent aussi discrètement que le 7e de Cavalerie fondant, sabre au clair, sur un village apache. Mais là, les Ford Thunderbird modèles 38 remplaçaient les canas-sons, dérapages plus ou moins contrôlés dans la caillasse entourant le hangar, sirènes hurlantes, crissements de pneus, claquements de portières. Pétoires en avant, dans une charge flamboyante comme celle des Texas Rangers à Fort Alamo, les flics en uniforme investirent les lieux. À leur tête, exhibant une plaque rutilante de la police fédérale d’une main et leur Browning de l’autre, deux inspecteurs en civil ordonnèrent aux combattants de se tenir à carreau. Tony balança sa pelle avec une moue de dépit et se laissa menotter sans résistance. Le flic qui s’occupait de lui, vu le volume de ses trijumeaux, devait passer l’essentiel de ses loisirs à soulever de la fonte. Aujourd’hui, c’est Tony qu’il soulevait par la peau du dos, d’une main ferme, le poussant sans ménagement vers la voiture. Le baraqué ressentit pourtant un vague malaise en croisant le regard menaçant du poids plume qu’il tenait à sa merci. Empoigner Fat Patty s’avéra plus délicat. Le truand, engoncé dans ses vêtements bon marché, plaqué ventre au sol, s’essayait à des reptations grotesques. Fâchés, les flics lui bottèrent les fesses et raclèrent leurs semelles sur ses poignées d’amour dans un joli mouvement d’ensemble. Une fois le calme revenu, quatre hommes furent nécessaires pour soulever son quintal et demi.
Chicago 16 février 1943, 10h
Les deux Mac et la salle aux bottins
La lumière blafarde d’une quinzaine de néons empoussiérés, tenant miraculeusement au plafond à raison d’une vis serrée sur trois, diffusait une lumière verdâtre dans la salle réservée aux interrogatoires.
Cette pièce, baptisée salle aux bottins par les agents de la deuxième brigade de police criminelle de Chicago installée au 1222 Michigan Boulevard, vaste de cent cinquante mètres carrés était totalement vide, à l’exception d’une lourde table et de deux chaises en ferraille, dont une se trouvait positionnée à proximité d’un anneau métallique scellé au sol. Les murs blanchis à la chaux et le carrelage jaunâtre servaient d’autoroutes à différents insectes, blattes ou araignées qui cherchaient désespérément à se planquer après s’être repus de moucherons cramés victimes de la chaleur dégagée par les néons.
Deux bottins, l’un mondain intitulé Chicago Select et l’autre diffusé par les services postaux de l’Illinois, étaient posés sur la table.
Tony Cascarino, menotté, fut jeté sans ménagement sur une des deux chaises, sa jambe blessée reliée à l’anneau métallique par une courte chaîne en acier. En attendant de passer au tourniquet, il se mit à feuilleter l’annuaire des postes d’un œil morne, s’étonnant de ne voir aucun téléphone à proximité. Sa blessure le faisait souffrir, surtout depuis le charmant moment passé en tête-à-tête avec le sadique responsable de l’infirmerie. Tout en lui prédisant un avenir truffé de plombs, un mégot collé au coin de sa lèvre inférieure, le docteur Mabuse s’était régalé en le charcutant sans anesthésie : sondage pour s’assurer que la balle était ressortie du mollet, puis bourrage de la plaie aux sulfamides. Tony avait mis un point d’honneur à ne pas broncher.
Les deux « Mac », comme on les surnommait au commissariat, firent une entrée tonitruante dans la salle aux bottins. L’inspecteur Bill Mac Carty, géant glabre au visage émacié, cheveux blonds drus agglomérés en touffes travaillées au cosmétique, bénéficiant néanmoins d’une coupe brosse paillasson impeccable, jouait le rôle du chef tyrannique. Son adjoint, John Mac Namara, se présentait comme sa doublure inversée ; un petit bonhomme enrobé au regard fuyant, chauve avec une triste mèche composée de quatre cheveux plaqués sur son crâne lisse. Ombre de l’ombre du grand blond, il le suivait à tout petits pas comme un caniche nain en mal de caresses. Son air résigné s’expliquait par le rôle ingrat qui lui était dévolu : souffre-douleur de son supérieur hiérarchique. Pourtant, sous son gilet ouvert, sa chemise mal boutonnée découvrait une toison de poils roux qui laissait présager un taux de testostérone élevé.
Coincé entre ses avant-bras grassouillets et son menton mal rasé, Mac Namara portait en geignant une pile de dossiers poussiéreux. Il la laissa choir avec soulagement sur la table sous les quolibets de son chef qui le traita de mauviette, lui reprochant en prime sa mauvaise haleine et l’absence de moutarde dans le sandwich qu’il avait préparé.
Double-patte Mac Carty posa sa Remington portable neuve modèle Universal à large ruban sur la table, frappa une série de Z avec un tempo de rumba pour s’assurer de la qualité de l’impression et s’installa face à Tony. Patachon Mac Namara attendait les ordres, debout derrière le prévenu, les mains en coquille autour de ses attributs.
Le chef, du haut de son mètre quatre-vingt-quinze, toisa Tony avec insistance. Il savait distinguer les pseudo-terreurs, les demi-sels tout en gueule et les vrais durs, ceux qu’il allait devoir chahuter pendant des jours et des nuits avant d’obtenir un hypothétique renseignement. Il avait bien étudié le casier judiciaire et la liste des méfaits qu’on imputait au type assis en face de lui.
Celui qu’on appelait Tony la gâchette dans tout l’Illinois ne pouvait pas ressembler à ça.
Mac Carty avait devant les yeux un gamin au visage de fille avec de grands yeux bruns aux longs cils, des cheveux d’un noir de jais légèrement ondulés. Sans son nez un peu tordu par les coups et les petites balafres qui lui striaient les joues, il aurait pu incarner le soir de Noël un des angelots de la traditionnelle crèche vivante de Saint-Patrick Church à l’angle d’Union Street. Doté d’un bon mètre quatre-vingt au garrot, épais comme un courlis, ce mec aurait pu passer derrière une affiche de base-ball sans la décoller.
– Je suis l’inspecteur Bill Mac Carty. L’Adonis derrière toi s’appelle John Mac Namara. Tu as la chance d’avoir à faire aux deux meilleurs flics de cette ville. Donne-moi ton nom et ton prénom.
– Cascarino Tony.
– Nationalité ?
– Américaine.
– Date et lieu de naissance ?
– 21 novembre 1918 à Étretat.
– Hetreuta ! C’est dans quel état ce trou paumé ?
– C’est en France.
Le flic soudainement sorti de sa routine afficha une mine consternée et reprit :
– Adresse actuelle ?
– 1825 Claridge Boulevard.
– Nom du père ?
– Vittorio Cascarino.
– Nom de la mère ?
– Adélaïde Haudecœur.
Le grand blond se tapa sur les cuisses avant d’allumer une Camel :
– Je comprends mieux ! puis s’adressant à son acolyte :
– Sa mère est une « Frenchie » !
Il accompagna sa remarque d’un rire gras.
Tony s’obstinait à regarder le bout de ses chaussures sans répondre. Ses parents s’étaient connus pendant la Première Guerre mondiale, à l’hôpital militaire d’Étretat où sa mère était chargée de l’entretien des sols du bloc opératoire. Un boulot très physique compte tenu de l’état des patients. C’est dans cet hôpital, loin du front, qu’on avait extrait du buffet de Vittorio un éclat de shrapnel, ramassé quelque part dans les Vosges.
– Dis-moi Tony : parles-tu français ?
– Oui, répondit-il à contrecœur.
Quotidiennement sa mère s’acharnait à détacher les tabliers ensanglantés de Vittorio, mais entre lessives et scènes de ménage, elle enseignait patiemment le français à son fils pour pouvoir parler avec lui sa langue natale. Déçue par sa condition de femme d’ouvrier aux États-Unis, elle avait rapidement eu la nostalgie des hautes falaises crayeuses de Normandie.
Peu à peu, Adélaïde et Tony ne se parlèrent plus qu’en français, mais si un seul mot leur échappait en présence de Vittorio, chacun écopait d’une gifle. Tony était secrètement fier de maîtriser cette langue exotique, pourtant bien inutile dans sa vie de tous les jours.
Au moment où il frappait sur son clavier le H de Haudecœur, Mac Carty lança un juron sonore. La première phalange de son index venait de se planter entre deux touches. L’ongle retourné, il suça son doigt afin de calmer la douleur et surprit Tony qui esquissait un sourire insolent.
– Fat Patty s’est mis à table. Tu es accusé du meurtre d’Émilio Sanchez, dit Le Jamaïcain, et de celui du rouquin, Maxime Bronstein de son vrai nom. Les balles qu’ils avaient dans le corps proviennent d’un Beretta sur la crosse duquel on a retrouvé tes empreintes.
L’inspecteur glissa en aparté à son sous-fifre :
– T’as vu l’état du rouquin ! trois balles dans le dentier, heureusement que le gros était là pour l’identifier…
Puis se retournant vers Tony :
– Fat Patty dit aussi que tu as fait main basse sur la recette des tables de poker des frères Murphy au Milton Bar. Ce petit différend serait d’ailleurs à l’origine de votre brouille. Tu vas me raconter ça !
Tony pianotait sur son genou. Le dessus de sa main droite était orné d’un superbe tatouage rouge et noir représentant les quatre as en arc de cercle. Tout en fixant le flic droit dans les yeux, il accéléra le mouvement et se mit à fredonner le fameux succès de Louis Armstrong : I Can’t Give you Anything but Love.
Tony remarqua bien le clin d’œil qu’adressait le grand flic à l’ectoplasme qui se trouvait derrière lui. Mais trop tard ! Il eut l’impression que sa pommette entrait en collision avec un semi-remorque, qu’on jouait aux osselets avec ses vertèbres cervicales. Il s’évanouit pour la deuxième fois de la journée.
Quand Tony se résolut à ouvrir un œil, il reconnut la silhouette encore floue du petit chauve qui brandissait un gros bouquin en se marrant.
– Tu vois, lui dit Mac Carty, ce que tu viens de prendre dans la figure, ce n’est que le bottin mondain, il fait seulement trois cents pages. La prochaine fois, tu auras droit à l’annuaire des Postes, deux fois plus gros. Ne fais pas ta mijaurée. Le bottin est l’accessoire indispensable du bon flic. Sa seule présence sur la table incite généralement le suspect à la réflexion évitant ainsi les violences inutiles. En cas d’embrouille, c’est un outil parfait qui ne laisse aucune trace sur le visage, aucune tâche d’hémoglobine sur le col de chemise.
Puis abandonnant son ton badin :
– Écoute-moi bien petite fiotte, t’es bon pour vingt ans de placard et encore, si t’as un bon avocat !
Entre temps Mac Namara avait débouché des canettes de Budweiser. Les deux flics engloutirent d’un trait le liquide tiédasse pour s’ouvrir l’appétit. C’était l’heure de la pause, ils attaquèrent les sandwichs, Tony en profita pour essayer de réfléchir :
« Que veulent ces guignols ? J’ai descendu deux types, ils ont l’arme, les empreintes, le mobile. Fat Patty s’est mis à table. Ils n’ont aucune raison d’être aussi nerveux… Sauf si… Sauf s’ils veulent le pognon. »
Chicago 16 février 1943, midi
Le destin du rachitique
Le grand blond mastiquait sauvagement un steak haché aux oignons coincé entre deux tranches de pain mou. Pour pouvoir s’exprimer, il insérait régulièrement l’ongle de son petit doigt entre ses dents de squale afin d’expulser les restes gênants de la collation, se souciant fort peu du spectacle affligeant qu’il imposait à ses interlocuteurs.
– Je ne vais pas relire toute ta fiche, Cascarino, mais voilà ce que l’on sait de toi : à treize ans, t’es déjà bootlegger ; à dix-huit, t’en es encore à distiller du whisky frelaté pour le compte de Bud Morane avant de devenir son chauffeur. On raconte même que, le jour du massacre de la Saint-Valentin, Al Capone t’a gracié à cause de ton jeune âge et de ta jolie gueule. Ensuite tu montes ton affaire. Avec trois grains de maïs et un demi-litre d’alcool, tu sais préparer cinq bidons d’une gnôle capable d’ulcérer n’importe quel estomac. T’es arrêté trois fois pour meurtre et une fois pour tentative de viol sur la personne de Patricia Mulligan mais à chaque fois tu t’en tires, faute de preuve. Depuis, tu es devenu un porte-flingue réputé. Mitraillette, carabine, revolver, avec n’importe lequel de ces engins, il paraît que t’es capable de dénoyauter une olive à trente mètres.
Patricia Mulligan. Bien sûr que Tony s’en rappelait, une blonde platine avec une poitrine de rêve. Habituellement, il ne se sentait pas très à l’aise avec les femmes, à cause de son corps maigre qu’il hésitait à exhiber. Il se contentait d’aller voir les filles du Miami’s Club de temps en temps. Mais ce soir-là, le jour du concert donné par Duke Ellington au Central Palace, dopé par l’ambiance, il avait dragué Patricia. Les deux tourtereaux avaient reniflé quelques lignes de coke et décidé de conclure l’affaire au Bunnie’s Hôtel en plein cœur du Loop.
Tony avait l’habitude de prendre avant qu’on lui ait dit de se servir. À peine arrivé dans la chambre, la bile échauffée par les substances illicites, il avait plaqué Patricia peu élégamment contre le mur, lui retroussant par surprise sa robe fourreau en lamé vert amande. La fille hésitait entre collaboration et résistance, entre gloussements d’aise et protestations. Quand il attaqua avec avidité la lingerie fine, tentant de la débarrasser de sa culotte de soie noire, la belle se déroba. Patricia lui échappa, se tortillant comme un ver de terre. Elle se mit à hurler. Il lui courut après dans l’appartement. Échange de claques, bris de glace, cris stridents poussèrent les détectives de l’hôtel à intervenir. Tony en allongea un à coups de lattes, mais l’autre, armé d’un nerf de bœuf, l’envoya au tapis.
Il se croyait dénué de tout scrupule et pourtant en y repensant, un sentiment de honte le submergea. Il ne voulait en rien ressembler à son père.
Sous ses yeux, certains soirs, Vittorio poussait Adélaïde en pleurs vers la chambre à coucher avec pour tout préliminaire quelques taloches bien appuyées et un déboutonnage hâtif de braguette. Dans ces moments-là, le petit Tony serrait les poings sans rien dire. Patricia ne porta pas plainte et l’affaire fut classée.
Au sujet des meurtres, les flics ne savaient pas tout. Tony se contentait simplement de dégainer le premier. Il prenait les devants, sans forcément préméditer ses actes. Appuyer sur la gâchette représentait pour lui un acte logique dans un contexte précis, une précaution utile ou un ultime recours, en tout cas il n’y prenait aucun plaisir. Il avait choisi d’évoluer dans le monde de la pègre plutôt que de finir ses jours comme une pauvre épave après trente années de labeur passées à la chaîne chez Mac Cormick ou aux abattoirs, comme sa brute de père. Mais pour exister dans ce milieu, si l’on pèse seulement soixante-trois kilos, il faut être plus malin et plus rapide que les autres.
Tony restait muet comme une carpe, les yeux dans le vague, ce qui eut pour effet de faire virer le teint de Mac Carty de la couleur d’une feuille d’érable en automne. Il arbora toutes les nuances de pourpre de la pomme d’Adam à la pointe des oreilles. Mac Namara quant à lui forma un rond parfait avec ses lèvres, exprimant ainsi sa désapprobation devant un comportement aussi désinvolte. Il piaffait d’impatience, prêt à fondre sur sa proie.
Le chef souleva Tony par le col, si violemment que la chaîne se tendit à fond, lui martyrisant les articulations du genou et de la hanche.
– Où est le fric, salopard ?
Ça se précise, se dit Tony.
Il releva la tête, le temps de lancer aux flics un regard assassin et, toujours sans répondre, reposa ses maigres fesses sur la chaise. Le grand blond saisit alors son mollet blessé de toute la largeur de sa pogne et le secoua en gloussant de satisfaction. Quand la douleur devint trop forte Tony balança son front en avant avec l’intention de casser le nez du tortionnaire, mais l’autre effectua une parade prenant la forme d’un salto arrière digne d’une patineuse professionnelle. Tony s’attendait à une avalanche de coups, mais curieusement rien ne se passa. Le chef adressa à son sbire un signe d’apaisement, puis s’affala sur sa chaise. S’activant comme une bonne ménagère, il essaya de redonner une forme présentable au sac qui lui servait de pantalon. Il prit le temps de rallumer une Camel avec un mégot fumant qui avait déjà embrasé le contenu du cendrier, empuantissant tout le commissariat.
– Dis-moi, Monsieur Cascarino : en pleine bagarre contre les Japs d’un côté et les Boches de l’autre, comment se fait-il qu’un gars comme toi se la coule douce dans la vie civile ? Même les types que tu viens de descendre ont été rapatriés pour cause de blessures après avoir fait leur temps dans l’armée des États-Unis.
– J’ai été réformé.
– Pour quel motif ?
– Rachitisme.
– Rachi…quoi ?
– Trop maigre.
– Trop maigre, ce n’est pas une maladie.
– Pour l’armée c’en est une !