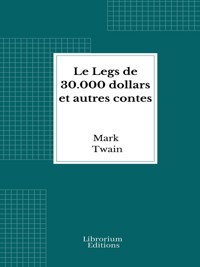
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
En 1835, toutes les régions situées à l’ouest du Mississipi ne possédaient guère plus de cinq cent mille habitants blancs au lieu des vingt-deux millions qui s’y trouvent aujourd’hui. Dans ces espaces immenses et à peu près inexplorés, les États-Unis ne comptaient que deux «États» organisés et policés, la Louisiane et le Missouri; tout le reste était «territoire» sans limite fixe et sans gouvernement. Deux villes seulement, la Nouvelle-Orléans et Saint-Louis, groupaient quelques milliers d’habitants, et si l’on excepte la Nouvelle-Orléans, qui est d’ailleurs à l’Orient du fleuve, on peut dire qu’il n’y avait dans ces vastes régions qu’une seule ville, Saint-Louis, qui fut longtemps la Métropole, la reine, le Paris de ces pays... Or Saint-Louis n’avait alors que 10.000 habitants. C’est dans ces solitudes, en un petit hameau perdu (Florida, du district de Missouri), que naquit Samuel Langhorne Clemens, le 30 novembre 1835. Ses parents s’étaient aventurés jusque-là pour profiter des grandes occasions qui devaient fatalement se produire en ces pays neufs, mais le hasard déjoua tous leurs plans, et, soixante ans après leur séjour à Florida, le hameau ne comptait pas plus de cent vingt-cinq habitants.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
MARK TWAIN
Le Legs de 30.000 dollars
ET AUTRES CONTESTRADUITS ET PRÉCÉDÉS D’UNE ÉTUDE SUR L’AUTEUR PAR MICHEL EPUY© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385744151
Le Legs de 30.000 dollars
MARK TWAIN (SAMUEL CLEMENS)
LE LEGS DE 30.000 DOLLARS
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
LE PASSEPORT RUSSE
I
II
III
IV
MÉMOIRES D’UNE CHIENNE
I
II
HOMMES ET PRINCES
I
II
III
IV
V
ENFER OU PARADIS?
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
UNE HISTOIRE DE MALADE
UN MONUMENT A ADAM
CONSEILS AUX PETITES FILLES
SAINTE JEANNE D’ARC[F]
I
II
UN ARTICLE AMUSANT
UN MOIS PLUS TARD
UNE LETTRE AU MINISTRE DES FINANCES
L’ESPRIT DES ENFANTS
UN MOT DE SATAN
LES CINQ DONS DE LA VIE
I
II
III
IV
V
L’ITALIEN SANS MAITRE
L’ITALIEN ET SA GRAMMAIRE
MARK TWAIN (SAMUEL CLEMENS)
En 1835, toutes les régions situées à l’ouest du Mississipi ne possédaient guère plus de cinq cent mille habitants blancs au lieu des vingt-deux millions qui s’y trouvent aujourd’hui. Dans ces espaces immenses et à peu près inexplorés, les États-Unis ne comptaient que deux «États» organisés et policés, la Louisiane et le Missouri; tout le reste était «territoire» sans limite fixe et sans gouvernement. Deux villes seulement, la Nouvelle-Orléans et Saint-Louis, groupaient quelques milliers d’habitants, et si l’on excepte la Nouvelle-Orléans, qui est d’ailleurs à l’Orient du fleuve, on peut dire qu’il n’y avait dans ces vastes régions qu’une seule ville, Saint-Louis, qui fut longtemps la Métropole, la reine, le Paris de ces pays... Or Saint-Louis n’avait alors que 10.000 habitants.
C’est dans ces solitudes, en un petit hameau perdu (Florida, du district de Missouri), que naquit Samuel Langhorne Clemens, le 30 novembre 1835. Ses parents s’étaient aventurés jusque-là pour profiter des grandes occasions qui devaient fatalement se produire en ces pays neufs, mais le hasard déjoua tous leurs plans, et, soixante ans après leur séjour à Florida, le hameau ne comptait pas plus de cent vingt-cinq habitants. Quand nous entendons parler de villes qui se fondent et se peuplent de vingt mille habitants en quelques mois, quand nous lisons les récits de ces miraculeuses fortunes réalisées dans ce Far-West en moins de dix ans, il semble que tous ceux qui s’y rendirent autrefois auraient dû arriver inévitablement à quelque résultat... Mais il n’en fut pas ainsi, et les parents de Mark Twain paraissent avoir passé à côté de toutes les merveilleuses occasions qui se multipliaient en vain sous leurs pas. Ils auraient pu acheter tout l’emplacement où s’élève aujourd’hui la ville de Chicago pour une paire de bottes. Ils auraient pu élever une ferme à l’endroit où s’est formé le quartier aristocratique de Saint-Louis... Au lieu de cela, ils vécurent quelque temps à Columbia, dans le Kentucky, dans une petite propriété que cultivaient leurs six esclaves, puis se rendirent à Jamestown, sur un plateau du Tennessee. Quand John Marshall Clemens prit possession de 80.000 acres de terres sur ce plateau, il crut que sa fortune était faite... mais les chemins de fer et les villes semblaient prendre plaisir à éviter les possessions de la famille Clemens. Elle émigra encore, alla d’abord à Florida,—qui semblait appelé à de grandes destinées au temps de la Présidence de Jackson;—puis enfin en un autre hameau qui s’appelait Hannibal.
Si Samuel Clemens naquit dans une famille pauvre, il hérita du moins d’un sang pur. Ses ancêtres étaient établis dans les États du Sud depuis fort longtemps. Son père, John Marshall Clemens, de l’État de Virginie, descendait de Gregory Clemens, un des juges qui condamnèrent Charles Iᵉʳ à mort. Un cousin du père de Twain, Jérémiah Clemens, représenta l’État d’Alabama au Congrès, de 1849 à 1853.
Par sa mère, Jane Lampton (ou mieux Lambton), le jeune Twain descendait des Lambton de Durham (Angleterre), famille qui possède la même propriété depuis le douzième siècle jusqu’aujourd’hui. Quelques représentants de cette famille avaient émigré de bonne heure en Nouvelle-Angleterre, et, leurs descendants s’étant aventurés toujours plus loin dans les terres inexplorées, Jane Lampton était née dans quelque hutte en troncs d’arbres du Kentucky. Cet État passait alors pour une pépinière de jolies filles, et tout porte à penser que la jeune maman de Mark Twain joignit de grandes qualités de cœur et d’esprit à sa remarquable beauté.
John Marshall Clemens avait fait des études de droit en Virginie et il exerça pendant quelque temps les fonctions de juge de comté (juge de paix) de Hannibal. Ce fut le seul maître du jeune Samuel, et lorsqu’il mourut, en mars 1847, Twain cessa d’étudier. Il avait été jusqu’alors assez chétif et son père n’avait pas voulu le surmener, bien qu’il eût été fort désireux de donner une solide instruction à ses enfants. Ce fut assurément une bonne chose pour Twain de ne pas subir l’empreinte uniforme de la culture classique. Ce sont les hommes, les livres, les voyages et tous les incidents d’une vie aventureuse qui ont formé son esprit, et c’est par là sans doute qu’il acquit ce tempérament si unique, personnel et original.
Après la mort de son père, il entra dans une petite imprimerie de village où son frère aîné Orion dirigeait, composait et fabriquait de toutes pièces une petite feuille hebdomadaire. L’enfant de 13 ans fut employé un peu dans tous les «services» et, en l’absence de son frère, il se révéla journaliste de race en illustrant ses articles au moyen de planches de bois grossièrement gravées à l’aide d’une petite hachette. Le numéro où parurent ces illustrations éveilla l’attention de tous les lecteurs du village, mais «n’excita nullement leur admiration», ajouta son frère en racontant l’incident.
Dès son jeune âge, Samuel avait témoigné d’un tempérament fort aventureux. Avant d’entrer à l’imprimerie de son frère, il fut retiré trois fois du Mississipi et six fois de la Rivière de l’Ours, et chaque fois il avait bien manqué y rester: mais sa mère, douée d’une imperturbable confiance en l’avenir, avait simplement dit: «Les gens destinés à être pendus ne se noient jamais!»
Vers dix-huit ans, le jeune Clemens commença à se trouver trop à l’étroit dans ce petit village d’Hannibal. Il partit et alla d’imprimerie en imprimerie à travers tous les États de l’Est. Il vit l’exposition de New-York en 1855, visita Boston et d’autres villes, vivant de rien, travaillant quelques semaines dans les imprimeries où il parvenait à s’embaucher. A la fin, à bout de ressources, il rentra chez lui, travailla dans quelques autres imprimeries à Saint-Louis, Muscatine et Keokuk jusqu’en 1857. Ce fut à ce moment qu’il changea de métier pour la première fois: il obtint de son ami Horace Bixby la faveur de devenir son élève... Horace Bixby était pilote sur le Mississipi. Le charme de cette existence paresseuse sur les eaux tranquilles du fleuve attirait le jeune homme et il en devait garder toute sa vie une empreinte indélébile. Dans Tom Sawyer, Huckleberry Finn, La Vie sur le Mississipi, Twain a abondamment parlé de ce beau métier rendu inutile maintenant par les progrès de la civilisation.
Assurément, les grands traits innés d’un caractère se développent toujours et malgré toutes les circonstances, mais on est en droit de se demander ce que serait devenue la gaieté communicative et gamine de Twain s’il avait été élevé à Ecclefechan au lieu de l’être à Hannibal, et en quoi se serait métamorphosée la gravité de Carlyle s’il avait passé sa jeunesse à Hannibal et non à Ecclefechan...
Il y a cinquante ans, un pilote sur le Mississipi était un grand personnage. D’une habileté consommée, il était maître absolu du bord, et à ce moment-là un vice-président des États-Unis ne gagnait pas plus que lui. C’était une très haute position, mais fort difficile à acquérir; et Samuel Clemens dut s’imposer un incroyable labeur, un travail auprès duquel la préparation au doctorat en philosophie n’est rien. Pour apprécier à sa juste valeur l’éducation d’un pilote, il faut lire toute la Vie sur le Mississipi... mais peut-être ce petit extrait pourra-t-il donner une faible idée d’un des éléments de cette éducation: la culture intensive de la mémoire:
«Il y a une faculté qu’avant tout autre un pilote doit posséder et développer d’une façon intense, c’est la mémoire. Il n’est pas suffisant d’avoir une bonne mémoire, il faut l’avoir parfaite. Le pilote ne saurait avoir la moindre défaillance du souvenir ou le moindre doute sur tel ou tel point du métier, il lui faut toujours savoir clairement et immédiatement. Quel mépris aurait accueilli le pilote d’autrefois s’il avait prononcé un faible «Je crois» ou «Peut-être» au moment où il fallait une décision prompte et une assurance résolue! Il est très difficile de se rendre compte du nombre infini de détails qu’il faut avoir présents à l’esprit quand on conduit un bateau le long du fleuve encombré, à travers des passes instables et par des fonds mouvants. Essayez de suivre une des rues de New-York en observant les détails de chaque maison, la disposition, la couleur, la nature des murs, des portes, des fenêtres, le caractère de chaque magasin, l’emplacement des bouches d’égout, etc., etc. Tâchez de vous souvenir de tous ces détails au point d’être capable de les retrouver immédiatement par la nuit la plus noire... Imaginez maintenant que vous faites la même étude pour une rue de plus de 4.000 kilomètres de longueur, et vous aurez une idée encore très atténuée de tout ce que doit savoir un pilote du Mississipi. De plus, il faut se dire que chacun de ces détails change constamment de place suivant une certaine loi et suivant certaines conditions climatériques... Vous comprendrez peut-être alors ce que peut être la responsabilité d’un homme qui doit connaître tout cela sous peine de mener un bateau et des centaines de vies à la perdition.
«Je crois, continue Mark Twain, que la mémoire d’un pilote est une merveille. J’ai connu des personnes capables de réciter l’Ancien et le Nouveau Testament d’un bout à l’autre, en commençant par l’Apocalypse aussi bien que par la Genèse, mais je proclame que ce tour de force n’est rien relativement au travail que doit déployer à chaque instant un bon pilote.»
Le jeune Clemens s’exerça et étudia longtemps; il reçut enfin son brevet de pilote, eut un emploi régulier et se considérait comme établi lorsque éclata la guerre civile qui brisa cette jeune carrière. La navigation commerciale sur le Mississipi cessa complètement, et les petits bateaux de guerre, les canonnières noires, remplacèrent les grands paquebots blancs dont les pilotes avaient été les maîtres incontestés. Clemens se trouvait à la Nouvelle-Orléans lorsque la Louisiane se sépara des autres États; il partit immédiatement et remonta le fleuve. Chaque jour son bateau fut arrêté par des canonnières, et pendant la dernière nuit du voyage, juste en aval de Saint-Louis, sa cheminée fut coupée en deux par des boulets tirés des baraquements de Jefferson.
Élevé dans le Sud, Mark Twain sympathisait naturellement avec les Esclavagistes. En juin, il rejoignit les Sudistes dans le Missouri et s’enrôla comme second lieutenant sous les ordres du général Tom Harris. Sa carrière militaire ne dura que deux semaines. Après avoir échappé de peu à l’honneur d’être capturé par le colonel Ulysse Grant, il donna sa démission, prétextant une trop grande fatigue. Dans ses œuvres, Twain n’a jamais parlé de cette courte expérience qu’avec ironie et il l’a présentée souvent comme un épisode burlesque, mais si l’on en croit les rapports officiels et la correspondance des généraux Sudistes, il se serait très valeureusement conduit... Ce n’est donc pas le courage qui lui manqua... Il vaut mieux penser que ses sympathies esclavagistes n’étaient que superficielles et qu’en lui se cachaient des sentiments de justice et d’humanité auxquels il se décida à obéir. C’est du reste ce qui lui est arrivé constamment durant tout le reste de sa vie: jamais il ne consentit à avouer les élans de son grand cœur et il cacha constamment ses bonnes actions sous le voile de son ironie, masquant le sanglot par le rire...
Mais revenons à la biographie. Son frère Orion, étant persona grata auprès des ministres du Président Lincoln, réussit à se faire nommer premier secrétaire du territoire de Névada. Il offrit aussitôt à son cadet de l’accompagner en qualité de secrétaire privé, avec «rien à faire, mais sans traitement». Les deux frères partirent ensemble et firent un magnifique voyage à travers la Prairie.
Pendant toute une année, Mark Twain parcourut en explorateur et chasseur les territoires avoisinant les mines d’argent de Humboldt et d’Esmeralda. C’est à ce moment qu’il fit ses premiers débuts d’écrivain. Il envoya quelques lettres au journal de la ville la plus proche, à l’Entreprise Territoriale de Virginia City. Cela attira l’attention du propriétaire du journal, M. J. T. Goodman, qui lui demanda une correspondance régulière. Les lettres du jeune Clemens firent une certaine sensation... Il ne s’agissait alors que de l’organisation de ces contrées incultes et non policées, mais dans ses lettres hebdomadaires, Samuel Clemens disait si rudement leur fait aux législateurs et aux aventuriers que, à chaque séance du Conseil d’État, un nouveau scandale éclatait, chaque député se voyant véhémentement accusé de quelque énormité... Voyant cela, le correspondant de l’Entreprise Territoriale redoubla ses coups et se décida à signer ses chroniques; il adopta comme pseudonyme le cri par lequel on annonçait autrefois la profondeur des eaux en naviguant sur le Mississipi: Mark three! Quarter twain! Half twain! Mark twain![A].
A cette époque le duel était fort répandu, et toujours sérieux. L’arme était le revolver de marine Colt. Les adversaires étaient placés à quinze pas et avaient chacun six coups; ils se blessaient presque toujours mortellement. Or, Mark Twain, dont les articles suscitaient beaucoup de colères, eut une querelle avec M. Laird, directeur du journal l’Union de Virginia City, et une rencontre fut jugée nécessaire. Aucun des deux combattants n’était bien fort au revolver; aussi se mirent-ils tous deux à s’exercer activement. Mark Twain tiraillait dans les bois, sous la direction de son second, lorsqu’on entendit les coups de feu de l’adversaire, qui s’exerçait non loin de là. Le compagnon de Twain lui prit alors son arme et à trente mètres abattit un oiseau... L’adversaire survint alors, vit l’oiseau, demanda qui l’avait tué. Le second de l’humoriste déclara que c’était Twain... et M. Laird, après quelques instants de réflexion, offrit des excuses publiques.
Cet incident eut des conséquences importantes. Les duellistes étaient pourchassés avec rigueur, et, apprenant qu’il était recherché par la police, Twain dut fuir jusqu’en Californie. A San-Francisco, il trouva un poste de rédacteur au Morning Call, mais ce travail routinier ne lui convenait pas et il alla tenter la fortune auprès de mines d’or. Il ne découvrit heureusement aucun filon précieux, et sut échapper à la terrible fascination qui retient tant de milliers d’hommes dans les abominables baraquements des placers. De retour à San-Francisco, trois mois après, il écrivit encore quelques lettres à son ancien journal de Virginie, puis accepta d’aller étudier la question de la culture de la canne à sucre à Hawaï pour le compte du journal l’Union de Sacramento. Ce fut à Honolulu qu’il accomplit son premier exploit de journaliste. Le clipper Hornet avait fait naufrage et arrivait à Honolulu avec quelques survivants qui avaient vécu de quelques boîtes de conserves pendant quarante-trois jours. Mark Twain leur fit raconter leurs aventures, travailla toute le nuit et envoya dès le lendemain à son journal un merveilleux récit du naufragé. Ce récit arrivé le premier à San-Francisco, fit sensation, et l’Union en témoigna sa reconnaissance à Mark Twain en décuplant ses honoraires ordinaires.
Après avoir passé six mois dans les îles Sandwich, Mark Twain revint en Californie et fit sur son voyage quelques conférences qui furent bien accueillies. En 1867, il se rendit dans l’Amérique Centrale, traversa l’isthme de Panama, revint dans les États de l’Est et accepta d’accompagner un pèlerinage de Quakers en Terre-Sainte, en qualité de correspondant de l’Alta California de San-Francisco. Il visita alors les principaux ports Méditerranéens et la Mer Noire. C’est de ce voyage qu’est née la principale inspiration des Innocents à l’Étranger, le livre qui assura la célébrité de Mark Twain. Il avait déjà écrit, il est vrai, la Grenouille Sauteuse, cette histoire d’une bonne farce bien yankee, mais ce fut cette peinture des Innocents à l’Étranger qui éveilla l’attention. Un critique digne de foi affirme que les cent mille exemplaires—auxquels rêve tout romancier—se vendirent en un an.
Les quatre années suivantes furent consacrées à des tournées de conférences: travail désagréable, mais lucratif. Mark Twain a toujours eu horreur de s’exhiber sur une plate-forme quelconque, et cependant c’est à cet exercice qu’il dut de gagner si vite la faveur du public. Il fit partie, avec Henry Ward Beecher, d’un petit groupe d’hommes que chaque municipalité de petite ville recherchait à tout prix et dont le nom seul assurait la réussite d’une série de conférences.
La tournée qui comprenait la Cité des Quakers eut un résultat heureux et important. Par son frère, qui faisait partie de la bande, M. Samuel Clemens fit la connaissance de Miss Olivia L. Langdon, et il en résulta, en février 1870, le plus gentil mariage que l’on puisse rêver. Quatre enfants naquirent de cette union. Le premier ne vécut que deux ans. Le second, une fille, Suzanne-Olivia, douée d’une intelligence remarquable, mourut à l’âge de vingt-quatre ans. Deux autres filles naquirent en 1874 et en 1880. L’une d’elles, qui avait toujours vécu avec son père, est morte dans son bain en 1909, moins d’un an avant Mark Twain lui-même.
Après son mariage, Twain résida d’abord à Buffalo, dans une propriété que M. Langdon avait donnée à sa fille en cadeau de noces. Il acheta une part d’administrateur dans un journal quotidien, l’Express de Buffalo, auquel il collabora activement. Mais ce travail au jour le jour ne lui convenait pas et ce fut là sa dernière incursion dans le domaine du journalisme. Au bout d’une année, il renonça à ses fonctions; désormais assuré de gagner tout l’argent qu’il voudrait en écrivant à sa fantaisie, il se vit libre de choisir le moment et le lieu de ses travaux.
Il y avait alors à Hartford un petit milieu littéraire très intéressant. Cette petite ville, fort pittoresque et très tranquille, avait attiré auprès d’elle quelques hommes d’élite, et son charme captiva le célèbre humoriste. Il s’y établit en octobre 1871 et bientôt après y bâtit une maison dont on parla beaucoup aux États-Unis. C’est qu’elle avait été bâtie selon des plans tout nouveaux et qu’elle devait servir de protestation contre le mauvais goût de l’architecture domestique en Amérique. Pendant plusieurs années, cette maison fut un objet d’étonnement pour le touriste ingénu. Le simple fait que ses chambres fussent disposées pour la commodité de ceux qui devaient les occuper, que ses fenêtres, ses vérandas, ses tourelles fussent construites en vue du confort et de la beauté, eut le don de réveiller l’apathie des critiques et de causer de grandes discussions dans tous les journaux et dans toutes les revues des États-Unis, à propos de ce qu’on appelait «la nouvelle farce de Mark Twain».
Mais avec le travail et le succès, le tempérament littéraire de Mark Twain achevait de se développer. Il publia Roughing It, qu’il avait écrit en 1872 et dont le succès égala presque celui des Innocents. C’était encore un simple récit humoristique des expériences personnelles de l’auteur, mais il y ajoutait cette fois de brillantes descriptions. Avec l’Age d’Or qui parut la même année et qu’il avait écrit en collaboration avec Charles Dudley Warner, l’humoriste commença à se transformer en philosophe. Tom Sawyer, qui parut en 1876, est une piquante étude psychologique, et le roman qui lui fait suite, Huckleberry Finn (publié neuf ans plus tard), est une étude fort émouvante du développement progressif d’une âme inculte et fruste. Le Prince et le Pauvre (1882), Un Yankee à la Cour du Roi Arthur (1890) et Pudd’nhead Wilson (1893) sont tout vibrants de sympathie, de tendresse et de délicate sentimentalité, l’humour y occupe une place inférieure, et c’est ce qu’on ne sait pas assez en France, bien que Mark Twain n’ait jamais écrit un livre d’où l’humour fût totalement absent.
En 1894 et 1895 parut en périodique un livre anonyme intitulé: Souvenirs personnels sur Jeanne d’Arc. La plupart des critiques l’attribuèrent à M. X. ou à M. Y... Aucun ne songea à Mark Twain, et pourtant ce livre était bien caractéristique, à chaque page se manifestait cette tranquille audace du grand homme qui savait si bien parler en riant des choses les plus respectables et les plus tristes sans jamais tomber dans la trivialité. Cette œuvre marque une date dans la vie littéraire de Mark Twain, il y fait preuve d’une puissance d’émotion qu’on n’aurait jamais soupçonnée chez l’auteur de la Grenouille Sauteuse. Dans les Innocents même Twain n’avait que de l’esprit, maintenant il a du cœur, il a de l’âme.
Et à côté de ce développement moral, se manifeste aussi un développement intellectuel. Le Mark Twain des Innocents avait le regard perçant et observateur; il savait trouver des mots drôles et des saillies spirituelles, mais il avouait franchement qu’il ne savait pas «ce que diable pouvait bien être la Renaissance». Après les Souvenirs personnels sur Jeanne d’Arc, l’humoriste bruyant des premières années est devenu un lettré accompli et un écrivain à qui l’Europe ne peut plus guère offrir de surprises.
En 1873, Mark Twain passa plusieurs mois en Écosse et en Angleterre, et fit quelques conférences à Londres. Il revint en Europe en 1878, et y passa un an et demi. A son retour, il publia, presque coup sur coup: Une promenade à l’Étranger, le Prince et le Pauvre, la Vie sur le Mississipi et Huckleberry Finn. Il faut noter que ce dernier livre, qui est d’une très haute portée morale, fut d’abord mal accueilli, sinon par le public, du moins par les libraires, qui le déclarèrent immoral.
Jusqu’alors, la fortune avait constamment souri aux entreprises de Twain. On le citait—avec envie—comme un exemple de littérateur millionnaire qui dédaigne les efforts des débutants pauvres et ne se soucie plus de ce qu’on peut dire ou ne pas dire de lui. Mais, à ce moment commencèrent des spéculations malheureuses, qui finirent par emporter tout le fruit de son pénible labeur et le laissèrent chargé de dettes contractées par d’autres. En 1885, il avait commandité la maison d’édition Charles L. Webster et Cⁱᵉ à New-York. Les affaires de cette maison commencèrent brillamment. Elle édita les Mémoires du Général Grant, dont six cent mille exemplaires se vendirent en peu de temps. Le premier chèque reçu par les héritiers de Grant fut de 150.000 dollars, et quelques mois après, ils en reçurent un autre de 200.000 dollars. C’est, croyons-nous, le chèque le plus considérable qui ait jamais été payé pour un seul ouvrage. Pendant ce temps, M. Clemens dépensait de fortes sommes à la fabrication d’une machine typographique qui devait faire merveille. A l’essai, cette machine fonctionna très bien, mais elle était trop compliquée et coûteuse pour devenir d’un usage courant, et, après avoir dépensé toute une fortune entre 1886 et 1889 à réaliser ce rêve, Mark Twain dut y renoncer. Après cela, la maison Webster, mal dirigée, fit faillite; Twain sacrifia encore 65.000 dollars pour essayer de la sauver. Il n’y réussit pas et se trouva enfin engagé pour 96.000 dollars dans le passif de cette maison.
En 1895 et 1896, il fit le tour du monde, et son récit de voyage, Following the Equator, paya toutes les dettes dont il avait assumé la responsabilité. De 1897 à 1899, il parcourut l’Angleterre, la Suisse et l’Autriche. Il se plut beaucoup à Vienne, où on voulait le retenir. Il y fut témoin de quelques événements intéressants. Il se trouvait au Reichsrath autrichien en cette séance mémorable qui fut violemment interrompue par l’arrivée de soixante agents de police venus pour arrêter seize membres de l’opposition. Il paraît que cet événement, unique dans les annales parlementaires, l’impressionna vivement.
Après être demeuré plusieurs années en Amérique, Mark Twain, septuagénaire, revint encore en Europe: c’était pour être solennellement reçu docteur de l’Université Anglaise, en même temps que Rudyard Kipling. En 1909, la mort de sa fille l’affecta beaucoup, et depuis lors, souffrant d’une maladie de cœur, que l’abus du cigare ne contribuait pas à guérir, Mark Twain languit et s’éteignit enfin, à l’âge de soixante et quinze ans, le 20 avril 1910.
Nous laissons aux critiques autorisés le soin d’apprécier comme il convient l’œuvre littéraire de Mark Twain: nous nous sommes bornés à donner ici une esquisse biographique du célèbre humoriste, mais, pour conclure, nous demandons la permission de protester contre les jugements hâtifs portés par plusieurs auteurs des notices nécrologiques consacrées à Mark Twain: est-il vrai que Mark Twain n’a été qu’une sorte de bouffon grossier et sans art, qu’un pince-sans-rire flegmatique, brutal amateur de lourdes plaisanteries?
Oui, Mark Twain a été cela, au début de sa carrière littéraire, et il faut se rappeler qu’alors il venait d’être pilote sur le Mississipi, et qu’il s’adressait à un public de pionniers et de rudes fermiers. Mais à mesure que les années passaient, le talent de Twain s’affinait, son gros rire s’atténuait, sa sensibilité, plus cultivée, vibrait chaque jour davantage, et le joyeux conteur de bonnes farces était devenu, vers soixante ans, un psychologue averti et un peintre attendri des plus fines nuances du sentiment. Nous pourrions citer ici, à l’appui de ces affirmations, plusieurs nouvelles toutes pénétrées de pitié et de tendresse, telles que Mémoires d’une Chienne, Enfer ou Paradis? etc... Dickens ou Daudet auraient pu signer ces pages émouvantes, mais le génie de Twain s’est élevé plus haut encore, et dans le Journal d’Ève, qui est un recueil des toutes premières impressions d’Ève au paradis terrestre, il a atteint la perfection d’Homère ou de La Fontaine. Ce petit chef-d’œuvre (qui mériterait d’être édité à part avec les suggestives illustrations qui l’accompagnent dans le texte anglais) est une merveille de grâce et d’esprit. Tout y est souple, aisé, souriant, léger et tendre, et nous ne croyons pas exagérer en disant qu’après avoir lu le Journal d’Ève, c’est à Voltaire ou à Anatole France que l’on se sent contraint de comparer le spirituel humoriste américain. Joignons-nous donc de tout cœur à ses compatriotes pour déplorer la perte de ce grand homme.
Michel Epuy.
LE LEGS DE 30.000 DOLLARS
Lakeside était un gentil petit village de trois à quatre mille habitants; on pouvait même le qualifier de joli pour un village du Far-West. Les facilités religieuses eussent été assez nombreuses pour une ville de trente-cinq mille âmes. C’est toujours ainsi dans le Far-West et dans le Midi où tout le monde est religieux et où toutes les sectes protestantes sont représentées par un édifice particulier. A côté de cela, les différentes classes sociales étaient inconnues à Lakeside, inavouées en tout cas; tout le monde connaissait tout le monde et son chien, et la sociabilité la plus aimable y régnait.
Saladin Foster était comptable dans un des principaux magasins et le seul de cette profession à Lakeside qui fût bien salarié. Il avait trente-cinq ans et était dans la même maison depuis quatorze ans. Il avait débuté la semaine après son mariage, à quatre cents dollars par an. Depuis quatre ans, il avait régulièrement obtenu cent dollars de plus chaque année. Après cela, son salaire était resté à huit cents dollars—un joli chiffre vraiment—et tout le monde reconnaissait qu’il en était digne.
Electra, sa femme, était une compagne capable, quoiqu’elle aimât trop (comme lui) à faire de beaux rêves et à bâtir des châteaux au pays des songes. La première chose qu’elle fit après son mariage, tout enfant qu’elle fût, c’est-à-dire à dix-neuf ans à peine, ce fut d’acheter un carré de terrain sur les limites du village et de le payer comptant, vingt-cinq dollars, soit toute sa fortune. (Saladin, lui, n’avait que dix dollars à lui à ce moment-là.) Elle y créa un jardin potager, le fit travailler par le plus proche voisin avec qui elle partagea les bénéfices et cela lui rapporta cent pour un par an. Elle préleva sur la première année le salaire de Saladin, trente dollars qu’elle mit à la Caisse d’épargne, soixante sur la seconde année, cent sur la troisième et cent cinquante sur la quatrième, le traitement de son mari étant alors de huit cents dollars. Deux enfants étaient arrivés qui avaient augmenté les dépenses; néanmoins, depuis ce moment-là, elle mit de côté régulièrement ses cent cinquante dollars par an. Au bout de sept ans, elle fit construire et meubla confortablement une maison de deux mille dollars au milieu de son carré de terrain. Elle paya tout de suite la moitié de cette somme et emménagea. Sept ans plus tard, elle s’était entièrement acquittée de sa dette et elle possédait plusieurs centaines de dollars tous bien placés.
Depuis longtemps elle avait agrandi son terrain et en avait revendu avec profit des lots à des gens de commerce agréable qui désiraient construire. De cette façon elle s’était procuré des voisins sympathiques. Elle avait un revenu indépendant en placements sûrs d’environ cent dollars par an. Ses enfants grandissaient et jouissaient d’une florissante santé. Elle était donc une femme heureuse par ses enfants, comme le mari et les enfants étaient heureux par elle.





























