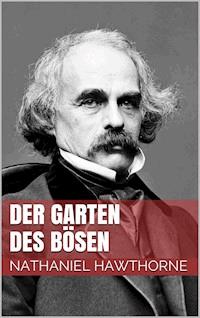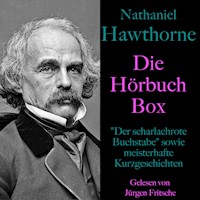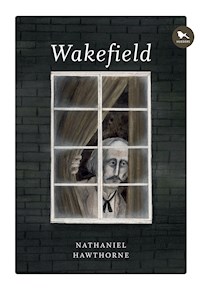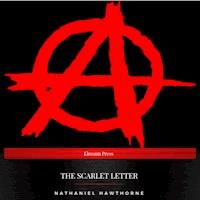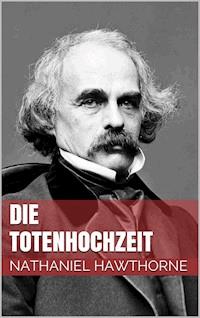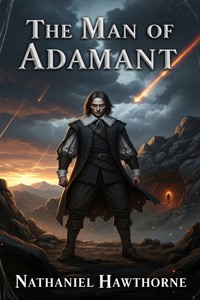1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
The House of the Seven Gables: A Romance is a Gothic novel written by American author Nathaniel Hawthorne and published in April 1851 of Boston. The novel follows a New England family and their ancestral home. In the book, Hawthorne explores themes of guilt, retribution, and atonement, and colors the tale with suggestions of the supernatural and witchcraft.
Plot
The novel is set in the mid-19th century, but flashbacks to the history of the house, which was built in the late 17th century, are set in other periods. The house of the title is a gloomy New England mansion, haunted since its construction by fraudulent dealings, accusations of witchcraft, and sudden death. The current resident, the dignified but desperately poor Hepzibah Pyncheon, opens a shop in a side room to support her brother Clifford, who has completed a thirty-year sentence for murder. She refuses all assistance from her wealthy but unpleasant cousin, Judge Jaffrey Pyncheon. A distant relative, the lively and pretty young Phoebe arrives and quickly becomes invaluable, charming customers and rousing Clifford from depression. A delicate romance grows between Phoebe and the mysterious attic lodger Holgrave, who is writing a history of the Pyncheon family...
|Wikipedia|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
SOMMMAIRE
PRÉFACE DU TRADUCTEUR.
PRÉFACE DE L’AUTEUR.
LA TÊTE DE LA GORGONE
LE PORCHE DE TANGLEWOOD.
LA TÊTE DE LA GORGONE.
LE TOUCHER D’OR
LE RUISSEAU OMBRAGÉ.
LE TOUCHER D’OR.
LE PARADIS DES ENFANTS
LES VACANCES DE NOËL.
LE PARADIS DES ENFANTS.
LES TROIS POMMES D’OR
UN NOUVEL AUDITEUR.
LES TROIS POMMES D’OR
LA CRUCHE MIRACULEUSE
LE PENCHANT DE LA COLLINE.
LA CRUCHE MIRACULEUSE.
LA CHIMÈRE
AU SOMMET DE LA COLLINE.
LA CHIMÈRE.
Notes
NATHANIEL HAWTHORNE
LE LIVRE DES MERVEILLES
Contes pour les enfants tirés de la mythologie
Traduction par Léonce Rabillon
1858
Raanan Editeur
Livre 849 | Édition 1
PRÉFACE DU TRADUCTEUR.
Le titre l’indique, ce petit volume n’est qu’une traduction : il forme la première partie d’un ouvrage publié, il y a quelques années, par M. Nathaniel Hawthorne, l’un des écrivains les plus distingués des États-Unis.
Nous n’entreprendrons point d’esquisser ici le portrait littéraire de l’auteur américain. Les revues les plus accréditées de l’Europe l’ont fait depuis longtemps, et toutes ont placé Hawthorne au premier rang des romanciers et des penseurs de notre époque. Quelques-unes de ses productions, aussi populaires en Angleterre qu’en Amérique, ont passé dans notre langue. Le succès obtenu chez les lecteurs français par la Lettre rouge et plusieurs autres compositions nous donne l’espoir que le Livre des Merveilles pourra intéresser le jeune public auquel il est trop modestement dédié.
Les sujets sont tous tirés de la Mythologie ; mais le conteur a su rajeunir avec un bonheur singulier ces légendes qui, répétées à tant de générations dans une forme invariable, finissaient par ne plus offrir qu’un attrait bien affaibli. Les types consacrés de la Fable ont été respectés ; seulement l’interprétation d’un esprit ingénieux les a doués vraiment d’une vie nouvelle. Sur le fond primitif et simple de la tradition classique, une imagination facile a semé, dans un style plein d’élégance, mille détails poétiques et charmants. À travers le prisme de cette verve, de cet humour, d’antiques sujets semblent comme trouvés d’hier ; et, ce qui n’est pas d’un moindre prix, sans doute, dans ces histoires, le moraliste ne reste pas inférieur à l’artiste.
C’est avec défiance que nous nous sommes hasardé à traduire ces récits dont la forme donne tant de grâce à l’œuvre originale. Nous ne nous sommes pas dissimulé le mérite supérieur de nos devanciers ; cependant, hôte aujourd’hui de la grande République, nous n’avons pas résisté au désir de faire connaître un des plus jolis livres qui aient jamais été écrits pour l’enfance ; et, si un jour notre travail tombe sous les yeux de M. Hawthorne, nous le prions de considérer cet essai simplement comme un hommage rendu à son talent.
Léonce Rabillon.
Baltimore, 20 septembre 1856.
PRÉFACE DE L’AUTEUR.
L’auteur a pensé longtemps qu’un grand nombre de fables mythologiques pourraient fournir aux enfants d’excellents sujets de lecture. C’est dans ce but qu’il a réuni dans le petit volume aujourd’hui offert au public une douzaine de récits. Il avait besoin, pour l’exécution de son plan, d’une grande liberté ; mais quiconque essayera de rendre ces légendes malléables au creuset de son intelligence, observera qu’elles sont merveilleusement indépendantes des temps et des circonstances. Elles demeurent essentiellement les mêmes, après une foule de changements qui altéreraient la véracité de toute autre histoire.
L’auteur ne se défendra donc point d’avoir commis un sacrilège, en revêtant parfois d’une forme nouvelle, selon les caprices de son imagination, des figures consacrées par une antiquité de deux ou trois mille ans. Aucune période de temps ne peut prétendre conserver à ces traditions immortelles un type privilégié. Elles semblent n’avoir jamais été créées ; et, sans aucun doute, aussi longtemps que l’homme existera, elles seront impérissables. Aussi, par cela même qu’elles sont indestructibles, chaque âge a le droit de s’en emparer pour les mettre en harmonie avec ses idées et ses sentiments, et leur imprimer le cachet de sa propre moralité. Elles peuvent avoir perdu, dans cette version, une grande partie de leur aspect classique (en tout cas, l’auteur n’a pas pris soin de le conserver) et l’avoir remplacé par un caractère gothique ou romanesque.
En exécutant cette tâche intéressante, car c’était réellement un travail convenable pour les chaleurs de la saison, et du genre littéraire le plus agréable qu’il pût aborder, l’auteur ne s’est pas toujours cru obligé de descendre pour se mettre à la portée de l’intelligence des enfants. Il a généralement laissé son sujet prendre son essor, toutes les fois que telle en était la tendance ; et lui-même s’y est prêté avec complaisance, quand il s’est senti assez léger pour pouvoir le suivre dans ses élans. Les enfants sont doués d’une pénétration d’esprit incroyable pour tout ce qui est profond ou élevé dans le champ de l’imagination ou du sentiment, à la condition qu’ils y rencontrent toujours la simplicité. C’est seulement l’artificiel et le complexe qui les égarent.
Lenox, 15 juillet 1851.
LA TÊTE DE LA GORGONE
LE PORCHE DE TANGLEWOOD.
Par une belle matinée d’automne on pouvait voir, réunis sous le porche d’une maison de campagne appelée Tanglewood, un certain nombre d’enfants, présidés par un jeune garçon dont la taille dépassait de beaucoup celle de ses camarades. Cette bande joyeuse avait projeté une cueillette parmi les noyers des environs, et attendait avec impatience que le brouillard se fût enlevé sur les collines, et que le soleil eût répandu sa chaleur dans les champs, dans les prairies et à travers les bois, dont l’été indien 1 colorait les feuilles de mille nuances. La matinée promettait l’un des plus beaux jours qui aient jamais égayé l’aspect de la nature, si plein de charmes et de délices. Toutefois le brouillard remplissait encore la vallée dans toute son étendue, jusqu’à une petite éminence où était située l’habitation.
À moins de cent yards 2 de la maison, une vapeur blanchâtre voilait tous les objets, à l’exception de quelques cimes vermeilles ou jaunies que venaient dorer les premiers rayons du jour, et qui çà et là perçaient l’épaisseur du brouillard. À une distance de quatre ou cinq milles, vers le sud, se dressait le pic du Monument-Mountain 3 qui semblait flotter sur un nuage. Quelques milles plus loin, au dernier plan, surgissait à une plus grande élévation la cime du Taconic, fondue dans une teinte azurée et presque aussi vaporeuse que l’atmosphère humide dont elle était enveloppée ; une couronne de légers nuages entourait le sommet des collines qui bordaient la vallée, à demi submergées dans la brume ; et, sous le voile dont elle était couverte, la terre elle-même n’offrant plus à l’œil que des lignes indécises, l’ensemble du paysage produisait l’effet d’une vision.
Les enfants dont nous venons de parler, aussi pleins de vie qu’ils pouvaient en contenir, s’élancèrent du porche de Tanglewood, et, s’enfuyant par l’allée sablonneuse, se répandirent en un clin d’œil sur l’herbe humide de la prairie. Nous ne saurions dire exactement combien il y avait de ces petits coureurs ; pas moins de neuf ou dix, et pas plus d’une douzaine ; petites filles et petits garçons, tous différents de taille et d’âge. C’étaient des frères, des sœurs, des cousins, et quelques jeunes amis invités par M. et mistress Pringle à passer une partie de l’automne avec leurs familles à Tanglewood. Je ne voudrais pas vous dire leurs noms ; je craindrais même de leur en donner qui aient été portés par d’autres enfants : car j’ai connu des auteurs qui se sont attiré de véritables désagréments pour avoir nommé les héros de leurs histoires comme certaines personnes existantes. Pour cette raison, j’appellerai mes petits compagnons Primerose, Pervenche, Joli-Bois, Dent-de-Lion, Bluet, Marguerite, Églantine, Primevère, Fleur-des-Pois, Pâquerette, Plantain et Bouton-d’Or ; noms qui, à tout prendre, conviendraient mieux à un groupe de fées qu’à des enfants réels.
Il ne faut pas croire que ceux qui composaient cette joyeuse petite troupe aient reçu de leurs parents, de leurs oncles, de leurs tantes, de leurs grands-pères ou grand’mères, la permission d’aller courir ainsi à travers champs et bois, sans être sous la tutelle d’une personne particulièrement recommandable par son âge et sa gravité. Ce respectable mentor s’appelait Eustache Bright ; je vous fais connaître son vrai nom, parce qu’il tient à grand honneur d’avoir raconté les histoires qui sont imprimées dans cet ouvrage. Eustache était un élève de Williams-College 4, et avait, à cette époque, environ dix-huit ans, âge vénérable qui le faisait passer à ses propres yeux pour un être digne de tout le respect que Dent-de-Lion, Églantine, Fleur-des-Pois, Bouton-d’Or et les autres devaient à leurs grands-pères. Une légère fatigue de la vue, maladie que de nos jours bien des écoliers croient nécessaire d’avoir, afin de prouver leur application à l’étude, lui faisait prolonger ses vacances d’une quinzaine. Mais, pour ma part, j’ai rarement rencontré une paire d’yeux qui pussent voir d’aussi loin et plus parfaitement que les yeux d’Eustache Bright.
Ce savant écolier, mince et pâle, comme le sont en général les étudiants du nord de l’Amérique, était aussi léger et aussi vif que s’il eût eu des ailes à ses chaussures. Aimant fort, par parenthèse, à passer les ruisseaux à gué, et à traverser les prairies humides, il avait mis pour cette expédition de grandes bottes de cuir de vache. Il portait une blouse de toile, une casquette de drap, et une paire de lunettes vertes, précaution probablement moins essentielle à la conservation de sa vue qu’à la dignité de son rôle. En tout cas, il aurait aussi bien fait de ne pas se donner ce dernier embarras ; car, à peine venait-il de s’asseoir sur les marches du porche, qu’Églantine, en vrai lutin, se glissa derrière lui, les lui enleva du nez pour les mettre sur le sien ; et, comme l’étudiant oublia de les lui reprendre, elles tombèrent dans l’herbe, où elles restèrent jusqu’au printemps suivant.
Il faut vous dire qu’Eustache Bright avait acquis parmi les enfants une grande réputation comme conteur de récits merveilleux. Bien qu’il se prétendît fatigué toutes les fois que ses auditeurs, qui ne se lassaient pas de l’entendre, lui en demandaient encore un autre, je doute réellement que rien pût lui faire autant de plaisir que de les leur débiter. Vous eussiez pu vous en apercevoir à un certain jeu de paupières significatif, lorsque Marguerite, Joli-Bois, Primevère, Bouton-d’Or et la plupart de ses petits compagnons, le supplièrent de raconter quelqu’une de ses histoires, en attendant que le brouillard fût dissipé.
« Oui, cousin Eustache, dit Primerose, pétillante enfant de douze ans, avec des yeux pleins de malice et un petit nez relevé, le matin est le meilleur moment de la journée pour raconter vos histoires qui sont toujours si longues. Nous serons moins exposés à blesser votre susceptibilité en nous endormant aux passages les plus intéressants, ce que la petite Primevère et moi nous avons fait hier au soir !
— Méchante ! cria Primevère, petite fille âgée de six ans, je ne me suis pas endormie ; j’ai seulement fermé les yeux, comme pour voir le tableau dont nous parlait cousin Eustache. Ses histoires sont au contraire bien jolies le soir, parce qu’on en rêve quand on dort, et bien belles le matin, parce qu’on en rêve tout éveillé. Aussi, j’espère qu’il va nous en raconter une tout de suite.
— Merci, ma petite Primevère, reprit Eustache ; je vais certainement vous conter les plus charmantes histoires que je pourrai imaginer, quand ce ne serait que pour avoir pris ma défense contre cette maligne de Primerose. Mais, chers enfants, je vous ai déjà dit tant de contes de fées, que j’ai bien peur de vous endormir tout à fait si je me répète encore.
— Non ! non ! non ! crièrent à la fois Bluet, Pervenche, Pâquerette, Plantain et les autres, nous aimons mieux les histoires que nous avons déjà entendues. »
Et c’est une vérité, qu’un récit paraît d’autant plus intéresser les enfants qu’ils le connaissent davantage, et que leur esprit en est plus profondément pénétré. Mais Eustache Bright, dans l’exubérance de ses ressources, dédaignait de tirer avantage d’une permission dont se serait empressé de profiter un narrateur plus âgé.
« Il serait bien fâcheux, dit-il, qu’un homme de mon érudition (pour ne pas parler de l’originalité de son imaginative) ne fût pas capable d’offrir chaque jour une histoire différente à des enfants comme vous. Écoutez bien ; je vais vous dire un de ces contes de nourrice, inventés pour amuser la Terre, notre vieille, vieille grand’mère, quand elle était petite fille en jupon et en sarrau. Il y en a une centaine, et je n’en reviens pas de ce qu’ils n’ont point été recueillis dans des livres d’images destinés aux petites filles et aux petits garçons. Au lieu de cela, les barbes grises se creusent la tête à les étudier dans de gros bouquins grecs couverts de poussière, et cherchent à savoir comment et pourquoi ils ont été inventés.
— Assez, assez, cousin Eustache ! crièrent d’une seule voix tous les enfants ; ne parlez plus de vos histoires, mais racontez-en une.
— Asseyez-vous donc autour de moi, dit Eustache, et restez tranquilles comme des souris. À la moindre interruption de Primerose ou des autres, j’arrête mon histoire d’un coup de dent, et j’avale le reste. Mais d’abord, y a-t-il parmi vous quelqu’un qui sache ce que c’est qu’une Gorgone ?
— Moi ! répondit Primerose.
— Eh bien ! gardez-le pour vous, répliqua Eustache, qui aurait préféré qu’elle n’en sût rien ; je vais vous conter une histoire sur la tête d’une Gorgone. »
Et il commença, comme vous pouvez vous en convaincre à la page suivante. Tout en se servant des matériaux que lui fournissait son érudition, et dont il était redevable au professeur Anthon, il ne manquait pas d’avoir le plus profond dédain pour les autorités classiques en général, et de s’en écarter aussi souvent qu’il y était poussé par l’audace de son imagination vagabonde.
LA TÊTE DE LA GORGONE.
Persée devait le jour à Danaé, qui elle-même était la fille d’un roi. À peine âgé de quelques années, de méchantes gens le mirent avec sa maman dans une boîte, et les livrèrent ainsi aux flots de la mer. Le vent souffla vivement, poussa la boîte loin du rivage, et les vagues capricieuses l’emportèrent en la secouant avec rudesse. Danaé serrait son enfant sur son sein, et tremblait à chaque instant de voir engloutir sa frêle embarcation, qui continua cependant à voguer, sans couler à fond ni même se renverser. Vers la fin du jour, elle flotta si près d’une île, qu’elle se trouva prise dans les filets d’un pêcheur, et fut déposée sur le rivage. L’île s’appelait Sériphus, et obéissait aux lois de Polydecte, qui par hasard était frère du pêcheur.
Ce dernier, je suis heureux d’avoir à le dire, était à la fois rempli d’honneur et de générosité. Il montra la plus grande bienveillance à Danaé et à son petit garçon, et leur continua ses bontés jusqu’à ce que Persée fût devenu un bel adolescent plein de force et de courage, et très-habile dans le maniement des armes.
Malheureusement le roi Polydecte n’était ni bon, ni bienveillant, comme son frère le pêcheur ; tout au contraire. Aussi résolut-il de charger Persée d’une entreprise périlleuse où il perdrait probablement la vie, ce qui lui permettrait d’exercer contre Danaé quelque cruelle persécution. Il se mit donc à chercher quelle était la chose la plus dangereuse qu’un jeune homme pût entreprendre. À force de méditations, ayant découvert une aventure dont l’issue ne pouvait manquer d’être aussi fatale qu’il le souhaitait, il envoya chercher le jeune Persée.
Celui-ci arriva au palais et parut devant le roi, qui était assis sur son trône.
« Persée, dit le roi Polydecte en lui souriant malicieusement, voilà que tu es devenu un grand et beau garçon. Ta bonne mère et toi, vous avez reçu de nombreuses marques de ma bienveillance personnelle, ainsi que de la bonté de mon digne frère le pêcheur ; je suppose que tu ne serais pas fâché de m’en témoigner ta reconnaissance.
— Votre Majesté n’a qu’à commander, répondit Persée ; je suis prêt à risquer ma vie pour lui en donner la preuve.
— Eh, bien ! alors, poursuivit le roi avec un sourire de plus en plus malicieux, j’ai une petite expédition à te proposer ; et, comme tu es un jeune homme courageux et entreprenant, ce sera pour toi une excellente occasion de te distinguer. Tu sauras que je pense à me marier à la belle princesse Hippodamie. Il est d’usage, dans une telle circonstance, de faire à sa fiancée un présent d’une rareté singulière et d’une élégance recherchée. J’ai été d’abord, je l’avoue sans honte, un peu embarrassé pour deviner ce qui pouvait plaire à une princesse d’un goût aussi délicat. Mais je me flatte d’avoir découvert, ce matin même, l’objet qui m’est nécessaire.
— Et puis-je avoir l’honneur d’aider Votre Majesté à se procurer cet objet ? s’écria Persée avec empressement.
— Tu le peux, si tu es aussi brave que je le crois, répliqua le roi Polydecte en prenant un air des plus gracieux. Le présent que je tiens à offrir à la belle Hippodamie, c’est la tête de la Gorgone Méduse, avec sa chevelure de serpents ; je compte sur toi, mon cher Persée, pour me la procurer ; et, comme je brûle de terminer avec la princesse, plus tôt tu iras à la recherche de la Gorgone, et plus je serai satisfait.
— Je partirai dès demain matin, répondit le jeune homme.
— Je t’en prie, n’y manque pas, mon brave ami ; surtout, fais attention, en tranchant la tête, à exécuter la chose avec dextérité, afin de ne rien changer à sa physionomie. Tu l’apporteras ici dans le meilleur état possible, et je ne doute pas que cela ne plaise à ma charmante princesse, quelque difficile qu’elle puisse être. »
Persée n’eut pas plus tôt quitté le palais, que Polydecte se mit à rire aux éclats, ravi, en méchant roi qu’il était, d’avoir tendu si facilement un bon piège à l’imprudent jeune homme. La nouvelle se répandit bien vite au dehors que Persée avait entrepris de trancher la tête de Méduse aux cheveux de serpents. Tout le monde fut dans la joie ; car la plupart des habitants de l’île étaient aussi méchants que le monarque lui-même, et se faisaient une fête, de voir arriver quelque horrible malheur au fils de Danaé. Peut-être n’y avait-il d’honnête homme dans tout le pays que le bon pêcheur, frère du méchant Polydecte. Lorsque Persée se mit en route, le peuple le montrait au doigt en faisant des grimaces ; chacun clignait de l’œil d’une manière significative, et le tournait en ridicule.
« Ah ! ah ! criait-on, les serpents de Méduse vont joliment le mordre ! »
Il faut vous dire qu’il y avait à cette époque trois Gorgones ; c’étaient les monstres les plus étranges et les plus terribles qu’on eût vus depuis que le monde existait, et probablement on n’en verra jamais d’aussi affreux dans l’avenir. Je ne sais réellement pas quelle place donner à ces affreuses créatures, et si elles appartenaient à la terre ou à l’enfer. C’étaient trois sœurs qui semblaient avoir quelque ressemblance avec les femmes ; pourtant elles appartenaient bien positivement à la plus horrible espèce de dragons et à la plus dangereuse. Il serait difficile d’imaginer quel aspect hideux présentaient ces trois monstres : au lieu de cheveux, croirez-vous que les Gorgones avaient sur là tête une centaine de reptiles se tordant, se repliant, s’entrelaçant, et allongeant des langues venimeuses armées d’un double dard ? Leurs dents étaient des défenses d’une longueur effrayante ; leurs mains étaient d’airain ; leur corps était couvert d’écailles au moins aussi dures et aussi impénétrables que le fer ; en outre, elles avaient des ailes, et de splendides, je vous en réponds, car chaque plume était de l’or le plus pur : aussi, quand elles prenaient leur vol au soleil, on en restait ébloui.
Mais ceux qui, par hasard, devenaient témoins de leur éclatante apparition dans les airs, ne s’arrêtaient pas à les contempler ; ils s’enfuyaient à toutes jambes, de peur d’être piqués par les serpents, d’avoir la tête broyée par les horribles mâchoires des Gorgones, ou, d’être mis en, pièces par leurs griffes d’airain. À coup sûr, c’étaient là de grands dangers, mais non pas les plus difficiles à éviter ; ce qu’il y avait de plus redoutable dans l’apparition des Gorgones, c’est l’effet que produisait leur aspect horrible sur les mortels : car il suffisait à un homme de regarder un de ces monstres, pour être immédiatement changé en statue de pierre.
C’était donc une aventure bien périlleuse qu’avait imaginée le roi Polydecte pour perdre l’innocent jeune homme. Persée lui-même, quand il y eut réfléchi, pensa qu’il avait fort peu de chances de réussir, que probablement il serait transformé en bloc de pierre lorsqu’il approcherait de Méduse, et que par conséquent, il ne pourrait pas rapporter la tête de la Gorgone. Sans parler des autres difficultés, il en existait une qui aurait embarrassé un homme plus expérimenté que lui. Non-seulement il lui fallait combattre et tuer ce monstre aux ailes d’or, aux écailles de fer, aux dents énormes, aux griffes de bronze et à la chevelure de serpents ; mais il fallait y parvenir en ayant les yeux fermés : car, en moins d’un clin d’œil, son bras, levé pour frapper, se serait pétrifié comme tout le reste de son corps, et aurait conservé cette position pendant des siècles, jusqu’à ce que le temps l’eût réduit en poussière. C’était une bien sombre perspective pour un jeune homme ambitieux d’accomplir un grand nombre d’exploits, et qui se croyait destiné à jouir de tant de bonheur dans ce monde si brillant et si beau.
Ces réflexions jetaient une telle tristesse dans le cœur de Persée, qu’il ne put se décider à dire à sa mère ce qu’il allait entreprendre. Après s’être armé de son bouclier et de son glaive, il traversa le détroit qui séparait l’île de la terre ferme. Arrivé là, il s’assit dans un lieu solitaire, et ne parvint pas à retenir ses larmes.
Mais, tandis qu’il s’abandonnait à son chagrin, il entendit une voix derrière lui qui disait :
« Persée, pourquoi es-tu si triste ? »
Il leva la tête, fort surpris de ce qu’il venait d’entendre, car il se croyait seul, et vit un étranger à l’œil vif, intelligent et remarquablement rusé, qui avait un manteau flottant sur les épaules, un chapeau bizarre sur la tête, à la main un petit bâton contourné d’une singulière façon, et un glaive très-court et fort recourbé au côté. Il paraissait excessivement actif et léger dans sa démarche, comme une personne accoutumée aux exercices gymnastiques et habile à sauter ou à courir. Il avait en outre un air si gai, si fin et si complaisant, bien qu’un peu malicieux, que Persée n’éprouva pas la moindre gêne en le regardant. Seulement, comme il était vraiment intrépide de sa nature, il se sentit confus d’avoir été surpris versant des larmes comme un timide écolier, quand après tout il pouvait bien ne pas y avoir à se désespérer. Il essuya donc ses yeux, et répondit à l’inconnu de l’air le plus dégagé qu’il lui fut possible de prendre :
« Je ne suis pas triste, mais je rêve à une aventure que je veux tenter.
— Dis-moi ce que c’est, reprit l’étranger ; et, lorsque tu m’auras mis au courant de ce que tu veux faire, je te serai peut-être de quelque utilité. J’ai tiré d’embarras beaucoup de jeunes gens dans des circonstances que l’on avait, de prime abord, jugées très-difficiles. Tu n’es pas sans avoir entendu parler de moi, je suis connu sous plus d’un nom ; mais celui de Vif-Argent me convient aussi bien que tout autre. Dis-moi quel est ton embarras. Nous en causerons, et nous verrons ensuite ce que nous avons à faire. »