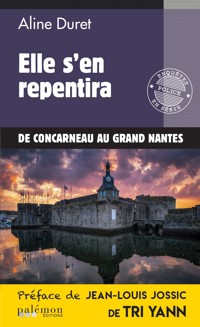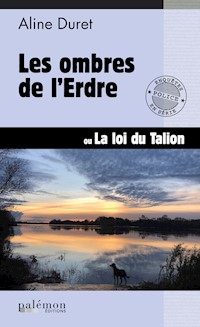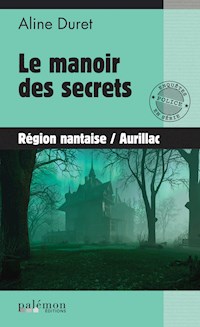
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Comment expliquer tous ces phénomènes qui se déroulent chez Jacques ? Parviendra-t-il à s'en sortir indemne ?
Jacques Desfontaine, un quinquagénaire solitaire, mène une existence paisible à Carquefou, une commune de la banlieue nantaise. Il vit retranché dans sa belle propriété familiale, préférant la compagnie de ses arbres à celle des hommes. Mais depuis la disparition de sa mère, rien ne va plus : des objets changent de place, de la nourriture disparaît et d’étranges bruits perturbent ses nuits. Tout ceci est-il bien réel ? Est-il en proie à des hallucinations ? Devient-il fou ? À fleur de peau, Jacques perd pied. Lorsque le corps de sa voisine Huguette est retrouvé au fond d’un puits, tous les soupçons se portent sur lui. Les gendarmes Belfort et Velganni mènent l’enquête – jusqu’en Auvergne – sous les ordres de la troublante Émilie Girard… Mais quand le Mal s’invite sous votre toit, il est déjà trop tard…
Meurtres en série, suspense et intrigue amoureuse font de ce roman un thriller captivant.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
« Une atmosphère glaçante, un rythme haletant. Aline Duret confirme sa maîtrise de l’art de maintenir le lecteur en haleine jusqu’au point final ! » Ouest-France.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Aline Duret enseigne la littérature dans un lycée de la couronne nantaise. Passionnée de dramaturgie et d’enquêtes criminelles, elle plonge le lecteur dans une atmosphère glaçante et l’entraîne dans une histoire machiavélique aux multiples rebondissements. L’ingéniosité de l’intrigue tissée à la manière d’un puzzle macabre reste longtemps gravée dans l’esprit du lecteur. Atteinte d’une maladie génétique orpheline dégénérative qui affecte sa vue, la romancière milite pour l’accessibilité aux livres grands caractères.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À mes filles, Alice et Émilie
Avertissement au lecteur
Ce roman est inspiré d’un fait divers survenu en France. Les personnages évoqués sont purement imaginaires et les lieux décrits ont été modifiés.
En conséquence, toute ressemblance entre les personnages présentés ici et des personnes ayant existé serait pure coïncidence et le fait du hasard.
« Le passé est une ombre qui reste attachée à vous » Edgar Morin, Le Paradigme perdu
« La senteur des fleurs, ou du santal, ou de l’encens, ou du jasmin ne remonte pas le vent. Dans toutes les directions, l’homme sage répand le parfum de sa vertu. »
Le Dhammapada de Bouddha
Le Santal blanc est un petit arbre tropical de la famille des Santalaceae. C’est la source la plus connue du bois de santal dont on tire une essence parfumée.
La plante parasite les racines des autres espèces d’arbres par un mécanisme de succion qui équipe ses propres racines.
PROLOGUE
Jacques était aux aguets. Recroquevillé sur lui-même, il tendait l’oreille.
Soudain, le bruit d’une clé dans une serrure, puis celui d’une porte qui s’ouvrit en grinçant, le firent tressaillir.
Des pas lourds sur le sol s’approchèrent lentement de lui.
Il devina la présence de son tortionnaire qui se tenait à quelques mètres, dans le calme de la nuit.
Jacques se releva en gémissant de douleur.
— Vous allez me tuer ? s’enquit-il d’une voix chevrotante, à peine audible.
— Tu es déjà mort ! rétorqua l’homme en s’asseyant sur un tabouret, face à lui.
L’individu renversa légèrement la tête en arrière, et demeura parfaitement immobile, les yeux rivés au plafond. Une bougie posée sur le sol projetait des ombres qui lui creusaient le visage tel un masque. Ses yeux sombres, au fond de leurs orbites, brillaient d’une lueur étrange.
Après une courte pause, il ajouta :
— Tu as cessé d’exister le jour où j’ai commencé à vivre.
Jacques se laissa lourdement tomber sur les genoux, le menton sur sa poitrine et sanglota. Quelques reniflements sporadiques brisèrent le silence. Le temps s’était arrêté.
Le contact de la terre battue lui glaça les os. Il se mit à trembler comme une feuille sous les assauts du vent, fragile et impuissante. Des perles de sueur envahirent son front et roulèrent sur le bandeau de ruban adhésif qui enserrait ses yeux. Il ne sentait plus ses bras entravés dans son dos ; un lien lui entaillait les poignets jusqu’au sang. Une chaîne en acier, menottée à la cheville, le maintenait attaché au mur de pierres.
Jacques aurait voulu hurler, mais aucun son ne sortit de sa gorge : il était à bout de forces.
Depuis combien de jours était-il enfermé ici ? Où se trouvait-il exactement ? Il avait perdu toute notion de temps et ne comprenait pas pourquoi on le retenait prisonnier.
Une odeur tenace et nauséabonde émanait de ses vêtements souillés par ses excréments. Elle se mêlait aux effluves de vin fermenté qui emplissaient la cave. L’air était difficilement respirable : les grilles d’aération étaient obstruées.
Des restes de nourriture étaient éparpillés autour de lui sur le sol. À chacune de ses visites, l’homme avait déposé à ses pieds juste de quoi le maintenir en vie. Jacques avait mangé sans ses mains, à genoux, comme un animal… Des rats affamés venaient chaque jour plus nombreux, attirés par les relents des aliments en décomposition.
Jacques ne les voyait pas, mais il les entendait. Il ne dormait que par intermittence, replié sur lui-même, les bras sanglés dans le dos.
La respiration de son geôlier était profonde et régulière. Jacques ne percevait aucun mouvement. Et cela l’inquiétait.
Pourquoi son bourreau restait-il aussi silencieux ? Que faisait-il ? Cela ne laissait rien présager de bon…
Soudain, une sonnerie retentit dans la nuit.
L’homme sortit un téléphone portable et consulta le message qui était affiché sur l’écran :
« Il faut en finir, maintenant ! »
Il rangea l’appareil dans son imperméable, se leva et arpenta nerveusement la pièce.
Jacques osait à peine respirer. Il aurait voulu se fondre dans le mur, disparaître.
Il sentit les pierres saillantes s’enfoncer dans sa chair. Son cœur se mit alors à battre violemment.
Contre toute attente, l’homme revint s’asseoir sur le tabouret et sortit un briquet et un paquet de Marlboro de la poche arrière de son jean. Il effleura les deux lettres gravées sur le briquet argenté.
Les deux « v » entrelacés formaient une sorte de « w ». Il porta une cigarette à ses lèvres et fit rouler la molette. Lorsque la flamme jaillit, Jacques sursauta. Dès la première bouffée, les muscles du visage du kidnappeur se détendirent.
D’un regard haineux, il fixa d’abord la frêle silhouette qui tremblait de peur, recroquevillée dans l’ombre, avant de s’accroupir auprès d’elle.
— Une dernière cigarette ? proposa-t-il d’un ton sarcastique.
Jacques secoua la tête. L’homme approcha son visage si près du sien qu’il sentit son souffle sur sa joue.
— Quelle existence misérable tu as eue, mon pauvre Jacques ! Pas de tabac, pas de femme ! Aucun plaisir. Mais, à présent, la vie de Jacques Desfontaine va changer radicalement.
Jacques ne comprenait rien. Qui était cet homme ? Que lui voulait-il ? Un ricanement sardonique sortit de la gorge de son tortionnaire.
Son effroi redoubla. Alors, rassemblant tout son courage, Jacques redressa la tête et demanda, des sanglots dans la voix :
— Qu’est-ce que je vous ai fait ? Si c’est de l’argent que vous voulez, je peux vous en donner… beaucoup… mais je vous en supplie, laissez-moi !
— Ce n’est pas ton fric qui m’intéresse ! lui hurla-t-il au visage. T’entends ? Ton pognon, je n’en ai rien à foutre !
L’homme se redressa, jeta sa cigarette au sol et l’écrasa rageusement du pied. Il se dirigea vers la caisse en bois qui se trouvait près de la bougie, renversa son contenu sur une toile de jute et l’inspecta. Tout y était : une scie à métaux, des lames de rechange, une pince coupante, ainsi qu’une corde. Il faudrait aussi prévoir plusieurs sacs-poubelles, songea-t-il.
Jacques ne parvenait pas à identifier les sons autour de lui. Cela ne fit qu’accroître sa peur. Un flot de paroles discontinues et incompréhensibles jaillit entre ses lèvres.
Tout à coup, l’homme lui assena un violent coup de poing. Jacques s’écroula au sol dans un bruit sourd.
Quand il reprit connaissance, il était assis par terre, adossé contre le mur, la tête penchée en avant. Un bâillon de ruban adhésif obstruait désormais sa bouche. La douleur sous son crâne était abominable. Le sang affluait par saccades contre ses tempes, dans un grondement assourdissant.
Peu à peu, il reprit ses esprits et réalisa que le bandeau qui enserrait ses yeux avait été retiré. Il souleva péniblement ses paupières endolories et reconnut aussitôt l’endroit où il se trouvait : il s’agissait de sa propre cave.
Son tortionnaire se tenait droit comme un piquet face à lui. Au prix d’un terrible effort, Jacques redressa la tête et put enfin voir son visage.
Le malheureux se figea sur place, la face livide, les yeux exorbités. Ce visage… Non… Ce n’était pas possible !
Il baissa les paupières, secoua la tête pour chasser cette image. Il les ouvrit puis les referma aussitôt, comme si sa vision lui brûlait les yeux de l’intérieur. Il se pelotonna sur lui-même en geignant.
C’était un cauchemar. Oui, ce ne pouvait être qu’un abominable rêve ! Il allait bientôt se réveiller, se répétait-il, comme pour se convaincre.
— Non, Jacques, tu ne rêves pas. Je suis bien réel. Regarde-moi ! Ah, si tu savais depuis combien de temps j’attends ce moment.
L’homme recula de quelques pas. Il se délecta du spectacle qui s’offrait à lui. Sur le mur du fond de la cave, éclairé par la lueur de la bougie, il contempla son ombre qui dominait de toute sa hauteur la frêle silhouette de Jacques, prostrée, secouée par de violents sanglots.
Enfin, il souffla sur la flamme et se dirigea vers la porte de la cave.
Le bruit de deux tours de clé dans la serrure résonna dans l’obscurité profonde.
Chapitre premier
Samedi 9 décembre.
Jacques Desfontaine se réveilla en sursaut dans son lit à baldaquin. Il se redressa sur un coude, le souffle court. Du revers de sa manche, il essuya la sueur qui glissait sur son front.
— Bon Dieu ! Satané cauchemar ! bougonna-t-il.
Cela faisait quelque temps que ses nuits étaient agitées, peuplées d’ombres et de ténèbres. Il passait de longues heures à attendre dans l’obscurité, blotti sous la couette, sursautant au moindre bruit, et n’arrivait jamais à se rendormir avant l’aube.
Il lui semblait parfois que sa maison était vivante, qu’elle respirait : des grincements et des craquements lui parvenaient depuis les combles. D’innombrables cartons et des meubles anciens y étaient entreposés depuis des générations. Mais Jacques n’y mettait jamais les pieds. Dans son enfance, on lui avait rapporté qu’un homme s’était pendu à l’une des grosses poutres qui soutenaient la toiture. Lors de ses nuits d’insomnie, il lui arrivait de ressasser cette vieille histoire et de penser que l’âme du défunt hantait la bâtisse.
Quand il se réveillait au petit matin, son esprit était si confus qu’il ne savait plus s’il avait réellement perçu tous ces bruits étranges ou s’il les avait seulement rêvés. Cette situation ne pouvait plus durer : il était à bout de nerfs.
Les volets en pantenne claquaient de nouveau contre la façade arrière de la maison, lorsqu’une pluie drue s’abattit violemment sur les carreaux de la porte-fenêtre. Une épaisse couche de nuages obscurcissait le ciel. Un frisson parcourut son corps.
— Quel temps de chien ! maugréa le quinquagénaire en se laissant retomber mollement sur l’oreiller.
Il demeura allongé un bon moment dans son lit, songeant à tout ce qu’il avait à faire dans la journée.
Un vent glacial pénétra par les interstices de la fenêtre, et s’engouffra en hurlant dans la cheminée. Il remonta promptement la couette jusqu’à son menton et se pelotonna dans la chaleur des draps. Par souci d’économie, il se refusait obstinément à dépenser le moindre centime pour chauffer le premier étage de son manoir.
Son regard erra longuement sur la tapisserie jaunie par le soleil et grignotée en divers endroits par l’usure du temps. Cette chambre avait toujours été la sienne ; rien n’avait vraiment changé. À commencer par le petit lit dans lequel il dormait un peu à l’étroit et dont il n’avait jamais voulu se séparer.
À droite de la porte-fenêtre, le vieux secrétaire en acajou lui servait encore de bureau. Nostalgique, il s’y installait chaque fin de mois pour tenir ses comptes. Face à son lit se trouvait une imposante armoire style Louis XV dans laquelle il rangeait soigneusement toutes ses affaires.
Et Dieu sait qu’il y en avait !
Comme Jacques ne jetait jamais rien, elle était pleine à craquer. Néanmoins, aucun désordre apparent. Tout était rigoureusement organisé selon un code couleur précis. Sur chacune des étagères reposaient trois piles de vêtements bien distinctes : une pour le linge blanc, une seconde pour les teintes vives et une troisième pour les couleurs foncées. La répartition suivait par ailleurs une logique implacable. Les chaussettes et les sous-vêtements occupaient l’étagère du bas, puis venaient les pantalons, les t-shirts, les pull-overs et enfin, sur celle du haut, se trouvaient les chapeaux. De sorte que, même les yeux fermés, il pouvait cibler n’importe quel habit en moins de temps qu’il ne fallait pour le dire.
Cette méthodologie rigoureuse s’appliquait à toute la demeure.
*
Après le décès de sa mère, Francine Desfontaine, Jacques s’était retrouvé seul dans cette vaste maison de maître datant de la fin du XIXe siècle, dont l’architecture d’inspiration néoclassique faisait la fierté de la commune de Carquefou.
La façade symétrique, ornée d’une porte d’entrée majestueuse, d’un balcon central en fer forgé et de corniches moulurées, suscitait autant d’admiration que de convoitise dans le voisinage. De hauts murs de pierre entouraient la propriété, la préservant des regards indiscrets.
Lors d’un rendez-vous qui visait à régler la succession de sa mère, le notaire, maître Vinaver, lui avait demandé ce qu’il comptait faire de cette maison.
— Vous devriez la mettre en vente et en acheter une autre, moins grande et plus facile à entretenir, avait-il suggéré d’une voix doucereuse.
Jacques n’avait pas sourcillé, assis bien droit sur sa chaise, les yeux mi-clos.
Le notaire s’était alors penché plus en avant sur son bureau et avait déclaré solennellement :
— C’est le bon moment pour vendre, croyez-moi ! Les taux des crédits sont particulièrement bas. Il faut en profiter. Jamais vous ne retrouverez une occasion comme celle-ci. Et je connais plusieurs acheteurs qui pourraient être très intéressés par votre bien. Je vous assure que je veillerai à vos intérêts en me chargeant personnellement de la transaction.
Les paupières de Jacques s’étaient alors mises à frémir. Ses poings s’étaient crispés sur ses genoux. Il avait senti une vague de colère monter en lui.
Pour qui le prenait-il ? Un simple d’esprit ? Certes, il n’avait pas fait de longues études, mais il était bien plus futé qu’il n’y paraissait au premier coup d’œil.
— Je connaissais bien votre maman, vous savez, s’obstina le notaire.
Jacques n’était pas dupe. Ce gredin honnête cherchait certainement à l’amadouer. Quant au fait de « connaître » Francine… Il ne manquait pas de toupet, celui-là ! Il se souvenait parfaitement qu’il avait fait la même proposition à sa mère, après le décès de son père, Charles, et qu’il s’était montré particulièrement insistant.
Maître Vinaver était venu lui rendre visite à plusieurs reprises, et sans en avoir été prié. Fort heureusement, elle ne s’était pas laissé influencer par ses minauderies et avait catégoriquement refusé de vendre la demeure. Au fil des discussions, elle avait fini par découvrir le pot aux roses : les familles Desfontaine et Vinaver entretenaient de vieilles rivalités qui portaient essentiellement sur des questions immobilières. La propriété de Charles avait autrefois appartenu à l’arrière-grand-père de maître Vinaver. Son aïeul, criblé de dettes, avait en effet été contraint de céder le bien au plus offrant.
Jacques avait vu clair dans le jeu de cet imposteur : il voulait remettre la main sur le domaine qui avait jadis été celui de ses ascendants.
Vendre le manoir dans lequel il avait grandi ?
C’était hors de question ! Et s’il pensait pouvoir le persuader à grand renfort de vaines promesses, c’était bien mal le connaître, pensa-t-il.
Alors que le notaire s’apprêtait à ouvrir la bouche, Jacques avait bondi de sa chaise, le visage rouge de colère. Il avait tapé du poing sur le bureau en déclarant d’une voix forte :
— Je ne vendrai pas ! J’ai toujours vécu dans cette maison et je compte bien y mourir ! Vous m’entendez ?
Le notaire n’osa plus jamais aborder la question de la vente de la propriété.
Jacques était très attaché au domaine. Il avait promis à sa mère de ne jamais s’en séparer.
Francine avait connu une enfance misérable. Elle était née à Jussac, une petite ville située près d’Aurillac, dans le Cantal, et avait grandi dans une famille de paysans. Comme elle était brillante élève, elle avait obtenu une bourse qui lui avait permis d’entreprendre des études de droit à la Faculté de Nantes. À l’occasion d’un stage effectué à la mairie de Carquefou, elle avait rencontré Charles, un riche notable de la commune. Ils s’étaient mariés en 1961 et avaient emménagé dans cette belle maison, qui appartenait aux Desfontaine depuis trois générations. Elle avait alors mené une existence confortable et avait définitivement coupé les liens avec ses parents. Chaque fois que son fils avait voulu l’interroger à ce sujet, elle lui avait répondu qu’il ne fallait jamais regarder en arrière, ni réveiller les fantômes du passé… Mieux valait filer droit devant soi et profiter de tout ce que la vie avait à nous offrir.
Francine, Charles et Jacques vécurent ainsi, plutôt heureux, dans cette belle demeure.
Lorsque Jacques atteignit la majorité, il fut contraint d’emménager dans la dépendance attenante au bâtiment principal. Charles souhaitait que son fils acquière davantage d’autonomie. Les deux logements communiquaient néanmoins par l’entremise d’une porte dérobée. À l’heure des repas, Jacques la franchissait pour venir s’installer à la table de ses parents.
En contrepartie, ayant toujours eu la main verte, il s’occupait de l’entretien du jardin d’agrément et du potager. Par contre, il délaissait volontiers les activités intellectuelles, au grand désespoir de Francine qui aurait pourtant souhaité que son fils poursuive ses études. Charles avait, lui aussi, en horreur tout ce qui avait trait aux travaux manuels. Et par chance, ses obligations professionnelles ne lui laissaient guère le temps de s’adonner au jardinage. Il était donc bien content que Jacques s’en occupe à sa place.
Quand Charles Desfontaine mourut prématurément en décembre 1985, Jacques n’en éprouva que peu de peine. Son père passait la plus claire partie de son temps à travailler ; il ne s’était guère préoccupé de l’éducation de son fils. De ce fait, Francine et Jacques avaient noué une relation fusionnelle indéfectible.
Le lendemain du décès, Jacques délaissa la dépendance et vint s’installer définitivement auprès de sa mère. Il reprit donc sa chambre et ses habitudes.
*
Un coup d’œil au réveil le décida à quitter promptement la chaleur de la couette.
— Bon Dieu ! Déjà neuf heures ! grommela-t-il en repoussant rageusement la couette.
Jacques n’avait pas pour habitude de traîner au lit le matin. Mais, épuisé par les nuits d’insomnie, il s’autorisait quelques petites entorses au règlement qu’il avait établi : ponctualité, ordre et méthode étaient ses maîtres-mots.
Sa vie était réglée comme du papier à musique. La matinée commençait toujours par le même rituel.
Il enfila sa robe de chambre et ouvrit les deux vantaux de la porte-fenêtre qui donnait sur l’arrière de la maison. Un vent froid s’infiltra aussitôt dans la pièce. Il dut se tenir au garde-corps du balconnet tant les rafales étaient puissantes. Une pluie verglaçante le saisit, mais cela ne le découragea pas pour autant.
Il aimait contempler son jardin depuis ce promontoire. C’était de loin le meilleur point de vue qui lui permettait d’apprécier le travail qu’il avait accompli. Le résultat était spectaculaire : tous les massifs étaient taillés au cordeau et présentaient une grande variété de plantes. La pelouse était impeccable. Adepte de l’art topiaire, il avait transformé les buissons en véritables chefs-d’œuvre.
Si Jacques était un virtuose du jardinage, il en allait tout autrement pour les activités plus cérébrales. Il avait échoué à chaque examen ou concours auquel il s’était présenté. Fort heureusement, Charles Desfontaine avait usé de ses relations pour obtenir un poste d’employé communal, chargé de l’entretien des espaces verts. Ce métier lui convenait parfaitement.
Son attention se porta ensuite au-delà du mur qui délimitait la propriété. De son balcon, il avait une vue imprenable sur le cimetière des Gauteries dont il contempla les belles allées sinueuses. Malgré la tempête, les tombes étaient encore fleuries à cette époque de l’année. Le cimetière paysagé ressemblait à un élégant tableau en forme d’arabesque colorée. Jacques ne se lassait jamais de ce spectacle floral.
Puis son regard se fixa sur le deuxième caveau de l’allée centrale : celui de la famille Desfontaine. Sa mère y reposait depuis juillet.
Une vague de tristesse le submergea. Il leva les yeux au ciel. Des larmes perlèrent au coin de ses yeux.
Contrairement à la plupart des habitants du quartier, Jacques ne considérait pas la proximité du cimetière comme une source de désagrément. Il se réjouissait d’avoir des voisins aussi silencieux et accommodants. Mais il ne pouvait pas en dire autant du vieux couple qui résidait juste en face de chez lui : Huguette et Maurice Letellier. Un vrai fléau ! Toujours à l’affût des moindres ragots.
Vivement qu’ils passent l’arme à gauche… se disait-il chaque fois qu’il songeait à eux. Il attendait en effet avec une impatience à peine dissimulée de voir leur tombe depuis son balcon.
Sur cette dernière considération, il referma la porte-fenêtre et descendit prendre son petit-déjeuner dans la cuisine.
Comme chaque matin, il eut la satisfaction de retrouver le plateau qu’il avait lui-même préparé la veille, posé sur la table, à sa place habituelle. D’un geste machinal, il alluma le poste de radio qui trônait sur le buffet et mit la cafetière en marche.
Assis devant son bol de café fumant, il entreprit de lire le journal. Il ouvrit Ouest-France directement à la rubrique nécrologique. Chaque jour, il lisait avec grande attention les avis d’obsèques de la commune, et notait scrupuleusement dans un petit carnet les dates et heures de toutes les inhumations auxquelles il pensait pouvoir assister depuis son balcon.
D’aussi loin qu’il se souvînt, Jacques avait toujours vu sa mère entamer la lecture du quotidien par la page des décès. Il avait pris l’habitude d’en faire autant après sa disparition.
« Grâce à Dieu ! » s’exclamait-elle à chaque fois qu’elle dépliait le Ouest-France, en joignant les deux mains et en levant les yeux au ciel. « Je ne suis point encore dans le canard aujourd’hui, mon chéri ! »
Le 29 juillet précédent, le journal était resté fermé sur la table de la cuisine. Il lui avait fallu plusieurs jours avant d’être capable de l’ouvrir. Du bout de ses doigts tremblants, Jacques avait effleuré l’avis qu’il avait lui-même rédigé pour annoncer le décès de Francine.
« Tu vois, Maman… Ça y est… T’es dans le journal », avait-il murmuré d’une voix entrecoupée de sanglots.
Il avait soigneusement découpé l’article et l’avait rangé dans son portefeuille, avec la photo de Francine. Il ne s’en séparait jamais.
Dix heures sonnèrent bientôt à la pendule du salon. Jacques replia méticuleusement le quotidien et se dirigea vers le réfrigérateur à grands pas. S’il ne s’activait pas, il finirait par arriver en retard.
Il ouvrit la porte du frigo, et, d’un geste automatique, s’empara de la bouteille de lait et du beurre qui se trouvaient sur l’avant-dernière tablette, consacrée aux produits laitiers. Il tendit ensuite la main vers l’étagère du bas… Sa main resta levée, en suspens.
Ses yeux furetèrent frénétiquement de gauche à droite. Il se pencha, se redressa, se baissa de nouveau, écarta les compotes et les fruits.
Où était le pot de confiture ?
Ses doigts fébriles fouillèrent vigoureusement les étagères les unes après les autres.
Enfin !
Il était là ! Posé sur la plus haute étagère, dissimulé derrière la charcuterie et la viande.
Jacques demeura interdit, bouche bée, les yeux comme deux ronds de flan.
Que faisait-il à cet endroit ?
Il esquissa une moue dubitative, se frotta le menton et resta planté devant le frigo, stupéfait. Les yeux mi-clos, il fouilla sa mémoire… Une telle erreur ne lui ressemblait pas.
Il se mit à table et prit son petit-déjeuner sans grand appétit. Ce petit désordre le déstabilisait au plus haut point. D’une oreille distraite, il écoutait les informations qui s’échappaient du poste de radio. Mais ses pensées étaient fixées sur cet incident.
Il fit sa vaisselle et monta prendre sa douche à l’étage, l’esprit toujours contrarié par cette mésaventure.
Parvenu en haut de l’escalier, il se souvint soudain du coup de fil qu’il avait reçu la veille au petit-déjeuner. Il se frappa le front de la paume de la main.
— Bien sûr ! Comment n’y ai-je pas pensé plus tôt ?
Ce détail lui était sorti de la tête. Sa voisine, Huguette, l’avait encore appelé, soi-disant pour lui dire quelque chose d’important.
Mais il ne lui avait pas laissé le temps de s’expliquer : il lui avait raccroché au nez, après avoir précisé qu’il était très occupé. Cet appel l’avait perturbé au moment de ranger le petit-déjeuner, sans doute. Voilà tout…
Rassuré, Jacques se hâta de se préparer. Les autres devaient l’attendre au café depuis déjà une bonne heure, se dit-il. En trois mois, il n’avait pas raté un seul rendez-vous du samedi. L’apéro avec ses nouveaux amis était sacré.
À peine eut-il mis un pied en dehors de la propriété qu’il vit frémir les rideaux de la fenêtre de la voisine d’en face. Une fois de plus, Huguette devait l’espionner derrière ses carreaux. Cette vieille pie n’avait décidément rien à faire de mieux pour occuper ses journées. Jacques fit un signe de la main pour lui signifier qu’il l’avait vue.
La fenêtre s’ouvrit aussitôt, laissant apparaître l’opulente silhouette de l’octogénaire. Sa figure ressemblait à un bouton de pivoine prêt à fleurir. Son époux se tenait derrière elle, aussi blanc qu’un cachet d’aspirine. Tous deux formaient résolument un couple atypique. Il ne se passait pas une journée sans qu’ils ne se chamaillent. Et cela durait depuis plus de cinquante ans. Jacques s’était toujours demandé comment le vieux avait fait pour supporter sa femme depuis autant de décennies. S’il avait été à sa place, il lui aurait mis une décharge de plomb dans le flanc depuis belle lurette. D’ailleurs, si Jacques était resté célibataire, c’était certainement à cause d’eux. À force de les voir se disputer sans relâche, jour après jour, cela avait fini par le dégoûter définitivement du mariage. Mieux valait encore vivre seul qu’être mal accompagné !
— J’ai fait des bottereaux, mon p’tit Jacques. Veux-tu que je t’en apporte cinq ou six ? proposa-t-elle d’une voix de fausset.
Jacques fit signe que non. Ses bottereaux, elle pouvait bien se les garder, pensa-t-il. Il était hors de question qu’il accepte quoi que ce soit d’elle. Maintenant que sa mère n’était plus de ce monde, rien ne l’obligeait à supporter la présence de cette commère.
— Mais si… Maurice te les déposera en allant chercher le pain, insista-t-elle.
Puis, se tournant vers son mari, elle s’écria :
— T’as entendu, Maurice ? Allons, secoue-toi un peu !
Le vieil homme opina timidement de la tête.
Jacques haussa les épaules et s’éloigna de sa démarche claudicante, en grimaçant. Le froid et l’humidité ne faisaient pas bon ménage avec ses rhumatismes, sans compter ce maudit pied droit auquel il manquait un orteil depuis son accident de vélo. Ce membre fantôme lui causait de vives douleurs, même après toutes ces années.
La pluie avait enfin cessé, mais le vent avait redoublé de force.
Jacques releva le col de sa veste et enroula son écharpe autour de son cou.
Le trottoir étant encombré par un monticule de matériaux, déposés pêle-mêle par des ouvriers en fin de semaine. Il fut contraint de marcher sur la route, ce qui le contraria fortement. Une dizaine de maisons en construction défiguraient littéralement le paysage. Elles avaient poussé toutes en même temps, comme des champignons uniformes et disgracieux. Le promoteur immobilier avait exploité le moindre mètre carré de la parcelle qui se trouvait entre sa propriété et le cimetière. Chaque fois qu’il passait devant, Jacques se désolait à la vue de ce triste spectacle.
Il ralentit un peu à hauteur du grand portail du cimetière. S’arrêter un instant sur la tombe de Francine le tentait, mais il n’avait résolument pas le temps : il était déjà suffisamment en retard. Il se promit d’aller la voir sur le chemin du retour.
Jacques emprunta la rue de la Marquise de Sévigné et bifurqua à gauche sur la rue de Châteaubriand. Face à lui, l’église Saint-Pierre se dressait de toute sa hauteur, étincelante comme un joyau. Depuis sa rénovation en 1980, cet édifice néogothique avait fière allure avec son clocher qui culminait à soixante-six mètres de hauteur. Jacques aimait surtout la contempler à la tombée de la nuit, lorsqu’elle revêtait son habit de lumière jaune, rouge, vert, bleu et rose. Il la regardait toujours avec le même émerveillement dans les yeux, mais n’y entrait que très rarement.
Chapitre II
Quand Jacques poussa la porte de L’Atelier, une vague de chaleur l’envahit instantanément. Le nouveau propriétaire avait opté pour une déco vintage et conviviale. Depuis le décès de Francine, ce café était devenu, pour Jacques, une seconde famille.
Fernand, Martin et Valmont étaient confortablement installés à leur table habituelle, au fond de la salle, devant un verre de Pastis aux trois quarts vide, un éventail de cartes entre les mains. Depuis l’entrée, Jacques perçut leur gaieté tant ils faisaient de bruit.
Une vingtaine de clients profitaient également de la bonne ambiance des lieux, attablés devant un café ou un verre de vin.
Mathilde, la serveuse, se déplaçait d’une table à l’autre avec dextérité. Le patron, qui venait tout juste de l’embaucher, se félicitait de son savoir-faire auprès des clients. Elle contribuait beaucoup à la bonne humeur qui régnait dans le café.
Fernand, Martin et Valmont ne remarquèrent pas l’arrivée de leur nouvel ami, tant ils étaient absorbés par leur partie de cartes. Jacques s’en offusqua.
— Vous auriez pu m’attendre avant de commencer à jouer ! râla-t-il en entraînant bruyamment une chaise sur laquelle il se laissa tomber de tout son poids.
Les rires cessèrent instantanément.
— On a pensé que tu ne viendrais pas aujourd’hui, rétorqua Martin en achevant de boire son verre.
— Je n’arrivais pas à me lever : je n’ai pas dormi à cause de ces fichus cauchemars !
— T’avais qu’à nous envoyer un message, on aurait patienté.
Jacques adressa à Fernand un regard noir de mécontentement.
— Tu sais parfaitement que je n’ai pas de portable. Ça coûte trop cher, ces engins !
— Avec tout l’argent que tu as gagné au loto, tu pourrais quand même t’en payer un, lança Fernand.
— Des portables, tu pourrais t’en acheter des milliers ! Alors, ne te fiche pas de nous ! renchérit Valmont d’un ton cassant.
Le visage de Jacques se crispa. Il changea de couleur.
— Vous saviez pour le loto ?
Les trois hommes échangèrent des regards entendus. Martin fut le premier à rompre le silence.
— Bien sûr qu’on était au courant… comme la plupart des habitants de Carquefou. Ce n’est pas le genre de truc qu’on peut garder secret bien longtemps, surtout quand on passe au journal de treize heures.
— On lit les journaux comme tout le monde. Si tu voulais rester incognito, c’est raté ! Il y avait ta photo et celle de ta mère en première page du Presse-Océan ! répondit sèchement Valmont.
— À cette époque, tu ne venais pas encore au café, précisa Martin. Mais nous, on t’a reconnu tout de suite quand t’es venu la première fois. Tu n’as jamais rien dit, tu as fait comme si de rien n’était.
Jacques, contrarié, croisa rageusement les bras sur son torse et releva le menton d’un air de défi.
— Et alors ? Je ne vois pas en quoi ça vous regarde.
— On pensait qu’on était tes potes, mais faut croire qu’on s’est trompés, renchérit Fernand sur un ton de reproche.
— On ne te demande pas l’aumône ; on voudrait juste que t’arrêtes de nous prendre pour des cons ! ajouta Valmont.
La mâchoire de Jacques se contracta et il serra les poings.
— Tu es quand même sacrément radin, accusa Valmont. En trois mois, tu n’as payé que deux tournées de Pastis.
Malgré les signes désespérés que Martin et Fernand lui faisaient, Valmont poursuivit de plus belle :
— Et encore, on a dû insister pour que tu mettes enfin la main au porte-monnaie. Il y a de quoi s’énerver, non ? Tu trouves toujours un prétexte pour ne rien débourser. Tu n’as jamais un sou en poche alors que tes comptes sont pleins à craquer. Nous, on en a ras le bol ! On aimerait bien que ça tourne un peu, tu comprends ? Alors, aujourd’hui, c’est toi qui paies ! conclut-il en tapant du poing sur la table.
Jacques se leva d’un bond et, de rage, renversa sa chaise.
Ses joues s’enflammèrent et ses yeux lancèrent des éclairs.
— Calme-toi, Jacquot ! intervint Martin d’une voix qui se voulait douce. Allez, assieds-toi ! On ne va tout de même pas se prendre la tête pour des histoires de fric.
Il releva la chaise et invita Jacques à y prendre place.
Mais ce dernier demeurait étranger à tout ce qui l’entourait. Il se tenait debout, les bras figés le long du corps, le regard dans le vide. Un silence de plomb s’était abattu sur toute la salle ; les autres clients avaient les yeux rivés sur eux.
L’inquiétude se lisait sur les visages de Martin et de Fernand, tandis que Valmont arborait un sourire narquois.
— Tu n’as pas idée de ce qu’on endure ! Le pognon te tombe du ciel, mais nous, on doit trimer comme des malades. Alors, ce serait bien de penser un peu aux autres. Regarde, dit-il en désignant Fernand de la main. Lui, il n’a que sa petite retraite de fonctionnaire pour vivre. Martin, ce n’est pas avec sa paye de postier et ses trois gamines à élever qu’il va pouvoir mettre un peu d’argent de côté et se faire plaisir de temps en temps. Quant à moi, c’est simple. Je suis au chômage depuis cinq ans maintenant. Il est quasiment impossible de retrouver du boulot à cinquante-sept ans. C’est fichu pour moi ! Et toi, tu mènes la belle vie et tu ne fais rien pour nous aider.
Valmont et Jacques se connaissaient depuis l’école primaire. Les deux hommes appartenaient à deux univers diamétralement opposés et leurs caractères l’étaient tout autant. Il avait fallu attendre la disparition de Francine pour que Valmont se décide à faire le premier pas.
Francine était une femme très appréciée dans la commune : elle œuvrait pour des associations caritatives et consacrait beaucoup de son temps libre au bénévolat. Lorsqu’elle avait remporté la super cagnotte du loto, elle avait fait plusieurs dons substantiels à ces associations.
Le jour de ses obsèques, l’église de Carquefou n’avait pas suffi à accueillir toutes les personnes qui étaient venues lui rendre un dernier hommage. Certaines d’entre elles avaient dû assister à la cérémonie depuis les marches de l’église. À l’issue de la messe, Valmont avait invité Jacques à venir boire un verre à L’Atelier. Il lui avait alors présenté Fernand et Martin, deux amis de longue date avec lesquels il se réunissait chaque samedi pour battre les cartes et prendre un verre.
Jacques avait accepté l’invitation à contrecœur. Mais au fil des semaines, ces rendez-vous du samedi matin lui avaient permis de mieux supporter l’absence de Francine.
Le visage rougeaud et luisant de Jacques se crispa. Il fit des efforts terribles pour se ressaisir, inspirant bruyamment par le nez. Les ricanements de Valmont redoublèrent à la vue de toutes ces simagrées.
— Dans le fond, vous êtes tous les mêmes ! Y a que mon pognon qui vous intéresse ! hurla-t-il de toutes ses forces en martelant la table. Vous m’avez bien eu, hein ? Vous m’avez attiré ici pour me soutirer de l’argent. Et c’est toi, Valmont, qui est venu me chercher après la mort de Maman. Moi, je ne vous avais rien demandé. J’étais tranquille chez moi.
— Tranquille, ça, c’est certain. Tu n’as jamais eu d’amis ! Et pour cause : personne ne supporte tes sautes d’humeur.
Le patron les interpella de derrière le comptoir :
— Allez, les gars ! C’est bon ! Aujourd’hui, c’est moi qui offre le Pastis, annonça-t-il d’une voix faussement joviale.
Jacques se retourna brusquement. Ses yeux balayèrent la salle de gauche à droite : il vit alors que tous les regards des autres clients étaient braqués sur sa personne. La serveuse, Mathilde, était plantée là, face à lui, son plateau chargé sur les bras, ses grands yeux verts le fixaient intensément. Jacques surprit un échange de clins d’œil entre Mathilde et Valmont.
Un violent coup de fouet le cingla, le sang lui monta aux joues. Il aurait voulu se jeter sur Valmont et lui casser la figure. Mais il n’en fit rien. Il se contenta de baisser la tête et se dirigea à grandes enjambées vers la porte.
Les trois hommes se regardèrent, consternés. Ce n’était pas la première fois que leur ami faisait un tel esclandre, mais force était de constater que son état ne faisait qu’empirer.
Jacques maugréa durant tout le trajet du retour, jurant que plus jamais il ne remettrait les pieds dans ce maudit café. Plus jamais !
La pluie s’était remise à battre le pavé avec fureur et le vent soufflait si fort qu’il dut lutter pour ne pas perdre l’équilibre. Il longeait les vitrines des magasins qui jalonnaient son chemin, les jambes flageolantes. Tête baissée, les yeux humides, il avançait avec peine.
Il s’abrita un instant sous le porche de la boutique de décoration, le temps de reprendre son souffle. C’était, jadis, le commerce préféré de Francine. Elle l’appelait la caverne d’Alibaba. En cette période de l’année, la vitrine, agencée avec soin, était parée de guirlandes lumineuses. Cette vision lui réchauffa le cœur ; il reprit sa route, en direction de la maison.
À peine eut-il passé le portail qu’il vit un petit paquet sur le perron. Il s’agissait sans aucun doute des bottereaux de Huguette. Il l’écarta rageusement du pied. Cette vieille peau n’en faisait décidément qu’à sa tête ! Il tourna la clé dans la serrure, ouvrit la porte et la referma aussitôt.
Jacques éprouva un immense soulagement.
Le trajet du retour lui avait paru interminable. D’un geste machinal, il déposa les clés dans la corbeille en osier qui se trouvait sur la desserte de l’entrée, retira sa veste et entreprit d’aller regarder le journal télévisé en attendant le déjeuner. Midi venait de sonner à la pendule, mais il n’avait pas faim. Toutes ces contrariétés lui avaient coupé l’appétit.
Il ouvrit le buffet, sortit un verre et un litre de Pastis qu’il posa sur la table basse. À la vue de la bouteille, il éprouva comme un petit pincement. Les autres étaient probablement encore au café, et ils devaient bien se marrer dans son dos. Cette pensée lui saigna le cœur.
Après s’être servi une bonne rasade d’alcool, il s’installa confortablement dans son fauteuil.
Ses yeux cherchèrent la télécommande de la télévision. Elle n’était pas à sa place habituelle, sur la table basse.
Il se leva et dérangea, un à un, les coussins du fauteuil. Rien.
Il se mit à genoux, fureta à tâtons sous le canapé et sous les meubles. Au comble de l’agacement, il ouvrit les portes du buffet, fouilla les étagères, et finit par vider le contenu des tiroirs sur le tapis.
Toujours rien.
Sa vision se troubla, il se mit à trembler nerveusement. Mais où était cette fichue télécommande ? Il étendit ses recherches à la cuisine puis aux autres pièces du rez-de-chaussée. Sa colère augmentait à mesure qu’il parcourait les pièces, dérangeant tout sur son passage, et ne rangeant rien. Il était comme possédé.
Essoufflé, il s’assit un instant sur la première marche de l’escalier et prit sa tête dans ses mains.
— Il faut que je me calme, que je réfléchisse, se dit-il. La dernière fois que je l’ai vue, c’était hier soir avant de monter me coucher. Elle ne peut pas être bien loin.
Il regarda par-dessus son épaule, en direction de l’étage. Non ! Elle ne pouvait pas être là-haut !
Il entreprit malgré tout d’aller vérifier par lui-même, juste au cas où…
Au bout d’une heure de recherches infructueuses, il se laissa tomber sur le canapé, l’âme en peine. Il but son Pastis d’une traite, se servit un second verre qu’il avala aussi précipitamment. Une vague de chaleur envahit tout son corps, lui procurant peu à peu une sensation de bien-être. Il se laissa glisser sur le flanc droit et sombra bientôt dans un sommeil de plomb.
À son réveil, Jacques fut horrifié de constater qu’il avait dormi presque tout l’après-midi.
Le soleil dardait de pâles rayons au travers de la baie vitrée. Il entreprit d’aller réparer les châssis qu’il avait entreposés au fond du jardin. Le vent soufflait toujours avec vigueur, l’air frais lui ferait le plus grand bien.
Chapitre III
Dimanche 10 décembre.