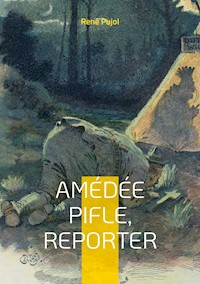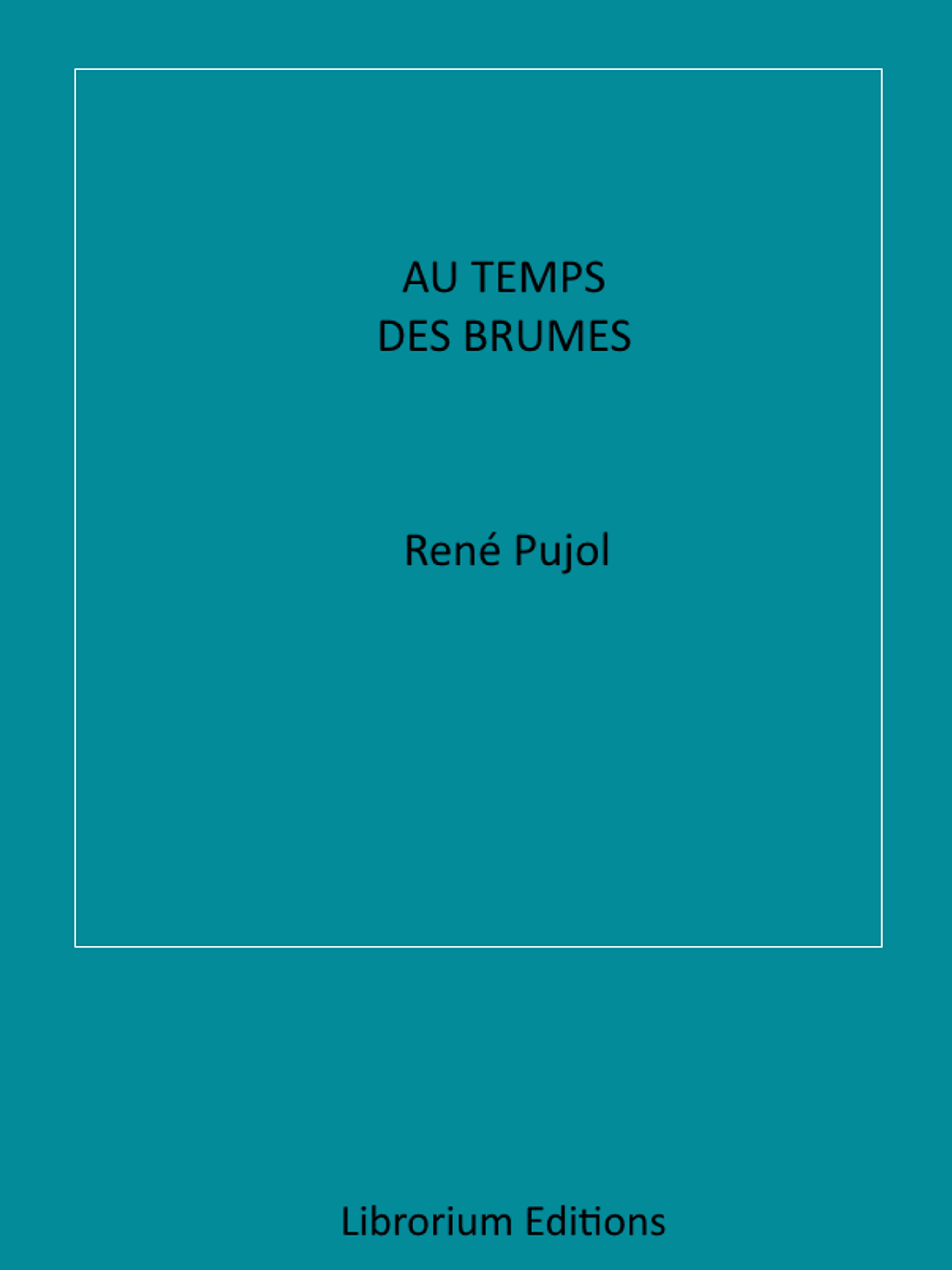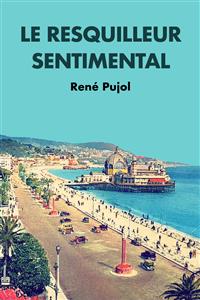0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Französisch
C’était un jeune homme d’environ vingt-cinq ans, assez grand et d’apparence athlétique. Il suffisait de voir ses épaules pour comprendre que c’était un sportif. Son visage reflétait l’énergie tranquille des forts. Nez droit, menton carré, touche rectiligne aux lèvres minces, yeux un peu enfoncés dans les orbites, tout indiquait une volonté qu’il ne devait pas être facile d’abattre.
Il regardait toujours l’horloge, et ses mains se crispaient sur la barre d’appui.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
René Pujol
LE MYSTÈRE DE LA FLÈCHE D’ARGENT
1933
© 2021 Librorium Editions
ISBN : 9782383831402
PREMIÈRE PARTIEL’ENFANT
ILE TRAIN DE CALAIS
— En voiture pour Paris !… en voiture pour Paris !…
L’employé courait le long du train en criant machinalement les mots rituels.
À la fenêtre d’un wagon de 1ère classe, un voyageur fumait une cigarette. Il avait l’air impassible, mais il jetait toutes les dix secondes un regard vers l’horloge de la gare de Calais. Ou bien il était pressé de partir, ou bien il attendait quelqu’un qui ne venait pas.
C’était un jeune homme d’environ vingt-cinq ans, assez grand et d’apparence athlétique. Il suffisait de voir ses épaules pour comprendre que c’était un sportif. Son visage reflétait l’énergie tranquille des forts. Nez droit, menton carré, touche rectiligne aux lèvres minces, yeux un peu enfoncés dans les orbites, tout indiquait une volonté qu’il ne devait pas être facile d’abattre.
Il regardait toujours l’horloge, et ses mains se crispaient sur la barre d’appui.
Enfin, un coup de sifflet retentit. Le jeune homme lança sa cigarette sur le quai, avec une nervosité qui trahissait la fin d’une contrainte, et il rentra dans le compartiment en disant :
— Ça y est, Georges !… Le train démarre, nous voilà tranquilles jusqu’à Paris !
Celui qu’il venait d’appeler Georges était du même âge, un peu plus vieux peut-être. Enfoncé, tassé dans son coin, la tête sur un oreiller, les jambes enveloppées dans une couverture de louage. Il était fort pâle et paraissait de complexion maladive. Sa poitrine se soulevait et s’abaissait avec difficulté, sous le rythme irrégulier de la respiration.
En entendant la phrase prononcée avec une satisfaction indicible par son camarade, il entr’ouvrit les paupières et esquissa un faible sourire :
— Tant mieux, murmura-t-il.
— Comment te sens-tu ?…
— Faible… très faible…
— Nous allons enfin pouvoir nous occuper de…
Il n’eut pas le temps d’achever, car la portière se rabattait avec un bruit de canon. Une seconde, ils aperçurent sur le quai le visage rougeaud d’un monsieur bien nourri. Une grosse valise fut vigoureusement lancée dans le compartiment, un nécessaire de toilette suivit comme un projectile, puis une jeune fille fut poussée avec vigueur au moment même où le rapide démarrait.
— Merci !… haleta la jeune fille.
— Bon voyage !… répondit le monsieur cramoisi, demeuré sur le sol. Mes hommages à votre tante !…
Elle resta à la fenêtre et agita son mouchoir jusqu’à ce que le train fût sorti du hall sonore et disparût dans la nuit.
La jeune fille était si contente de son aventure, qu’elle souriait encore en gagnant sa place. On comprenait qu’elle pensait :
« J’ai bien failli le manquer, mais je l’ai tout de même !… »
Cette satisfaction était compréhensible. La compagnie du Nord venait de mettre en service, depuis peu, un nouveau train qui portait le nom de Silver Arrow. Ce rapide, qui ne s’arrêtait qu’à Amiens, facilitait les communications de nuit et était très apprécié des gens pressés.
Le voyageur à la couverture avait refermé les yeux, il semblait déjà dormir. L’irruption de la jeune fille le laissait si indifférent, qu’il n’avait même pas tourné la tête de son côté.
L’autre avait eu un geste de dépit. Croire qu’on va s’allonger confortablement sur les coussins et voir surgir in extremis une gêneuse qu’il est impossible d’évincer, ce n’est pas drôle. Mais on peut être contrarié et faire preuve de courtoisie. Le voyageur s’empara donc de la grosse valise qui gisait au milieu du compartiment et, bien qu’elle fût lourde, il la déposa sans effort dans le filet à bagages.
— Merci, monsieur… dit simplement la jeune fille.
Le jeune homme ôta sa casquette pour saluer et ils n’échangèrent aucune parole.
Ils étaient assis face à face ; le voyageur à la couverture était seul à l’autre extrémité du compartiment. Il était impossible à la jeune fille de comprendre que ces deux hommes se connaissaient, car ils ne se regardaient même pas. Ils semblaient maintenant s’ignorer tout à fait.
Vingt ans, tel était l’âge approximatif de celle qui venait ainsi de faire irruption dans le compartiment. Ce n’était plus une adolescente et ce n’était pas encore une femme. Fine, gracile, elle avait l’allure hardie des jeunes filles modernes.
Sous son petit chapeau de cuir passait une mèche d’un blond cendré. Elle avait de grands yeux bleus, d’un bleu de nuit presque noir et une délicieuse frimousse sur laquelle on lisait une incontestable joie de vivre.
Le voyageur la détailla, comme font machinalement la plupart des hommes quand ils se trouvent devant une femme nouvelle, mais sans insister. Elle ne parut d’ailleurs faire sur lui aucune impression. Pendant qu’elle achevait de s’installer, dépliant un plaid, gonflant un petit oreiller pneumatique, il sortit pour fumer une cigarette dans le couloir.
La jeune fille était trop occupée pour faire attention à lui, sinon elle aurait remarqué, qu’adossé à la paroi, un pli soucieux entre les sourcils, le fumeur ne quittait pas le dormeur des yeux.
Au bout d’un instant, il rentra et déplia un journal qu’il se mit à parcourir avec une distraction évidente. Il tenait la feuille assez haut pour cacher une sorte d’angoisse de plus en plus accentuée.
De son côté, la jeune fille avait ouvert un livre et ne s’occupait nullement de ce qui se passait autour d’elle.
Elle ne s’intéressait qu’aux péripéties de son roman. On n’entendait que le ronronnement monotone du train et le léger craquement des feuilles qu’elle coupait au fur et à mesure.
Bientôt fatiguée de lire, la voyageuse ferma son roman et se disposa à sommeiller. Avant de clore les paupières, elle examina machinalement le compartiment.
Son attention fut attirée par une tache brune, sur le tapis, aux pieds du dormeur.
Une tache sur un tapis de train, cela n’a rien d’extraordinaire. Mais il sembla à la jeune fille que celle-ci existait depuis quelques instants à peine, qu’elle avait des reflets rouges et qu’elle s’élargissait peu à peu.
Une minute plus tard, elle ne doutait plus : la tache était de plus en plus grande. Elle atteignait presque le milieu du compartiment. Quant au dormeur, il inclinait progressivement la tête sur l’épaule droite et il restait toujours d’aspect aussi paisible.
La jeune fille comprit tout à coup la vérité. Elle éprouva une si vive émotion qu’elle se pencha vers le voyageur qui lui faisait face :
— Monsieur !… balbutia-t-elle, monsieur !…
— Que désirez-vous, mademoiselle ? fit-il d’une voix qui tremblait un peu.
— Là, voyez donc !…
Le voyageur devint livide et, se levant d’un bond, s’élança vers le dormeur. Il l’eut à peine effleuré que celui-ci glissa sur les coussins, mollement, comme un pantin cassé.
— Georges !… dit le jeune homme d’une voix rauque. Georges !… réponds-moi, Georges !…
Mais Georges ne répondit pas.
— Il faut appeler ! conseilla la jeune fille. Il est malade, il faut le secourir… Tirez la sonnette d’alarme !
— Ne bougez pas !… fit l’autre avec une certaine dureté, comme s’il donnait un ordre.
— Mais il faut le soigner d’urgence !
— Je m’en charge.
Sans perdre la tête et sans plus se soucier de la voyageuse que si elle n’existait pas, il courut à la porte du compartiment, la tira et baissa rapidement les rideaux.
Cette inquiétante précaution prise, le jeune homme défit la couverture et étendit son compagnon sur la banquette.
Le blessé – car c’était un blessé – était couvert de sang. Un ruisselet sinistre coulait de sa poitrine jusqu’à ses pieds. L’homme qui le soignait ouvrit le gilet et arracha la chemise pour découvrir la poitrine.
La jeune fille distingua avec horreur un trou rond, sous le sein gauche. C’était de ce trou, vraisemblablement fait par une balle de browning, que s’épanchait te sang.
Le jeune homme tâta le pouls du blessé, puis colla son oreille à hauteur du cœur. Se relevant plus blême encore, il tira un petit miroir de sa poche et l’approcha des lèvres du blessé. Le miroir ne fut pas terni. Le jeune homme exhala un profond soupir et une lassitude infinie creusa ses traits.
La jeune fille comprit immédiatement, mais n’osa pas prononcer le mot terrible.
— Est-ce qu’il est… ? fit-elle à voix basse.
L’homme boutonna lentement son veston. Il se mordait les lèvres et jetait autour de lui des regards de bête traquée.
— Monsieur !… reprit la jeune fille sur un ton de supplication. Dites-moi la vérité !… Est-ce qu’il est… ?
Alors l’homme articula sourdement :
— C’est fini !… il est mort.
D’un élan, la jeune fille se précipita vers la sonnette d’alarme.
— Pas ça ! cria l’homme.
— Si, il le faut !…
— N’en faites rien, mademoiselle… je vais vous expliquer…
— Lâchez moi !… lâchez-moi !…
Il la maintenait sans violence, tandis qu’elle se débattait de toutes ses forces pour atteindre le signal. Mais elle avait trop présumé de son énergie. Elle fléchit sur ses genoux et s’évanouit.
IIJULIA
La représentation du Wonderland, le grand music-hall du boulevard des Capucines, venait de s’achever. On jouait Paris à la diable, une revue à grand spectacle, qui attirait la clientèle étrangère, et réalisait des recettes formidables.
Rapidement démaquillées et rhabillées, les danseuses sortaient ensemble dans un pépiement de volière. Elles étaient gaies et familières.
— Hé ! Gaby… ton amoureux est encore là !…
— Tant pis pour lui, j’ai rendez-vous avec Gaston.
— Il reviendra demain !… Bonsoir, Gaby !…
— Bonsoir, Julia.
Celle qu’on venait de nommer Julia était une grande fille mince, d’une mise à la fois simple et coquette. Très brune, elle semblait être d’origine espagnole ou italienne.
Elle se hâta vers le métro. Il lui tardait de rentrer chez elle, rue d’Amsterdam, à deux pas de la place de l’Europe.
Si la danseuse était si pressée, c’était parce quelle se savait attendue. Elle avait un ami, un ami qu’elle aimait avec la foi de ses vingt ans, et c’était lui qu’elle allait rejoindre.
L’appartement de Julia, modestement meublé, encombré de bibelots bon marché, tapissé de photos d’artistes dédicacées, ne comprenait que trois pièces.
Une voix aigre glapit :
— Tu as un pneu sur la table du studio !…
Ces mots produisirent sur la jeune fille l’effet d’une douche glacée. Ce pneu, elle savait d’avance ce qu’il annonçait. Elle l’ouvrit en soupirant et lut :
« Ma chère Juju,
« Impossible de venir ce soir, car je quitte Paris pour quelques heures.
« Excuse-moi, et reçois les tendres baisers de ton
« G. »
Une grosse matrone au visage vulgaire, au peignoir constellé de taches, roula dans la pièce pompeusement appelée studio.
— Encore un lapin, n’est-ce pas ?… ricana-t-elle.
Julia haussa les épaules avec impatience :
— Maman, je t’en prie, laisse-moi… Je suis lasse…
— Oui, oui !… reprit la mère. Tu es surtout contrariée. C’est bien fait pour toi. Je t’ai dit mille fois que ce garçon n’est pas digne de toi. Quand je pense que tu ne sais même pas ce qu’il fait dans la vie !…
— Maman, je t’en supplie !…
— Évidemment, ça te vexe que j’aie raison… C’est que j’ai de l’expérience, moi !… Si tu continues à écouter ton cœur, il te mènera loin, mais sûrement pas au pays de la fortune !…
Excédée par ce verbiage, Julia se réfugia dans sa chambre, dont elle ferma la porte à clé.
Elle était triste, prête à pleurer – et pourtant ce n’était pas sa première déconvenue. Elle était habituée aux brusques éclipses de son Georges, qui menait une existence à la vérité fort mystérieuse.
Quand ils s’étaient connus, au hasard d’une rencontre dans la rue, Georges avait tout de suite posé ses conditions :
— Pendant quelques mois, vous ne saurez ni qui je suis, ni où j’habite… Il se peut que ma conduite vous paraisse parfois étrange. Ayez confiance, croyez que je vous aime sincèrement, et tout s’arrangera plus tard.
Julia avait accepté. Quelle est la jeune fille capable de résister à l’attrait du romanesque ?…
Georges la rendait d’ailleurs très heureuse. Il subvenait largement à ses besoins, et il l’entourait d’une affection toujours déférente et égale.
Mme Galvado, la mère de la danseuse, avait toujours vu cette liaison d’un mauvais œil.
— S’il tient tant au secret, insinuait-elle, c’est parce qu’il est marié.
Il m’a juré que non, et il ne ment jamais.
— Alors, il a un métier inavouable !
— Qu’entends-tu pas métier inavouable ?…
— Je ne sais pas, moi… voleur, peut-être !…
Ce soir, seule dans sa chambre, Julia pensait obstinément à tout ce qu’elle ne savait pas. Non, Georges n’était pas, ne pouvait pas être un voleur…
Ah ! pourquoi n’était-il pas là, cette nuit ? Où était-il et que faisait-il ?…
Une mélancolie insurmontable l’étreignait, la paralysait.
Elle se coucha, lut un instant, puis éteignit la lumière.
Le sommeil fut très long à venir, et quand Julia s’endormit, ce fut pour vivre un cauchemar affreux. Là, devant elle, elle voyait son Georges étendu, livide – mort…
Ainsi se vérifiait une fois de plus cette étrange et terrible loi de la télépathie, qui nous fait évoquer, à la seconde suprême de l’adieu éternel, les êtres que nous aimons.
IIIUN PAS DANS LE MYSTÈRE
L’homme n’avait eu que le temps de retenir la jeune fille dans ses bras pour l’empêcher de tomber dans la flaque de sang. L’ayant déposée le plus loin possible du mort, il la contempla pensivement :
« Pauvre petite !… murmura-t-il. Sa présence n’est pas faite pour simplifier les choses !…
« Allons !… Il faut maintenant agir au plus vite… »
Méthodiquement, il fouilla les vêtements du mort. Les poches ne contenaient aucun papier, mais un porte-billet et une montre en or, qu’il fit disparaître avec dextérité.
« Il le faut !… reprit-il, après une minute de réflexion. Il n’y a que cette solution… Georges, mon ami, mon frère, pardonne-moi !… »
Sans tergiverser davantage, il baissa la glace du côté opposé au couloir.
Le train roulait à toute vitesse en pleine campagne, sous un ciel noir comme de l’encre.
Le jeune homme se pencha sur le cadavre, l’embrassa fraternellement, avec un sanglot étouffé. Puis il le saisit à bras-le-corps et, le faisant basculer, il le laissa tomber sur le ballast.
Quand il eut accompli cet acte horrible, l’homme resta un instant frappé de stupeur comme s’il allait s’évanouir lui aussi. Mais sa volonté eut raison de cette faiblesse. Il releva la glace, étendit la couverture pour cacher complètement le sang, vérifia son veston et son pantalon pour voir s’ils n’avaient aucune tache suspecte, et enfin s’occupa de la jeune fille, toujours inerte.
Il essaya de la ranimer en lui frappant dans les mains, mais il n’y parvint pas. Il eût fallu des sels ou tout simplement de l’eau fraîche.
« De l’eau, il y en a au bout du couloir… monologua le jeune homme ; mais si elle revient à elle pendant mon absence, elle actionnera sûrement le signal d’alarme, et je serai perdu… Je ne peux donc pas la quitter une seconde… Alors, que faire ?… Si j’avais un révulsif quelconque… Il doit y avoir de l’eau de Cologne dans son sac, mais ai-je le droit d’y toucher ?… Ma foi, tant pis !… »
Et saisissant avec décision le nécessaire de toilette de la jeune fille, il l’ouvrit.
Le sac contenait une série de flacons à bouchons d’argent, tous marqués du chiffre « S ». Le voyageur vit également un revolver de petit calibre et un passeport établi au nom de Suzy Nelson. Il ne déchiffra cette indication que par hasard, car d’autres soins le réclamaient.
Ayant versé de l’eau de Cologne sur son mouchoir, il referma le nécessaire de toilette, et humecta le visage de la jeune fille.
Sous le bienfaisant effet de l’alcool, elle ne tarda pas à ouvrir les yeux. En reconnaissant son compagnon de voyage, elle eut un haut-le-corps d’effroi, mais il la rassura aussitôt avec douceur :
— Ne craignez rien, mademoiselle. Vous êtes en sûreté, il ne vous arrivera rien de fâcheux.
Suzy Nelson se dressa sur son séant et regarda autour d’elle d’un air égaré. Sous la couverture, elle ne distingua plus la forme sinistre qu’elle pensait y trouver…
— Qu’en avez-vous fait ?… demanda-t-elle d’une voix qu’elle s’efforçait de rendre impérieuse et qui chevrotait d’émotion.
Le jeune homme ne répondit pas directement :
— Oubliez tout, mademoiselle… Figurez-vous que vous avez fait un mauvais rêve…
— Je veux savoir ce que vous avez fait de ce pauvre corps !… répéta-t-elle. Dites-le moi tout de suite !…
— Ne cherchez pas à le savoir, mademoiselle…
— Vous ne voulez pas m’expliquer ?…
— Je ne peux pas, mademoiselle…
— Je l’exige !…
Fébrile, Suzy Nelson fouilla dans son nécessaire de toilette. Le jeune homme ne fit pas un geste pour l’empêcher de s’armer de son browning.
— Vous n’avez nul besoin de cela, dit-il, sans rien perdre de son calme. Vous me considérez comme un bandit, mais je n’en suis pas un…
Il s’exprimait d’un tel ton que Suzy Nelson remit le revolver dans le sac. Elle éprouvait encore une terreur très justifiée, mais elle comprenait qu’elle n’avait rien à redouter de son bizarre compagnon de voyage.
— Mademoiselle, reprit-il, par suite de circonstances déplorables, vous avez été témoin d’une scène tragique…
— Non, j’ai été témoin d’un assassinat !… interrompit Suzy Nelson.
Le jeune homme se passa la main sur les yeux.
— Peut-être… dit-il. Mais il ne s’agit pas d’un crime ordinaire… Si je vous ai empêchée de tirer la sonnette d’alarme, c’est que des intérêts supérieurs exigent au moins pendant quelques heures une discrétion qui doit vous paraître monstrueuse.
— Mais enfin, monsieur, comment pouvez-vous parler de discrétion ?… Quand un crime a été commis, il est juste de poursuivre le meurtrier !…
— Pas toujours, mademoiselle. Dans certains cas, il vaut mieux se taire.
— Qui a tué cet homme ?…
Le jeune homme baissa la tête.
— Je ne puis vous le dire, mademoiselle.
— Pourquoi ?
— C’est un secret dont je ne suis pas le maître.
— Excuse facile !… riposta Suzy Nelson.
— Je ne puis vous en donner d’autre pour l’instant. Il m’en coûte pourtant beaucoup, car je voudrais sur-le-champ vous démontrer que vous avez affaire à un honnête homme…
— Ou à un coupable !… s’exclama Suzy Nelson. Qui me prouve que ce n’est pas vous qui avez assassiné cet homme ?
— Je l’aimais comme un frère, fit le voyageur, dont les yeux s’embuèrent aussitôt de larmes. Je vous jure sur ce que j’ai de plus sacré que je suis innocent de sa mort… je veux dire que ce n’est pas moi qui l’ai tué…
Suzy Nelson médita un instant sur ce qu’elle venait d’entendre.
— Et celui que vous appeliez Georges, demanda-t-elle, était-ce aussi un honnête homme ?…
— Mademoiselle, dit le mystérieux voyageur, je vous supplie d’oublier le nom que vous m’avez entendu prononcer dans mon affolement. Il ne faut pas que ce nom soit révélé !…
— Répondez à ma question : Était-ce un honnête homme ?
— Oui, mademoiselle, un parfait honnête homme.
— Dans votre genre, sans doute ?…
Le voyageur parut plus peiné que froissé de ce sarcasme.
— C’est normal, mademoiselle, que vous soyez dure avec moi… je ne vous convaincrai pas… continua-t-il. Je comprends d’ailleurs votre méfiance… Il est des cas où les apparences sont accablantes…
— Surtout quand ces apparences ressemblent étrangement à des preuves… Au surplus, monsieur, nous n’avons pas à discuter plus longtemps…
« Si vous avez, des explications à donner, vous les fournirez tout à loisir au Commissaire de police de la prochaine gare.
Ici, le jeune homme sembla se troubler.
— Mademoiselle, dit-il, j’ai une requête extraordinaire à vous présenter.
— Laquelle, monsieur ?…
— Celle de ne parler à âme qui vive de la terrible scène à laquelle le hasard vous a fait assister.
— En effet, c’est extraordinaire !… Cela l’est même beaucoup trop, et vous me permettrez de ne tenir aucun compte de votre désir. Je préviendrai la police le plus tôt possible.
Le jeune homme, désespérant de la fléchir, joignit les mains et crispa ses doigts avec tant de force qu’elle entendit les articulations craquer.
— Mademoiselle, reprit-il lentement, en cherchant ses mots, je sais que vous devez logiquement me croire insensé et criminel. Je ne suis ni l’un ni l’autre et je regrette de ne pas trouver les mots capables de vous émouvoir…
« Je vous fais serment, sur la tombe de ma mère, que votre devoir est de vous taire !…
— Mais enfin, pourquoi ?…
— Pour des raisons d’une importance incalculable.
— Si vous me communiquiez ces raisons, je saurais au moins ce que j’ai à faire ?…
— Je vous répète que je suis obligé de les garder secrètes et qu’il ne m’est pas permis de les divulguer.
— Alors, tant pis !…
— Mon Dieu !… s’écria le jeune homme avec un véritable désespoir. Est-il possible d’échouer si près du but ! Si je vous supplie de vous taire, ce n’est pas parce que je redoute un châtiment. Devant un juge d’instruction, rien ne serait plus facile que de me disculper…
— Dans ce cas, pourquoi refusez-vous d’avertir le commissaire ?…
— Parce que j’ai besoin de ma liberté, de toute ma liberté, pendant quelques heures encore !…
Le rapide ralentissait, on entendait les freins crisser. On atteignait Amiens, l’unique station de la Flèche d’Argent avant Paris. Un bref coup de sifflet annonça l’entrée en gare.
— Mon sort est entre vos mains, dit simplement le jeune homme. Mademoiselle, agissez selon votre conscience… je me soumets à mon destin.
Suzy Nelson le toisa avec une sorte de mépris :
— Écoutez !… reprit-elle. Il m’est impossible de favoriser des bandits, mais vous me faites pitié. Pendant que je vais descendre de ce wagon pour aller chez le commissaire, fuyez !… J’aurai ma conscience en paix et vous garderez votre précieuse liberté si vous échappez aux inspecteurs.
Le jeune homme secoua la tête :
— Non, mademoiselle… je refuse, parce que ma fuite serait un aveu et parce qu’il faut absolument que je rentre à Paris cette nuit.
— Pour quoi faire !?
— C’est toujours le même secret…
— Et toujours la même tactique !… Vraiment, vous pourriez trouver mieux !
Le jeune homme montra deux gendarmes qui se promenaient placidement sur le quai.
— Appelez-les, fit-il non sans noblesse, et tout sera fini pour moi !…
Suzy Nelson n’obéit pas, malgré tout ce qu’elle venait de dire. Un sentiment furieux, inexprimable, la tenait clouée sur place. Elle devait dénoncer cet homme et elle savait qu’elle ne le dénoncerait pas.
Les quelques minutes de l’arrêt parurent durer des siècles. Et le rapide s’ébranla et le jeune homme épongea son front ruisselant de sueur.
— Merci !… dit-il avec une gratitude infinie. Vous venez d’accomplir une bonne action… Merci !…
Mais Suzy Nelson regrettait maintenant sa veulerie.
— Ne me remerciez pas !… s’écria-t-elle. J’ai été lâche, voilà tout… J’ai besoin de réfléchir… je prendrai une décision définitive à Paris…
— Je reste à vos ordres, mademoiselle. Je ne bougerai pas de ce compartiment.
— Une fois à la gare du Nord, rien ne vous empêchera de filer… Moi, il faut à tout prix que je libère ma conscience.
— Vous ferez comme vous l’entendrez, dit-il, mais je refuse cette espèce d’évasion.
— En me taisant, je deviens votre complice !…
— Vous n’êtes pas ma complice, puisque je ne suis pas coupable.
— C’est toujours vous qui l’affirmez !
— Je vous en refais le serment, et jusqu’ici, je ne me suis jamais parjuré…
Ils se turent tous deux, jusqu’à la fin du voyage. Pour ne pas gêner Suzy Nelson, le jeune homme affecta même de ne plus la regarder. Au contraire, elle ne le quittait pas des yeux, cherchant âprement un signe quelconque, une preuve de cette innocence invraisemblable, à laquelle elle voulait pourtant croire…
Bientôt la banlieue aligna à droite et à gauche les points d’or de ses réverbères. Puis la locomotive siffla une dernière fois et le train stoppa. C’était la gare du Nord.
Redevenu entièrement maître de lui, le jeune homme approcha obligeamment de la portière la valise de Suzy Nelson. Elle remarqua alors qu’il ne possédait lui-même aucun bagage. Il avait pris sans doute le train à l’improviste, pour échapper à quelqu’un. Ce fut d’une voix posée qu’il demanda :
— Qu’avez-vous décidé, mademoiselle ?… Voulez-vous me dénoncer, ou bien suis-je libre ?…
Suzy Nelson lui tourna le dos en murmurant :
— Adieu !
Il descendit sans hâte. Suzy Nelson le vit s’éloigner à pas comptés et disparaître dans la foule…
IVSUZY NELSON
Suzy Nelson, debout sur le marchepied, chercha des yeux, la personne qui devait l’attendre. Un homme d’une cinquantaine d’années s’élança vers elle. Il avait l’allure d’un valet de chambre et, en effet, c’en était un.
— Bonsoir, mademoiselle, fit-il, en s’empressant. Mademoiselle a-t-elle fait un bon voyage ?
— Excellent, Jérôme… Et ici, tout va-t-il bien ?…
— Oui, mademoiselle, Madame et Monsieur sont en parfaite santé… Si Mademoiselle veut se donner la peine de me suivre, je vais la conduire à l’auto…
Cinq minutes plus tard, ils roulaient vers l’avenue Henri-Martin.
Seule dans le confortable coupé, le regard vague, Suzy Nelson songeait aux quatre heures qu’elle venait de vivre.
Maintenant, il n’était plus temps de prévenir la police. Si la jeune fille s’y décidait, son retard serait impossible à expliquer et ne manquerait pas de paraître louche aux enquêteurs.
« Mais on découvrira la tache de sang !… pensa soudain Suzy. On découvrira également le corps, qui a sans doute été jeté hors du wagon pendant mon évanouissement… On va faire des recherches, on me retrouvera peut-être ?… Alors, quelle sera ma situation ?… Mais non, il n’y a pas eu de contrôle en route, et personne ne m’a remarquée… je ne risque rien personnellement… Par exemple, je ne sais à quel magnétisme j’ai obéi en ne dénonçant pas cet homme… Il est sûrement coupable !… Par ma faute, un assassin court librement le monde, alors qu’il pourrait être déjà sous les verrous… »
Elle avait beau employer le mot « assassin » et affirmer avec toute sa conviction la culpabilité du voyageur, elle ne parvenait pas à y croire réellement.
Il était tard, les rues n’étaient guère encombrées, aussi l’auto parvint-elle rapidement à destination.
Elle s’arrêta devant un des charmants petits hôtels particuliers qui bordent l’avenue Henri-Martin.
Dans un salon du rez-de-chaussée, une dame à cheveux blancs attendait en lisant.
— Bonsoir, ma tante !… cria joyeusement Suzy, heureuse de se sentir enfin en sécurité.
Sa tante, Mme La Borde, avait une stature majestueuse et un beau visage empreint de sérénité. Elle rendit affectueusement les baisers de la jeune fille.
— Comment, vont vos parents anglais ?
— À merveille !… Ils m’ont tous chargée de leurs compliments.
— La traversée du Channel ne t’a pas fatiguée ?
— Du tout !… la mer était d’un calme plat. Je n’ai pas fait le voyage seule, car Cecil Mortimer venait justement en France. Il m’a accompagnée jusqu’à Calais… Nous avons dîné copieusement…
— Comme dîne toujours ce gourmand !…
— Nous nous sommes tellement attardés que j’ai failli manquer le train… J’ai sauté dans le wagon à la dernière seconde… Où est mon cousin ?…
— Robert avait, ce soir, un dîner d’affaires, expliqua Mme La Borde, il n’a pas pu se dégager, car ton télégramme est arrivé tard.
— J’ai été déçue de ne pas le trouver à la gare comme d’habitude…
— Il était désolé de ne pas y aller… Tu sais qu’il n’y manque jamais.
— Tant pis !… je ne l’embrasserai que dans plusieurs heures. Ce sera sa punition.
— Tu dois être lasse, ma petite Suzy ?
— Un peu, ma tante.
— Monte dans ta chambre, nous causerons plus longuement demain matin.
Sur le seuil, la jeune fille se retourna.
— La soirée chez les Thénard tient-elle toujours ?
— Mais oui, pour demain, dit Mme La Borde.
— On dansera ?
— Jusqu’au jour ! Tu sais bien que chez les Thénard, on aime ça.
— Alors, je vais bien me reposer en prévision des fatigues futures.
La chambre de Suzy, située au premier étagé, était nette et claire comme une chambre de fillette. Suzy l’habitait depuis presque vingt ans, c’est-à-dire depuis la mort de son père, qui avait suivi de près sa mère dans la tombe.
Archibald Nelson, riche commerçant britannique vivant à Paris, avait épousé une demoiselle La Borde. Ils s’adoraient tous deux et rien ne paraissait s’opposer à un bonheur parfait. Mais Marie-Anne La Borde avait succombé en donnant le jour à sa fille, et son mari n’avait pas pu résister à l’immense chagrin qui l’accablait.
Suzy n’avait donc jamais connu son père et sa mère. Elle avait été élevée par une tante, Mme La Borde, belle-sœur de Marie-Anne, et avait reporté sur elle toute l’affection de son jeune cœur.
Mme La Borde était veuve. Le frère de Marie-Anne avait été tué à la guerre. Suzy s’en souvenait comme d’un homme taciturne, toujours assez distant et presque continuellement en voyage.
Robert La Borde, le cousin de Suzy Nelson, s’accordait parfaitement avec elle. Les deux jeunes gens, élevés ensemble, vivaient comme frère et sœur. Robert était un grand et beau jeune homme, intelligent et de caractère franc. Il avait hérité la froideur de son père, mais ce n’était qu’en apparence, car il montrait, en certaines circonstances, l’esprit le plus gai, et il aimait passionnément sa maman et celle qu’il nommait sa sœurette.
Suzy Nelson avait en Angleterre des quantités d’oncles, de tantes, de cousins et de cousines chez qui elle allait, deux ou trois fois par an. Cette fois, elle revenait du baptême d’un délicieux baby, dernier-né de sa cousine Christie, épouse de lord Helvin. Mais elle ne s’était pas attardée à Londres, car les réceptions d’octobre commençaient à Paris.
Suzy et les La Borde, très mondains, reçus partout et recevant beaucoup eux-mêmes, menaient une existence agréable, tout à fait exempte de soucis.
La jeune fille se tourna et se retourna longtemps sur sa couche avant de trouver le sommeil, mais la fatigue eut raison de ses préoccupations et elle finit par s’endormir.
Quand elle s’éveilla, son premier soin fut de demander un journal, qu’elle ouvrit le cœur battant. Elle trouva en première page ce qu’elle cherchait et le lut avidement.
L’article s’exprimait ainsi :
Un crime dans le train de Calais
« Un crime atroce a été commis, cette nuit, dans le rapide nommé « Flèche d’Argent », allant de Calais à Paris.
« À l’arrivée de ce train, l’attention des nettoyeurs de wagons de première classe fut attirée par une large flaque de sang cachée sous une couverture. Questionnée, la surveillante du wagon sanglant déclara qu’aucun bruit n’avait attiré son attention en cours de route et que le voyage s’était effectué dans des conditions normales.
« On se perdait en conjectures sur l’origine de cette flaque de sang, lorsqu’un télégramme d’Amiens vint éclaircir le tragique mystère.
« À une cinquantaine de kilomètres de cette ville, en pleine campagne, dans la direction de Calais, on a découvert le cadavre d’un homme.
« Le malheureux a été tué d’un coup de revolver au-dessous du cœur, puis précipité sur la voie par son ou ses assassins.
« On n’a trouvé dans les poches de la victime ni argent ni papiers. Le vol est donc sûrement le mobile du crime.
« D’actives recherches sont entreprises sous la direction de M. Monniot, chargé de l’enquête. Malheureusement, les indications utiles font défaut pour l’instant. Le ou les complices sont descendus à Amiens ou à Paris, où ils ont passé complètement inaperçus.
« Il y avait quarante et un voyageurs de première classe dans le rapide, dix-sept à destination d’Amiens, vingt-trois à destination de Paris.
« Ce renseignement n’est donné qu’à titre purement indicatif, car le crime peut aussi bien avoir été commis par un voyageur de deuxième ou même de troisième classe. Les wagons étant reliés par des soufflets, rien n’est, en effet, plus facile que de circuler d’un bout à l’autre du train. »
Ce reportage n’apprenait rien de nouveau à Suzy Nelson, sinon qu’elle ne serait sûrement jamais inquiétée, puisque nul n’avait remarqué sa présence. Elle en fut égoïstement satisfaite. Et puis, chose étrange, elle n’était pas mécontente de penser que l’inconnu avait également passé inaperçu.
Robert La Borde attendait sa cousine dans la salle à manger. Après les premières effusions, Suzy remarqua qu’il avait les traits tirés et le visage fatigué.
— Serais-tu souffrant ? demanda-t-elle avec inquiétude.
— Nullement, sœurette.
— Alors, tu t’es couché tard ?
— Ma foi oui, assez tard.
— À quelle heure ?
Robert La Borde se mit à rire :
— Je n’ai pas consulté mon chronomètre, mais je crois bien qu’il commençait à faire jour.
— Tu n’as pas honte ? gronda Suzy. Pourquoi mènes-tu cette vie-là ? Tu te surmènes, tu finiras par tomber malade !
— Tu as raison, sœurette, mais, cette fois, ce n’est pas pour mon plaisir que j’ai passé une nuit blanche…
— C’est peut-être pour le mien !… fit-elle en le menaçant du doigt.
— Ce n’est ni pour le tien, ni pour le mien. J’étais avec de gros clients de Berlin. Ils sont très gentils, mais tu n’imagines pas ce qu’ils peuvent ingurgiter de champagne au cours d’une seule nuit ! Si j’avais bu autant qu’eux, je me serais honteusement grisé et je cuverais encore mon vin à l’heure qu’il est.
— Il ne manquerait plus que ça !
Sur ce, surgit Mme La Borde, un journal à la main.
— Suzy, fit-elle, avec autant d’émotion qu’elle pouvait en extérioriser, sais-tu qu’on a commis un crime dans ton train, cette nuit ?
Suzy jugea inutile d’affecter l’ignorance :
— Oui, ma tante, je viens de le lire.
— C’est abominable !… Quand donc parviendra-t-on à assurer la sécurité des voyageurs ?
— Quand il n’y aura plus d’assassins ! répliqua Robert.
— C’est tout de même terrible ! dit Mme La Borde.
— Montre-moi ça ? demanda Robert.
Suzy Nelson relut l’article par-dessus l’épaule de son cousin.
Soudain, Robert poussa une exclamation de stupeur :
— Oh ! par exemple !… Ça c’est fort !…
— Qu’est-ce qu’il y a encore ? questionna Mme La Borde.
— On a assassiné Middlebourg !
Ce nom n’apprit rien aux deux femmes, car elles l’entendaient prononcer pour la première fois.
— Qui est Middlebourg ? Interrogea Mme La Borde.
— Un homme avec qui j’étais en relations d’affaires depuis quelque temps… Je l’ai encore vu la semaine dernière…
Suzy lut un entrefilet où l’on racontait que M. Karl Middlebourg, de Hanovre, avait été trouvé assommé, le crâne fracturé, dans une chambre du Grand Hôtel de Calais, qu’il habitait seulement depuis la veille. Bien entendu, on lui avait volé tout ce qu’il possédait.
« Un revolver gisait à côté du corps, continuait le journaliste. Une seule balle manquait dans le chargeur ; elle a sans doute été tirée contre l’assassin, qui est peut-être blessé. Cette blessure faciliterait considérablement les recherches de la police.
« Le personnel de l’étage n’a pas entendu la détonation, et par conséquent n’a pu fournir aux enquêteurs aucune indication utile. »
— Pauvre M. Middlebourg ! fit Robert, sincèrement attristé. C’était un si brave homme !…
Suzy Nelson n’entendit guère l’éloge pourtant chaleureux de M. Middlebourg. Elle songeait au mort du wagon, qui venait de Calais et qui portait une toute petite blessure ronde au-dessous du sein gauche… une blessure sûrement produite par une balle de browning…
VUNE BONNE MÈRE
Pour donner à sa fille l’exemple d’une saine et fructueuse activité, Mme Galvado se levait de bonne heure. Elle tournait dans l’appartement jusqu’au moment où Julia partait pour l’école de danse. Et puis, tranquillement, elle se recouchait.
Ce matin-là, elle fut tirée de son sommeil par un coup de sonnette court, mais énergique. La grosse matrone loucha vers la pendule : onze heures. Ce n’était pas encore Julia, qui n’arrivait guère avant onze heures et demie.
« Qui ça peut-il être ?… » grogna Mme Galvado.
Le visiteur, s’impatientant sur le paillasson, sonna deux fois. Il ne se décourageait pas facilement, mieux valait ouvrir.
Pestant contre l’intrus, Mme Galvado endossa son peignoir et, traînant ses savates, alla voir de quoi il s’agissait.
Elle se trouva en présence d’un jeune homme très bien mis, qui se découvrit respectueusement.
— Vous désirez, monsieur ?
— Mlle Julia ?…demanda le jeune homme.
— Je suis sa mère, mais c’est à moi qu’il faut s’adresser pour tout ce qui concerne mon enfant… Qu’est-ce que vous voulez ?
— Je serais heureux d’avoir un entretien avec vous, reprit le visiteur.
— Dans ce cas, entrez !
Pour lui permettre de s’asseoir elle expédia élégamment dans la pièce à côté un paquet de linge sale posé sur le fauteuil. Et fourrageant dans sa chevelure hirsute, elle attendit.
— Madame… commença le jeune homme, je viens de la part de Georges…
— Ah ! fit la mère renfrognée.
Et le jeune homme comprit alors que ce n’était pas une référence de se présenter à Mme Galvado de la part de Georges.
— Madame, reprit-il, vous devez bien penser qu’il a fallu un événement grave pour que je me permette cette démarche. Georges est mort…
Mme Galvado cessa de tirailler ses cheveux et ses yeux brillèrent d’une joie féroce.
— Pas possible ! s’exclama-t-elle.
— Oui, madame, il est mort…
— De quelle maladie ?
Le jeune homme eut une hésitation imperceptible.
— De… de mort presque subite, dit-il.
— Il avait donc une maladie de cœur !
— C’est ça… une maladie de cœur… Mais, avant de mourir, il m’a fait promettre de venir annoncer cette triste nouvelle à Mlle Julia.
— Brave jeune homme ! s’attendrit ironiquement Mme Galvado. Ainsi jusqu’au dernier moment, il a pensé à ma fille !…
— Oui, madame.
— Ça prouve qu’il l’aimait bien…
Le jeune homme continua :
— Georges m’a également prié de vous remettre ceci :
C’était le porte-billets recueilli par l’inconnu du train dans la poche du cadavre. Mme Galvado le happa avec avidité et l’ouvrit.
— Cinq mille francs !… compta-t-elle. C’est gentil de sa part… J’ai toujours dit qu’il avait bon cœur…
Le visiteur dissimulait avec peine l’écœurement et l’indignation qui le gagnaient.
— Cela m’est pénible d’annoncer ce malheur à Mlle Julia, poursuivit-il.
— Qu’à cela ne tienne ! s’écria la mère. Je lui révélerai ça moi-même, avec toutes les précautions qu’il faudra…
Le visiteur n’attendait que cela pour se lever.
— Dans ce cas, madame. Je n’ai plus rien à faire ici…
— Bien sûr ! acquiesça Mme Galvado, impatiente de le voir filer. Je ferai la commission, monsieur… Je suis avant tout une maman… J’en voulais un petit peu au pauvre Georges d’avoir détourné mon enfant du droit chemin, mais devant la mort, je ne songe plus à ma rancune…
Elle le poussait presque dehors. À l’instant où il mettait le pied sur le palier, quelqu’un montait rapidement l’escalier. Le visiteur s’effaça pour laisser passer une jeune fille qui le dévisagea avec curiosité et s’introduisit dans l’appartement.
« C’est sans doute Julia, se dit-il en commençant à descendre. Le pauvre Georges avait bon goût, car elle est délicieuse… Mais je préfère laisser la triste corvée à la mère…