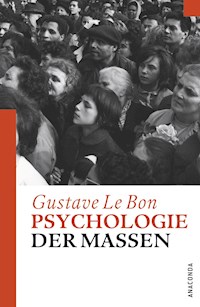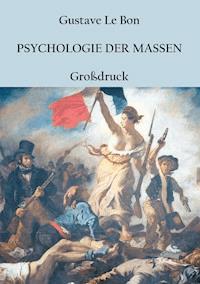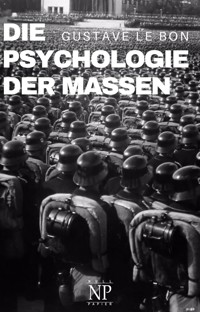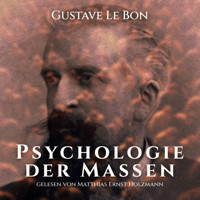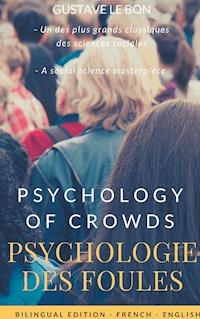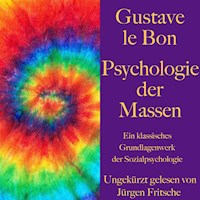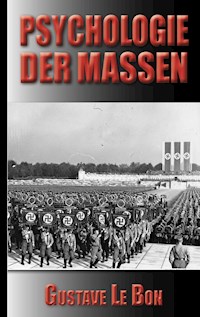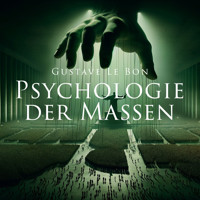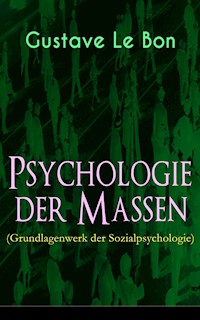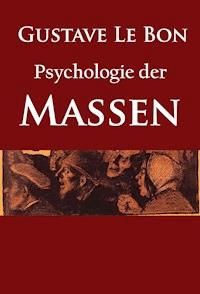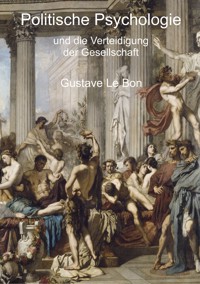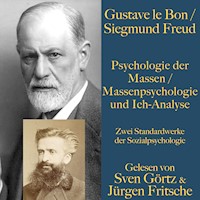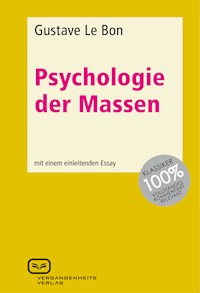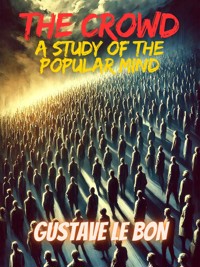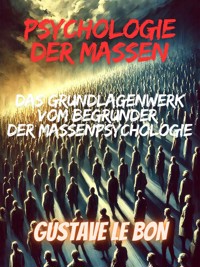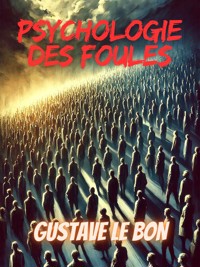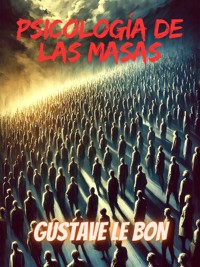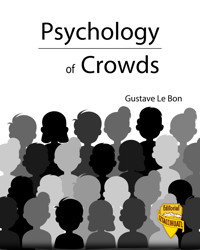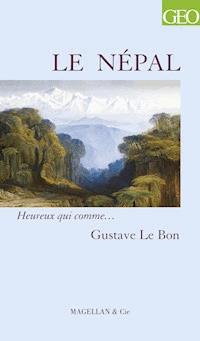
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Heureux qui comme…
- Sprache: Französisch
Laissez-vous happer par les mystères du Népal du XIXe siècle
« Chimiste, physicien, médecin, sociologue, psychologue, philosophe, archéologue, expérimentateur, artiste, voyageur, quel esprit peut-on comparer à Gustave Le Bon ? Il faut remonter jusqu’à Leibniz, jusqu’à Léonard de Vinci, pour retrouver une pareille universalité, une pareille génialité. »
Ainsi parle Raymond Queneau de Gustave Le Bon, qui influença Freud par ses travaux sur la psychologie des foules… Une singulière redécouverte !
Texte intégral publié dans Le Tour du monde en 1886.
Gustave Le Bon dresse le portrait d’un pays et de sa culture avec justesse et humour
EXTRAIT
Après avoir franchi la dernière des chaînes de montagnes, nous nous trouvâmes au-dessus de la vallée où s’élèvent, dans un espace restreint, la capitale et les plus importantes cités du pays. Elle offrait un aspect d’une fertilité incomparable. Les villages dissimulés sous cette végétation exubérante ne se révélaient qu’à notre approche. Avec ses petits temples, ses maisons de bois toutes sculptées, chacun d’eux semblait une réunion de pagodes. Nous entrâmes à Kathmandou avec l’escorte envoyée à notre rencontre par le résident.
A PROPOS DE LA COLLECTION
Heureux qui comme… est une collection phare pour les Editions Magellan, avec 10 000 exemplaires vendus chaque année.
Publiée en partenariat avec le magazine Géo depuis 2004, elle compte aujourd’hui 92 titres disponibles, et pour bon nombre d’entre eux une deuxième, troisième ou quatrième édition.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Gustave Le Bon, né le 7 mai 1841 à Nogent-le-Rotrou et mort le 13 décembre 1931 à Marnes-la-Coquette, est un médecin, anthropologue, psychologue social et sociologue français.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UN ROYAUME À L’ABRI DES GÉANTS DE LA MONTAGNE
Présenté par Marc Wiltz
Quand il publie son récit de voyage au Népal, Gustave Le Bon a déjà quarante-cinq ans, beaucoup de publications médicales et scientifiques derrière lui, une réputation en train de se forger avec ses partisans – et déjà quelques adversaires –, mais son heure n’est pas encore venue.
Pour l’instant, avec ces propos circonstanciés sur la découverte inouïe d’un monde étrange et si riche culturellement, loin de la tranquillité que pourrait en procurer une seule connaissance livresque, Gustave Le Bon se met en danger pour apprécier la grandeur des lieux à leur juste mesure ; et le lecteur d’aujourd’hui ne peut qu’admirer la mise en scène, l’esprit d’aventure et la pertinence des obsevations. C’est un homme curieux, infatigablement curieux, qui se déplace sans perdre son sens de l’humour, en toutes circonstances. Le portrait qu’il dresse du dernier, et cruel, souverain du Népal est plein de malice, en même temps que juste et précis : « Grâce à ces procédés d’exécution sommaire, ce Jung Bahadur, qui fut pendant plus de trente ans le souverain absolu du Népal, mourut de sa mort naturelle il y a quelques années seulement. C’est certainement une des plus curieuses figures de despote asiatique que l’on puisse rêver. D’une intelligence véritablement supérieure, il rendit les plus grands services à son pays. Il connaissait les choses de l’Occident, avait visité Londres et Paris, et introduisit dans son pays de sages réformes. Doué d’une force remarquable, il pouvait faire à cheval cent soixante-cinq kilomètres en seize heures. Il coupait en deux une panthère d’un coup de sabre, et débarrassait lui-même de leur tête, sans phrases inutiles, les seigneurs qui conspiraient contre la sûreté de l’État. Il n’avait plus d’ennemis, les ayant tous exterminés. Les emplois publics importants étaient occupés par des membres de sa famille, suffisamment nombreuse d’ailleurs puisqu’il avait plus de cent fils. »
La narration du voyage de Gustave Le Bon au Népal, où il passe deux ans entre 1884 et 1886, subventionné par le ministère de l’Instruction publique pour étudier les monuments bouddhiques, est empreinte de vivacité et d’énergie joyeuse. Dans des pages très documentées, il retrace par le menu les étapes du parcours, les conditions de vie en montagne dans ce royaume apparemment fermé – et les détails de son histoire –, les visites et la description des monuments les plus remarquables, les mœurs des habitants et la condition féminine a priori assez libre, les hautes et tristes figures d’Anglais – les conquérants – croisés en chemin, et jusqu’aux rapports entretenus avec ses domestiques qu’on peut avoir ici pour vingt francs par mois et dont on ne peut se passer. Parlant de l’un d’eux, il indique : « Le pauvre diable m’aurait d’ailleurs quitté bien avant la fin du voyage s’il avait eu l’idée la plus vague des chemins à parcourir pour retourner dans son pays. Après m’avoir suivi dans un parcours de quatre mille lieues, et avoir consommé toute ma provision de quinine pour combattre les fièvres gagnées dans les jungles, il a fait le vœu à Vishnou de ne plus jamais servir un de ces démons d’Européens. » Avant de conclure sur un autre : « Les Hindous résistent beaucoup moins à leur climat, lorsqu’ils se fatiguent, qu’on ne le croit généralement. Mon premier domestique, obligé de rester avec moi huit à dix heures au soleil chaque jour, par une température oscillant généralement autour de cinquante degrés, pour m’aider à manier mes instruments scientifiques, était mort d’insolation au bout de quinze jours. »
Mais, plus sérieusement, il décrit les ressorts de la société népalaise, le système des castes et les spécificités locales du bouddhisme avec une telle précision et une telle simplicité que son texte est un modèle d’intelligence en action. Pour tous les amateurs du monde indien, dans lequel s’inscrit depuis toujours le Népal, bien à l’abri derrière les fantastiques sommets dépassant les 8 000 mètres d’altitude de la chaîne des Himalayas, ce récit est précieux parce que, somme toute, le contexte géographique et humain n’a guère changé…
À son retour en France, la personnalité riche et complexe de Gustave Le Bon se met en action et attaque l’ascension d’autres hauteurs. Raymond Queneau, qui s’y entendait en la matière le décrit ainsi : « Chimiste, physicien, médecin, sociologue, psychologue, philosophe, archéologue, expérimentateur, artiste, voyageur… Quel esprit peut-on comparer à Gustave Le Bon ? Il faut remonter jusqu’à Leibniz, jusqu’à Léonard de Vinci, pour retrouver une pareille universalité, une pareille génialité. »
Il publie plus de quatre-vingts ouvrages sur tous les sujets : médecine, biologie, anthropologie, éducation, politique, histoire, archéologie, philosophie… jusqu’au vrai et improbable succès de sa Psychologie des foules (1895). Ce livre passionna Freud par des théories qui annonçaient ses propres recherches ; il intéressa vivement les futurs dictateurs du XXe siècle qui y trouvèrent une part de leur inspiration pour le maniement des masses et leur besoin d’un maître dominateur, avec la réussite que l’on sait ; il s’attira aussi le respect des républicains éclairés parmi lesquels Clemenceau, Churchill, Roosevelt ou De Gaulle par ses analyses des ressorts de la société. En 2010, après un long purgatoire, Psychologie des foules a fait partie de la série « Les 20 livres qui ont changé le monde » publiée conjointement par le journal Le Monde et les éditions Flammarion, distinction sans rapport avec le fait que Gustave Le Bon ait, en plus du reste, dirigé longtemps chez cet éditeur la collection qu’il a créée : « Bibliothèque de philosophie contemporaine ».
Quelques esprits délicats ont critiqué cet éminent touche-à-tout, parce qu’il n’était pas vraiment médecin, ni universitaire, ni philosophe, ni chercheur, ni archéologue… ou parce que ses théories se seraient révélées assez faibles à l’usage. Mais d’autres l’ont fréquenté et l’on trouvé d’un commerce intéressant : Émile Guimet, Henri Poincaré, Henri Bergson, Aristide Briand, Camille Saint-Saëns, jusqu’à Albert Einstein qui reconnaît l’apport de ses travaux sur l’énergie atomique.
C’est peut-être d’ailleurs au cours de ses nombreux voyages qui, comme chacun le sait maintenant, aiguisent les sens, qu’il a forgé ses convictions et l’axe de ses recherches. Il le mentionne explicitement dans son récit népalais : « Un des plus utiles profits des voyages est de nous apprendre que les peuples ne choisissent pas les institutions qu’ils veulent, mais subissent fatalement celles que les nécessités de races et de milieux leur imposent. Indépendantes du choix des hommes, elles sont toujours plus puissantes que leur volonté. »
Récit publié dans Le Tour du Monde en 1886.
LE NÉPAL
I
Difficultés d’un voyage au Népal – Négociations préparatoires pour obtenir l’entrée du territoire – Arrivée à Motihari – Réunion des porteurs nécessaires pour franchir l’Himalaya – Beauté du spectacle – Arrivée dans la vallée du Népal – Aspect féerique des temples et des palais – Séjour à Kathmandou – Curiosité des habitants – Leurs idées sur la France – Rencontre de l’Empereur
Les études archéologiques dont j’avais été chargé par le ministère de l’Instruction publique devaient me conduire successivement dans les régions les moins explorées de l’Inde. Parmi les contrées qui tentaient le plus ma curiosité se trouvait le mystérieux Népal. Je savais que cet antique empire, isolé de tous les pays voisins par la formidable barrière que forment autour de lui les géants de l’Himalaya, est situé dans une des régions les plus pittoresques et les plus grandioses du monde ; qu’il possède des villes merveilleuses, dont l’architecture fantastique diffère entièrement de ce que nous connaissons en Occident. Mais je savais aussi qu’on ne peut y parvenir qu’en surmontant des difficultés de toutes sortes, et qu’une consigne rigoureuse, soigneusement respectée par le gouvernement des Indes, interdit absolument à tout Européen, Anglais ou autre, en dehors de l’ambassadeur britannique, de pénétrer sur le territoire de cet empire sans une autorisation spéciale de l’empereur. Or une telle autorisation est très exceptionnellement accordée. Jacquemont dut renoncer jadis à visiter le Népal. Aucun Français n’y avait pénétré encore. L’Allemand Schlagintweit1 n’avait réussi à y entrer, il y a quelques années, qu’après d’interminables pourparlers diplomatiques et en mettant en œuvre les plus puissantes influences. Ces difficultés diverses ne faisaient naturellement qu’accroître mon désir de visiter cette curieuse contrée.
Il serait sans intérêt pour le lecteur de raconter comment elles furent successivement aplanies en ma faveur après les démarches de divers personnages qui voulurent bien s’intéresser à mon entreprise. Je suis heureux de dire que le gouvernement du viceroi me prêta, ainsi d’ailleurs qu’il l’a fait en toutes circonstances pendant mon séjour aux Indes, le plus gracieux concours, et se chargea de toutes les négociations nécessaires avec la cour du Népal.
La dernière ville anglaise de l’Inde voisine de la frontière du Népal est Motihari, au nord de l’Inde ; j’y étais arrivé, venant de Patna. C’est là que je devais faire mes préparatifs de voyage et réunir les quarante porteurs nécessaires pour transporter, à travers l’Himalaya, les provisions et les bagages indispensables.
Motihari est une petite ville habitée surtout par de riches planteurs d’indigo. Je reçus chez l’un d’eux, M. Edwards, que le hasard m’avait fait rencontrer, cette large hospitalité que les Anglais des classes supérieures pratiquent si libéralement aux Indes.
Les Européens qui n’ont visité que les grandes villes de l’Inde, Bombay, Delhi, Calcutta, etc., situées sur de grandes lignes de chemins de fer, ne soupçonnent pas les difficultés d’un voyage d’exploration dans l’Hindousthan. Les monuments importants sont situés pour la plupart dans des jungles désertes infestées de bêtes féroces et où l’on ne trouve aucun moyen d’existence. Il faut tout emporter avec soi, depuis la farine qui sert à faire le pain jusqu’aux objets de campement. Or, pour transporter ce matériel, il n’existe aucun moyen en dehors des éléphants ou des chevaux que les princes indigènes ou les gouverneurs de province peuvent seuls mettre à votre disposition. Le voyageur, livré à ses seules ressources, ne peut s’écarter des grandes routes ou des chemins de fer. C’est en partie pour cette raison que les anciens monuments de l’Inde, qui valent pourtant nos plus merveilleuses productions de l’art gothique, sont si peu visités par les Européens qui résident dans la contrée. Les monuments d’Ajunta et de Khajurao, pour ne parler que des plus célèbres, ne reçoivent guère plus d’un visiteur par an. Oudeypour2, une des plus curieuses capitales des royaumes indiens, reçoit la visite d’un Européen à peu près tous les trois ans.
En l’absence du magistrat anglais de Motihari, je ne pus réunir comme porteurs qu’une quarantaine d’affreux gredins. Je n’aurais pas voulu rencontrer assurément au coin d’un bois en Europe aucun des individus dont la nécessité m’obligeait de faire mes seuls compagnons de voyage pendant plusieurs jours et plusieurs nuits dans les solitudes de l’Himalaya. Ma longue expérience des voyages m’ayant appris que le fatalisme est la plus sage des philosophies, j’acceptai, faute de mieux, cette suite désagréable.
C’est au commencement de janvier 1885 que je quittai Motihari. De cette ville à Kathmandou, on compte environ cent soixante-trois kilomètres, dont le plus grand nombre à travers les chaînes avancées de l’Himalaya qui bordent au sud la vallée du Népal. Le voyage se fait en partie en palanquin, en partie dans une sorte de hamac nommé dandy, porté par quatre hommes qui peuvent au besoin se ranger à la file dans les sentiers étroits. Le nombre de porteurs nécessaire pour tout le voyage et les provisions indispensables, car on ne peut rien se procurer en route, est d’une quarantaine. Ils trottent constamment et se relaient, sans ralentir leur marche, environ toutes les cinq minutes.
La région la plus dangereuse à franchir, à cause des miasmes mortels dont elle est remplie, est l’épaisse forêt marécageuse nommée Téraï, située au pied de l’Himalaya. Lorsqu’on la traverse la nuit, on allume de nombreuses torches pour éloigner les bêtes féroces qui y pullulent comme des lapins. La forêt commence près du village de Semelbasa. Sous le prétexte d’aller acheter des torches, mes porteurs m’y abandonnèrent toute une nuit, dans l’espoir que les tigres et les panthères mangeraient le voyageur, mais épargneraient les sacs de roupies dont il était muni. Une collection de bougies, tirée du panier de provisions qui ne me quittait jamais, me préserva des bêtes féroces. Une divinité bienfaisante, Vishnou sans doute, me préserva des miasmes que je redoutais beaucoup plus que les tigres. Il fallut passer la nuit à travailler sur le palanquin, transformé en pupitre, pour ne pas laisser les bougies s’éteindre ; et quand, le matin, la bande de mes aimables compagnons revint pour voir s’il restait encore quelques fragments de l’Européen, un discours bref, mais énergique, leur fit comprendre que le revolver est un instrument créé spécialement par Siva pour casser les têtes des porteurs récalcitrants dans l’Himalaya.
Les deux passes de l’Himalaya qu’on doit franchir pour descendre dans la vallée du Népal, celles de Sisaghiri et Chandragiri, sont extrêmement difficiles. Il faut passer plusieurs fois sur des sentiers larges de quelques centimètres, taillés sur les flancs de la montagne et dominant un abîme au fond duquel on entend mugir un torrent. La vue splendide qu’on a de ces hauteurs défie toute description. Les cimes nuageuses de l’Himalaya, que domine la masse géante du Gaurisankar, forment autour de vous une couronne de neige, tandis qu’à vos pieds s’étendent des forêts et des vallées verdoyantes. Auprès d’un tel spectacle, les plus beaux sites de la Suisse ou ces régions grandioses des monts Tatras que j’ai eu autrefois l’occasion de décrire, ne me semblaient plus qu’un pâle décor.
Les fatigues et les ennuis du voyage avaient été largement compensés par la beauté de l’Himalaya. Ils le furent bien plus encore par le spectacle que devaient m’offrir les villes du Népal, Kathmandou, Patan, Bhatgaon, Pashpati, etc.
Après avoir franchi la dernière des chaînes de montagnes, nous nous trouvâmes au-dessus de la vallée où s’élèvent, dans un espace restreint, la capitale et les plus importantes cités du pays. Elle offrait un aspect d’une fertilité incomparable. Les pentes que nous descendions, en traversant, par endroits, des cours d’eau rapides, étaient couvertes des plus beaux arbres ; les villages dissimulés sous cette végétation exubérante ne se révélaient qu’à notre approche. Avec ses petits temples, ses maisons de bois toutes sculptées, chacun d’eux semblait une réunion de pagodes.
Nous entrâmes à Kathmandou avec l’escorte envoyée à notre rencontre par le résident. Une foule nombreuse s’était massée dans les rues pour assister à notre arrivée, qui était annoncée depuis longtemps. Je pus juger quel événement c’était dans le pays, et aussi me rendre compte dès l’abord de l’âpre et gênante curiosité qui distingue les Népalais. Désirant nous rendre à la résidence, il nous fallut traverser toute la ville. Notre escorte faisait de son mieux pour écarter les spectateurs qui nous pressaient de tous côtés, mais elle y perdait sa peine et ses coups de bâton.
Mes rapports avec l’ambassadeur anglais, un peu tendus d’abord, dans la correspondance que nous avions échangée avant d’entreprendre le voyage, furent courtois. Ceux que j’eus avec l’excellent docteur Gimlette, chirurgien de l’ambassade, furent des plus amicaux. Ce savant confrère a été ma providence pendant mon séjour à Kathmandou. Il m’a comblé de prévenances de toutes sortes, et je suis heureux de pouvoir l’en remercier ici. C’est à lui que je dois en outre d’avoir pu vérifier et compléter les informations variées que j’ai recueillies, suivant une méthode particulière d’étude que j’emploie dans tous mes voyages, auprès des habitants des nombreux villages que j’ai eu occasion de visiter et de tous les individus avec lesquels j’ai pu me trouver en rapport. J’ai pu également rectifier grâce à lui les renseignements contenus dans les ouvrages publiés sur le Népal par plusieurs des ministres qui ont séjourné à Kathmandou, renseignements vrais à une certaine époque, mais qui ne le sont plus aujourd’hui.
Je m’étais installé sous une tente, à quelque distance de la ville, en pleine campagne. L’installation pouvait passer pour convenable, et je m’y serais trouvé assez bien, n’eussent été la froideur des nuits et les visites trop fréquentes des chacals qui venaient dévorer nos provisions. Je vivais surtout des aliments que mon domestique parvenait à se procurer, malgré la répugnance des Népalais à vendre quoi que ce soit à un Européen. De temps à autre, l’ambassadeur anglais, et surtout le docteur Gimlette, m’envoyaient quelques vivres.