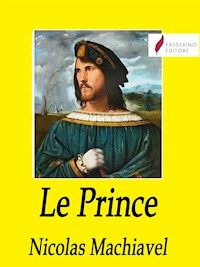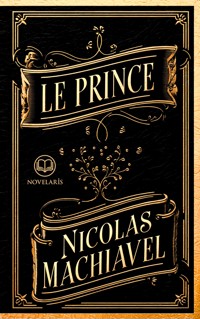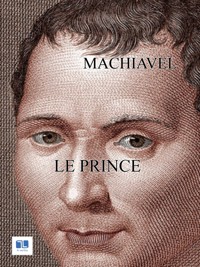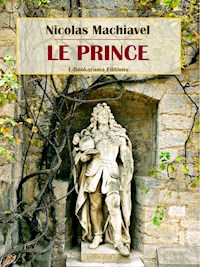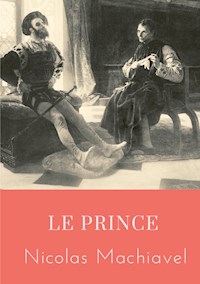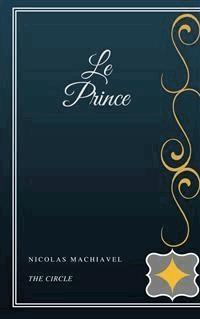C'est
dans une principauté nouvelle que toutes les difficultés se
rencontrent.
D'abord, si elle n'est pas
entièrement nouvelle, mais ajoutée comme un membre à une autre, en
sorte qu'elles forment ensemble un corps qu'on peut appeler mixte,
il y a une première source de changement dans une difficulté
naturelle inhérente à toutes les principautés nouvelles : c'est que
les hommes aiment à changer de maître dans l'espoir d'améliorer
leur sort ; que cette espérance leur met les armes à la main contre
le gouvernement actuel ; mais qu'ensuite l'expérience leur fait
voir qu'ils se sont trompés et qu'ils n'ont fait qu'empirer leur
situation : conséquence inévitable d'une autre nécessité naturelle
où se trouve ordinairement le nouveau prince d'accabler ses sujets,
et par l'entretien de ses armées, et par une infinité d'autres
charges qu'entraînent à leur suite les nouvelles conquêtes.
La position de ce prince est
telle que, d'une part, il a pour ennemis tous ceux dont il a blessé
les intérêts en s'emparant de cette principauté ; et que, de
l'autre, il ne peut conserver l'amitié et la fidélité de ceux qui
lui en ont facilité l'entrée, soit par l'impuissance où il se
trouve de les satisfaire autant qu'ils se l'étaient promis, soit
parce qu'il ne lui convient pas d'employer contre eux ces remèdes
héroïques dont la reconnaissance le force de s'abstenir ; car,
quelque puissance qu'un prince ait par ses armées, il a toujours
besoin, pour entrer dans un pays, d'être aidé par la faveur des
habitants.
Voilà pourquoi Louis XII, roi de
France, se rendit maître en un instant du Milanais, qu'il perdit de
même, et que d'abord les seules forces de Lodovico Sforza suffirent
pour le lui arracher. En effet, les habitants qui lui avaient
ouvert les portes, se voyant trompés dans leur espoir, et frustrés
des avantages qu'ils avaient attendus, ne purent supporter les
dégoûts d'une nouvelle domination.
Il est bien vrai que lorsqu'on
reconquiert des pays qui se sont ainsi rebellés, on les perd plus
difficilement : le conquérant, se prévalant de cette rébellion,
procède avec moins de mesure dans les moyens d'assurer sa conquête,
soit en punissant les coupables, soit en recherchant les suspects,
soit en fortifiant toutes les parties faibles de ses États.
Voilà pourquoi aussi il suffit,
pour enlever une première fois Milan à la France, d'un duc Lodovico
excitant quelques rumeurs sur les confins de cette province. Il
fallut, pour la lui faire perdre une seconde, que tout le monde se
réunit contre elle, que ses armées fussent entièrement dispersées,
et qu'on les chassât de l'Italie ; ce qui ne put avoir lieu que par
les causes que j'ai développées précédemment : néanmoins, il perdit
cette province et la première et la seconde fois.
Du reste, c'est assez pour la
première expulsion d'en avoir indiqué les causes générales ; mais,
quant à la seconde, il est bon de s'y arrêter un peu plus, et
d'examiner les moyens que Louis XII pouvait employer, et dont tout
autre prince pourrait se servir en pareille circonstance, pour se
maintenir un peu mieux dans ses nouvelles conquêtes que ne fit le
roi de France.
Je dis donc que les États conquis
pour être réunis à ceux qui appartiennent depuis longtemps au
conquérant, sont ou ne sont pas dans la même contrée que ces
derniers, et qu'ils ont ou n'ont pas la même langue.
Dans le premier cas, il est
facile de les conserver, surtout lorsqu'ils ne sont point
accoutumés à vivre libres : pour les posséder en sûreté, il suffit
d'avoir éteint la race du prince qui était le maître ; et si, dans
tout le reste, on leur laisse leur ancienne manière d'être, comme
les mœurs y sont les mêmes, les sujets vivent bientôt
tranquillement. C'est ainsi que la Bretagne, la Bourgogne, la
Gascogne et la Normandie, sont restées unies à la France depuis
tant d'années ; et quand même il y aurait quelques différences dans
le langage, comme les habitudes et les mœurs se ressemblent, ces
États réunis pourront aisément s'accorder. Il faut seulement que
celui qui s'en rend possesseur soit attentif à deux choses, s'il
veut les conserver : l'une est, comme je viens de le dire,
d'éteindre la race de l'ancien prince ; l'autre, de n'altérer ni
les lois ni le mode des impositions : de cette manière, l'ancienne
principauté et la nouvelle ne seront, en bien peu de temps, qu'un
seul corps.
Mais, dans le second cas,
c'est-à-dire quand les États acquis sont dans une autre contrée que
celui auquel on les réunit, quand ils n'ont ni la même langue, ni
les mêmes mœurs, ni les mêmes institutions, alors les difficultés
sont excessives, et il faut un grand bonheur et une grande habileté
pour les conserver. Un des moyens les meilleurs et les plus
efficaces serait que le vainqueur vint y fixer sa demeure
personnelle : rien n'en rendrait la possession plus sûre et plus
durable. C'est aussi le parti qu'a pris le Turc à l'égard de la
Grèce, que certainement, malgré toutes ses autres mesures, il
n'aurait jamais pu conserver s'il ne s'était déterminé à venir
l'habiter.
Quand il habite le pays, le
nouveau prince voit les désordres à leur naissance, et peut les
réprimer sur-le-champ. S'il en est éloigné, il ne les connaît que
lorsqu'ils sont déjà grands, et qu'il ne lui est plus possible d'y
remédier.
D'ailleurs, sa présence empêche
ses officiers de dévorer la province ; et, en tout cas, c'est une
satisfaction pour les habitants d'avoir pour ainsi dire sous la
main leur recours au prince lui-même. Ils ont aussi plus de
raisons, soit de l'aimer, s'ils veulent être de bons et fidèles
sujets, soit de le craindre, s'ils veulent être mauvais. Enfin,
l'étranger qui voudrait assaillir cet État s'y hasarde bien moins
aisément ; d'autant que le prince y résidant, il est très difficile
de le lui enlever.
Le meilleur moyen qui se présente
ensuite est d'établir des colonies dans un ou deux endroits qui
soient comme les clefs du pays : sans cela, on est obligé d'y
entretenir un grand nombre de gens d'armes et d'infanterie.
L'établissement des colonies est peu dispendieux pour le prince ;
il peut, sans frais ou du moins presque sans dépense, les envoyer
et les entretenir ; il ne blesse que ceux auxquels il enlève leurs
champs et leurs maisons pour les donner aux nouveaux habitants. Or
les hommes ainsi offensés n'étant qu'une très faible partie de la
population, et demeurant dispersés et pauvres, ne peuvent jamais
devenir nuisibles ; tandis que tous ceux que sa rigueur n'a pas
atteints demeurent tranquilles par cette seule raison ; ils n'osent
d'ailleurs se mal conduire, dans la crainte qu'il ne leur arrive
aussi d'être dépouillés. En un mot, ces colonies, si peu coûteuses,
sont plus fidèles et moins à charge aux sujets ; et, comme je l'ai
dit précédemment, ceux qui en souffrent étant pauvres et dispersés,
sont incapables de nuire. Sur quoi il faut remarquer que les hommes
doivent être ou caressés ou écrasés : ils se vengent des injures
légères ; ils ne le peuvent quand elles sont très grandes ; d'où il
suit que, quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de
telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance.
Mais si, au lieu d'envoyer des
colonies, on se détermine à entretenir des troupes, la dépense qui
en résulte s'accroît sans bornes, et tous les revenus de l'État
sont consommés pour le garder. Aussi l'acquisition devient une
véritable perte, qui blesse d'autant plus que les habitants se
trouvent plus lésés ; car ils ont tous à souffrir, ainsi que
l'État, et des logements et des déplacements des troupes. Or,
chacun se trouvant exposé à cette charge, tous deviennent ennemis
du prince, et ennemis capables de nuire, puisqu'ils demeurent
injuriés dans leurs foyers. Une telle garde est donc de toute
manière aussi inutile que celle des colonies serait
profitable.
Mais ce n'est pas tout. Quand
l'État conquis se trouve dans une autre contrée que l'État
héréditaire du conquérant, il est beaucoup d'autres soins que
celui-ci ne saurait négliger : il doit se faire chef et protecteur
des princes voisins les moins puissants de la contrée, travailler à
affaiblir ceux d'entre eux qui sont les Plus forts, et empêcher
que, sous un prétexte quelconque, un étranger aussi puissant que
lui ne s'y introduise ; introduction qui sera certainement
favorisée ; car cet étranger ne peut manquer d'être appelé par tous
ceux que l'ambition ou la crainte rend mécontents. C'est ainsi, en
effet, que les Romains furent introduits dans la Grèce par les
Étoliens, et que l'entrée de tous les autres pays où ils
pénétrèrent leur fut ouverte par les habitants.
À cet égard, voici quelle est la
marche des choses : aussitôt qu'un étranger puissant est entré dans
une contrée, tous les princes moins puissants qui s'y trouvent
s'attachent à lui et favorisent son entreprise, excités par l'envie
qu'ils nourrissent contre ceux dont la puissance était supérieure à
la leur. Il n'a donc point de peine à gagner ces princes moins
puissants, qui tous se hâtent de ne faire qu'une seule masse avec
l'État qu'il vient de conquérir. Il doit seulement veiller à ce
qu'ils ne prennent trop de force ou trop d'autorité : avec leur
aide et ses propres moyens, il viendra sans peine à bout d'abaisser
les plus puissants, et de se rendre seul arbitre de la contrée.
S'il néglige, en ces circonstances, de se bien conduire, il perdra
bientôt le fruit de sa conquête ; et tant qu'il le gardera, il y
éprouvera toute espèce de difficultés et de dégoûts.
Les Romains, dans les pays dont
ils se rendirent les maîtres, ne négligèrent jamais rien de ce
qu'il y avait à faire. Ils y envoyaient des colonies, ils y
protégeaient les plus faibles, sans toutefois accroître leur
puissance ; ils y abaissaient les grands ; ils ne souffraient pas
que des étrangers puissants y acquissent le moindre crédit. Je n'en
veux pour preuve qu'un seul exemple. Qu'on voie ce qu'ils firent
dans la Grèce : ils y soutinrent les Achéens et les Étoliens ; ils
y abaissèrent le royaume de Macédoine, ils en chassèrent Antiochus
; mais quelques services qu'ils eussent reçus des Achéens et des
Étoliens, ils ne permirent pas que ces deux peuples accrussent
leurs États ; toutes les sollicitations de Philippe ne purent
obtenir d'eux qu'ils fussent ses amis, sans qu'il y perdît quelque
chose, et toute la puissance d'Antiochus ne put jamais les faire
consentir à ce qu'il possédât le moindre État dans ces
contrées.
Les Romains, en ces
circonstances, agirent comme doivent le faire des princes sages,
dont le devoir est de penser non seulement aux désordres présents,
mais encore à ceux qui peuvent survenir, afin d'y remédier par tous
les moyens que peut leur indiquer la prudence. C'est, en effet, en
les prévoyant de loin, qu'il est bien plus facile d'y porter remède
; au lieu que si on les a laissés s'élever, il n'en est plus temps,
et le mal devient incurable. Il en est alors comme de l'étisie,
dont les médecins disent que, dans le principe, c'est une maladie
facile à guérir, mais difficile à connaître, et qui, lorsqu'elle a
fait des progrès, devient facile à connaître, mais difficile à
guérir. C'est ce qui arrive dans toutes les affaires d'État :
lorsqu'on prévoit le mal de loin, ce qui n'est donné qu'aux hommes
doués d'une grande sagacité, on le guérit bientôt ; mais lorsque,
par défaut de lumière, on n'a su le voir que lorsqu'il frappe tous
les yeux, la cure se trouve impossible. Aussi les Romains, qui
savaient prévoir de loin tous les inconvénients, y remédièrent
toujours à temps, et ne les laissèrent jamais suivre leur cours
pour éviter une guerre : ils savaient bien qu'on ne l'évite jamais,
et que, si on la diffère, c'est à l'avantage de l'ennemi. C'est
ainsi que, quoiqu'ils pussent alors s'en abstenir, ils voulurent la
faire à Philippe et à Antiochus, au sein de la Grèce même, pour ne
pas avoir à la soutenir contre eux en Italie. Ils ne goûtèrent
jamais ces paroles que l'on entend sans cesse sortir de la bouche
des sages de nos jours : Jouis du bénéfice du temps ; ils
préférèrent celui de la valeur et de la prudence ; car le temps
chasse également toute chose devant lui, et il apporte à sa suite
le bien comme le mal, le mal comme le bien.
Mais revenons à la France, et
examinons si elle a fait aucune des choses que je viens d'exposer.
Je parlerai seulement du roi Louis XII, et non de Charles VIII,
parce que le premier ayant plus longtemps gardé ses conquêtes en
Italie, on a pu mieux connaître ses manières de procéder. Or on a
dû voir qu'il fit tout le contraire de ce qu'il faut pour conserver
un État tout différent de celui auquel on a dessein de
l'ajouter.
Le roi Louis XII fut introduit en
Italie par l'ambition des Vénitiens, qui voulaient, par sa venue,
acquérir la moitié du duché de Lombardie. Je ne prétends point
blâmer le parti qu'embrassa le roi : puisqu'il voulait commencer à
mettre un pied en Italie, où il ne possédait aucun ami, et dont la
conduite de Charles VIII lui avait même fermé toutes les portes, il
était forcé d'embrasser les premières amitiés qu'il put trouver ;
et le parti qu'il prit pouvait même être heureux, si d'ailleurs,
dans le surplus de ses expéditions, il n'eût commis aucune autre
erreur. Ainsi, après avoir conquis la Lombardie, il regagna bientôt
la réputation que Charles lui avait fait perdre : Gênes se soumit ;
les Florentins devinrent ses alliés ; le marquis de Mantoue, le duc
de Ferrare, les Bentivogli, la dame de Forli, les seigneurs de
Faenza, de Pesaro, de Rimini, de Camerino, de Piombino, les
Lucquois, les Pisans, les Siennois, tous coururent au-devant de son
amitié. Aussi les Vénitiens durent-ils reconnaître quelle avait été
leur imprudence lorsque, pour acquérir deux villes dans la
Lombardie, ils avaient rendu le roi de France souverain des deux
tiers de l'Italie.
Dans de telles circonstances, il
eût été sans doute facile à Louis XII de conserver dans cette
contrée tout son ascendant, s'il eût su mettre en pratique les
règles de conduite exposées ci-dessus ; s'il avait protégé et
défendu ces nombreux amis, qui, faibles et tremblant les uns devant
l'Église, les autres devant les Vénitiens, étaient obligés de lui
rester fidèles, et au moyen desquels il pouvait aisément s'assurer
de tous ceux auxquels il restait encore quelque puissance.
Mais il était à peine arrivé dans
Milan, qu'il fit tout le contraire, en aidant le pape Alexandre VI
à s'emparer de la Romagne. Il ne comprit pas qu'il s'affaiblissait
lui-même, en se privant des amis qui s'étaient jetés dans ses bras,
et qu'il agrandissait l'Église, en ajoutant au pouvoir spirituel,
qui lui donne déjà tant d'autorité, un pouvoir temporel aussi
considérable.
Cette première erreur en entraîna
tant d'autres qu'il fallut que le roi vînt lui-même en Italie pour
mettre une borne à l'ambition d'Alexandre, et l'empêcher de se
rendre maître de la Toscane.
Ce ne fut pas tout. Non content
d'avoir ainsi agrandi l'Église, et de s'être privé de ses amis,
Louis, brûlant de posséder le royaume de Naples, se détermine à le
partager avec le roi d'Espagne : de sorte que, tandis qu'il était
seul arbitre de l'Italie, il y introduisit lui-même un rival auquel
purent recourir tous les ambitieux et tous les mécontents ; et
lorsqu'il pouvait laisser sur le trône un roi qui s'estimait
heureux d'être son tributaire, il l'en renversa pour y placer un
prince qui était en état de l'en chasser lui-même.
Le désir d'acquérir est sans
doute une chose ordinaire et naturelle ; et quiconque s'y livre,
quand il en a les moyens, en est plutôt loué que blâmé : mais en
former le dessein sans pouvoir l'exécuter, c'est encourir le blâme
et commettre une erreur. Si donc la France avait des forces
suffisantes pour attaquer le royaume de Naples, elle devait le
faire ; si elle ne les avait pas, elle ne devait point le
partager.
Si le partage de la Lombardie
avec les Vénitiens pouvait être excusé, c'est parce qu'il donna à
la France le moyen de mettre le pied en Italie ; mais celui du
royaume de Naples, n'ayant pas été pareillement déterminé par la
nécessité, demeure sans excuse. Ainsi Louis XII avait fait cinq
fautes en Italie : il y avait ruiné les faibles, il y avait
augmenté la puissance d'un puissant, il y avait introduit un prince
étranger très puissant, il n'était point venu y demeurer, et n'y
avait pas envoyé des colonies.
Cependant, tant qu'il vécut, ces
cinq fautes auraient pu ne pas lui devenir funestes, s'il n'en eût
commis une sixième, celle de vouloir dépouiller les Vénitiens de
leurs États. En effet, il eût été bon et nécessaire de les
affaiblir, si d'ailleurs il n'avait pas agrandi l'Église et appelé
l'Espagne en Italie ; mais ayant fait l'un et l'autre, il ne devait
jamais consentir à leur ruine, parce que, tant qu'ils seraient
restés puissants, ils auraient empêché les ennemis du roi
d'attaquer la Lombardie. En effet, d'une part, ils n'y auraient
consenti qu'à condition de devenir les maîtres de ce pays ; de
l'autre, personne n'aurait voulu l'enlever à la France pour le leur
donner ; et enfin il eût paru trop dangereux d'attaquer les
Français et les Vénitiens réunis.
Si l'on me disait que Louis
n'avait abandonné la Romagne au pape Alexandre, et partagé le
royaume de Naples avec l'Espagne, que pour éviter la guerre, je
répondrais ce que j'ai déjà dit, qu'il ne faut jamais, pour un
pareil motif, laisser subsister un désordre ; car on n'évite point
la guerre, on ne fait que la retarder à son propre
désavantage.
Si l'on alléguait encore la
promesse que le roi avait faite au pape de conquérir cette province
pour lui, afin d'en obtenir la dissolution de son mariage et le
chapeau de cardinal pour l'archevêque de Rouen (appelé ensuite le
cardinal d'Amboise), je répondrais par ce qui sera dit dans la
suite, touchant les promesses des princes, et la manière dont ils
doivent les garder.
Louis XII a donc perdu la
Lombardie pour ne s'être conformé à aucune des règles que suivent
tous ceux qui, ayant acquis un État, veulent le conserver. Il n'y a
là aucun miracle ; c'est une chose toute simple et toute
naturelle.
Je me trouvais à Nantes à
l'époque où le Valentinois (c'est ainsi qu'on appelait alors César
Borgia, fils du pape Alexandre VI) se rendait maître de la Romagne
; le cardinal d'Amboise, avec lequel je m'entretenais de cet
événement, m'ayant dit que les Italiens ne comprenaient rien aux
affaires de guerre, je lui répondis que les Français n'entendaient
rien aux affaires d'État, parce que, s'ils y avaient compris
quelque chose, ils n'auraient pas laissé l'Église s'agrandir à ce
point. L'expérience, en effet, a fait voir que la grandeur de
l'Église et celle de l'Espagne en Italie ont été l'ouvrage de la
France, et ensuite la cause de sa ruine dans cette contrée. De là
aussi on peut tirer cette règle générale qui trompe rarement, si
même elle trompe jamais : c'est que le prince qui en rend un autre
puissant travaille à sa propre ruine ; car cette puissance est
produite ou par l'adresse ou par la force : or l'une et l'autre de
ces deux causes rendent quiconque les emploie suspect à celui pour
qui elles sont employées.