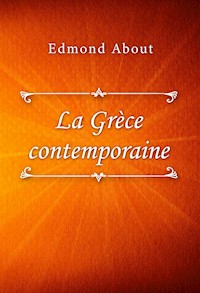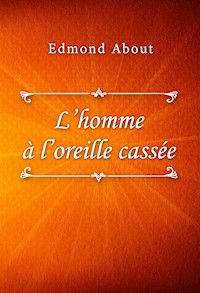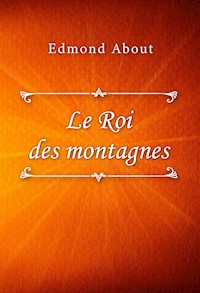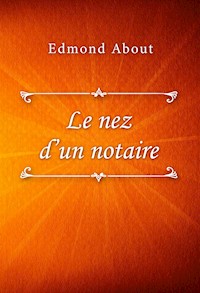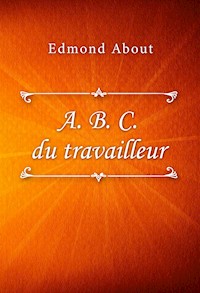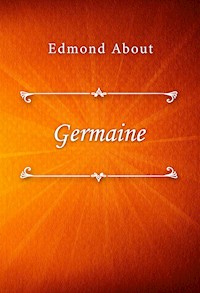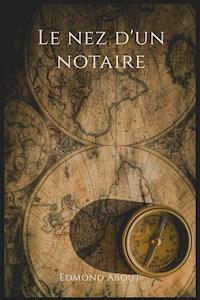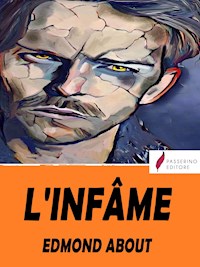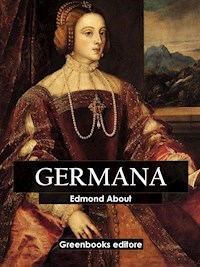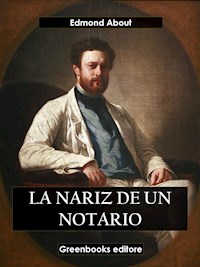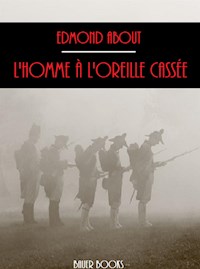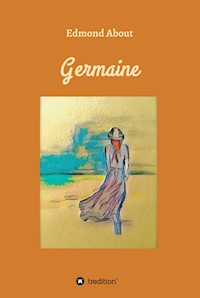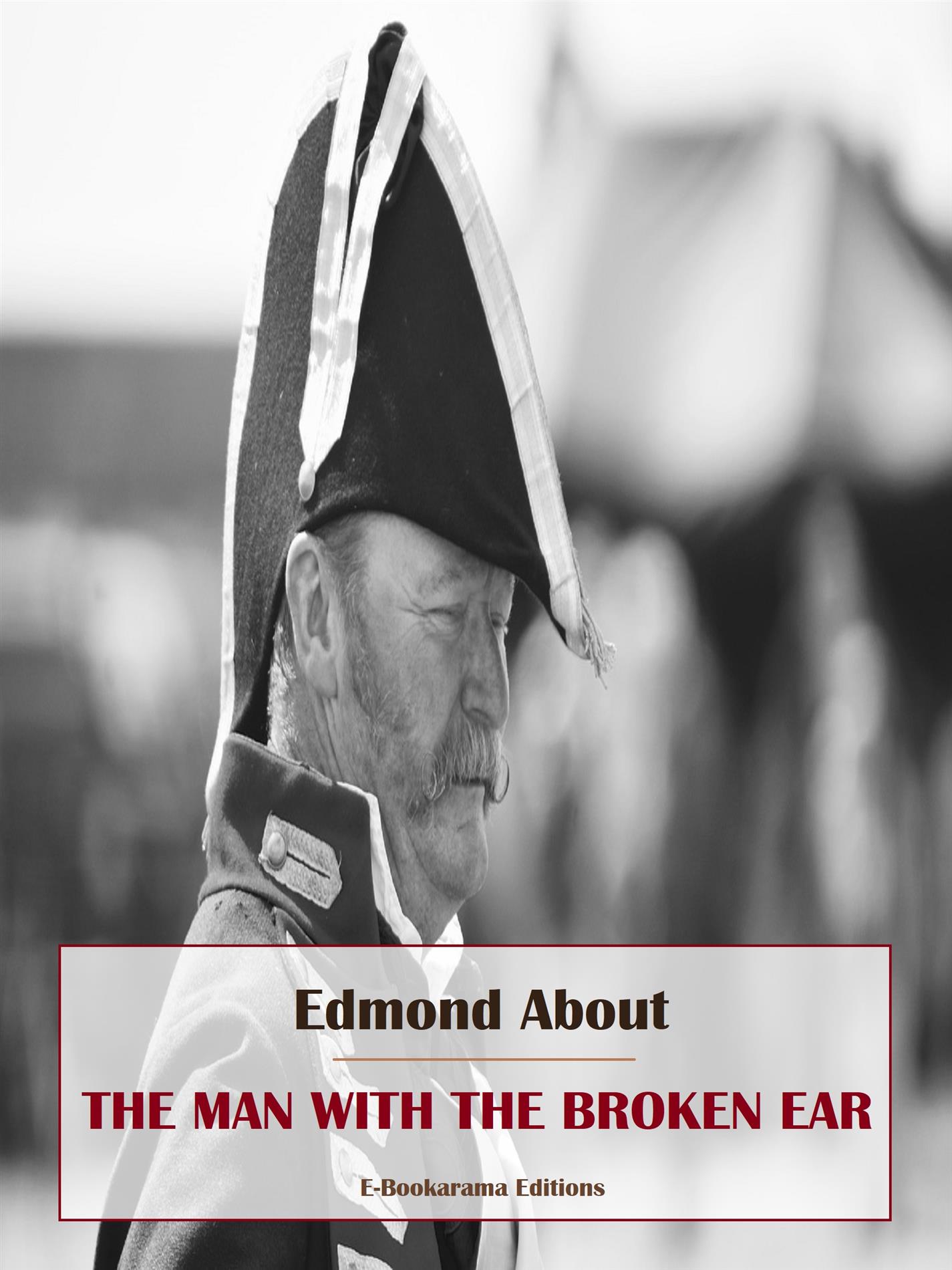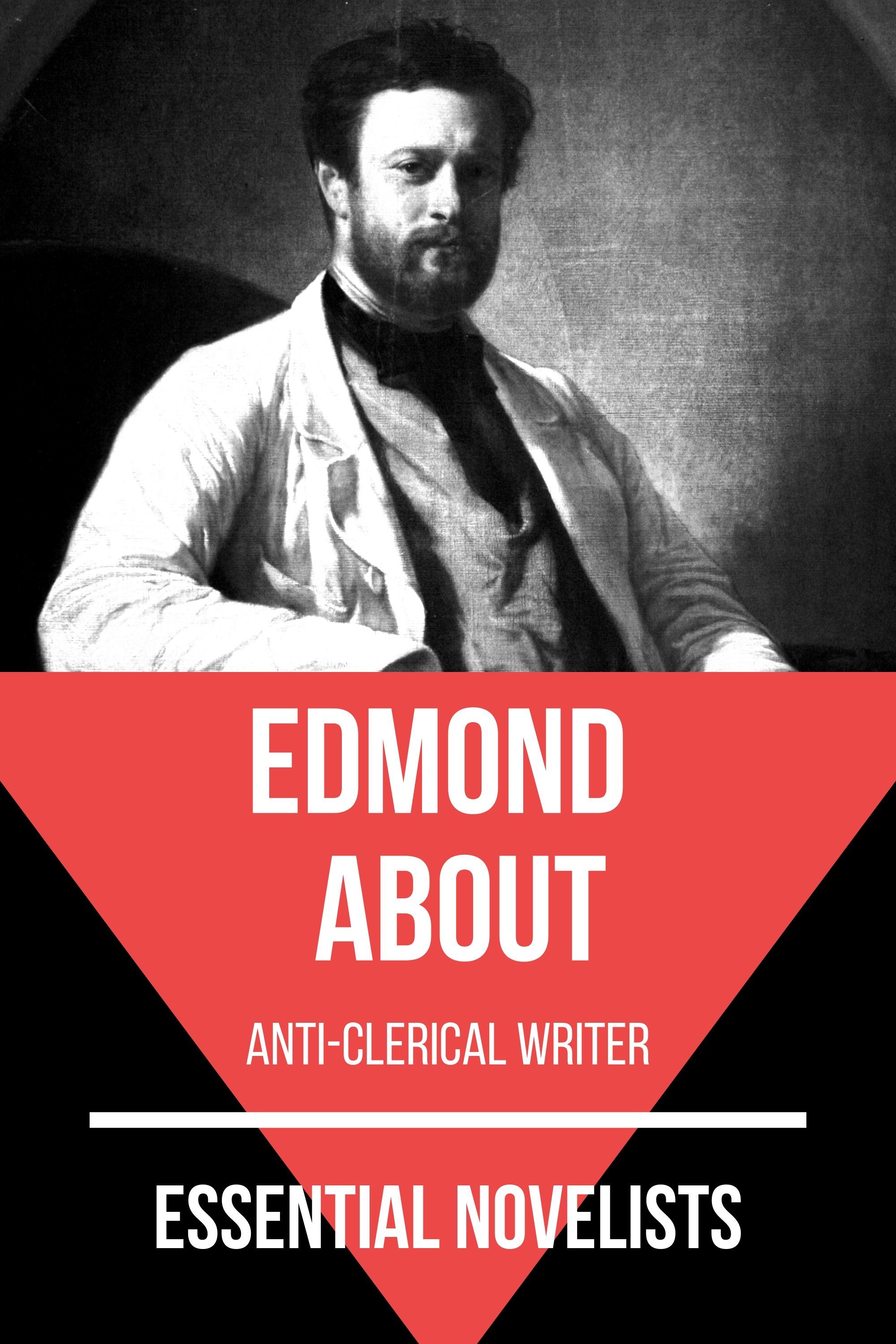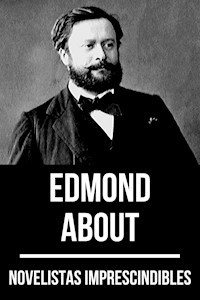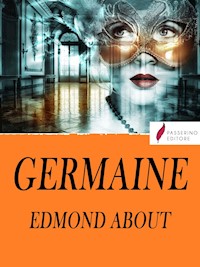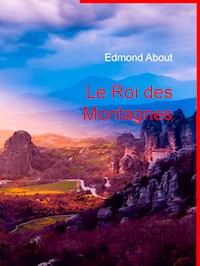Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Qui que tu sois, lecteur (et tu me pardonneras si je te calomnie), je suppose que tu n'es ni meilleur ni pire que moi. Je ne connais ni ton âge, ni ta fortune, ni le rang que tu occupes dans ce monde ; mais je suis à peu près sûr que tu as l'amour du bien et quelque penchant au mal ; beaucoup d'idées justes et passablement de préjugés ; une forte dose de bienveillance au fond du cœur et un petit levain de haine et de colère."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335097672
©Ligaran 2015
MADAME,
Voici un gros volume où j’ai dit sans rhétorique, sans passion, sans calcul, sans flatterie ascendante ou descendante, mon humble sentiment sur les grandes affaires de la vie. Je ne sais s’il mérite d’être présenté au plus noble esprit de notre époque, mais je suis sûr d’y avoir mis le meilleur de moi afin de vous l’offrir. J’ai fait de sérieux efforts pour y concentrer toutes mes idées ; ceux qui ont la curiosité de connaître un homme trop loué par les uns, trop diffamé par les autres, le trouveront ici tel qu’il est.
C’est vous qui m’avez conseillé ce travail, peut-être un peu austère pour un esprit vagabond et naturellement dissipé. La solitude et la campagne m’ont prêté le loisir et l’apaisement dont j’avais besoin pour l’entreprendre. Chemin faisant, j’ai beaucoup lu, beaucoup médité, un peu mûri : je me suis aperçu que je n’étais plus un jeune homme, que je ne serais jamais un grand homme, mais que je pouvais me rendre utile en ajoutant quelques observations pratiques au fonds commun de l’expérience humaine.
Notre siècle est vraiment beau, quoi qu’en disent les mécontents de toutes écoles. L’homme qui joue des coudes dans la cohue s’insurge au moindre choc contre les petites misères du présent ; mais si, comme le peintre devant son tableau, on prend une bonne reculée pour le juger dans son ensemble, on voit qu’il fourmille d’idées neuves, d’aspirations hardies, de sentiments généreux. Ce qui lui manque, à mon avis, c’est la notion claire du vrai, du juste et du possible. La vie moderne est comme une eau large, puissante et trouble. Que les ambitieux y jettent leurs filets ! Que les orgueilleux désabusés la fouettent de verges à l’exemple du roi Xerxès ! Je suis plus que content si j’en ai filtré un bon verre.
Vous avez daigné m’écrire l’an dernier que je n’étais pas plus mal doué que beaucoup d’autres, mais que je laissais toujours échapper le génie entre mes doigts. Hélas ! madame, mon indigence me défend contre tout soupçon de gaspillage. Je n’ai reçu de la nature qu’un atome de bon sens, une miette balayée sous la table où Rabelais et Voltaire, les Français par excellence, ont pris leurs franches lippées. Quant au génie, je l’admire de loin, je le vénère profondément, j’obéis toujours à ses conseils, je m’honore aujourd’hui en lui dédiant un livre.
EDM. ABOUT.
Qui que tu sois, lecteur (et tu me pardonneras si je te calomnie), je suppose que tu n’es ni meilleur ni pire que moi. Je ne connais ni ton âge, ni ta fortune, ni le rang que tu occupes dans ce monde ; mais je suis à peu près sûr que tu as l’amour du bien et quelque penchant au mal ; beaucoup d’idées justes et passablement de préjugés ; une forte dose de bienveillance au fond du cœur et un petit levain de haine et de colère. Tu as un peu travaillé, un peu lutté, un peu souffert, et connu cependant les heures délicieuses où l’on s’écrie que la vie est bonne. Tu sais un peu de tout, mais la somme de tes connaissances n’est presque rien au prix des choses que tu ignores. La passion, le calcul et la raison te conduisent tour à tour, mais il t’arrive aussi de sacrifier tes intérêts les plus évidents au bonheur de faire le bien, et c’est ainsi que tu te maintiens dans ta propre estime. Enfin, ami lecteur (ou ennemi), tu fais assurément de temps à autre le travail intérieur auquel je me livre aujourd’hui : tu t’écartes des plaisirs, des affaires, de tous ces riens tumultueux qui étourdissent la raison humaine, et seul en face de l’inconnu, tu cherches à tâtons la solution du grand problème.
Heureux ou malheureux, tous les hommes passent par là. L’excès des afflictions et la satiété du bonheur nous conduisent par des routes différentes à ce carrefour obscur où les plus affairés s’arrêtent malgré eux, plongent la tête dans leurs mains et déroulent avec terreur une interminable litanie de comment ? et de pourquoi ?
« Comment suis-je tombé sur cette motte de terre ? D’où vient l’homme ? Où va-t-il ? Quel est le but de la vie ? Et, d’abord, cette course entre deux néants a-t-elle un but ? Suis-je né pour moi seul ? ou pour les autres ? ou les autres pour moi ? Que dois-je ? Que me doit-on ? Qu’est-ce que le lien moral qui m’attache à une famille, à une patrie, et peut-être même à tout le genre humain ? D’où viennent ces obligations qui m’ont souvent gêné ? Ces lois qui m’enchaînent ? Ces gouvernements qui me dominent et qui me coûtent cher ? Cette société où nous sommes tous entassés comme à plaisir les uns sur les autres ? Ceux qui m’ont précédé sur la terre étaient-ils plus heureux que moi ? Et ceux qui naîtront dans cent ans vivront-ils mieux ou plus mal ? Faut-il remercier ou maudire le sort qui m’a fait vivre aujourd’hui plutôt qu’hier ou demain ? Le monde va-t-il de bien en mieux ou de mal en pis ? Ou ne fait-on que tourner dans un cercle ? Décidément était-ce la peine de naître ? »
Neuf fois sur dix, dans cette heure de doute et d’angoisse, l’homme épuisé, éperdu, en proie à toutes les hallucinations de la lassitude et de la peur, voit descendre du ciel une figure noble, douce et gravement souriante. « Ferme les yeux, dit-elle, et suis-moi. Je viens d’un monde où tout est bon, juste et sublime ; je t’y conduirai, si tu le veux, à travers les sentiers de la terre pour te faire jouir d’une félicité éternelle. Laisse-moi mettre sur ta vue un bandeau plus doux que la soie, dans ta bouche un mors plus savoureux que l’ambroisie ; sur ton front un joug plus léger et plus brillant que les couronnes royales. À ce prix, tu verras distinctement le principe mystérieux et la fin surnaturelle de toutes les choses de monde ; tu échapperas pour toujours à l’anxiété du doute : soutenu dans tes fatigues, consolé dans tes tristesses, tu marcheras sûrement au bonheur par la vertu. Je suis la foi ! »
Lecteur, si tu es un des neuf qui se sont levés pour suivre la vision ailée, je ne te plains ni ne te blâme, mais ce n’est pas pour toi que mon livre est écrit. J’ai surtout pensé au dixième, à ce superbe, à ce malheureux qui aime mieux marcher à tâtons dans les chemins ardus et fouiller du regard les ténèbres épaisses que d’accepter des affirmations sans preuves et un espoir sans certitude. C’est vers lui que je viens à pied (n’ayant jamais eu d’ailes) et vêtu comme tous ceux qui travaillent ici-bas. Je ne porte pas autour du front l’auréole phosphorescente, mais j’ai allumé une petite lampe au foyer de la science humaine, et je tâcherai qu’elle ne s’éteigne pas en chemin. Sans t’entraîner, même en esprit, au-delà des limites de la vie, j’espère te montrer un but : le progrès ; un chemin : le travail ; un appui : l’association ; un viatique : la liberté.
Suis-nous un instant si tu veux : peut-être ne regretteras-tu pas le voyage. J’aurai pour toi, chemin faisant, les égards que l’homme doit à l’homme : je n’outragerai rien de ce que tu respectes ; je m’abstiendrai même de nier ce que tu tiens pour vrai.
L’école à laquelle j’appartiens se compose d’esprits positifs, rebelles à toutes les séductions de l’hypothèse, résolus à ne tenir compte que des faits démontrés. Nous ne contestons pas l’existence du monde surnaturel ; nous attendons qu’elle soit prouvée et nous nous renfermons jusqu’à nouvel ordre dans les bornes du réel. C’est là, dans un horizon étroit, dépeuplé de toutes les apparitions souriantes et de tous les fantômes menaçants, que nous cherchons à tirer parti d’une humble condition et d’une vie courte.
Les systèmes théologiques, depuis le plus grossier fétichisme jusqu’au christianisme le plus épuré, mettent tous à notre service une solution complète et absolue du grand problème. Mais il n’en est pas un qui ne commence par exiger un acte de foi, c’est-à-dire une abdication partielle de la raison humaine. Nous qui parlons à la terre au nom de la terre, nous n’avons pas le droit de demander rien de tel.
En acceptant la loi de ne rien affirmer sans preuves, en nous interdisant les ressources de l’hypothèse, nous nous condamnons à donner plus d’une fois des solutions incomplètes comme la science de notre temps. Mais les solutions naturelles, malgré ce défaut capital, ont un avantage sur les autres. Elles peuvent être acceptées par les hommes de tout pays, de tout climat, de toute religion. On a vu les dogmes les plus sublimes chercher en vain à s’établir sous certaines latitudes ; la variété infinie des races et des civilisations fait que la terre est partagée entre une multitude de dogmes religieux ou simplement métaphysiques. C’est pourquoi il n’était peut-être pas inutile de chercher un système de règles purement pratiques que l’absence de tout dogme et de tout élément surnaturel fit accepter aux chrétiens comme aux musulmans, aux déistes comme aux athées.
À Paris comme à Bombay, tout homme qui raisonne sait, qu’à moins d’un miracle, c’est-à-dire d’un fait surnaturel, aucun atome de matière ne peut ni commencer ni cesser d’être. Prenez un centimètre cube d’eau distillée pesant un gramme : vous pourrez le déplacer, le dilater, le contracter, le faire passer de l’état liquide à l’état gazeux ou à l’état solide ; le décomposer par la pile, le recomposer par l’étincelle électrique : l’expérience et la raison déclarent unanimement que cette parcelle du monde inorganique, si lestement transformée, si facilement escamotée à nos regards, ne saurait être anéantie et n’a pu être créée par aucune force naturelle. Il faut ou recourir aux hypothèses d’outre-terre (ce que nous nous sommes interdit en commençant) ou croire que tous les éléments dont notre sphère se compose existent et existeront de toute éternité.
À la surface de ce globe inorganique, le seul que nous puissions étudier de près, il se produit depuis quelques milliers de siècles un phénomène nouveau, très complexe et terriblement fugitif appelé la vie. C’est une imperceptible efflorescence de la matière brute, une modification microscopique de l’extrême pellicule : en disant que la cent millionième partie de la terre est organisée sous forme animale ou végétale, on exagérerait beaucoup. Un observateur placé dans la lune et armé des meilleurs instruments d’optique ne saurait discerner ici-bas aucun symptôme de vie : tant la matière organisée est peu de chose sur la masse totale !
S’il nous est impossible de percevoir par les sens et même de concevoir par l’imagination la naissance ou l’anéantissement d’une molécule de matières, nous voyons en revanche et nous comprenons fort bien que toute vie commence et finit. L’agrégation de quelques corps simples sous une forme organique nous apparaît comme un heureux accident, de trop courte durée. Il semble que toutes les forces de la nature soient conjurées contre l’être vivant, ce privilégié de quelques heures ; elles réclament et reprennent incessamment chacun des atomes qu’il a empruntés au fonds commun. La vie ne se soutient que par une lutte de tous les instants, une réparation continuelle. La plante ou l’animal le plus robuste combat quelques années, puis se couche dans la mort.
La science nous prouve qu’il fut un temps où l’organisation était absente et même impossible ici-bas. Il a fallu bien des siècles de siècles pour qu’une masse gazeuse, détachée de l’atmosphère de quelque soleil, se refroidît au point de permettre la vie. Les plantes et les animaux des premiers âges ne pourraient plus vivre aujourd’hui : la terre est déjà trop froide pour eux. Un jour viendra peut-être où l’homme lui-même enrichira de ses derniers ossements la grande collection des espèces fossiles. Mais nous avons du temps devant nous, et fût-il démontré qu’il ne nous reste qu’un millier de siècles, on pourrait néanmoins les employer au bien.
Or, qu’est-ce que le bien ? Toute métaphysique à part, vous voyez clairement que la dernière des plantes, fût-elle mal venue, rachitique, laide, puante et même vénéneuse par-dessus le marché, est une chose plus parfaite et meilleure au point de vue absolu que mille millions de quintaux à choisir dans l’universalité des corps inorganiques. L’organisation la plus incomplète et la plus défectueuse est un bien que tous les trésors de la matière brute ne sauraient balancer un instant.
Et si la plante en question ajoute à ce premier mérite toutes les qualités qui constituent pour ainsi dire la perfection végétale ; si elle est saine, belle, grande, vigoureuse ; si sa tige est un bois magnifique ; si ses fleurs brillent des couleurs les plus riches ; si son fruit est irréprochable, la réunion de tant d’avantages augmentera le prix d’un si heureux organisme. Personne ne pourra nier que la naissance d’un tel arbre sur la terre n’y apporte avec elle une somme considérable de bien ; que sa vie ne mérite une longue durée ; que sa mort ne soit un mal. À supposer qu’il n’y ait pas d’autre organisme à la surface du globe que cette plante unique, il sera bon qu’elle prospère et qu’elle se multiplie, que nul accident n’arrête son développement et sa reproduction, que les forces brutales de la matière ne puissent jamais prévaloir contre elle.
Mais voici un phénomène nouveau, que tous les esprits s’accorderont à déclarer supérieur et meilleur, quelle que soit la diversité des opinions sur sa cause première : Un animal est né. L’animal est, comme la plante, un composé de molécules simples, de matériaux inorganiques ; il emprunte son corps au même fonds, il le versera à la même masse après la mort. Mais la matière prend en lui des propriétés nouvelles, des attributs particuliers, un complément de qualités positives. Entre le cèdre du Jardin des plantes et le misérable cloporte qui se traîne à ses pieds, la distance hiérarchique est grande ; ce petit crustacé est placé bien plus haut dans l’échelle des êtres que son majestueux voisin. C’est un organisme qui marche auprès d’un organisme éternellement immobile ; un organisme qui voit, auprès d’un organisme aveugle. Les éléments constitutifs de ces deux êtres inégaux sont à peu près les mêmes, comme l’acier d’un marteau-pilon et l’acier d’un ressort de montre sortent du même minerai, mais les propriétés de l’un sont beaucoup plus délicates, plus savantes, plus recherchées que celles de l’autre. L’organisation a monté en grade lorsqu’elle a passé de la plante à l’animal. Il y a eu progrès, c’est-à-dire accroissement de bien sur la terre.
L’existence d’un lézard est meilleure, absolument parlant, que celle d’un cloporte. L’animal est plus complet, mieux doué, plus fini. Il possède une colonne vertébrale, des poumons ; il a le sang rouge. La matière, plus affinée en lui, est douée d’une sensibilité un peu plus grande.
Montez encore, et dites-moi si la somme de bien ne s’est pas accrue notablement sur la terre, le jour où le sang chaud circula pour la première fois dans les veines d’un oiseau ? Quel progrès ! La matière inorganique, après un lent affinage, se sublime pour ainsi dire et prend des ailes.
Sous l’action d’une ou de plusieurs causes que la métaphysique cherche encore à définir, le Progrès a paru se faire tout seul ici-bas pendant quelques milliers de siècles. En autres termes, le Bien (ou l’existence) s’est accru spontanément en quantité et en qualité à la surface de ce globe. Si vous vous faites raconter par un géologue tous les essais informes et monstrueux qui préludèrent à la naissance des mammifères de notre époque, vous croirez assister aux efforts héroïques, aux tâtonnements fougueux de la vie essayant plus de formes et plus de déguisements que Protée pour rester maîtresse du monde et échapper à la dissolution qui réclame chaque molécule de tous les corps. Vous la verrez gagnant de proche en proche et tout à la fois de bas en haut ; multipliant les êtres organisés, semant les germes à pleines mains, mais toujours affinant et subtilisant la matière, et ne désespérant jamais de produire son chef-d’œuvre définitif : l’organisme pensant.
Ce long drame, entrecoupé d’éruptions, de soulèvements et de cataclysmes qui ont changé plus de vingt fois l’aspect du décor, entre dans une nouvelle phase le jour où l’homme paraît en scène. Qu’il soit éclos par génération spontanée ou qu’il se soit formé par un suprême affinage dans la cellule de l’animal immédiatement inférieur, c’est une question de médiocre importance. Le certain, c’est qu’entre les grands singes passionnés et intelligents de l’Afrique centrale et les premiers hommes nus, désarmés, ignorants, farouches, toute la différence consistait dans un degré de perfectibilité. L’histoire nous montre assez qu’il a fallu des centaines de siècles pour que le plus perfectible des animaux arrivât à développer son intelligence et à régler logiquement ses rapports. Aujourd’hui même, en l’an 1864 d’une ère toute récente, vous trouveriez encore, au centre de l’Afrique et dans quelques îles de l’Océanie, des hommes qui se mangent entre eux comme les loups ou les brochets ; des hommes que l’angle facial, le volume du cerveau et les facultés intellectuelles placent encore au niveau du gorille, ou peu s’en faut. Ceux-là sont les traînards de l’armée. Mais à dater de la naissance des premiers hommes, les forces inconscientes de la vie ont trouvé dans notre espèce un auxiliaire actif. Le dernier venu et le mieux doué de tous les êtres s’est associé d’emblée à ce travail de perfectionnement universel qui jusque-là s’était fait tout seul.
Tous les êtres tendent à vivre et à se reproduire ; c’est-à-dire à conserver leur individu et leur espèce. Les premiers hommes en cela ressemblaient aux autres vivants. L’individu, à quelque règne qu’il appartienne, subordonne tout à ses besoins, écarte ou détruit tout ce qui l’incommode ou le menace, s’assimile avidement tout ce qui doit le conserver. Chaque espèce organisée fait tout ce qu’elle peut pour conquérir la terre et la peupler à elle seule. Il suit de là que nos ancêtres ont eu de rudes combats à livrer, de vastes destructions à accomplir. S’il nous reste aujourd’hui quelques précautions à prendre pour empêcher que la France ne soit couverte de mauvaises herbes et que Paris ne soit dévoré par les rats, jugez de la besogne quand les fougères avaient dix mètres de haut ; quand l’animal à poursuivre dans les trous était l’ours des cavernes ! Sans doute les carnassiers nos précurseurs ici-bas ont dû vivre quelque temps sur ce troupeau d’intrus ; avant d’être chasseurs nous avons été gibier. Nous n’étions pas les mieux armés par la nature ; nous avions la main mieux construite et le cerveau plus développé, voilà tout.
Que ne puis-je ressusciter le pauvre antédiluvien dont M. Boucher de Perthes a retrouvé la mâchoire ! Ce contemporain de l’âge de pierre, qui vivait au milieu d’animaux formidables sans autres outils, sans autres armes offensives ou défensives qu’un caillou grossièrement taillé, nous donnerait des détails curieux sur la fondation de la dynastie humaine. Son témoignage nous prouverait, j’en suis sûr, que nous ne régnons pas seulement par droit de naissance.
Mais chasseur ou chassé, vainqueur ou vaincu, l’homme a toujours été le maître et le possesseur légitime de la terre. Aucun témoignage certain ne nous oblige à croire que ce domaine lui ait été donné par une autorité surnaturelle, mais il est positif que notre naissance est le produit du suprême effort de la nature, et, jusqu’à nouvel ordre, son dernier mot. Aucun être vivant n’a les organes de la pensée aussi développés, aussi parfaits, aussi indéfiniment perfectibles que le pire d’entre nous. L’existence du dernier des hommes a plus de prix en elle-même, au point de vue absolu, que celle de toutes les plantes et de tous les animaux. L’organisme prodigieux qui consomme de la matière et qui produit des idées est un bien hors de comparaison, supérieur à tout ; on lui peut immoler sans scrupule tous les êtres inférieurs.
La plus humble existence animale ou végétale sera toujours un bien ; mais il est impossible que toutes les espèces de plantes et d’animaux se multiplient indéfiniment sur la terre ; on sait d’ailleurs que l’animal ne peut vivre qu’aux dépens des plantes ou des autres animaux. Il faut donc subordonner ou même sacrifier tous les biens secondaires au plus grand de tous, à celui qui est évidemment la dernière fin de la nature, si la nature a conscience de son but. Or, quel est l’idéal du progrès ? le maximum du bien désirable ici-bas ? C’est que la vie atteigne en quantité et en qualité les dernières limites du possible ; la terre portant à sa surface autant d’hommes qu’elle en peut loger ; tous les hommes aussi parfaits et aussi heureux qu’ils peuvent l’être. Ce but est souverain ; pour l’approcher, tout est permis ; aucun des actes qui tendent là ne peut être jugé mauvais sur le globe ni ailleurs. C’est la seule occasion où la fin justifie les moyens, parce que les moyens ne sauraient en aucun cas porter préjudice à personne.
Donc le souverain bien, humainement parlant, celui que chacun de nous peut poursuivre sans scrupule en passant sur le corps de la nature entière, c’est la perfection et le bonheur de l’homme.
La perfection que l’homme peut rêver, sinon atteindre, consiste dans le développement complet et harmonieux de tout son être physique et moral. Celui qui réunirait en lui, dans un juste équilibre, la santé, la vigueur et la beauté du corps et de l’âme, serait parfait. Mais il est terriblement difficile de développer le physique et le moral, ces deux côtés de la personne humaine, sans que l’un soit sacrifié à l’autre. L’homme qui subordonne son esprit aux appétits du corps se rapproche de la bête ; celui qui tue son corps en détail pour avancer le progrès de son âme est déjà plus qu’à moitié fou. Le vrai sage est celui qui ne méprise le bien sous aucune forme, et s’emploie résolument à l’accroître en lui et autour de lui. La santé, la force et la beauté physique sont des biens très réels, inférieurs à d’autres, j’en conviens, mais qui méritent d’être recherchés.
Le bonheur est le sentiment vague et délicieux du bien que nous avons réalisé. C’est le cadran qui marque en nous le degré de perfection relative auquel nous sommes parvenus. Il n’y a pas un progrès, pas un accroissement d’être, pas une conquête sur le néant, qui ne se traduise en bonheur au fond de l’âme humaine. La maladie, la peur, la contrainte, l’ignorance, le manque, en un mot toutes les choses négatives et qui attestent une imperfection physique ou morale, correspondent nécessairement à une souffrance. La somme de bonheur fut à peu près nulle ici-bas quand l’homme n’était guère qu’un sous-officier d’avenir dans la grande armée des singes ; nous sommes devenus moins malheureux de jour en jour, à mesure que nous devenions moins imparfaits.
La hiérarchie naturelle de nos facultés se continue dans toutes les choses humaines ; elle s’applique au bonheur comme à la perfection. Autant le cerveau est supérieur au muscle, autant la science est supérieure à la force brutale, autant le bonheur de savoir, d’enseigner, de vivre conformément à la justice, est au-dessus du simple plaisir. Le plaisir, ou bonheur des sens n’est pas méprisable en lui-même. Il est le signe d’une santé florissante et d’un besoin naturel satisfait. On peut le rechercher honnêtement, pourvu qu’il ne nuise ni à nous ni aux autres, qu’il ne soit pas acheté au prix de la souffrance ou de la dégradation d’un être humain. Mais le véritable homme de bien, sans torturer son corps par des rigueurs inutiles, assigne à ses efforts un but plus haut que le plaisir : travailler au progrès, ou accroître le patrimoine de la société humaine.
Si vous découvriez, à l’âge de trente ans, qu’un brave marinier vous a sauvé la vie quand vous étiez petit garçon ; qu’il vous a rapporté chez vos parents dans sa veste, qu’il s’est enfui sans accepter aucune récompense et qu’il est mort de pleurésie huit jours après, voici ce que vous feriez sans nul doute. Vous chercheriez ses enfants, s’il en a laissé, ou les enfants de ses enfants pour vous acquitter envers eux. Riche, vous leur donneriez une partie de votre fortune ; pauvre, vous mettriez vos bras à leur service, et vous les aideriez à vivre. Si l’un d’eux n’avait pu recevoir aucune éducation, vous payeriez ses mois d’école, ou vous lui apprendriez à lire vous-même ; si un autre, plus à plaindre encore, était tombé plus bas que la misère, vous ne l’accableriez pas de votre mépris. Vous tendriez vos mains vers lui pour le relever, comme son pauvre grand-père vous a tendu les siennes. N’est-il pas vrai, monsieur, qu’en agissant ainsi vous feriez simplement votre métier d’honnête homme ? Vous l’avouez, j’en prends acte, et je poursuis.
Tout homme de trente ans qui réfléchit un peu s’aperçoit qu’il doit sa vie, sa santé, son bien-être, son éducation, tout ce qu’il a et tout ce qu’il est, à des millions de sauveteurs obscurs, inconnus, introuvables, qui sont morts à la peine, qui n’ont presque jamais reçu le prix de leurs services, mais qu’on peut récompenser dans leur postérité, car, le monde n’est peuplé que de leurs fils et de leurs filles.
Considérez, monsieur, que la terre est la plus ingrate des marâtres : elle ne produit spontanément que des végétaux insipides et des animaux farouches ; les seuls logis qu’elle prête gratis à ses enfants sont des cavernes fécondes en rhumatismes ; les vêtements, les chaussures et les coiffures qu’elle nous offre sont des feuilles et des écorces ; les seuls outils qu’elle nous ait jamais donnés sont les dix doigts de nos deux mains ; elle a soin de cacher au plus profond de ses entrailles les métaux qui pourraient nous aider.
Tous les biens dont vous jouissez aujourd’hui, vous les devez à l’effort héroïque des hommes qui vous ont précédé en ce monde. Il n’y a pas sur votre table un fruit, un légume, un condiment, un vin qui n’ait pu être l’objet d’un brevet d’invention, d’un brevet d’importation et de cent mille brevets de perfectionnement. Vous remerciez la nature quand vous vous promenez dans un jardin magnifique : c’est à l’homme qu’il faudrait rendre grâces. La plupart des fleurs naturelles que vous admirez là sont de fabrication humaine ; s’il en est quelques-unes auxquelles on n’ait pas travaillé, du moins s’est-on donné la peine de les aller chercher au bout du monde. Les céréales de la plaine, les arbres du verger, tout ce qui paraît sortir du sein de la terre, est importé, développé, perfectionné, amendé, métamorphosé par la main de l’homme. La forêt même est peuplée d’arbres que l’homme est allé prendre au-delà des mers. Votre écurie, l’étable, la bergerie, le têt à porcs, la basse-cour, le chenil, fourmillent d’animaux plus ou moins exotiques, mais tous domptés, apprivoisés, dressés, modifiés et comme pétris sur un modèle nouveau par les mains ingénieuses de l’homme. Je ne cite que pour mémoire les animaux féroces, dont l’absence est encore un bienfait de nos devanciers. Ils ont trié soigneusement les dons animés de la nature, supprimant les espèces tout à fait incorrigibles, et tournant à notre profit tout ce qui pouvait être apprivoisé.
Si vous jetez un regard sur le vêtement qui vous protège de la tête aux pieds (fussiez-vous habillé comme un pauvre) vous verrez que l’agriculteur, le filateur, le tisserand, le teinturier, le navigateur, le mécanicien, le tanneur, le tailleur, le cordonnier, le blanchisseur, le cartonnier, le chapelier, l’éleveur de vers à soie et vingt autres industriels, exerçant des arts difficiles ou même savants, ont appliqué l’étude et l’expérience de cinquante siècles à la confection de votre modeste enveloppe. Le moindre clou de votre chaussure résume en lui la découverte du fer, l’exploitation des mines, la fusion du minerai dans les hauts fourneaux, l’affinage de la fonte, les merveilles de la filière, la construction du soufflet de forge, le travail si rapide et si ingénieux du cloutier. Mille générations ont sué sang et eau pour produire cet ensemble fort laid, mais simple, commode et économique, que l’ouvrier parisien achète au Temple contre son salaire de quelques jours.
Maintenant levez les yeux de dessus mon livre et regardez la chambre où vous êtes. Le géomètre, l’architecte, le terrassier armé de trois ou quatre outils dont le plus simple est un chef-d’œuvre, le carrier, le maçon, le charpentier, le tuilier, le plâtrier, le peintre et le chimiste qui lui fournit ses couleurs, le verrier, le vitrier avec son diamant qu’on est allé prendre au Brésil, le menuisier, le serrurier (j’en passe, et des meilleurs) ont dû mettre en commun une somme prodigieuse d’études continues et de labeur accumulé pour vous loger le plus modestement du monde. Le moindre fauteuil plaqué d’acajou a coûté l’invention de la boussole, le perfectionnement de la navigation, la découverte de l’Amérique ! Le vernis commun qui le couvre vous rappelle qu’on a planté la vigne, pressuré le raisin, livré le moût à la fermentation, distillé le vin dans un alambic et rectifié l’alcool où l’on dissout la térébenthine de Bordeaux colorée par le santal de l’Inde ou le carthame de l’Égypte.
Si je ne craignais pas de pousser l’énumération au-delà des limites de votre patience, je vous dirais combien il a fallu d’inventions sublimes pour fabriquer matériellement le livre que vous tenez en main, ou simplement le savon dont vos mains sont lavées, ou la pendule qui interrompra tantôt votre lecture en sonnant l’heure du dîner. J’attirerais votre attention sur le catalogue du plus simple musée ou de la plus misérable bibliothèque pour vous rappeler quelques-unes des belles choses que les morts ont laissées pour vous. J’aime mieux, pour abréger, vous montrer vous-même à vous-même ; votre santé à laquelle un million de savants ont travaillé depuis Hippocrate ; votre mémoire meublée de beaux vers qu’on a faits pour vous, votre raisonnement redressé par les philosophes de vingt écoles, votre goût formé peu à peu par le spectacle des chefs-d’œuvre, votre cœur ennobli par les conseils de la sagesse et les exemples de la vertu.
Comprenez-vous maintenant que tous les hommes d’autrefois sont vos bienfaiteurs plus ou moins anonymes ? Que vous devez quelque chose à leurs fils, vos contemporains ? Qu’il ne suffirait point, pour acquitter votre dette, de ne pas faire le mal ? Qu’il faut faire le bien et laisser quelque chose après vous comme vos devanciers vous ont laissé quelque chose ? Que vous êtes l’anneau d’une chaîne, le degré d’une échelle ascendante, une transition vivante, active et laborieuse entre ce qui a été et ce qui sera ?
On ne vous demande pas d’opérer des miracles ; on désire seulement que vous laissiez quelque chose après vous. « Celui qui a planté un arbre avant de mourir n’a pas vécu inutile. » C’est la sagesse indienne qui le dit. En effet, il a ajouté quelque chose au capital de l’humanité. L’arbre donnera des fruits, ou tout au moins de l’ombre à ceux qui naîtront demain, affamés et nus. Un arbre, un toit, un outil, une arme, un vêtement, un remède, une vérité démontrée, une loi découverte, un livre, une statue, un tableau : voilà les additions que chacun de nous peut faire au trésor commun.
Il n’y a pas aujourd’hui un homme intelligent qui ne se sente lié par des fils invisibles à tous les hommes passés, présents et futurs. Nous sommes les héritiers de tous ceux qui sont morts, les associés de tous ceux qui vivent, la providence de tous ceux qui naîtront. Pour témoigner notre reconnaissance aux mille générations qui nous ont faits graduellement ce que nous sommes, il faut perfectionner la nature humaine en nous et autour de nous. Pour remercier dignement les travailleurs innombrables qui ont rendu notre habitation si belle et si commode, il faut la livrer plus belle et plus commode encore aux générations futures. Nous sommes meilleurs et plus heureux que nos devanciers, faisons que notre postérité soit meilleure et plus heureuse que nous. Il n’est pas d’homme si pauvre et si mal doué qui ne puisse contribuer au Progrès dans une certaine mesure. Celui qui a planté l’arbre a bien mérité ; celui qui le coupe et le divise en planches a bien mérité ; celui qui assemble les planches pour faire un banc a bien mérité ; celui qui s’assied sur le banc, prend un enfant sur ses genoux et lui apprend à lire, a mieux mérité que tous les autres. Les trois premiers ont ajouté quelque chose au capital commun de l’humanité ; le dernier a ajouté quelque chose à l’humanité elle-même. Il a fait un homme plus éclairé, c’est-à-dire meilleur.
Si nous sommes d’accord et si vous voulez franchement vous atteler au Bien, nous ne chercherons pas longtemps une honnête besogne à faire. Je vous détaillerai par le menu tout ce qui manque encore à la société humaine dans un pays aussi mûr et aussi civilisé que la France : vous choisirez librement le travail qui convient à vos goûts et à vos aptitudes. Je mettrai en lumière les moyens d’action, les facilités sans nombre, les collaborations actives et dévoués que notre siècle, le plus grand de l’histoire, offre à tout homme de bonne volonté.
Car notre siècle est grand entre tous aux yeux de l’homme qui ne se laisse point aveugler par ses incommodités personnelles ou par les fumées turbulentes de l’esprit de parti. Il faut être bien ignorant ou bien aveugle pour regretter aujourd’hui tel ou tel moment du passé.
Est-ce à dire que nos hommes d’État soient plus vertueux qu’Aristide ? nos généraux plus invincibles que César ? nos sculpteurs plus admirables que Phidias ? nos peintres plus divins que Raphaël ? nos poètes plus charmants que la Fontaine et Molière ? nos orateurs plus éloquents que Démosthène ou Cicéron ? Il s’en faut un peu, je l’avoue. Je dois même confesser que du point où je me place on ne voit pas beaucoup de grands hommes élever la tête au-dessus du niveau commun. Mais le niveau lui-même s’est élevé prodigieusement. Le siècle de Périclès, vu de loin, ne représente qu’un petit état-major de gens d’esprit, ou de génie, groupé autour de l’Acropole d’Athènes. Le siècle d’Auguste avec toutes ses grandeurs et ses gloires pourrait tenir en entier dans une des salles du Palatin. Vous rassembleriez sans peine le siècle de Léon X à la chapelle Sixtine et Versailles serait trop grand pour loger le siècle de Louis XIV ou sa cour (c’était tout un). Mais le commun des martyrs, le gros de l’armée, le milliard d’hommes qui habitaient la surface de la terre, comment vivaient-ils au temps de Louis XIV, de Léon X, de César, de Périclès ? Quelle était la durée moyenne de leur existence ? Au prix de quels efforts gagnaient-ils leur pain de chaque jour ? Et d’abord chacun d’eux consommait-il dans son année les trois hectolitres de blé qui sont le strict nécessaire pour l’homme moyen ? Combien de temps leur restait-il, sur vingt-quatre heures, pour penser, pour apprendre, pour raisonner, pour aimer, pour développer en eux l’être moral ? À quels dangers étaient-ils exposés ? Combien de malfaiteurs avaient-ils à redouter sur un million d’hommes pris au hasard ? C’est une grosse question, et digne qu’on l’étudie. Jadis une poignée de personnages éminents suffisait à marquer une grande époque ; aujourd’hui l’histoire commence à demander quelque chose de plus. La plus grande époque à ses yeux n’est plus celle où quelques individus ont le mieux fait ressortir la misère et l’ignorance de tous les autres, mais celle où l’humanité en corps a fait les plus longues étapes sur la route du Progrès.
Un trait caractéristique du temps où nous vivons, c’est la rapidité presque foudroyante avec laquelle chaque progrès se développe, se complète, se répand jusqu’au bout du monde, et porte ses derniers fruits. Je m’explique.
Il s’est écoulé probablement un siècle ou deux entre l’invention du cadran solaire et celle du sablier et de la clepsydre. Entre la clepsydre et cette ingénieuse mécanique qui fut envoyée, diton, à Charlemagne par le calife Haroun-al-Raschid, il faut compter plus de mille ans. L’horloge à poids, meuble massif et de transport difficile, a mis sept cents ans à se changer en montre portative. La montre du bon vieux temps, l’œuf de Nuremberg, ne se simplifie et ne s’aplatit que trois cents ans après sa naissance. Quelle incubation ! La boussole était inventée depuis plus de deux mille ans lorsque Christophe Colomb eut l’idée de s’en servir pour chercher les grandes Indes. La poudre à canon, découverte en Chine, on ne sait quand, arrive en Europe au quatrième siècle, et c’est huit ou neuf cents ans plus tard qu’on s’avise de fabriquer un canon. Du canon à l’arquebuse, de l’arquebuse au mousquet, du mousquet aux armes modernes, l’industrie chemine à pas si lents, qu’il s’est écoulé plus de trois siècles entre l’arquebusade dont mourut Bayard et l’invention du revolver Colt. Voilà plus de trois mille ans qu’on fabrique le verre, et les instruments d’optique se sont perfectionnés aussi lentement que les armes à feu.
Les découvertes de notre siècle marchent d’un autre train. C’est qu’autrefois l’inventeur était un homme à part, isolé de ses plus proches voisins par sa supériorité même. Entre lui et son temps, l’ignorance, les préjugés, les erreurs officielles et quasi religieuses élevaient mille barrières. Ce n’était pas tout de découvrir une vérité ; il fallait la faire comprendre à des hommes qui n’en avaient aucune idée ; il fallait l’imposer à des corporations anciennes et puissantes qui fondaient leur autorité sur l’erreur ; il fallait enfin la colporter jusqu’au bout du monde, dans un temps où la moindre montagne et le plus modeste cours d’eau séparaient invinciblement deux peuples, et où la moitié du genre humain ignorait l’existence de l’autre.
Que les temps sont changés ! Aujourd’hui, tous les peuples se connaissent et communiquent régulièrement entre eux : il ne faut pas plus d’un mois à une idée pour faire le tour du monde. L’inventeur ne prêche plus dans le désert ; dès qu’il ouvre la bouche il est compris à demi-mot par deux cent mille hommes environ, qui sont tous au niveau de la science actuelle, qui connaissent les données de tous les problèmes et qui saisissent les solutions au vol. Quelquefois même, tant l’ardeur de progrès est universelle, deux chercheurs séparés par les mers trouvent en même temps sans s’être donné le mot. C’est ainsi que l’ovariotomie, une merveille chirurgicale, vient d’être retrouvée à peu près à la même heure en Angleterre et à Strasbourg. C’est ainsi que les nouvelles planètes ont souvent deux ou trois inventeurs. Chaque progrès établi devient le point de départ de nouvelles recherches : tous les curieux, tous les ardents, tous les ambitieux de la science ou de l’industrie courent au fait, le constatent, y touchent barre et se lancent en avant avec une nouvelle fureur. Chaque carrière devient un turf bruyant et tumultueux où le coureur le plus rapide ne saurait s’arrêter et reprendre haleine sans être dépassé ou culbuté. Inventez la machine la plus ingénieuse et la plus utile, la machine à coudre, par exemple ; si vous ne lui donnez pas d’emblée toute la perfection qu’elle comporte, vous serez débordé ce soir même par quelque perfectionnement. Trouvez l’anesthésie par l’éther, et votre nom sera inscrit sur le livre des bienfaiteurs de l’humanité ; mais si votre éther n’était pas d’une innocuité parfaite, s’il endormait quelquefois les malades d’un sommeil définitif, le chloroforme viendrait bientôt prendre sa place et l’on effacerait votre nom pour en écrire un autre dans le souvenir des peuples.
Cette collaboration de tous à l’œuvre du siècle, cette concurrence dans le bien, cette rivalité active, finira par produire, un effet moral assez imprévu : elle supprimera la gloire. Le grand livre dont nous parlions tout à l’heure sera couvert de plus de noms que la colonne de Juillet : or, personne ne s’amuse à lire la colonne de Juillet. Que serait-ce, si elle fourmillait de renvois, de surcharges et de ratures ? La table de Pythagore est définitivement acquise à Pythagore, et personne ne s’avisera jamais d’en attribuer le mérite à M. Le Verrier ; mais il n’y a pas une grande découverte de notre siècle qui ne soit disputée ou tout au moins partagée par une multitude d’inventeurs. À qui devons-nous les merveilles de la photographie ? Est-ce à Daguerre ? Est-ce aux Niepce de Saint-Victor ? À Talbot ? à Lerebours ? à Gaudin ? à Fizeau ? à Chevalier ? à Foucault ? Et supposé que l’on partage le prix entre tous ceux-là, n’y aura-t-il rien pour leur père en physique, Baptiste Porta, inventeur de la chambre noire ? Et ne sera-t-il pas bon d’inscrire à côté d’eux une vingtaine de chimistes, sans qui les physiciens n’auraient jamais fixé l’image fugitive ? Ne faudra-t-il pas enfin réserver une place à Martin et à tous ceux qui, comme lui, travaillent à graver la photographie ? C’est tout un calendrier d’hommes utiles. On en ferait un autre, et plus considérable, avec ceux qui ont découvert, ou perfectionné les divers usages de la vapeur. Et l’électricité ! Je parie pour cinq cents inventeurs, tous dignes de gloire, et qui seront tous oubliés parce qu’ils sont cinq cents ; tandis que le monomane Érostrate, qui brûla le temple de Diane à lui seul, est immortel.
À tous les ouvriers qui travaillent en commun sur le grand chantier du Progrès, la postérité devra joindre dans sa reconnaissance deux classes entières sans lesquelles le dix-neuvième siècle n’aurait rien fait, ou peu de chose. Je veux parler des agioteurs et des folliculaires.
L’agiotage est flétri par les moralistes épais de la gérontocratie, les prédicateurs des vieux dogmes l’anathématisent ; les poètes de la routine le flagellent à coups d’alexandrins. Les gouvernements ne sont pas encore bien fixés sur ses dangers et ses mérites ; ils le poussent, l’arrêtent, l’encouragent et le découragent par intermittence ; aujourd’hui lui bâtissant des temples et demain lui jetant la porte au nez. Mais la postérité, qui verra plus clair que nous dans nos affaires, rendra justice à la sublime invention de l’Écossais Law. L’agiotage est l’art de rassembler les petits capitaux pour faire de grandes choses. C’est lui qui a créé les routes royales de France en 1720 et tous les chemins de fer de l’Europe vers 1850. C’est lui qui a fondé toutes les merveilles que Turgan réunit dans son épopée industrielle ; c’est lui qui fournit aux inventeurs le nerf du travail. L’agiotage a ses défauts et ses dangers, ses caprices et ses injustices. Il a fait des victimes ; la vapeur en fait aussi. Il nous amènera peut-être un jour ou l’autre quelque crise désagréable, où l’on verra l’Europe incommodée par une pléthore de papier. Mais la circulation de ce papier dont l’agiotage nous inonde aura créé des richesses durables. Les isthmes seront percés, les montagnes seront éventrées, les fleuves canalisés, les villes assainies, les marais desséchés, les pentes reboisées ; la terre sera un séjour plus habitable et la somme de biens qui est le patrimoine commun de tous les hommes aura doublé. Nos descendants béniront alors ces manieurs d’argent que la gérontocratie traite avec un dédain sublime, lorsqu’elle n’a pas d’actions à leur demander.
Et nous aussi, pauvres barbouilleurs de papier, nous aurons bien mérité de l’avenir ! Ce n’est pas seulement parce qu’un petit pamphlétaire du nom de Pascal aura inventé la brouette ; ni parce que deux ou trois autres auront résolu le problème de la navigation aérienne ; ni même parce que tel ou tel d’entre nous découvre de temps en temps une vérité d’intérêt universel comme la souveraineté du peuple ou le principe des nationalités. Ne fussions-nous que de simples intermédiaires, des colporteurs d’idées et rien de plus, notre rôle aurait encore une assez belle importance. Les idées, comme les capitaux, se multiplient par le mouvement. Il suit de là qu’un publiciste capable remplit exactement les mêmes fonctions que M. de Rothschild : il y gagne un peu moins, voilà tout.
Ces jours derniers, comme je descendais la route de Phalsbourg, je rencontrai un petit porte-balle de quarante à cinquante ans. Il s’était assis, pour souffler, sur un mètre de pierre. Je pris place à côté de lui, et après les politesses usitées entre voyageurs, je lui demandai s’il était content de son sort ?
Il hocha mélancoliquement la tête, et répondit : « Je suis marchand de lunettes ; marchand ambulant, comme vous voyez. Le commerce irait assez bien, car les hommes d’aujourd’hui, même les plus pauvres et les plus ignorants, aiment à voir. Le mal est qu’on ne peut pas traverser un village sans que les gamins vous jettent des pierres et sans que les gendarmes vous demandent vos papiers. On se débarrasse encore des gamins ; mais avec les gendarmes, c’est le diable ! Ils vous tracassent comme des malfaiteurs, et le chagrin d’être pris pour ce que je ne suis pas m’a donné mille tentations d’abandonner la partie. Je continue pourtant, car il faut vivre ; et puis je me dis tous les soirs, en me couchant, que bien des hommes mes frères seraient comme aveugles si je ne leur portais jusqu’au fond de leurs villages les moyens de voir plus clair.
– Touchez là ! lui dis-je. Presque tous mes amis font le même métier que vous. Ils colportent dans la France et à l’étranger des verres de toute sorte à l’usage des yeux du peuple. Ils vendent des verres roses, dans lesquels le malheureux voit un avenir de justice et d’égalité ; des verres bleus qui permettent au simple citoyen de regarder les trônes dorés et les couronnes étincelantes sans en être même éblouis ; des verres grossissants à travers lesquels un homme utile vous apparaîtra dix fois plus grand qu’un préfet dans sa gloire. À l’aide des instruments qu’ils colportent jusque dans les campagnes, vous verrez tous les fourbes démasqués, tous les oppresseurs renvoyés, tous les jougs secoués, tous les hommes unis pour bien faire ; la vérité, le travail et le droit régnant partout.
– Parbleu ! mon bon monsieur, voilà un commerce qui ressemble au mien comme un télescope de cent mille francs à une paire de besicles de dix sous. J’aime à croire que vos amis n’ont rien à craindre des gamins ni des gendarmes ?
– À vous dire le vrai, leur commerce est surtout incommodé par les chefs de bureau. »
Le colporteur se découvrit à ce nom, car personne n’ignore en France que les chefs de bureau sont, de temps immémorial, les véritables maîtres du pays. C’est grâce à leur prudence et dans l’intérêt de leur sécurité que la presse n’a jamais été libre. Les souverains, qui lisent peu, se soucient médiocrement des choses qu’on peut écrire ; il se trouve quelquefois des ministres assez courageux pour suivre leur chemin sans craindre la critique. Mais le prince le plus libéral et le ministre le plus intrépide n’obtiendront jamais que les chefs de bureau nous accordent la liberté. Chacun d’eux est fermement convaincu que tous les journalistes veulent vendre des lunettes rouges au peuple pour renverser le gouvernement et s’emparer de tous les bureaux.
Qu’y ferions-nous, hélas ? Rien de meilleur assurément, ni de plus utile au Progrès que notre humble métier de marchand de lunettes. Mieux vaut rester où nous sommes, quoique nous n’y jouissions pas des sept allégresses, quoique le bon public ne nous dédommage pas toujours des rigueurs de l’administration, quoique nous n’apercevions pas même à l’horizon lointain cette grande consolation des orgueilleux, la gloire !
Car il faut en prendre notre parti : nous n’obtiendrons qu’une gloire collective. Aucun de nous, à moins de hasards imprévus, ne fera parvenir son nom jusqu’à la postérité. Mais qu’importe, après tout ? Le bien que nous aurons laissé ne sera pas perdu pour elle. Travaillons !
Le travail est un devoir, selon les uns, un frein selon d’autres. Nous chantions en 1848 une chanson d’ouvriers qui disait : le travail, c’est la liberté !
Il y a du vrai dans chacune de ces affirmations, quoiqu’elles se contredisent entre elles. Vous remarquerez peut-être, si vous lisez ce livre jusqu’au bout, que j’évite le mot devoir, quoiqu’il soit très sonore, très clair et très noble. C’est que je me suis interdit la plus furtive excursion dans la métaphysique. Le devoir sous-entend un maître qui l’impose, comme la dette indique un créancier. Si le travail n’était qu’une obligation infligée à l’homme, on pourrait supposer que l’homme n’y a pas toujours été soumis et qu’il pourrait un jour ou l’autre en être dispensé. C’est pourquoi j’aime mieux dire que le travail est la loi de l’homme sur la terre. Les lois, suivant la belle définition de Montesquieu, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Tant que le monde sera monde et que l’homme sera homme, il faudra nécessairement travailler. La loi ne serait abrogée que si toutes les forces hostiles de la nature avaient désarmé devant nous, si tous les hommes étaient heureux et parfaits, si la somme de bien réalisée se trouvait telle qu’on n’y pût rien ajouter, ce qui est absurde.
Ne pas faire le mal est une chose si simple, si naturelle et si peu méritoire que j’ai cru inutile d’en faire mention. Faut-il donc qu’on vous interdise de dépouiller, d’opprimer, de violenter, d’assassiner les descendants de ceux à qui vous devez tout ? Un homme qui nuit à son semblable fait cause commune avec la faim, la soif, la maladie, la gelée, la sécheresse, l’inondation, la foudre et les mille fléaux qui sont perpétuellement en armes contre l’humanité. C’est un traître qui passe à l’ennemi.
Tout le monde est de cet avis, et ceux même que l’ignorance, la misère ou quelque maladie du cerveau égare dans les régions du crime sont avertis par un secret reproche qu’ils se dégradent en faisant mal. Ils se sentent tomber dans la catégorie des loups et des serpents à sonnettes.
Ceux-là ne se font pas d’illusion sur leur abaissement, mais j’en sais beaucoup d’autres qui se trompent avec confiance, et même avec orgueil, au détriment de leur dignité personnelle et du bien de l’humanité. Je parle de tous ceux qui ont de quoi vivre et qui se croient autorisés à ne rien faire, parce que le besoin n’enfonce pas ses éperons dans leurs flancs.
Lorsque j’étais encore au collège, et dans le plus pauvre et le plus laborieux collège de Paris, il y avait parmi nous trois ou quatre jeunes gens qui disaient avec une fatuité naïve : « moi, je ne ferai rien ; je vivrai de mes rentes. » Selon toute apparence, ils n’avaient pas trouvé cela tout seuls ; ils répétaient ce qu’ils avaient entendu dans la maison paternelle.
Certes on les aurait bien étonnés si on leur avait répondu que l’oisif, si riche qu’il puisse être, est un ingrat qui méconnaît les bienfaits du passé, un banqueroutier qui nie sa dette envers l’avenir.
On croit encore en plus d’un lieu, que l’oisiveté est une noblesse, un signe honorifique, une plume au chapeau. Pourquoi ? parce que le travail, après avoir été le lot des esclaves, puis des serfs, puis des vilains, est échu finalement aux prolétaires. Les révolutions que nous avons faites n’ont pas déraciné tous les préjugés du bon temps. Nous crions sur les toits que la démocratie déborde ; mais nous sommes restés passablement aristocrates au fond du cœur. Un manufacturier enrichi par le travail le plus utile et le plus réellement noble croit s’élever d’un étage en donnant sa fille à un marquis. Plus le jeune homme est de vieille race, plus le beau-père est radieux : pensez donc ! Il y a quatre cents ans que personne n’a fait œuvre de ses dix doigts dans la famille de mon gendre !
Faute de gentilhomme, on prend un simple fils de famille bourgeoise ; ses parents ont travaillé, c’est un malheur ; mais grâce au ciel, voici plus de dix ans qu’ils sont retirés des affaires. Quant à lui, nous sommes tranquilles : jamais, au grand jamais il ne fera rien !
Un fonctionnaire est encore un parti convenable. Les fonctionnaires font si peu de chose dans notre admirable pays ! Ils vont à leur bureau par acquit de conscience. Leurs occupations sont si futiles qu’ils ont presque le droit de se dire rentiers sur l’État. Les plus recherchés parmi eux sont naturellement ceux qui gagnent le plus avec le moins de fatigue. Par exemple un receveur général sortant du collège ! Voilà ce qui s’appelle un jeune homme méritant ! Cent mille francs à gagner et rien à faire ; tout au plus quelques signatures à donner : le fondé de pouvoir, un nègre blanc, se charge du reste. Et l’on est un personnage ! La troisième autorité du département ! Aucun père n’hésitera dix minutes entre un haut fonctionnaire et un grand industriel, l’homme laborieux fût-il dix fois plus intelligent et plus riche. C’est que le fonctionnaire est presque un gentilhomme : il travaille si peu !
Quand par malheur une jeune fille est réduite à épouser un beau garçon, riche, instruit, honnête, bien élevé et gagnant vingt mille écus par an dans le commerce, elle prend de longs détours pour expliquer cette déchéance à son amie de couvent. « Mon mari est dans le commerce, mais dans le haut commerce ; il fait les affaires en grand, il ne s’occupe pour ainsi dire de rien ; à peine s’il se montre à son bureau une demi-heure par jour. Du reste nous comptons nous retirer bientôt. »
L’amie, qui doit épouser un sous-préfet à 4500 francs, l’embrasse avec effusion et lui dit : pauvre belle ! je serai toujours la même pour toi. Mon mari n’a pas de préjugés. Tu nous présenteras le tien, lorsqu’il sera sorti des affaires !
Voilà comme la société française apprécie les services qu’on lui rend. Elle commence à considérer un homme le jour où il ne travaille plus. Elle met l’industriel et le commerçant qui font marcher la grande machine nationale au-dessous du fonctionnaire inutile et gourmé qui place solennellement des bâtons dans les roues. Ô les fonctionnaires ! C’est qu’ils ne sont pas même heureux, les malheureux ! Assermentés, enrégimentés, condamnés à changer d’opinion à tous les changements de régime, soumis jusque dans leur costume et dans les poils de leur barbe au caprice d’un chef, astreints au célibat dans certaines positions, au mariage dans quelques autres ; nomades, logés partout en garni ou forcés de courir la France et les colonies avec une traînée de bagages ; occupés souvent à des niaiseries qu’une mécanique ferait mieux qu’eux, non seulement ils s’interdisent tous les rêves qui sont permis à l’épicier derrière son comptoir, mais ils renoncent presque tous à cultiver leur esprit. Que de fois j’ai entendu des hommes d’administration (et non pas, s’il vous plaît, de simples copistes) s’écrier d’un ton important : « Je ne lis pas. Vous savez ? Les affaires ! » Je connais en revanche des filateurs, des forgerons, des négociants, des agents de change qui lisent tout. Les ouvriers de Paris lisent peut-être plus que les expéditionnaires. Il est vrai qu’ils gagnent plus et qu’ils ont moins de frais.
Ah ! si la jeunesse de notre pays connaissait un peu mieux le néant des carrières publiques ! Elle porterait son activité sur d’autres points l’État, obligé, faute de candidats, à réduire le nombre des places, ferait exécuter par dix hommes la besogne de cent, et les carrières utiles se recruteraient comme par miracle.
Mais il faudrait d’abord que le peuple le plus spirituel du monde apprît à estimer le travail. Malheureusement les travailleurs eux-mêmes ont les idées les plus fausses sur leur mérite respectif. Le négociant qui n’a pas d’enseigne à sa maison se croit supérieur à ceux qui en ont une ; le marchand en gros prend le pas sur le détaillant, le détaillant sur le revendeur, le revendeur sur l’ouvrier, l’ouvrier des villes sur l’ouvrier des campagnes. Entre ouvriers il y a des catégories, un classement aristocratique. Les imprimeurs prennent la tête ; les chiffonniers, les vidangeurs, les égoutiers ferment la marche. Tous les autres corps d’état se croient au-dessus d’eux ; eux-mêmes, j’en ai peur, se placent par une modestie absurde et sans motif au-dessous de tous les autres. Et pourquoi ? parce que leur travail est plus pénible et plus répugnant ? Mais pauvres imbéciles que vous êtes, plus grands sont les dégoûts et les difficultés, plus il est honorable de les vaincre ! Les premiers en ce monde sont les meilleurs et les plus utiles. Soyez honnêtes gens, ne vous roulez pas dans l’ivrognerie et la débauche, et tout en remplissant vos hottes, en roulant vos tonneaux, en balayant vos égouts, vous prendrez le pas sans difficulté sur les petits messieurs qui s’enivrent au café Anglais avec des demoiselles.
Les musulmans, qui n’ont pas l’habitude d’être cités en exemple, raisonnent moins sottement que nous sur la question du travail. Ils disent qu’un homme doit être honoré pour ses vertus en sa sagesse, quel que soit le métier qui lui donne du pain. Dans les bazars de Constantinople ou même d’Alger on vous montrera des talebs que le peuple consulte et vénère : celui-ci fait des babouches, celui-là raccommode les vieux burnous.
Comment dont s’appelait ce philosophe grec qui tirait de l’eau durant la nuit pour gagner sa vie ? Pendant le jour, il donnait la sagesse pour rien.
Je me suis laissé dire que M. Victor Hugo en exil avait trouvé de grandes consolations dans l’amitié d’un homme éclairé, lettré, versé dans toutes les études libérales et entouré d’une admirable bibliothèque. C’est, si je ne me trompe, un épicier de Guernesey. Qu’en pensent les loustics de Paris ?