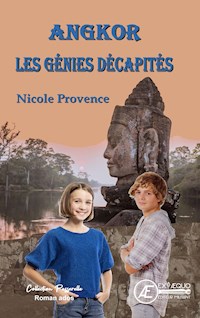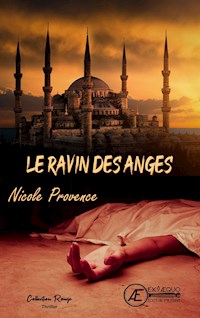
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Plongez dans une enquête haletante entre la noirceur d'une cité française et la splendeur des mosquées d'Istanbul.
À quelques semaines d’intervalle, deux cadavres de lycéennes sont découverts dans le ravin d’une déchetterie et l’adjudant Di Nazzo mène l’enquête.
Un polar à l'atmosphère sombre et réaliste dont les nombreux rebondissements vous feront frémir !
À PROPOS DE L'AUTEURE
Nicole Provence est née en 1948 à Châtellerault dans la Vienne et elle vit aujourd’hui dans la région lyonnaise. Férue de lectures et d’écritures en tous genres, elle participe à un concours en 1998 et a le plaisir de voir une première nouvelle du genre polar retenue par France Loisirs. Le pied est mis à l’étrier. Depuis, elle se consacre entièrement à l’écriture de romans polars-terroir et de romans jeunesses. Avec Le ravin des anges, elle renoue avec le polar dont les enquêteurs sont les héros de ses précédents romans policiers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nicole Provence
Le ravin des anges
Thriller
ISBN : 979-10-388-0171-4
Collection Rouge
ISSN : 2108-6273
Dépôt légal : septembre 2021
© Couverture Ex Aequo
© 2021- Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite.
« Il n’y a rien de plus apaisant qu’un cimetière. Il n’y a plus de souffrance, plus de violence, plus de guerre. Il n’y a que de la paix et de la sérénité. »
Alexis Aubenque. La fille de la plage, 2018
1. Sandra, Roussillon
Samedi 13 septembre 2005, 14 heures
Il était un peu plus de quatorze heures, la grosse aiguille de l’horloge de la mairie effectuait un autre saut saccadé sur un point noir entre les chiffres douze et un. Les boutiques étaient encore fermées. Sur la margelle de la fontaine, une jeune fille attendait. Les gestes brusques de sa tête qui tournait de gauche à droite traduisaient son impatience. Dix-sept, dix-huit ans, vingt au maximum. Sa courte jupe en jean dénudait largement ses cuisses, un T-shirt noir moulant découvrait la ligne médiane de ses seins, et ses ongles d’orteils vernis de rouge un peu écaillé ornaient le bout de ses sandalettes à épaisses semelles comme le voulait la mode du moment. D’un geste sec, elle ouvrit le petit sac en raphia tressé et sortit un miroir de poche, s’assura de son maquillage et le fit glisser malencontreusement dans la doublure qui s’était décousue. Pêchant la dernière cigarette de son paquet, elle l’alluma en s’y reprenant à trois fois. Ses mains tremblaient. Enfin, elle aspira une longue bouffée en fermant les yeux, cou tendu, tête en arrière, comme les héroïnes de films dont elle se gavait à la télé, cherchant dans la nicotine un substitut à la drogue qui lui manquait.
Brice avait promis de lui apporter sa dose. Elle venait de se coltiner trois passes pour en monnayer une partie, trois passes avec des gars du café PMU près de la gare. Elle retint une envie de vomir, trois vicieux qui venaient de toucher une avance sur leur paie et en voulaient pour leur fric. Ils avaient exigé d’elle des trucs dont elle n’aurait jamais eu l’idée, la baiser, les trois ensemble, ils avaient promis une rallonge. Elle avait accepté, bien sûr ! Le sexe à la sauvette, elle connaissait. Des camarades du lycée qui voulaient faire leurs premières armes et comparer leur expérience entre eux, les copains que son frère aîné lui imposait avec la ferme recommandation d’être plutôt compréhensive. Quant à son père, il la jouait aux dominos dans la salle à manger un mardi sur deux, pendant que les plus jeunes dormaient. Sandra savait ce qu’il lui en coûterait de refuser, aussi retardait-elle toujours l’heure de son retour. Les mauvaises rencontres de la rue n’étaient pas pires que celles qui l’attendaient chez elle. Avec ces hommes, elle avait appris à faire le vide dans sa tête, fermer les yeux pour ne pas voir leurs regards brillants de lubricité et détourner sa bouche en serrant les dents, tentant d’éviter la leur, humide, impatiente, dont l’haleine empuantie d’alcool lui donnait la nausée. Parfois, elle devait céder, les joues prises en étau par les mains brutales, les doigts forçant sa bouche. Elle savait être docile pour que cela cesse vite, se dégageant d’un coup de reins et s’enfuyant dans la salle de bains quand ils n’étaient pas arrivés au bout de leur désir. Et surtout, ne pas protester, ne pas se plaindre, cela aurait provoqué la violence de son père.
Sandra s’en fichait, elle se le répétait pour ne pas sombrer dans le trou noir qui la guettait. Tous des salauds qui confondaient gémissements de souffrance et soupirs de jouissance. Sandra ne jouissait pas, elle réprimait ses cris de dégoût et retenait sa douleur pour supporter ces étreintes sauvages et rapides qui l’écorchaient dans son corps et dans son cœur. L’an dernier, elle avait essayé d’en parler à l’assistante sociale du bahut, mais au dernier moment elle avait reculé. De toute façon, tout le monde s’en fichait, et l’autre, avec sa distribution de préservatifs et ses conseils débiles, ne comprendrait jamais ni pourquoi ni comment, elle en était arrivée là. Et puis, si son frère ou le vieux filaient en taule, qui apporterait de quoi payer les factures d'une H L M ? Ce n’était sûrement pas sa mère avec ses ménages à l’hospice le jour et dans les bureaux la nuit ! Un flux de haine monta en elle. Sa mère savait tout de son martyre, mais ne dirait jamais rien, feignant l’ignorance pour ne pas en subir les conséquences.
Elle était née sous une mauvaise étoile, elle en était persuadée depuis longtemps, mais elle s’acharnait à croire au miracle. Seule Alicia lui avait fait entrevoir un petit coin de paradis. Elle l’aimait beaucoup cette femme, et il lui arrivait de se confier à elle, juste à elle, dans ses moments de trop gris. Pourtant, la grosse femme noire qui promenait sa carcasse au milieu des Chênes verts ne lui était rien, juste une voisine, mais elle avait aussitôt deviné dans le regard de la jeune fille combien elle en vivait de dures. Alicia savait, comme les autres, mais jamais elle n’avait porté sur elle un œil accusateur ou méprisant. Un jour de trop noir, de trop dur, Alicia l’avait écrasée contre sa vaste poitrine. Sandra avait failli s’étouffer entre les deux solides bras qui la plaquaient contre elle. Petit à petit sa chaleur avait envahi son corps, et elle avait entendu battre son cœur. Impressionnant le bruit de ces coups sourds dans la grosse caisse qui vibrait régulièrement, et elle s’était laissé bercer par ce son. Jamais Sandra n’avait perçu de si près le bruit d’un cœur qui battait ainsi, presque que pour elle, elle en avait été remuée à en pleurer.
Alicia avait deviné cette émotion, si forte qu’elle affaiblissait, si rare qu’elle surprenait et déroutait. Elle avait continué à la bercer comme un nourrisson, presque tentée de lui fredonner un de ces airs Gospels entonnés à la chorale du quartier qu’elle dirigeait. La petite salle prêtée par le centre social réunissait toutes les paumées de la cité. Elles voyaient dans le chant une merveilleuse évasion, un extraordinaire voyage au pays du coton en oubliant combien autrefois il avait fait souffrir. Avec Sandra, elle s’était contentée d’un son entre ses dents, comme une mélopée, douce et grave. Sandra avait presque regretté que cela s’achève et la femme noire l’avait persuadée en quelques mots magiques que tout le mal de la terre ne pouvait pas s’acharner sur une même personne. Il y aurait forcément un jour où elle découvrirait le bleu du ciel et le jaune du soleil. Sa vie prendrait alors une couleur rose et lilas, et son cœur voguerait dans une mer d’un vert profond.
Alicia aimait parler en couleur, peut-être pour oublier celle de sa peau, si noire, si triste, si sale comme disaient les enfants qui ne la connaissaient pas. Une Black ! Mais Alicia pardonnait à tout le monde. Elle avait tant trimé et hurlé elle-même qu’elle pouvait tout comprendre. En entendant Sandra se révolter contre l’indifférence des autres, elle l’avait convaincue qu’elle seule devait se prendre en main sans attendre des autres un geste de compassion. Non qu’ils s’en fichent, mais ils n’en avaient pas le temps, occupés chacun à courir derrière leur misère comme s’ils avaient peur qu’elle leur échappe.
Sandra avait cru aux paroles d’Alicia et elle se sentit brusquement frustrée de ce rose et de ce bleu. Elle espérait qu’un C A P de coiffure lui donnerait sa chance, même si elle était en retard par rapport aux autres. Sandra adorait toucher les cheveux. Les doigts impatients de sa mère n’avaient su que tirer et arracher les siens. Au salon, les boucler, les tresser, les teindre, lui procurait un intense plaisir, un petit miracle qu’elle s’attribuait quand elle était parvenue à découvrir dans le regard de la cliente l’imperceptible satisfaction qu’elle voulait lui cacher par mesquinerie. Après tout, ce n’était qu’une apprentie !... Mais la patronne qui l’avait prise à l’essai pendant l’été venait de rompre son contrat d’apprentissage. Trop d’absences, trop de bêtises aussi, et elle ne pouvait nier. Elle n’arrivait plus à se concentrer, surtout depuis que Brice l’avait progressivement habituée à la coke. La coke, elle ne pouvait plus s’en passer, c’était le rêve après le cauchemar, ce petit bout de route pour le rose d’Alicia qu’elle se payait et qui l’emmenait bien loin de la cité bruyante et puante, dans un monde d’amour artificiel.
D’amour et d’amitié surtout. Sandra était affamée de tout ce qui faisait la vie belle aux autres. Le réveil était à chaque fois plus rude et elle n’avait qu’une hâte, s’élever à nouveau dans l’épaisseur de ce nuage qui l’engloutissait quelques heures comme dans une coquille protectrice.
Le reste, ce n’était que le moyen indispensable pour y parvenir.
La cigarette s’était presque entièrement consumée. Juste avant qu’elle ne s’éteigne, Sandra l’appliqua sur son bras. La douleur irisa sa peau en lui apportant presque du plaisir. Hypnotisée, elle fixa pendant quelques minutes ce petit rond rouge et brun qui la cuisait et faisait suite à une myriade d’autres petits soleils bruns, comme un collier. Elle balança le mégot par terre, la grosse semelle l’écrasa.
Brice arriva dans son Audi noire, rutilante, sans une éraflure. Il ouvrit la portière et lui désigna le siège. Elle monta sans mot dire. Avant de s’envoyer sur son nuage, il lui fallait remplir un autre contrat dans une baraque de chantier, un ou deux mecs qui voulaient s’offrir la totale avant de reprendre les trois-huit, et s’en retourner soulagés chez eux le soir avec bobonne, les enfants, le chien, la soupe et l’émission télé. Elle s’isola dans sa tête, sourde à la musique raï diffusée dans l’autoradio. Elle posa son front contre la vitre et ferma les yeux.
Elle s’était assoupie, elle se sentit secouée. Brice proposait de prendre un verre dans un bistrot avant de rejoindre la cabane. Trop heureuse de retarder, ne serait-ce qu’un instant, le but de sa destination, et plutôt surprise de cette rare attention, elle acquiesça d’un mouvement de menton. Il choisit une table dans un recoin sans clarté, la moleskine d’un rouge fané qui collait aux cuisses, le long miroir piqueté de vieillesse et de chiures de mouches au-dessus des banquettes reflétait la silhouette des buveurs attablés et des joueurs de belote. Les plaisanteries volaient gras et bas. Des mégots débordaient des cendriers et traînaient par terre. Plutôt crado pensa-t-elle. Avant que le serveur n’apporte les cocas, il lui suggéra d’aller se remaquiller un peu. Elle avait mauvaise mine, les gars voulaient s’amuser, pas s’apitoyer sur son allure de chat écorché.
— T’as pas une cigarette, mon paquet est fini.
Brice haussa les épaules.
— C’est ton jour de chance, tiens, mon dernier joint ! Gratuit ! T’auras le reste après !
Sandra n’en revenait pas, Brice n’avait pas l’habitude d’être aussi généreux. Elle s’éclipsa. Près des lavabos, elle s’appliqua à profiter au maximum de ce cadeau inattendu. L’herbe la détendit, elle se sentit mieux. Après avoir mouillé le bout incandescent, elle le balança dans la poubelle qui débordait sous les lavabos. À son retour il lui tendit son verre.
— T’en as mis du temps !
Elle haussa les épaules, un peu euphorique, puis porta le verre à ses lèvres et le but d’un trait.
— C’est du coca ? demanda-t-elle un peu surprise par le goût de la boisson.
— Je t’ai rajouté un peu de whisky, ça te donnera du plomb dans l’aile. Tu as vraiment une sale tête !
Sandra ne s’étonna pas que Brice lui trouve mauvaise mine, elle était même plutôt crevée. Il entama une conversation à mi-voix avec le serveur, elle n’entendait pas ce qu’ils se disaient, mais ça lui était égal. Une fatigue et une irrésistible envie de dormir l’envahirent doucement, c’était presque bon. Elle se sentit tirée par la main et poussée dans la voiture. Le trajet s’effectua dans une ambiance étrange, elle avait envie de réagir, mais cette sensation de se mouvoir au ralenti ne lui était pas désagréable. Elle était incapable d’évaluer pendant combien de temps ils roulèrent, assez peu, lui sembla-t-il. Ils arrivèrent à destination et elle s’aperçut, malgré son malaise grandissant, que ce n’était pas la cabane de chantier habituelle. Mais là encore, elle ne protesta pas. Il la poussa sans ménagement, elle tituba, et se laissa tirer sans opposer de résistance. Quand la porte s’ouvrit, elle distingua dans la pénombre entretenue par une ampoule blafarde plusieurs hommes et une paillasse à terre. Ce n’était pas ce qu’il lui avait dit.
Leurs yeux.
Dans la maigre lueur, Sandra ne vit que leurs yeux avant qu’ils ne la jettent littéralement sur le matelas. Des yeux brillants, de concupiscence et de cruauté, comme ceux des loups affamés qui encerclent leur proie, et d’autres, effrayants et froids, comme ceux des serpents qui savent attendre en balançant la tête juste avant d’envoyer les crocs mortels. Le reste... Ce ne fut qu’une perception irréelle de ce qu’elle subissait, un dédale de souffrances, de brutalités de tous côtés, auxquelles elle ne put s’opposer et encore moins résister. Elle assista presque en étrangère à sa descente en enfer. A-t-elle crié ? Ont-ils seulement entendu ? Cela faisait plus d’une heure et demie que la porte s’était refermée sur elle quand tout cessa enfin. Dans l’obscurité de la pièce, elle était incapable de lever son poignet pour lire l’heure. S’était-elle évanouie ?
Le silence après les cris d’excitation et les rires obscènes, la paix du corps après la torture, la solitude rassurante dans le noir, et cette sensation que la vie s’échappait lentement. C’était très bien ainsi, ça ne recommencera jamais plus ! Elle offrit un sourire à la faucheuse qui venait.
Elle avait dû perdre à nouveau connaissance, dehors, elle devina la nuit à cause du reflet de la lune. Depuis combien de temps gisait-elle sur cette paillasse ? Dans le clair-obscur qui l’entourait, elle ne distinguait que des formes d’outils posés sur une longue étagère. Un bruit de porte attira son attention, un visage se penchait, une lumière se balançait au-dessus de sa tête comme la corde du condamné. Elle ne pouvait même pas crier, implorer. Un espoir qui malgré elle fusait, on la secourait. Puis l’horreur quand elle comprit. Des mains se crispaient autour de sa gorge, la serraient et l’étouffaient. Un éclair d’acier fusa devant ses yeux, puis ce fut un coup violent sur sa tête lui apportant l’oubli, presque la délivrance.
Non, pas encore, la marche dans le long tunnel sombre n’était pas achevée. Il lui faudrait encore souffrir pour mériter sa mort.
2. Gladys, Les Lilas
Le jour n’était qu’un point blanchâtre quand Gladys Miller se leva et brancha la cafetière. Alors que l’arôme revigorant du café se répandait dans la maison, elle ouvrit le carnet posé en permanence sur la tablette du téléphone et inscrivit quelques mots. Une habitude conservée depuis que ses idées se bousculaient dans sa tête à n’importe quel moment de la journée et de la nuit. Le plus souvent, à deux ou trois heures, quand les chouettes hululaient encore et que les étoiles commençaient à s’estomper. Trois autres carnets occupaient des postes stratégiques, la salle de bains, la cuisine et sa table de chevet. Elle notait rapidement de courtes phrases, quelques questions, deux ou trois projets de paragraphe. Remettre à plus tard lui faisait perdre la tournure précise d’une phrase jaillie de son subconscient, sans aucune chance de la restituer intacte. C’était simplement alors qu’elle pouvait reprendre la tâche entreprise ou espérer se rendormir l’esprit en paix.
Elle s’accorda le moment délicieux du petit déjeuner dans le silence, laissant son esprit vagabonder si loin qu’elle ne sut pas vraiment où il s’était enfui. Elle remit pied sur terre, l’ordinateur allumé patientait. Sans plus attendre, elle se plongea dans son labyrinthe de mots et de phrases, progressant consciencieusement dans son roman, sans s’appesantir sur l’automne proche qui, par sa flamboyante floraison, donnait à sa rocaille une couleur chaude, sans nostalgie pour les fleurs endormies jusqu’au printemps prochain. Elle s’absorba, uniquement gagnée par la faim qui la tenaillait de pousser toujours plus loin sa résistance à la fatigue, à la douleur de son dos et de ses doigts qui refusaient parfois d’en faire un peu plus en plein milieu d’un chapitre haletant. Le polar devait sortir au début du printemps. Pour un travail soigné, elle n’avait pas trop de temps devant elle.
Gladys ne se plaignait pas, elle s’en tirait bien sur le plan financier. Depuis dix ans, elle avait totalement abandonné le journalisme pour ne se consacrer qu’à l’écriture, sa passion. Ce n’était pas encore la célébrité, mais une demande régulière et croissante de lecteurs qui attendaient avec plus ou moins d’impatience le prochain Miller, le pseudonyme qu’elle avait choisi en hommage à GLENN MILLER, le jazzman qu’elle adorait. Elle collaborait aussi à des scénarios de polars et même si son nom restait encore dans l’anonymat, elle en éprouvait une grande satisfaction. Le syndrome de la page blanche ne la hantait pas, elle créait, encore et toujours, et au fil des romans et des années, ses personnages étaient devenus ses amis. Ils peuplaient sa mémoire d’instants vécus en leur compagnie, d’aventures exaltantes ou de drames auxquels elle assistait presque en spectatrice tant ils paraissaient naître d’eux-mêmes, mais pour lesquels elle souffrait avec autant d’intensité. Elle pensait à eux comme à de véritables êtres doués du sens de la parole et de la pensée, et dans ses moments de blues, c’est auprès d’eux qu’elle se réfugiait. Eux seuls comprenaient ses états d’âme. De vrais amis, comme faits de chair et de sang, oublieux de leurs soucis, à l’écoute de la plainte qui parfois s’insinuait et éclatait dans sa gorge.
Les autres, les humains, la vie les lui avait arrachés. Ceux qu’elle aimait le plus, ses parents, divorcés dans son jeune âge, et disparus l’un après l’autre, à quelques mois d’écart, comme si la mort avait été l’unique solution pour les réunir dans la paix. Ils reposaient ensemble dans le cimetière de Roussillon. Puis les quelques relations qui gravitaient autour d’elle, des auteurs pour la plupart, lâchement enfuis lors de sa séparation d’avec son compagnon. Malgré les circonstances, Pierre avait recueilli la faveur et le soutien de leur cercle d’habitués. Ils s’étaient détournés d’elle sans l’ombre d’un remords. Il avait su les convaincre. Pas elle. Sans doute à cause d’un caractère entier, hérité de son père, qui constituait le perpétuel reproche dont l’affublait son compagnon quand il perdait pied devant son opiniâtreté.
Ce caractère pur et sans concession, surtout quand elle savait avoir raison, lui avait alors fait condamner la valse-hésitation de ses propres amies qui n’avaient pas su être présentes dans la tourmente. Toutes s’étaient subtilement retranchées dans le respect de leur vie privée pour n’être pas amenées à porter préjudice à l’homme qu’elles admiraient. Gladys avait compris. Elle n’aurait aucun soutien de ce côté-là, et ce fut une déception qui s’ajouta au reste. La trahison et la lâcheté lui étaient insupportables, elle préféra la solitude à l’hypocrisie.
Pierre était un Dieu, et elle avait osé le faire dégringoler de son piédestal, pire, le faire condamner par la justice. Celles qui se disaient alors ses véritables amies, incontestables adoratrices du romancier adulé par un lectorat presque exclusivement féminin, ne lui avaient pas pardonné de l’avoir traîné dans le box des accusés, elle qui avait eu cette incroyable chance de s’en faire aimer.
Devant ce mutisme et cette condamnation sourde, Gladys ne donna aucune explication. À quoi bon tenter de se justifier, personne n’avait eu envie d’entendre et encore moins de comprendre. Et puis, sa douleur n’appartenait qu’à elle, tout comme ses regrets. Une demi-heure après le verdict, elle avait fui la salle hostile, emportant avec elle le long regard de Pierre quand, avant de quitter son box, il l’avait fixée avec insistance. Elle n’avait pu mettre un nom sur l’expression collée à ses traits, haine, remords, désespoir? Elle était elle-même trop atteinte pour avoir la force de s’attendrir sur son sort. Ensuite, elle avait simplement refermé la porte de son appartement, décrochant le téléphone, s’isolant du monde extérieur pendant une semaine. C’est le temps qu’elle s’était fixé, pas un jour de plus, pour aborder une vie définitivement privée de Pierre et du passé. Elle ne consulta plus sa messagerie et abandonna le roman en cours. Ses nouveaux personnages ne lui étaient pas encore assez familiers pour la soutenir. Elle préféra combattre seule.
Non, elle n’avait pas bu à en oublier le temps et les heures, même si la tentation avait été grande, elle réservait ça à ses héros de papier, elle voulait rester lucide. Non, elle ne s’était pas gavée de sucreries censées apaiser le stress ni dévalisé son réfrigérateur, l’idée de manger lui soulevait le cœur. Elle n’avait pas non plus parcouru les albums photo des jours d’avant. Morbides ! Elle s’était simplement laissée glisser dans le gouffre, la solution idéale pour ne penser à rien de précis, et se noyer petit à petit sans lutter, presque avec soulagement. Puis, le coup de pied au fond, le bond salutaire, la révolte contre elle-même d’oser partir en abandonnant tout, lâchement.
Non, elle ne serait pas une marionnette désarticulée que l’on jette sans un regard. La petite lueur qui résistait vaillamment au fond d’elle, et qu’elle distinguait à peine, c’était l’espoir, même s’il n’avait pas encore de visage. La boule qui l’opprimait s’amenuisa, elle put enfin pleurer, roulée en boule dans son fauteuil, doucement, puis fort, s’obligeant à arracher de son cœur tous ses souvenirs de bonheur qui s’obstinaient, ceux d’avec Pierre, et les autres, surtout les autres, ceux qu’elle avait anticipés, qu’elle aurait pu vivre si... pour qu’ils ne l’empoisonnent plus à l’avenir.
Pour faire passer les jours et les heures de sa convalescence, elle avait entrepris un grand ménage de printemps, à briquer, cirer, dépoussiérer, sans oublier un seul petit coin, insistant même où ce n’était pas utile, triant des vêtements qu’elle ne remettrait jamais plus, surtout ceux qui ressuscitaient de beaux souvenirs. Même son bureau y passa. Rien de tel que de mettre de l’ordre autour de soi pour en mettre en soi. Cependant, malgré le vide qui l’habitait, pendant deux mois elle n’alla pas retrouver ses amis de plume, ceux qui s’étaient endormis dans son ordinateur en attendant son retour. Trop tôt, elle n’aurait pu leur mentir. Ils auraient vite découvert sous ses mots anesthésiés la douleur encore présente, le rire mensonger. Impossible de leur donner le change, elle était trop intime avec eux pour les tromper. Un peu schizophrène, bien sûr, comme tous les créateurs qui trouvent dans l’irréalité un monde parallèle dans lequel ils évoluent à loisir.
Puis froidement, repoussant au fond d’elle cette incroyable glaçure qui l’étreignait, elle décida d’entamer un nouveau voyage. Sans oser trop réfléchir, elle prit la seule décision qui s’imposait. Fuir ailleurs pour tout recommencer. Lâcheté ou réaction salutaire ? Peu importait, il lui fallait combattre seule. Enfin, pas tout à fait seule puisqu’elle avait la chance de pouvoir créer un monde issu de son imagination et des amis à sa mesure, à sa convenance, et même si c’était illusoire, c’était mieux que souffrir à en crever. Elle vendit son bel appartement parisien et retourna dans sa région natale. La maison familiale ne lui convenait pas, elle la vendit sans remords et acheta la vieille maison aux murs de pierre qui l’avait accueillie alors que les lilas blancs et violets explosaient en grappes fleuries et embaumaient l’air. Elle la baptisa de leur nom. Les Lilas.
Heureusement, dans son horizon ravagé il lui restait un ami, Jacques, sans lequel elle n’aurait jamais pu tenir le coup. Depuis son emménagement campagnard, celui-ci lui rendait souvent visite aux Lilas. Il y était comme chez lui, squattant un ou deux tiroirs vides et des étagères pour ses précieux appareils photo qu’il refusait de laisser dans son appartement courant d’air parisien. Vaquant d’une pièce à l’autre en toute liberté, il s’y installait même quelques jours quand Gladys se rendait dans la capitale. Reporter au magazine Le monde ailleurs, elle l’avait croisé pour la première fois alors qu’elle remettait à son boss un bon papier certes, mais qui manquait de photos pour enfoncer le clou. Jacques les avait interrompus en souriant, répétant avec ironie la phrase cliché d’un journal célèbre pour lequel il avait souvent travaillé, proposant spontanément les siennes pour secourir une inconnue, sa réputation n’était plus à démontrer. Tout s’était enchaîné, d'autres rencontres dans les couloirs, devant la machine à café, puis quelques rendez-vous dans les troquets parisiens. Gladys était persuadée qu’il se déclarerait à un moment propice, mais non, Jacques semblait en fuite perpétuelle, comme si le sol de France lui brûlait les pieds, un errant, un va-t-en-guerre, toujours de retour ou prêt à partir. Un homme qui gérait sa solitude comme une compagne nécessaire à sa profession, ne s’encombrant d’aucune attache, ne laissant aucun numéro où pouvoir le joindre
Le hasard tisse l’avenir à sa façon, c’est Jacques qui avait mis Pierre sur son chemin. Se sentait-il un peu responsable ?
Elle avait confié à ce seul ami qui lui restait son projet de fuite et de renaissance et il l’avait soutenue dans ce difficile travail de démolition et de deuil qu’elle s’était imposée. Plus rien ne devait subsister de ce passé. Mais surtout, il savait tout de l’irrémédiable chagrin qui avait dépassé en tout la douleur de sa séparation d’avec Pierre. Depuis le drame, Gladys s’était bâti une solide armure pour repousser tous les assauts que son corps menait, éteindre ses désirs, ignorer ses besoins, une véritable automutilation, mais parfois la carapace se fendillait et sa sensualité inassouvie accentuait son manque, et l’impression d’avoir perdu jusqu’à son âme.
Du vide, elle évoluait dans du vide.
L’écriture devint alors son véritable lieu de repli, une tanière où nul ne pourrait l’atteindre pour la blesser. Elle fit de ses pages blanches un implacable miroir dans lequel elle se mira sans complaisance, nue et vraie, cherchant dans les lignes qui s’échappaient de ses doigts la vérité qu’elle avait consciemment ignorée, par lâcheté, et qui à présent l’éclaboussait. Pierre ne portait pas à lui seul toute la responsabilité de la mort de leur enfant. Quand elle admit cette vérité, elle eut de nouveau envie de vivre, ne serait-ce que pour tenter de réparer. Magnanime, elle s’accorda de l’écoute et de l’estime sans lesquels elle n’aurait pu progresser, mais surtout, elle s’offrit une impitoyable autocritique, si difficile, si sincère et si blessante quand elle s’avouait sa justesse.
Gladys avait laissé refroidir sa deuxième tasse de café, elle la repoussa. Son inspiration enfuie, elle traîna d’une pièce à l’autre, sans se décider à ranger un peu le capharnaüm qui sévissait dans le salon. Mais il n’y avait pas urgence, deux jours à attendre et lundi, Jasmine sera là pour l’aider. Un peu de ménage, si peu, uniquement le classement de sa documentation, le réapprovisionnement de son imprimante, puis, comme à son habitude, de longues plongées dans les manuscrits épars et non publiés pour lesquels elle donnait toujours son avis. La passion de la jeune fille pour ses romans l’avait convaincue de ne plus exiger d’elle les heures de ménage qu’elle détestait faire elle-même. Elle engagea donc quelqu’un d’autre. Seul impératif, que Jasmine reste auprès d’elle.
Bientôt Jasmine viendrait mettre un peu de vie dans cette maison endormie. La jeune fille remplissait presque tous les vides qui étaient en Gladys, sauf un seul qui ne serait jamais comblé. Cela ne faisait-il vraiment que deux ans qu’elle avait franchi le seuil de sa porte et pénétré dans son cœur ?
3. Gilles Moreau
Dans la salle enfumée du Marrocco, un bar à la périphérie de Roussillon, des hommes en bleus de travail éclusaient verre sur verre. L’œil brillant, la lèvre humide, ils échangeaient des propos salaces sur les prouesses qu’ils réaliseraient dès que la nuit serait plus avancée. Encore une bonne demi-heure à patienter, une autre tournée générale, et ils auraient droit à leur récréation. À bien écouter, il ne s’agissait nullement de péripéties dans la couche conjugale. Ils avaient rendez-vous dans un lieu précis pour y être acteurs ou spectateurs. C’était à celui qui épaterait le plus par ses détails scabreux, ses descriptions imagées teintées de pornographie, espérant par tous les moyens convaincre les autres de ses performances.
Derrière son comptoir, Moreau essuyait le zinc d’un geste nerveux, un rictus d’agacement sur les lèvres qu’il voulait faire passer pour un sourire commercial. Si ce n’était le bénéfice enregistré par ces boit-sans-soif qui ne vérifiaient même plus la note de leur ardoise ni la qualité du vin qu’il leur servait tant ils étaient éméchés, il les aurait jetés dehors.
Il sentit à nouveau une crampe malmener ses tripes. Comment faire pour arrêter les conneries auxquelles il avait participé sans se douter qu’elles tourneraient mal ? L’autre jour, tout s’était passé de manière différente, il ne l’avait appris que plus tard, il en avait eu des sueurs et des cauchemars. Mais il devait continuer à la fermer. Il était furieux. Un de ces quatre, il finirait par payer lui-même l’addition. Convaincu qu’il s’était engagé dans un chemin dangereux, il ne pouvait cependant plus faire machine arrière. Son protecteur le tenait à la gorge, et il ne désirait pas que son bar subisse à nouveau sa furie.
Et merde ! Pourquoi s’était-il fourré dans ce guêpier ? Au début, fournir les ados en poudre l’avait plutôt amusé. Des petits connards qui se shootaient dans les caves en imaginant atteindre le paradis. Mais très vite ils étaient devenus exigeants, le menaçant de le dénoncer s’il ne les fournissait pas plus régulièrement. Il s’approvisionnait au minimum, juste pour dépanner et gagner un peu de fric, pas le vrai business. Mais depuis, la demande grandissant, accompagnée de sous-entendus bien explicites, il se trouvait acculé. C’est là que l’autre était entré en jeu. Ferré Moreau !
Il jeta un coup d’œil impatient à l’horloge crasseuse de chiures de mouches. Il n’allait pas tarder à leur faire signe. Un petit soupir s’exhala de sa poitrine. Qu’ils dégagent !
4. Déchetterie, Roussillon, 18 septembre
Robert Berthet ouvrit les longues grilles de la déchetterie. Il n’était pas encore neuf heures et déjà la file de camionnettes et de remorques chargées des dernières tailles de haies s’impatientait.
— Hé alors, Bébert, tu dors encore !
— Oh, mollo, l’heure c’est l’heure !
— T’es plus à la Poste, et nous, on a encore du boulot !
— T’as tout le temps pour te fatiguer, profite un peu de la vie !
— Alors, viens terminer ma haie et j’irai faire une pétanque !
— Si t’en as marre de ce boulot, t’as qu’à faire comme moi, habiter une HLM ! Pas de pelouse, pas d’arbres, pas de haies !
— Plutôt crever !
Tous les jours la même scène avec des acteurs différents. Bébert la connaissait par cœur, mais elle lui aurait manqué si l’un d’eux n’y avait pas sacrifié. Ici, c’était autre chose que l’ambiance des HLM. Hier soir encore des petits cons faisaient du rodéo sur les pelouses pendant que d’autres taguaient les murs du local à poubelles. Chiottes de chiottes, s’il avait eu le choix !
Il n’avait pas accroché la barre que le convoi s’éparpilla. Le chemin du haut pour les bennes qui recevaient les divers matériaux, en bas pour aller droit vers la carrière. D’habitude, les usagers avaient obligation de passer aussi par en haut, pour faire contrôler le contenu de leur chargement. Des saligauds en profitaient pour dissimuler des pneus sous les branchages et les faisaient tomber par inadvertance dans les déchets verts. Mais il n’avait pas que ça à faire, et les gars, il les connaissait presque tous. Il était presque heureux de naviguer d’une benne à l’autre, discutant avec les habitués, récupérant des ustensiles, des bouteilles de gaz, et parfois même des meubles qu’il arrangeait et vendait pour se faire une cagnotte. Un jardinier amateur l’interpella.
— Ça y est ! De retour !
— Il me restait des RTT, j’ai tout pris !
— Personne ne te le reproche, mais on a nos habitudes. Et puis ton remplaçant était plutôt cool. Lundi dernier vers la carrière c’était inaccessible. Les gars déversaient au bord du chemin.
— Toujours pareil ! On donnera un coup de bull et on repoussera tout dans la pente ! Allez, à la prochaine !
— Pour moi c’est bientôt fini ! Un dernier chargement, et après, je file tous les week-ends à la chasse !
— Veinard !
Émilien démarra en dérapant un peu, la remorque pleine de branches de lauriers, une vieille haie qu’il venait de condamner au profit d’une petite esplanade ombragée. L’été, le nombre de participants autour de la table grandissait d’année en année, et la place commençait à manquer. Sur la terrasse on grillait. Bon, plus qu’un voyage avec les souches, et il pourrait souffler un peu.
Au bord du ravin, c’était toujours le même encombrement. Il se dirigea un peu sur la gauche et se gara en marche arrière pour déverser. Avec le râteau, il fit glisser les branches, puis s’avança un peu au-dessus du vide pour les faire dégringoler plus bas. Machinalement il balaya des yeux le bas de la pente.
— Tu parles des enfoirés ! Ils ont même la flemme de jeter les vêtements dans la benne à tissu !
C’est alors qu’il sentit l’effroi l’envahir. Il distinguait nettement une tête qui sortait des gravats. En se penchant davantage c’est un pied qui avait l’air de flotter sur une branche et émergeant des détritus, une main encore ouverte, comme pour un appel à l’aide. Un écœurement envahit ses tripes et monta au cœur. « Je vais dégobiller ! » pensa-t-il. Pas de doute, un corps gisait sous les branchages. Il resta sans voix, les jambes paralysées. Son premier réflexe fut d’appeler à l’aide, mais de l’endroit où il se trouvait personne n’entendrait. Il vida rapidement sa remorque, démarra en trombe et fila à vive allure malgré les cailloux qui ripaient sous ses roues pour prévenir Bébert. Il débita sa macabre découverte d’un trait, les jambes encore flageolantes d’émotion. Il ne faudrait pas longtemps pour que les gendarmes rappliquent.
— Je vais chercher mes souches et je reviens. Ils voudront peut-être m’interroger.
— Je le leur dirai, allez, grouille !
Le gardien appela le 17, donna le peu de renseignements qu’il possédait sans toutefois préciser qu’une tête dépassait des éboulis et fila derechef vers le ravin. Arrivé au bord de la pente, il hésita un peu et se laissa glisser jusqu’au bas du terrain. Médusé par le spectacle qui s’offrait devant lui, il regretta d’être descendu. Il ne toucha à rien, mais ne put détacher son regard du visage noirci de gravats dont les yeux vitreux fixaient obstinément le haut du ravin. Les traits exprimaient l’atrocité du dernier moment de sa vie. Bébert eut alors une curieuse sensation, comme un vertige, une nausée grouilla dans l’estomac et monta à toute allure dans sa gorge. Il n’eut que le temps de se détourner et courir à quelques mètres pour vomir son petit déjeuner.
L’adjudant Gabriel Chavant de la brigade de Roussillon essuyait la sueur qui coulait de son képi. La canicule n’était pas en cause, elle s’était calmée cet été. Le spectacle qu’il fixait le chavira. Il se croyait endurci, il déchanta. La fille devait être là depuis quelques jours. Dans la carrière la chaleur se concentrait, c’était sans doute la raison de l’état du cadavre et de la puanteur qui s’en dégageait. Les vêtements qui recouvraient le corps inerte étaient partiellement déchirés. Chavant la fixait, décontenancé, presque incrédule. Depuis qu’il était en poste ici, c’était la première fois qu’il était confronté à ce genre de crime. Certes, la commune n’était pas à donner en exemple, mais d’ici à imaginer le massacre d’une jeune fille... Il était secoué, de qui s’agissait-il, sortie de l’adolescence, mais pas encore une femme, probablement le même âge que sa fille.
Du creux du ravin, il entendit son adjoint Fargeot qui tentait de disperser les voyeurs. Il l’interpella d’un ton furieux :
— Fais les dégager !
— Pire que les mouches sur de la bidoche. En revanche le gardien est plutôt retourné, ajouta Fargeot.
— Pourtant il faudra qu’il nous aide un peu.
— Cette fois-ci, faut prévenir la BR de Vienne.
— Je m’en occupe !
Le téléphone nasilla.
— Quelle équipe ? demanda Chavant en fixant une fois encore le visage de la fille.
— Di Nazzo et Grandjean.
— OK ! Et le légiste ?
— Impossible ! Il est en pleine autopsie.
— Eh bien, l’adjudant fera son premier constat sur place et Pinaud l’examinera plus tard dans son labo !
5. Brigade des Recherches de Vienne
18 septembre
Di Nazzo abandonna la trituration de ses belles moustaches qui lui donnaient un certain charme pour tapoter un dossier du doigt et adressa un franc sourire à son interlocutrice. L’éclat de fierté qui brillait dans ses yeux en disait long.
— Bravo Borry ! Sur cette affaire vous n’avez pas manqué de flair !
— Comme quoi, le mien vaut bien le vôtre, n’est-ce pas mon adjudant ?
Auparavant, une telle réflexion l’aurait contrarié. Lui, son pif et son flair, ajouté à son nom... ! Il en avait entendu d’autres. Vacciné, aurait-il pu ajouter. Mais cette réputation n’était pas pour le desservir. Quant à celle qui venait de lui lancer sa petite vanne, très sympathique par ailleurs, elle était un de ses meilleurs éléments. Juste la maille, elle avait failli être recalée pour sa petite taille, blonde, mince, nerveuse, volontaire, têtue, opiniâtre corrigeait-elle en souriant, Cécile Borry avait intégré l’équipe de la BR de Vienne en qualité de chef. Elle s’était vite fondue dans le lot, tout en se distinguant par son acharnement à réussir une enquête entreprise, tentant par tous les moyens de faire oublier sa grande sensibilité qui n’était pas toujours un atout dans son jeu, mais cristallisait ce sixième sens infaillible dont Di Nazzo faisait grand cas. Lors d’une première enquête dans le village de Meyssiez, Cécile avait su s’imposer, jetant aux orties les ridicules critiques attribuées aux femmes en gendarmerie, et même Marc Grandjean, son bouc émissaire préféré, avouait qu’elle avait bien sa place parmi eux. Celui-ci avait dû souvent faire amende honorable et reconnaître aux gendarmes féminins des qualités que son instinct rejetait. Quant à Fabrice Briand, il l’avait adoptée dès le premier jour comme une sœur aînée. Son seul but aujourd’hui : glaner çà et là dans l’expérience de ses aînés pour en faire son profit. L’avancée dans ces techniques progressait à vive allure et Briand les mettait toutes à profit.
L’adjudant l’avait en grande estime pour ses qualités d’adjointe et d’enquêtrice, tout comme il appréciait son camarade Grandjean, un homme de terroir, musclé sans être massif, cheveux blonds, yeux bleus, des couleurs trop pâles qui lui ôtaient un peu de personnalité, le sourire et la plaisanterie toujours au bord des lèvres, amicalement baptisé par tous GJ, inconditionnel misogyne qui refusait de le reconnaître. Par sa connaissance du terrain et les us et coutumes de sa région, GJ lui était souvent d’un grand secours. Petit jeunot de l’équipe, Fabrice Briand, TIC, technicien en identification criminelle qui ne ménageait ni son temps, ni sa patience à la recherche d’indices souvent les plus ardus à déceler. Si Briand était un grand garçon mince, aux cheveux bruns et yeux sombres comme Di Nazzo, il n’avait pas son pouvoir de séduction qui, assurait-il avec une certaine fierté, lui venait tout droit de son arrière-grand-père. Il évoquait avec plaisir et malice son aïeul, un bel et séduisant Italien qui avait franchi les Alpes en de longues et harassantes marches pour fuir la misère de son pays, s’établir en France, et épouser une belle Bourguignonne qui le dépassait de deux têtes.
Tous quatre formaient une équipe solidaire, œuvrant dans une ambiance de camaraderie. Bernard Di Nazzo n’allait pas tarder à fêter la quarantaine, il était un supérieur hiérarchique intelligent, à l’écoute des autres et sachant reconnaître leur mérite sans tirer à lui la couverture dans la réussite d’une affaire.
Depuis deux jours, une atmosphère faussement tranquille régnait à la Brigade des Recherches de Vienne. Le calme avant la tempête aurait susurré GJ qui avait décidé pour la énième fois d’arrêter de fumer et ne se sentait bien que l’esprit et les mains occupés. Il fit irruption dans le bureau de l’adjudant et demanda sur un ton presque agressif.
— On n’a rien de nouveau à se mettre sous la dent ?
— Du calme, mon vieux, tu as une pile de dossiers qui périssent d’ennui. Pioche dedans !
— Pas possible. J’attends des résultats d’expertises et d’analyses.
GJ tapota la poche de son pantalon pour constater qu’elle était vide. Un profond soupir agacé s’exhala de sa poitrine. Di Nazzo ironisa :
— Mâche des chewing-gums à la nicotine, ça te soulagera !
— C’est comme si je t’offrais une bière sans alcool, ou un café sucré à la saccharine, je ne suis pas certain que tu apprécierais !
— Si je n’avais pas d’autre choix !... Et puis d’ailleurs, je bois le café sans sucre !
— OK. Mais j’aimerais bien que ça bouge un peu !
— T’inquiète, ça viendra bien assez tôt !
Il n’avait pas achevé sa phrase que le téléphone se manifesta.
Di Nazzo perdit vite le sourire qu’il avait eu en reconnaissant la voix de son interlocuteur.
— OK, on arrive...
Puis il s’adressa à Grandjean.
— Qu’est-ce que je te disais ! En route pour Roussillon, je t’affranchirai en route !
6. Jasmine
Dans un des appartements du groupe HLM, baptisé sans raison les Frênes puisqu’ils avaient disparu depuis bien longtemps, Yasmina Yilmaz repassait le linge de sa famille. De ses deux frères, l’aîné lui donnait le plus de travail. Le jeune homme attachait une grande importance aux soins apportés à ses vêtements. Il les inspectait d’un œil redoutable et la jeune fille avait appris à effectuer un travail soigné. Yasmina savait qu’il plaisait bien aux filles, et contrairement à ses copains, il portait rarement des jeans troués ou des pulls déformés, encore moins des survêtements. Il choisissait des pantalons et des blousons de marques, et ses chaussures ne venaient pas des halles de grandes surfaces. D’ailleurs, elle s’étonnait qu’il puisse investir tant d’argent. La boîte d’informatique dans laquelle il était employé avant son licenciement n’avait pas la réputation d’être généreuse avec son personnel. Elle le soupçonnait de travailler au noir ou de traficoter, et de ne verser aucune pension à son père. D’où la nécessité pour elle d’apporter sa contribution en cherchant un petit boulot. C’est avec impatience qu’elle attendait d’aller rejoindre Gladys.
Jasmine. C’était le nom qu’elle avait choisi de porter désormais, pour ressembler davantage à ses amies de lycée. Yasmina la classait trop vite dans la condition de fille voilée, même si elle ne l’était pas, musulmane, intouchable. Les regards autour d’elle étaient explicites, attention; se méfier, de sa famille surtout. À Roussillon la communauté turque éprouvait d’énormes difficultés à s’intégrer et les hommes jouissaient d’une mauvaise réputation. Tous les incidents et les faits divers leur étaient régulièrement attribués. Jasmine vivait dans la crainte de provoquer malgré elle un scandale qui l’aurait condamnée aux regards suspicieux et inquisiteurs de son père, et pire encore, de son frère. Sa mère, une Française qui s’était laissée embobiner par ce bel homme brun paré du mystère oriental, doux et enjôleur au début, autoritaire et implacable par la suite, n’avait plus proféré une parole depuis le jour où il l’avait convaincue qu’en l’épousant, elle avait aussi épousé ses lois et ses coutumes. Elle ne s’opposa jamais à lui, pas même pour soutenir ses filles qui, nées dans un pays de liberté, tombaient implacablement sous la coupe de l’Islam, remis en vigueur avec excès par les hommes de sa famille. Sa mort n’émut personne, depuis longtemps elle n’était qu’un petit fantôme qui se déplaçait le plus silencieusement possible pour n’irriter personne. La vie continua sans elle, et Jasmine la remplaça tout naturellement dans les tâches ménagères. Elle se sentait très seule, surtout depuis que sa sœur aînée Zeynep, malgré son amour pour un jeune Français, avait été mariée contre son gré en Turquie à un homme qu’elle ne connaissait pas.
Jasmine avait grandi dans cette petite ville implantée à la croisée de quatre départements, Rhône, Isère, Drôme et Ardèche, campée au pied du Pilat, proche de Vienne. Région productrice de fruits qui employait en grande partie des Turcs venus chercher une illusion de fortune. Contrairement à certaines de ses amies coreligionnaires, la jeune fille avait refusé de porter le voile, et même les menaces de son père et de son frère n’y avaient rien fait. Elle s’était appuyée sur les débats houleux qui agitaient les lycées, et avait décrété qu’elle ne voulait en aucun cas entrer dans le conflit.
Elle n’avait qu’un désir, s’instruire, et elle ne se voyait pas différente de toutes ses autres camarades de lycée. Elle pensait et réagissait comme elles, mais le soir elle redevenait la fille obéissante et soumise qu’il convenait. Certes, elle ne portait pas le hidjab, mais sa prison n’en était que plus insidieuse puisqu’invisible.
Petite silhouette mince habillée d’une éternelle robe longue, elle arborait le front nu, les cheveux noirs un peu frisés, tirés en arrière, avec un visage blanc et lisse. Ses yeux sombres, avec des sourcils épilés très fins de chaque côté d’un nez long et droit, étaient cernés de khôl, seul artifice consenti par le frère aîné. Cet ovale délicat et bien dessiné lui donnait une pureté qu’elle se devait d’afficher et de garder. Dans sa communauté la pudeur était de rigueur, la virginité sacrée. Elle était un gage incontournable pour le mariage. Son frère y veillait jalousement.
Jasmine se hérissait contre cette destinée que rien ne devait bouleverser. Elle s’ouvrait régulièrement de ses griefs contre sa famille à Gladys qui connaissait par cœur le registre de ses doléances.
— Gladys, j’ai bien l’intention de vivre comme bon me semble. Quelques-unes d’entre nous le font déjà et elles y arrivent fort bien. Mais il me faut quitter ma famille, et trouver un emploi qui m’assure liberté et indépendance. C’est pour cela que j’ai voulu que tu m’accompagnes à Valence. Mon père et mon frère auraient refusé de m’y emmener. Je veux préparer un BTS en communication, et m’assumer. Pour l’instant, je n’ai pas du tout l’intention de me marier malgré le désir pressant de mon père, et si cela était, c’est moi qui choisirai. Je refuse de vivre comme mes amies des autres familles turques qui sont cloîtrées et acceptent tout ce qu’on leur impose. Elles aussi devraient réagir ! On n’est plus à l’époque des harems !
Gladys souriait en écoutant ses arguments qui se voulaient convaincants sur le droit à la liberté de toutes les jeunes filles de sa génération, même celles qui pratiquaient la religion musulmane, souhaitant sincèrement que ce rêve se réalise. Jasmine les répétait sans cesse, comme pour s’en persuader, comme pour se fixer une ligne de vie dont elle ne devait pas dévier, ou pour contrecarrer le destin déjà tout tracé que lui réservait son père, et qu’elle redoutait. Après chacun de ses départs qui replongeaient Les Lilas dans le silence et la solitude, et tout au long du trajet qui la ramenait chez elle, la jeune Turque laissait gonfler en elle une révolte silencieuse devant le sort qui l’obligeait à se soumettre sans mot dire aux lois de ses aînés. Elle restait convaincue que l’autorisation de travailler chez Gladys lui avait été accordée uniquement parce qu’elle vivait seule et qu’aucun homme ne rôdait pendant sa présence. Elle avait tout appris de la discrète enquête menée par son frère aîné.
L’annonce que Gladys avait rédigée sans conviction, parue dans le journal local et affichée sur le panneau de petites annonces au lycée, avait changé sa vie.
Cherche jeune fille sérieuse pour effectuer travail de bureau et quelques heures de ménage. Horaires après cours acceptés.
La réponse n’avait pas tardée. « Jasmine sera présentée par son père » avait précisé le directeur du lycée. Si Gladys n’avait pu réprimer sa surprise à cette exigence, elle comprit dès qu’elle vit les deux personnages qui se tenaient un peu en retrait de sa porte d’entrée. L’homme, une cinquantaine d’années, brun de peau et de poil, avec seulement quelques fils d’argent aux tempes, portait une djellaba par-dessus son pantalon de Tergal. Gladys identifia immédiatement dans cet homme au regard arrogant et autoritaire, un Turc qui vivait en famille à la périphérie de Roussillon. Elle devina sa surprise, sans doute s’attendait-il à rencontrer une femme d’un certain âge.
Yasmina en revanche s'était réjouie, un peu plus de trente-cinq ans pensa-t-elle avec soulagement. Ses cheveux blonds coupés en dégradé, sa frange légère, son regard vert, tout lui plut, elle espérait bien s’en faire une alliée. Le père avait jeté un regard circonspect dans le hall et les pièces du rez-de-chaussée, dont le bureau dans lequel elle travaillait. Son attitude ne laissait aucun doute quant à la méfiance qui l’habitait. Apparemment, il cherchait quelque chose du regard et le fait de ne pas l’avoir trouvée eut l’air de le rassurer.
— C’est pour l’annonce ! Yasmina pourrait venir, elle sait faire du ménage, même de la cuisine, sa mère lui a appris ! La place est toujours libre ?
— En effet ! J’ai besoin d’aide, mais pas seulement pour du ménage. Je n’ai pas assez de temps pour m’occuper de mon courrier et ranger ma documentation. Si elle sait travailler sur un ordinateur....
— Qu’est-ce que vous faites ? avait-il demandé soudain alerté.
Gladys avait intercepté le regard brusquement inquiet de la jeune fille, et sentant le danger de sa réponse, avait simplement annoncé quelques-unes de ses activités en omettant soigneusement ses romans.
— Je prépare des conférences, des séminaires. Elle me rendrait de grands services.
Le mot conférences l’impressionna, il était à lui seul un passeport valable, cependant il lui lança tout de même un regard soupçonneux.
— Il y a des hommes ici ?
— Non, je vis seule.
— Même pas de frère ?
— Non, je n’ai plus de famille !
Un petit silence, une évaluation du regard, sans doute avait-il apprécié la jupe longue que Gladys portait ce jour-là.
— Bon, alors ça pourra aller. Elle pourra commencer dès demain, elle vous dira pour ses heures de cours. Ensuite, elle doit rentrer directement !
— N’ayez crainte, et si je la retiens un peu tard, je la ramènerai en voiture. Je vous téléphonerai.
— De toute façon, son frère viendra la chercher si vous ne pouvez pas !
— Eh bien, c’est d’accord !
L’osmose avait été immédiate, et le tu remplaça rapidement le vous. D’ailleurs, elles ne s’en aperçurent que plus tard, quand l’habitude avait été prise et que c’était devenu si agréable, créant entre elles une intimité à laquelle aucune des deux n’aurait voulu renoncer. Mais de toutes les confidences que lui faisait la romancière, Jasmine sentait qu’il en manquait une. Un secret qui semblait lourd et qu’elle n’avait pas encore partagé et que même son affection ne pourrait pas combler. Elle attendait sereine, persuadée que ce jour viendrait. Gladys racontait ses romans, ses personnages, Jasmine sa vie de frustration et de silence, laissant entrevoir cette révolte qui ne tarderait pas à éclater.
Un jour Jasmine s’était interrompue dans la lecture d’un roman et avait regardé Gladys droit dans les yeux, un sourire malicieux sur les lèvres.
— Qu’y a-t-il ?
— C’est au sujet des femmes.
— Oui. Que veux-tu savoir ?
— Font-elles vraiment tout ce que tu écris dans tes histoires ?
Gladys n’ignorait rien des régulières incursions de la jeune fille dans les bouquins rangés sur les rayons de la bibliothèque. Les siens, et bien d’autres qui ne lui étaient pas forcément destinés. Elle devinait aussi que l’éducation sexuelle n’était pas un sujet privilégié dans sa communauté.
— Tu parles de l’amour ?
— Oui ! Enfin, du sexe, ajouta-t-elle d’une voix presque inaudible. C’est vraiment ce qu’elles font quand elles sont avec leur mari ? Et elles ressentent toujours ce que tu décris ?
Gladys n’avait pu s’empêcher d’éclater de rire.
— Jasmine, tu sais bien que ce ne sont pas leurs maris, n’est-ce pas !
La jeune fille avait haussé les épaules.
— Oui bien sûr, dans tes romans elles sont rarement mariées. Chez nous, ça ne se ferait pas...
— Je n’en doute pas ! Alors, parlons d’abord du sentiment. L’AMOUR... Comment te dire, la passion, l’ivresse, l’impression d’être au septième ciel, oui, cela existe. Cela fait partie de l’exaltation, elle te porte, te projette, tu as enfin l’impression de vivre. Avant tu n’étais rien, à présent tu existes vraiment. C’est une divine sensation que toute femme amoureuse peut ressentir. Pour le sexe c’est autre chose.
— Alors, ce que tu écris, c’est juste pour tes romans ? avait-elle répondu plutôt dépitée.
Gladys avait échappé un sourire, comme pour se disculper.
— Là, tu veux parler du sexe ! Je suis parfois obligée d’écrire de l’érotisme. Ce n’est pas ma tasse de thé. Moi, ce serait plutôt les sentiments, la beauté de la nature et tout ce qu’elle éveille en nous. Peut-être parce que je suis encore pleine de pudeur même si c'est démodé, ou que je n’aime pas me livrer aux autres. Mais mon éditeur en veut, ça fait rêver les femmes qui en sont privées, et nourrit leurs fantasmes.
Le mot à lui seul avait fait rougir Jasmine.
— Mais toi Gladys, si tu en parles de cette façon, c’est que tu as vécu ce sentiment. Tu n’écris pas ça que pour tes romans ?
— J’ai connu ça, oui. C’était, c’était... enivrant. Je ne pouvais envisager de vivre autrement. D’ailleurs je pensais que c’était impossible. Mais je croyais aussi que ça durerait toujours.
— Alors, pourquoi as-tu quitté cet homme ?
Gladys était restée un moment, silencieuse, puis avait rapidement lâché.
— La vie de couple ne se réalise pas qu’au travers du sexe. Sans amour, sans complicité, elle devient une torture, même avec l’homme qu’on a épousé. Je ne te souhaite pas de connaître cela.
Après son repassage la jeune Turque quitta l’immeuble en accélérant le pas. Il lui fallait encore faire les provisions et préparer le repas. Sur la place, une bande de jeunes ados se livrait à une partie de foot avec une poubelle. Elle avait hâte d’être à lundi pour rejoindre Gladys et lui confier la nouvelle qui l’angoissait.
7. Brigade de Roussillon, 18 septembre
Fargeot agita le menton en direction d’un véhicule qui arrivait. De loin il reconnut la silhouette de l’adjudant. Haute, le pas alerte, le cheveu brun comme tout bon Italien qui se respecte. Di Nazzo arborait en toutes circonstances un regard de séducteur, chaud et sombre que beaucoup enviaient et qui en faisait frémir plus d’une. GJ, son équipier qui l’accompagnait lui arrivait à l’épaule et il faisait pâle figure aux côtés de son camarade. Blond, plutôt trapu sans être lourd, originaire de la région il apportait beaucoup par sa connaissance dans la plupart des enquêtes. Tous deux, avec le jeune Briand, étaient très appréciés et Fargeot fut soulagé de les voir arriver. Il s’adressa à son camarade.
— Tiens, quand on parle du loup... voilà ceux de Vienne !.. Mon adjudant, par ici !
Bernard Di Nazzo, répondit à son appel d’un mouvement de la main. Les deux enquêteurs traversèrent le terrain caillouteux pour le rejoindre. Ils se saluèrent rapidement et après une descente en glissade contrôlée, les deux enquêteurs s’approchèrent du cadavre. GJ mitrailla de son appareil photo le corps et son environnement, laissant la place à l’adjudant pour une première observation. Malgré la couleur sombre de la peau, il nota tout de suite la marque noirâtre qui entourait la base du cou. Il déplia son bras pour découvrir des ronds bruns, des brûlures de cigarettes à n’en pas douter, mais elles devaient être anciennes, ainsi que des traces de piqûres qui formaient une tache diffuse. Elle se droguait. Impossible pour l’instant de déterminer si la fille avait été violée, mais vu l’état de ses vêtements et le rictus de douleur sur le visage, Di Nazzo pensa qu’elle aurait pu être victime de plusieurs agresseurs. À tous les coups, des sadiques.
Grandjean fouilla gravats et branchages séchés, à la recherche d’objets qui auraient pu l’accompagner dans sa chute, mais ne découvrit rien. La civière transportée par les employés des Pompes Funèbres remonta lentement la pente abrupte envahie de branchages. Grandjean jeta un coup d’œil dépité vers le fond du ravin, rejoignit son camarade en dérapant à plusieurs reprises et secoua la poussière de son pantalon.
Un attroupement d’hommes venus décharger leurs tailles de haies s’était formé près des deux véhicules. Malgré les injonctions, aucun d’eux ne voulait reculer, affamés d’atrocités et de sensations fortes, désensibilisés de l’horreur par les reportages dont ils étaient témoins au JT, irrespectueux du corps à moitié nu et martyrisé qu’on avait rapidement dissimulé dans une housse en matière plastique. La jeune fille ne ferait pas partie d’un simple « fait divers », ils auraient encore l’occasion d’entendre la description de son visage tuméfié pour solliciter une identification et pourraient à loisir imaginer son martyre avant de passer à un autre crime, à un autre scandale.
L’adjudant intima fermement l’ordre de se disperser. La civière posée sur le sol, il fit à nouveau glisser la fermeture Éclair. Bébert s’était recomposé un visage. Il avança, mais détourna les yeux du corps. Di Nazzo l’encouragea d’un regard compréhensif.
— Je sais que c’est difficile, mais votre identification pourrait nous aider !
— J’peux pas ! Tout à l’heure, j’ai cru que j’allais tomber dans les pommes !
— Je vous en prie, essayez. Vous rappelle-t-elle quelqu’un, l’auriez-vous vue en ville ou ailleurs ?
— C’est pas facile comme ça, avec son visage gonflé...
— Ses cheveux peut-être ?
— Les filles du coin, elles sont toutes rousses !
— Là, c’est plutôt rouge, des couleurs à la mode, elle a dû se faire remarquer avec une toison pareille.
— Non, vraiment, j’vois pas. Peut-être une des gamines du quartier des Chênes verts, à mon avis, elle doit crécher par là-bas.
L’adjudant s’adressa à son homologue isérois.
— Tu connais ce coin Chavant ?
— Oui, c’est une des HLM en dehors de Roussillon.
— Moi j’habite aux Frênes, c’est guère mieux, reprit Bébert, pas très loin des Chênes, mais j’ai jamais vu pareille tignasse non plus.
— Bon, on ira faire un tour.
— Rien d’autre ? Pas de sac, de papiers, un porte-monnaie vide ?
Grandjean qui reprenait son souffle lâcha.
— Non, ceux qui l’ont balancée ont été prudents. Rien qui pourrait nous donner un indice sur son identité.
L’adjudant regardait les véhicules qui défilaient sur le chemin pierreux. Il s’adressa au gardien.
— Ici, on entre comme dans un moulin ! Vous n’auriez pas remarqué quelque chose de bizarre, monsieur...
Bébert se redressa un peu. Il répondit en se mettant presque au garde-à-vous, comme à l’époque de son service militaire.
— Robert Berthet, cinquante-huit ans, retraité des PTT, j’ai fait quinze ans dans la Marine. Bébert pour ceux qui me connaissent. Ici, toute la journée c’est un manège de remorques, de C 15, de camions à plateaux qui viennent déverser. Alors vous pensez, un cadavre planqué au fond, on peut pas voir !
— Vous ne vérifiez jamais le contenu ?
— Si des fois, surtout du côté des végétaux, pour débusquer ceux qui planquent les vieux frigos ou les télés foutues, mais vous savez combien il en arrive par jour ? Il n’y a pas que les tontes de pelouses, on trouve des restes de béton, les pierres de démolitions, des poutres, des saloperies quoi ! Mais les gars, je les connais tous. J’imagine pas qu’il y en ait un...
— C’est toujours ce qu’on pense !
— Quand même ! Des gens du coin qui taillent leurs haies, des...