
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Jasmin
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Une nouvelle vie pas vraiment rêvée...
La cité, Thib, un jeune bourgeois de la belle banlieue, n'en entendait jamais parler. S'imaginer y vivre, encore moins... Alors, lorsque son père, cadre supérieur dans la grande entreprise locale, est accusé de détournement et jeté en prison, sa mère sans ressources, sa grande sœur et lui n'ont plus qu'une solution : habiter un logement HLM dans cette cité.
Il doit quitter son collège, ses amis, ses loisirs. Il découvre la vie quand on est pauvre.
S'il est froidement accueilli par une bande qui fait la loi dans la cité, il rencontre aussi un Rom hors normes, qui deviendra son ami.
L'auteur dépeint toute une galerie de personnages hauts en couleur.
Et ce gardien du chantier de construction devant ses fenêtres, quelle drôle de vie doit-il avoir ? Et pourtant... Heureusement qu'il est là...
Plongez dans ce récit prenant sur la réalité de la vie en banlieue. Un roman jeunesse à dévorer dès 10 ans !
EXTRAIT
Il y a des policiers, calot bien ajusté et matraque à la ceinture, qui observent. L’un d’eux tient en laisse un chien, le museau entravé d’une muselière. Un autre les fixe intensément, l’œil noir et le regard menaçant, puis s’avance vers les deux garçons. Un mur de chair les oblige ainsi à s’arrêter. Il ne fixe que Malik, Thib visiblement ne l’intéresse pas.
— Tes papiers, toi. Carte d’identité.
Le « toi » montre bien qu’il fait immédiatement la différence entre l’interpellé et son camarade.
Le jeune Kabyle ne se démonte pas. Il fixe le policier avec confiance. Cela a dû déjà lui arriver.
— Monsieur, je n’ai pas de carte d’identité. Je suis étranger et j’ai une carte de séjour. Je ne pourrai demander la nationalité française qu’à partir de seize ans.
— Fais voir ta carte de séjour alors.
La voix est sèche et instaure aussitôt entre eux un climat glacial.
— C’est que, c’est ma mère qui l’a.
Sa voix s’est affaiblie, il commence à perdre pied. C’est à Thib de lui venir en aide.
— Montre ta carte de bus, il y a ta photo et ton adresse dessus.
— Te mêle pas de ça, toi, grogne le policier.
Le ton a monté, signifiant ainsi qu’il n’est pas prêt de lâcher prise.
— Je veux voir ta carte de séjour, rien d’autre. Sinon c’est le centre de rétention et le bled.
— Y a pas de bled pour moi, monsieur, chez moi c’est ici.
Il dit ça alors que des larmes ont jailli.
— Ça, c’est pas à toi d’en décider.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
La déchéance sociale d'une famille bourgeoise obligée de se loger dans une barre HLM d'un quartier chaud. Sociologiquement très intéressant et surtout, plutôt bien écrit. -
CélineCDI, Babelio
A PROPOS DE L'AUTEUR
Né à Nice en 1961,
Philippe Maurel y a vécu jusqu'à son service militaire qu'il a effectué à Djibouti. Après avoir travaillé à la DDASS des Alpes maritimes, il a intégré l'École nationale de la magistrature. Après avoir occupé des postes dans le Cantal, à Grasse et à la Réunion, il est actuellement juge des libertés et de la détention à Gap. Il a depuis longtemps la passion des livres. Son premier roman,
Le Royaume du Ghoul, est inspiré de ses expériences professionnelles et de ses lectures passées.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Copyright
L’auteur
Né à Nice en 1961, Philippe Maurel y a vécu jusqu’à son service militaire qu’il a effectué à Djibouti. Après avoir travaillé à la DDASS des Alpes maritimes, il a intégré l’École nationale de la magistrature. Il a occupé des postes dans le Cantal, à Grasse et à la Réunion, il est actuellement juge des libertés et de la détention à Gap.
Il a depuis longtemps la passion des livres. Son premier roman,Le Royaume du Ghoul,est inspiré de ses expériences professionnelles et de ses lectures passées.
Illustration de couverture : Behry Rotsen
Tous droits de reproduction, de traduction
et d’adaptation réservés pour tous pays
©2014 Éditions du Jasmin
www.editions-du-jasmin.com
Dépôt légal juin 2014
ISBN : 978-2-35284-563-8
Titre
Dédicace
Pour Elena-Carmen
P. M
1Les meubles
Les meubles sont rassemblés sur ce qui ressemble vaguement à un trottoir. Des plaques de béton mal armé, faites d’un maillage de petits carreaux déformés, fissurés en plaies ouvertes dans lesquelles surnagent quelques brins de végétation défraîchie. Les meubles ? Une armoire normande à l’air boudeur, un buffet aux portes gauchies, l’armature en fer d’un sommier à la peinture écaillée, un matelas enroulé sur lui-même, quelques chaises de cuisine orphelines de leur table et un canapé invalide qui fait, un peu plus loin, bande à part. Thib, préposé à leur garde pendant que sa mère et sa sœur aînée sont déjà dans l’appartement pour un état des lieux symbolique, pose sur eux le regard d’un berger sur son troupeau. Absorbé par sa tâche, il en oublie presque qu’autour de lui les premiers quolibets achèvent de disgracier cet amas hétéroclite d’objets tellement usés qu’ils semblent sortis d’une remise centenaire. Ils ont d’ailleurs la mine défaite et mal réveillée de quelqu’un qu’on sort inopinément de sa torpeur. Déjà un petit attroupement s’est formé, en lignes concentriques qui se déplacent au gré de l’arrivée de nouveaux badauds.
L’adolescent réfrène avec force une pulsion qui l’incite à fuir cet endroit, à laisser là ce prototype de sculpture abstraite faite de meubles du quotidien, d’un assemblage désarticulé de ferraille, de Formica écorné et de vieilles planches de mélaminé. Tout ce qui va constituer le décor de sa vie nouvelle. Certains autour de lui ont amorcé un mouvement tournant, comme une ronde solitaire, pour apprécier la valeur de l’ouvrage sous le meilleur angle. Une fois satisfaits de leur position, ils se figent. Seuls leurs visages s’expriment avec une mimique qui donne une intensité particulière au jugement qu’ils portent sur les nouveaux arrivants. Un jugement lourd de certitudes, et même en évitant de les regarder dans les yeux, le garçon comprend qu’au travers de l’amoncellement de meubles plus ou moins vermoulus, c’est lui et sa famille qui passent en procès. On l’a pourtant averti. Là-bas, vois-tu, aux Champs-Fleuris, on est bien accepté quand on sent que le dernier arrivé est plus pauvre que soi. De cette hiérarchie, il éprouve maintenant l’humiliation suprême, celle de devoir faire publiquement étalage des indices de son futur train de vie pour mieux apprivoiser le regard de ceux qui en seront les témoins. Il implore intérieurement sa mère et sa sœur d’en finir avec une formalité bien inutile et de le tirer de son supplice. Il se sent déshabillé, sans pouvoir réagir à ce sursaut de pudeur, comme si les meubles décatis qui vont bientôt être son environnement domestique représentaient le tableau de sa vie future.
Le déménageur ne s’est d’ailleurs guère soucié des états d’âme que pourrait susciter chez un garçon de quinze ans l’étalage de son désarroi. Il a, avec son aide, déchargé sa cargaison sans rien dire. L’opération rapidement terminée, il est reparti, toujours sans rien dire. À peine l’adolescent a-t-il surpris dans le rétroviseur de la camionnette le regard inquiet du chauffeur qui semblait lui souhaiter bonne chance. Aussitôt, un responsable de l’office public d’H.L.M. a accaparé sa mère et sa sœur avec l’intention de mener au pas de charge la visite de l’appartement. Lui est resté seul, triste sentinelle d’un lot de mobilier sauvé du rebut, aussi inutile à ce moment-là que peut l’être sa propre vie égarée dans un monde inconnu qui lui semble hostile.
Les secondes s’égrènent, pesantes, lestées d’angoisse, douloureuses. La chaleur estivale se met de la partie et garnit son front d’un ourlet de sueur encore à couvert d’une mèche rebelle. L’attroupement ne s’est pas encore dispersé, mais la foule est désormais immobile, respectant toujours une distance incompressible avec le jeune garçon, comme pour renforcer son isolement. Il comprend que lui et ses meubles sont pour eux un spectacle rassurant. Savoir qu’il existe des paliers encore plus bas dans la pauvreté réconforte ceux qui occupent les niveaux supérieurs. Thib sait qu’il devra porter encore longtemps la marque d’infamie de sa disgrâce. Au moins, de ce point de vue, les choses sont claires, il n’aura pas besoin de tricher. Il se veut aussi fataliste en se disant que l’épreuve est terrible mais salutaire. Il se remémore ainsi les paroles de son professeur de français. Une citation d’un auteur dramatique dont il n’a pas retenu le nom et qui en pleine occupation nazie avait écrit qu’avant il vivait dans la crainte et maintenant il vivrait dans l’espoir1. Le seul viatique qui lui reste, alors que tout ce qu’il a redouté s’est réalisé, est l’espoir comme substitut à la crainte.
Un frémissement dans les rangs des badauds qui vire rapidement au tourbillon. Une brèche dans le mur compact des curieux et la ligne de front se disloque. Face à Thib, une phalange de garçons, tous a priori de son âge. Leur manière de progresser en fer de lance montre à elle seule que le groupe obéit à un ordre discipliné. Impossible de ne pas reconnaître que celui qui se pose en vis-à-vis est le chef incontesté. Un mètre soixante-quinze de provocation hautaine, une masse musculeuse recouverte d’un blindage de marques que décline chaque vêtement qu’il porte. Ses yeux noirs, comme derrière une meurtrière, lancent un regard aiguisé d’ironie et d’agressivité. Un pas. Puis un autre, plus affirmé. Les autres contournent l’obstacle de l’amas de meubles. Une approche en forme de défi. L’invite est déjà lancée pour un premier affrontement et c’est lui, visiblement, qui imposera le choix des armes. Toujours à l’écart de la masse informe du mobilier, le canapé en déglingue rumine en solitaire. Le garçon s’y installe avec l’air de prendre ses aises. C’est maintenant lui le propriétaire de l’objet. Son visage sombre s’éclaire d’un sourire de contentement qui atteste son triomphe.
Thib tente de se bricoler en catastrophe une posture conciliante et de faire comme si la scène avait d’emblée pris un tour comique. Les gouttelettes de sueur ont franchi la frontière ombrée de sa frange et son malaise s’accroît en voyant l’autre, son adversaire déjà, s’installer en position dominante. Il sent tout autour de lui le petit attroupement nouer avec le garçon un lien de complicité tacite. Celui-ci s’alanguit sur le skaï, râpé aux coins. De narquois, son sourire est passé au triomphe silencieux. Il est tellement soucieux de montrer qu’il est entièrement détendu qu’il a mis ses deux mains sur sa nuque et a déplié son corps qu’il offre aux rayons d’un soleil servile.
— Dis donc, Gaulois, on a quand même fait mieux dans le genre mobilier de jardin.
On rit de son impertinence. Des petits en vélo tout terrain ou en tricycle se sont mis à faire des cercles autour de lui. Une manière de prêter allégeance à la toute-puissance du jeune tyran qui semble apprécier cette marque d’obédience. Il a repéré quelque chose sur le vantail d’une petite armoire dont un pied manquant menace l’équilibre. Il étire son cou, bouge sa tête pour mieux observer. Thib suit les oscillations d’une tignasse brune parsemée de mèches qui rebiquent comme autant de vagues tempétueuses qu’un vent mutin prend plaisir à dresser.
— Mais ma parole, c’est les meubles des Mechtour. Je me souviens, c’est Yazid qui avait taillé avec son shlass le petit dessin sur la porte, là.
Tout le monde fixe le bout du doigt tendu vers la blessure à vif que fait sur le meuble, déjà mal en point, un dessin informe qui entaille profondément sa chair ligneuse.
— Si maintenant les Gaulois en sont à récupérer les rebuts des Mechtour, c’est le monde à l’envers.
Des mots qui déclenchent l’hilarité générale et destinés à faire baisser la tête au « Gaulois », mais tel Vercingétorix devant César, Thib maintient sa tête haute, bravant de la sorte l’impudence démoniaque de celui qui se présente comme un adversaire. Il ne réplique pas, encaisse sans broncher les moqueries qui fusent comme les tirs d’une baraque foraine et prie pour que sa mère et sa sœur abrègent son calvaire. Fort de son joli succès auprès de son auditoire improvisé, le garçon ne se prive pas de surenchérir dans l’ironie blessante.
— Pas à dire, c’est pas aujourd’hui qu’on enverra aux Champs-Fleuris les grandes fortunes. Qui aurait dit que les antiquités des Mechtour pourraient encore resservir ?
Cette fois, leurs regards se sont croisés et une étincelle qu’ils ont été les seuls à percevoir a jailli de leur frottement.
— Tu t’appelles comment, Gaulois ?
L’interpellation est sèche, sans relent de sarcasme.
— Thibaut.
— Un nom de croisé. On aime pas beaucoup ça ici.
— Pour mes proches, c’est Thib.
— Le problème, c’est que personne ici ne deviendra un de tes proches.
Joignant le geste à la parole il désigne la petite assemblée qui lui fait cortège et qui semble tacitement approuver ses paroles. À distance, il y voit une mosaïque de races, de morphologies, petites, grandes, maigres ou avec embonpoint. L’ensemble est un magma de couleurs et de formes, de visages aussi, avec une expression de soumission et de défiance qui l’invitent à assumer son statut de croisé, lui qui n’en a que de lointains souvenirs scolaires.
Le garçon, toujours allongé sur le canapé, se déhanche pour sortir quelque chose de sa poche. Un couteau long comme son poing dont il déplie lentement la lame. Il se lève et trace une croix avec la pointe sur l’un des pans de la petite armoire.
— Maintenant aucun doute, elle est vraiment à toi.
Thib n’a pas bougé. Une fois encore il a encaissé. Peur de la foule instinctivement hostile ? Peur de déclencher un accès de violence de la part de cet ennemi inconnu sans qu’il soit en mesure de lutter ? Peur de passer aux yeux de tous pour un Gaulois croisé arrogant mais pusillanime qu’il suffira de renvoyer à son statut de déclassé, pas assez riche pour s’acheter des meubles neufs en kit bon marché ? Il refoule sa rancœur et peut-être sa colère, les gouttes de sueur qui perlent son front sont les larmes qu’il se retient de verser.
— Allez, yeux bleus, on se reverra.
Le garçon tourne les talons à la vue d’un grand homme noir qui s’approche vers le petit nouveau dans la cité. Ses yeux sont bleus, c’est vrai, mais c’est la première fois qu’on le lui fait remarquer en public, et sur un air de reproche, comme si le fait d’avoir le teint plus clair que la plupart des gens autour de lui était une tare. Le grand noir est près de lui et arbore un grand sourire. À sa vue, les badauds du premier rang amorcent un mouvement de reflux.
— Salut bonhomme, moi c’est Benoît.
Thib est déconcerté par cet accueil qui tranche avec celui qu’on lui a réservé jusqu’à présent. En plus, la carrure de l’homme a de quoi impressionner. La main qu’il lui tend fait facilement deux fois la sienne.
— Benoît… réussit-il à balbutier. Benoît comment ?
— Benoît tout court. Le nom complet, c’est pour Pôle emploi, les services sociaux et la préfecture. Toi, c’est Thibaut ?
— Thib, c’est plus court. Le nom complet ça sera pour les profs du lycée.
— Tu entres à Jean-Ferrat, c’est ça ?
— C’est ça.
— Ce sera autre chose que ce que tu as connu jusqu’à présent. Et ça sera pas la seule, il y en aura bien d’autres que tu devras apprendre. Comme à supporter les railleries de Hafid.
D’un coup de menton il désigne le garçon au couteau graveur qui s’éloigne entouré de sa petite bande qui, les mains dans les poches de leur pantalon de survêtement, ont une démarche de manchot en bordée sur la banquise.
— Je suis médiateur ici aux Champs-Fleuris et responsable du club de judo. Je suis venu te donner un coup de main pour monter les meubles. C’est à quel étage ?
— Cinquième.
— C’est le moment de montrer ta force, Thib. Parce que je ne sais pas si on t’a mis au courant, mais l’ascenseur est en panne depuis pas mal de temps.
Il scrute attentivement d’un œil expert les meubles à transporter. Il n’a peut-être pas identifié la famille qui s’en est débarrassée mais sa mimique désabusée est sans appel sur leur état.
— Il va falloir faire très attention dans les escaliers, tout ça ne m’a pas l’air de la première jeunesse.
Il tire des entrailles d’un petit porte-documents un autocollant dont il enlève soigneusement le film protecteur et qu’il applique sur la petite armoire à l’endroit même où Hafid a entaillé le vernis avec la pointe de son couteau. C’est une publicité pour un club d’arts martiaux, celui dont il vient de parler sans doute.
— Comme ça, tu pourras oublier ce qu’il y a dessous sans oublier de venir t’inscrire.
— C’est que…
Thib n’aime pas la violence, ni les disciplines sportives qui la cultivent pour mieux l’apprivoiser, mais il ne veut pas se mettre d’emblée à dos celui qui a été jusqu’à présent le seul à faire preuve de convivialité.
— Allez mon gars, au boulot, on a encore cinq étages à monter.
Benoît s’avise alors de la mine déconfite du jeune garçon.
— C’est que j’attends ma mère et ma sœur qui…
— T’en fais pas, lui dit péremptoirement Benoît en s’efforçant de masquer l’impression de dégoût que lui inspire la vue du mobilier bon pour la réforme, personne ne te volera rien.
Il redresse sa poitrine d’athlète et son imposante carrure donne un sérieux gage à ses propos, comme si la crainte révérencieuse qu’il inspire pouvait faire illusion et masquer le dégoût qu’ils peuvent susciter.
Véro, la mère de Thib, lui avait annoncé la vente de tous leurs meubles trois semaines auparavant. Il s’y attendait tant leur situation financière avec ce mari et père absent, sans doute pour longtemps encore, devenait critique. Le départ du pavillon de Marly était programmé depuis des semaines et il n’y avait plus aucun espoir qu’ils puissent emporter avec eux tout leur mobilier, quel que soit l’endroit où ils iraient. Elle s’était efforcée d’être rassurante. Les difficultés n’étaient que temporaires, on achèterait petit à petit des meubles neufs. En attendant, il fallait se contenter de vieilleries qu’elle avait dénichés dans un entrepôt des chiffonniers d’Emmaüs. Le comble de la déchéance sociale qui leur faisait maintenant réaliser la hauteur de leur chute vertigineuse. Pendant la dernière semaine, ils avaient vécu dans une maison vide où ne subsistaient qu’une plaque chauffante, une table de jardin en plastique avec trois fauteuils, et des sacs de couchage à même le sol en guise de literie.
— Nous sommes obligés de tout vendre. Les honoraires d’avocat coûtent tellement cher.
Nous, pourquoi nous ? Pourquoi employait-elle encore ce pluriel que plus rien dans sa situation ne justifiait ? Pourquoi sacrifier leur confort pour le bien-être de celui qui était, même indirectement, la cause de leur malheur ?
Tous les trois, ils s’étaient rendus à l’entrepôt et Véro avait choisi tout ce qu’il y avait de moins cher, au grand désarroi des deux enfants qui ne pouvaient imaginer vivre entourés au quotidien de ces immondices que même en temps normal ils n’auraient pas reléguées dans un débarras. Thib n’avait desserré les mâchoires que pour grommeler ; « Je suis sûr qu’en prison ils sont mieux lotis. » Sa mère n’avait rien répliqué et avait réglé la facture, une somme qui pouvait représenter le prix d’une virée au McDo le samedi soir pour trois personnes dont un enfant.
Depuis, il se persuadait qu’il allait nouer avec cet amas de planches vermoulues une complicité de circonstance qui l’aiderait à mieux accepter son changement de vie. Ça marchait plutôt bien, jusqu’à ce qu’un coup de déprime vienne tout balayer. Il avait très tôt compris qu’il lui fallait lutter contre ces instants d’abandon. Lutter de toutes ses forces, au risque de tomber et ne plus pouvoir se relever.
L’appartement n’est ni grand ni petit. Simplement à la mesure de leur nouvelle existence, modeste et sans apprêt mais suffisant pour devenir le nouveau creuset de leur intimité familiale. Pour Hilda, sa sœur aînée, l’heure n’est pas à la déception. Elle virevolte, risque une suggestion, s’enthousiasme de la perspective sur laquelle ouvrent les fenêtres de sa chambre, une forêt de mycoses en béton dont le gigantisme ne l’effraie même pas. Le feu follet de sa chevelure blonde fait comme un éclairage irradiant autour d’elle et, au bout du compte, sa bonne humeur est contagieuse.
Véro est en conversation avec le représentant de l’office d’H.L.M. Pour se présenter à lui sous son meilleur profil, elle se montre tour à tour enjôleuse, déterminée, conciliante ou, au contraire, revendicatrice. Des attitudes que Thib sait être de petites ruses pour écarter du quotidien les nuages sombres de son désespoir. Mais pour l’avoir si souvent observée ces derniers temps, il sait aussi reconnaître les moments où, comme aujourd’hui, elle ne force pas son talent de comédienne pour paraître authentique.
Hilda et Benoît sont en grande discussion au sujet de l’emplacement des meubles. Chacun ici aura sa chambre et le choix d’affectation du mobilier, trop rare pour remplir l’espace disponible, requiert d’emblée des arbitrages. Avec eux, un garçon de l’âge de Thib peut-être, qui finit par lui adresser la parole. Il n’est pas très grand, de type maghrébin, ce qui rend Thib méfiant après l’expérience de sa première rencontre avec Hafid.
— Salut. Malik. J’habite au troisième avec ma mère.
Il lui dit ça avec un large sourire qui colore de sincérité ses paroles de bienvenue.
— Moi c’est Thib. Enfin, Thibaut, un nom de croisé à ce qu’il paraît.
— Les croisés, c’était il y a longtemps. Si tu permets, pour moi ce sera Thib. J’aime bien ce nom. Il me fait penser à un poète kabyle, Mohamed Dib. Kabyle comme moi. Je te prêterai ses livres. Viens, je vais te faire visiter la cité.
Redescendre, déambuler dans les allées bordées de tours, barres et autres incongruités architecturales au risque de tomber nez à nez avec Hafid et sa bande en pleine chasse aux Gaulois. Non, ça lui a suffi, tout à l’heure. Malik avise sa mine déconfite.
— T’inquiète pas, on va faire ça de la fenêtre de ta chambre. De toute façon avec ma patte folle, vaut mieux que j’évite de trop cavaler.
Et il se met à claudiquer dans la pièce destinée à devenir le salon une fois bien arrangée.
— Polio. Poliomyélite c’est le terme médical. Ici, en France, il y a des vaccins contre ça. Mais là-bas, en Kabylie, c’est autre chose. Et un enfant qui naît avec ça, c’est des frais supplémentaires et une bouche inutile à nourrir. Alors ma mère a quitté mon père et est venue s’installer ici. J’avais un an.
L’encadrement de la fenêtre laisse apparaître les visages des deux adolescents. Malik est plus petit que Thib et pendant sa station debout il étire sa jambe comme pour la mettre au repos, l’autre supportant visiblement tout le poids de son corps frêle. Thib voudrait l’inviter à s’asseoir, mais sa chambre ne contient qu’un lit, une armoire de rangement et une petite table basse qui recevra en dépôt ses affaires avant de se coucher. Pour un bureau, on verra plus tard. Parole de mère attentionnée qui tient à ce que ses enfants revendiquent, pour le moment, le moins possible.
Du cinquième, ils ne dominent pas entièrement la forêt d’immeubles qui s’étend devant eux mais une légère déclivité du terrain leur donne un bel aperçu en surplomb.
— Bon, pour commencer profite bien de la vue que tu as sur les Glycines. C’est le bâtiment juste en face. Il est vide. On le détruira dans un mois ou deux par implosion. Ils ont déjà fait ça pour les Glaïeuls, c’était l’immeuble qu’il y avait à la place du chantier que tu vois là-bas au fond.
Il étend, en disant cela, un bras fureteur vers l’horizon proche. Un squelette d’immeuble avec ses prothèses de grues, de coffrages et de ferrailles avec un toit fraîchement dallé qui annonce un achèvement prochain.
— Il faudra pas rater ça. On sera aux premières loges pour le spectacle. Bon là-bas, dans le fond, c’est les Hortensias. C’est l’Afrique subsaharienne. Des familles sénégalaises, ivoiriennes, maliennes. On parle plus le peul ou le soninké que le français. Quelques jeunes, surtout des filles, vont à Jean-Ferrat, mais on les fréquente pas trop et eux ne tiennent pas trop à se mélanger à nous.
— Et Benoît ?
— Benoît n’est pas africain, il est martiniquais. Un vrai de vrai. Punch, biguine et collé-serré. Il travaillait à la Sorinor comme agent de maîtrise, mais en fait il était embauché par le comité d’entreprise pour s’occuper des clubs de sport de la boîte. Il fait à peu près la même chose maintenant, mais c’est la mairie qui l’embauche. La Sorinor, t’as entendu parler ?
Thib se contracte, évite de regarder le jeune Kabyle, se trouble et répond évasivement par un signe de tête.
— Une grosse boîte qui va pas très bien et avec tout un tas d’histoires autour, reprend Malik.
— J’ai entendu parler. Et là-bas, c’est quoi ?
Il a vite enchaîné et Malik a bien perçu la gêne de son interlocuteur. Il n’insiste pas. L’immeuble que Thib vient de lui désigner est une barre qui ondule autour de trois arrondis. Les façades sont grises, avec par endroits l’enduit écaillé comme une peau desquamée, et partout aux fenêtres des paraboles qui font autant de parasites métalliques.
— Là-bas, c’est les Forsythias. Craignos comme endroit. Quand on ira en bus au bahut, mieux vaut prendre un chemin plus long pour éviter de passer devant. Les entrées d’immeuble sont occupées dès huit heures du matin. Le trafic commence vers dix heures. Ça défile une bonne partie de la journée.
Thib prend un air effaré. Il a compris le sens de ses propos sans parvenir à se convaincre que telle sera désormais sa réalité quotidienne. Malik, à qui rien n’échappe, a immédiatement perçu la contrariété de Thib.
— T’inquiète pas. Ils jouent les gros bras, mais chacun pris à part est plutôt froussard. La police organise des coups de filet réguliers. Quelques-uns partent en prison. D’autres les remplacent.
Silence.
— C’est là, aux Forsythias, qu’habite la famille de Hafid. Le père travaillait à la Sorinor. Il est en préretraite.
Le ton est fataliste et sans espoir. Le nouvel arrivant n’a pas cillé.
— Ce qui serait bien, c’est qu’on soit dans la même classe à la rentrée, à Jean-Ferrat.
Thib se tourne vers son nouvel ami avec un sourire pincé qui vaut approbation.
— Tu serais allé où si tu n’avais pas déménagé ?
Pour l’adolescent, la question est indiscrète car elle met une friction douloureuse sur une blessure intime.
— À Montesquieu.
Le cursus normal après son collège. Montesquieu, le meilleur et le plus prestigieux lycée de la ville. Rien que son architecture attestait la noblesse de l’institution et tranchait avec celle de tous ceux qui avaient été construits dans le style triste et convenu d’un urbanisme hâtif. Comme Jean-Ferrat, sans doute. Mais dès le nom de l’écrivain prononcé, les yeux du jeune maghrébin s’illuminent.
— Montesquieu ? C’est là que je dois aller l’année prochaine. Enfin, si tout va bien. Ici, la carte scolaire fait qu’on va tous à Jean-Ferrat. Mais ils font des exceptions. Une par tranche d’âge. Et comme mes notes n’ont pas été trop mauvaises…
Thib vient de comprendre qu’il n’est pas sûr d’intégrer l’établissement scolaire à quoi tout le destinait. Non qu’il soit un brillant élève, mais sans trop d’efforts, il maintenait une bonne moyenne. On le dépouille de tout en changeant de vie, mais la perspective d’intégrer Montesquieu et d’y retrouver ses camarades d’avant lui donnait au moins un motif d’espoir. Rendez-vous avait d’ailleurs été pris avec eux. Il aura fallu les paroles bien anodines de cet inconnu, infirme et étranger par-dessus le marché, pour lui ôter ses dernières illusions. Si la place est déjà réservée à un élève des « minorités visibles », il resterait, après l’orientation de la fin de seconde, à Jean-Ferrat, dans ce bahut qu’il appréhende déjà comme un lieu de souffrance.
Une larme perle au coin de sa paupière mais sa fierté lui permet de dominer cet instant d’abandon. Juste un petit coup de blues très vite surmonté. Il lui faut être aussi volubile que sa sœur. Il sait qu’elle cache sous une humeur enjouée des tonnes de frustration. Il doit enfiler le déguisement du bonheur. Un peu comme tous ces immeubles à qui on a donné des noms de fleurs pour mettre un masque de félicité sur leur tristesse.
Une petite tape sur son épaule et une main qui y reste accrochée. Décidément, rien ne lui échappe à celui-là.
La nuit estivale a allumé le damier des fenêtres dans les immeubles des Champs-Fleuris. Thib a laissé la fenêtre de sa chambre ouverte et de l’extérieur lui parviennent les bruits de ceux qui ont profité de la chaleur pour étendre des couvertures sur les pelouses lépreuses et allumer des barbecues. Il y a de la musique à tue-tête. Des chants s’élèvent quelquefois. Il s’est couché sur son lit, les mains en coupole sous sa nuque et fixe des fissures qui font des méandres sans fleuve au plafond. Ses sentiments sont mitigés. Il se sent à la fois chez lui et étranger à jamais à cet endroit.
Ce soir il a décliné l’offre de sa mère d’avaler un morceau prétextant un état de fatigue. Compréhensive, Véro n’a pas insisté. Un nom résonne encore dans sa tête. Sorinor. S’il connaît cette entreprise ? Et comment ! Mais rien que le mot lui fait mal, comme si du sel était appliqué sur une plaie à vif.
Quand on lui parle de la Sorinor, c’est l’image de son père qui réapparaît, et celle de son titre un peu ronflant et un rien mystérieux de directeur financier. Tous les ans, pour l’arbre de Noël du comité d’entreprise, Thib franchissait avec lui les portes de l’usine et se sentait empli d’une grande fierté lorsqu’il voyait à son passage les employés s’incliner ou marquer une déférence qu’il identifiait légitimement à un signe extérieur de pouvoir. C’était avant. Avant qu’un matin, alors qu’il s’apprêtait à partir au collège où son père le déposait avant de rejoindre son bureau, deux hommes ne se présentent. Des policiers. Ils avaient emmené son père en lui recommandant, à lui jeune collégien affolé, de prendre le bus pour se rendre à l’école. Sa mère était déjà partie pour déposer Hilda à l’IUT où elle était en première année. Quand il était rentré le soir, il l’avait retrouvée en pleurs, allongée sur le canapé. Hilda avait été priée de se faire héberger par une copine. Véro était seule dans la maison en désordre qui avait été visiblement fouillée de fond en comble. Il n’avait plus revu son père, même pas le jour de son procès où il avait été condamné à une peine de prison ferme. Depuis, seulement une lettre par mois dans laquelle ce dernier parlait avec optimisme de leur avenir à tous les deux et où il incitait son fils à faire preuve de courage dans l’épreuve mais s’obstinait à refuser qu’il vienne le voir au parloir. Thib lui-même n’y tenait pas et il était soulagé qu’un tel refus n’émane pas de lui.
Du courage, il en avait eu. En affrontant les regards de ceux qui savaient, camarades et professeurs du collège. En acceptant sans rien dire de quitter Marly, son pavillon coquet, ses copains friqués, pour une cité de banlieue où on ne parlait français que par intermittence, où les immeubles n’avaient plus d’ascenseur, où il fallait employer des itinéraires de contournement pour se rendre au lycée. Un lycée qu’il avait d’abord idéalisé et considéré comme la seule planche de salut à un sort funeste, perspective qui se dérobait maintenant. Il lui faudrait aussi accepter l’idée que peut-être il n’irait pas à Montesquieu et qu’il achèverait son second cycle à Jean-Ferrat. Achever était d’ailleurs le mot approprié tant il pouvait s’appliquer à lui.
Dehors, des cris, des chants, une musique de percussion de djembé. Il ferma les yeux et le sommeil prit la suite.
1. Tristan Bernard (NDLE).
2Jours de vacances
Kadija, la mère de Malik, s’est levée tôt le matin pour préparer le couscous. La veille, elle s’est rendue au centre commercial le plus proche et, sans rien dire à son fils des préparatifs en cours, a acheté tous les ingrédients d’un plat réservé d’habitude au premier week-end du mois. Malik l’a entendue s’affairer dans sa cuisine pratiquement dès l’aube et il a compris que cette entorse au calendrier signifie qu’elle a décidé, à sa façon, d’accueillir les nouveaux arrivants. Des heures de patience à exécuter les mêmes gestes répétitifs avec la radio en fond sonore, mais en sourdine pour ne pas réveiller son fils. Il se lève et déjeune tard en la regardant. Un spectacle qui dégage toujours une égale intensité lumineuse dans l’espace étroitement confiné de la minuscule cuisine. Un plat qui fera le menu de deux jours, plus peut-être, mais il perçoit dans ses mouvements toute la joie simple du partage, la même qu’elle éprouve en regardant à la télévision les émissions de charité médiatique.
— On le leur portera ensemble, quand tu auras fini. Prends ton temps, lui dit-elle en kabyle, la seule langue qu’elle maîtrise à peu près correctement.
Le temps, c’est finalement tout ce que dans sa vie elle peut s’approprier sans frais quand elle est chez elle. Le reste de la journée, elle le passe à faire des ménages chez des particuliers et, le soir venu, à nettoyer les salles de classe d’une école primaire. Un rythme de vie qui n’a pas changé depuis quatorze ans, ce qui ne lui confère aucun grade ni privilège, hormis celui d’emporter chez elle quelques restes de la cantine.
Presque quinze ans de présence en France, aux Champs-Fleuris uniquement, cité qu’elle n’a jamais quittée sauf pour un séjour d’une semaine en Bretagne, l’an passé, avec son fils, pris en charge pour moitié par la caisse d’allocations familiales. Elle balbutie quelques mots de français mais se sent mal à l’aise dans cette langue qu’elle assimile à une inaccessible culture, dont elle est pourtant si fière que son fils en soit aujourd’hui un digne représentant. D’où sa satisfaction de le voir si habile à manier cette langue qui, pour l’essentiel, lui demeure hermétique, et se montrer ainsi à la hauteur de tous les espoirs qu’elle met en lui.
C’est Hilda qui leur ouvre la porte et, surprise, ne sait se montrer avenante. Elle esquisse une mimique d’incompréhension qui désappointe la Maghrébine, interprétant sa gêne comme une marque d’hostilité. Malik vient aussitôt à la rescousse.
— Vous n’avez certainement pas eu le temps de faire les courses, alors…
Kadija tient le plateau en offrande collé à sa poitrine. L’odeur de semoule, de mouton et de légumes qui s’en exhale affole aussitôt les papilles.
— Bien, entrez, bredouille la jeune fille, toujours aussi mal à l’aise.
— Non, ce n’est pas la peine, nous allons vous laisser.
Véro et Thib ont accouru. Eux non plus ne savent pas comment réagir. La mère de famille essaie de cacher son embarras et se demande comment elle doit les accueillir. Les inviter à entrer ? Malik vient d’anticiper le refus. Donner quelque chose en échange ? Ils pourraient se sentir humiliés. Elle essaie alors de rester dans le registre de la convivialité.
— C’est très gentil à vous. Croyez bien que nous sommes très touchés. Thib vous rapportera le plateau tout à l’heure… Juste le temps de préparer une mousse au chocolat.
La mousse au chocolat a disparu à toute vitesse. Véro en a rempli d’imposantes tasses à café de son service en faïence. Une des seules pièces de son trousseau de mariage dont elle a refusé de se séparer. Les tasses finement ornées de dorures ont suscité l’admiration ébahie de Kadija.
Les deux garçons sont dans la chambre de Malik. Une pièce très exiguë car l’appartement est plus petit que celui du cinquième. Là, au troisième, on a, dans le même espace, doublé le nombre de logements par rapport aux étages supérieurs. C’est l’étage des célibataires, des familles monoparentales, des logements où s’éparpille une multitude d’existences solitaires qui ne se rencontrent jamais.
Malik a un vieil et volumineux ordinateur posé sur un meuble qui occupe tout un angle de la pièce et qui semble souffrir d’insuffisance respiratoire. Thib aussi en avait un. Un portable extra-plat qu’il emportait partout. Le collège en avait financé une partie, le solde était remboursable sur deux ans. Plus possible, a dit Véro. Exit le portable.
— Tu en as un ? demande Malik qui a observé la mine contrite de son camarade fixant l’objet.
— Non.
— Pas de souci. Je vais voir si José peut t’en dénicher un.
— José ?
— Oui, José. C’est le fils de l’assistante sociale du secteur. Il est en première année de droit et prépare le concours d’entrée à sciences p
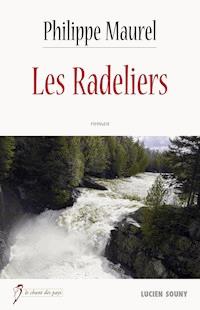













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














