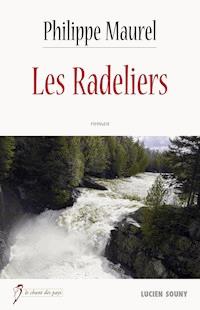
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Seule échappatoire à la dureté de leur existence : braver tous les dangers et risquer leurs vies.
Refusant le sort qui semble s’acharner sur eux, des hommes et des femmes d’abnégation et de passion braveront tous les dangers avec, pour seules armes, leur courage chevillé au corps et l’amour de leurs proches. Car la descente d’une rivière en plein hiver n’a rien d’une chimère. Pour Rosto, le montagnard illettré, Nemo, l’Italien taiseux mais calculateur, Flavien, le médecin communard, et Pascalet, l’enfant perdu, il s’agit d’une question de survie. Pire que la nature hostile se déchaînant autour d’eux, ils affronteront tous ceux qui n’ont d’autre visée que leur échec et qui semblent avoir conclu avec le mal un pacte d’alliance sans partage. En contrepoint de cette expédition se déroule le périple téméraire de Maria, épouse et fille de radeliers. Elle a pris la route avec ses deux enfants pour retrouver son mari dont elle n’a plus de nouvelles. Et l’avenir sans lui n’est juste pas concevable.
À travers le parcours et le chagrin de personnages émouvants, découvrez une histoire bouleversante qui acquiert une véritable dimension contemporaine.
EXTRAIT
— On parle de vous dans le pays. La portière de Cramans en plein hiver, un exploit qu’on n’est pas près d’oublier, croyez-moi. Le P’tiot est devenu un héros. Un héros, j’vous dis. Ce n’est pas ce qui m’ôte l’envie de lui botter les fesses pour tout ce qu’il m’a chapardé de légumes dans mon potager ou de volailles dans mon poulailler. Mais puisque c’est un héros…
Pascalet avait fait faux bond à la petite assemblée dès leur arrivée à la maison du vieux propriétaire. Il était resté dehors, et le froid qu’il ressentait tenait aussi bien au temps qu’il faisait qu’à la distance que les gens du domaine mettaient entre eux et lui. Ils étaient visiblement du côté de leur patron, incapables d’un sentiment de révolte, confits dans la crainte ou la dévotion, la mine figée dans une béatitude pâlement imitée de celle qu’arborait constamment leur maître. Ils le fixaient comme une vache curieuse et, en voyant les haillons dont le jeune garçon était revêtu, ils reprenaient confiance en leur condition en s’apercevant qu’elle n’était finalement pas le dernier degré de la misère.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Originaire de Nice,
Philippe Maurel est appelé de par son métier de magistrat à sillonner la France. Il réside présentement à Lons-le-Saunier, non loin du pays des radeliers, qui ont descendu la Loue maintes et maintes fois. Écrivain des soirées et des fins de semaine, il est surtout lecteur attentif à tout ce qui peut susciter l'admiration et développer l'imagination.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À Anne-Laure, Chantal, Sylviane et Lucille,en souvenir de la chambre détachée.
Le sentier était raide, creusé à flanc de talus, mais Charles Ziegler ne voulait rien laisser paraître de l’effort qu’il accomplissait pour le gravir. Il soufflait, et sa respiration même devenait douloureuse ; il grimaçait et enfonçait régulièrement son menton glabre dans le col de sa redingote pour se protéger du froid. Lorsque l’épuisement faisait vaciller son vieux corps voûté, il utilisait sa canne qui partait à tâtons à la recherche d’un appui sûr. Le reste du temps, il la calait au creux de l’épaule comme l’emblème d’une fierté qui ne pouvait souffrir l’humiliation de la fatigue.
Le chemin sinuait entre tertres, souches et petits arbres qui avaient échappé à la cognée dévastatrice des bûcherons. Les couches sédimentaires en torsades qui louvoyaient entre les saillies du relief apparaissaient à vif, maintenant que leur couverture végétale avait disparu. La forêt dense et ténébreuse, qui excitait jadis les imaginations les plus sensibles aux forces occultes, laissait la place à une masse informe à la peau desquamée.
Parvenu au sommet d’un monticule buissonneux, il se retourna pour jouir de la perspective. La petite vallée encaissée entre deux escarpements abrupts lui apparaissait triste dans sa nudité minérale, mutilée de la couverture d’arbres qui, quelques jours auparavant encore, recouvrait ses pentes d’une toison veloutée. Pourtant, cette vision le rendait heureux, satisfait, au point qu’il en oubliait les douleurs qui enflammaient le bas de son dos lorsque l’effort devenait trop intense. Le débardage avait été achevé avec une journée d’avance, favorisé par un temps clément et l’ardeur au travail des hommes, et rien ni personne n’avait interrompu leur tâche. Les motifs de contentement du vieillard ne manquaient pas.
« Faut en profiter, avait lancé le chef des bûcherons, un gros homme madré qu’on aurait dit taillé dans le bois qu’il venait d’abattre et dont on faisait l’armature des navires au long cours. M’est avis, père Ziegler, que ça va pas durer. Trop de douceur, c’est le ciel qui prépare sa neige. » Il l’avait spontanément appelé père Ziegler, avec une familiarité respectueuse dont usent les gens simples. Père, il l’était, et une génération le séparait du dernier représentant de sa lignée, si bien que le vieil homme ne s’était pas senti outragé par cette entorse aux règles de civilité, qui mettait en concordance l’image qu’il avait de lui-même et celle qu’on percevait autour de lui. Rien ne valait finalement ces moments où la joie du travail accompli autorisait les petits manquements à la bienséance. Oublié le violent tour de rein qu’il s’était fait la veille en voulant donner la main aux débardeurs et dont il s’efforçait de transformer en sourire pincé les rictus de douleur qu’il lui arrachait.
Quand il s’en était aperçu, le chef y était allé de ses réprimandes courroucées. « Plus de son âge ! » Ils avaient l’effectif suffisant pour le travail à faire ; et avec le temps qui y mettait du sien, pas besoin d’aide. Dans les paroles apaisantes du colosse, il avait perçu la pointe d’irritation de l’employé qui tient à ce que son patron reste à sa place et assume sa fonction de donneur d’ordre sans mélanger les rôles. La douleur lancinante, à l’affût de ses moindres mouvements, était venue fournir une caution physique à la sagesse des propos de l’ouvrier. Son orgueil lui donnait à peine la contenance nécessaire pour feindre de n’avoir plus besoin de sa canne pour assurer son pas sur la terre lacérée de radicelles.
— Faites attention, père Ziegler, on vient de façonner ici.
Le sol était un amalgame de boue, de grume, de branches délaissées après la séparation de leur fût. S’étaler comme un enfant dans la cour d’une école aurait pour lui été la pire des situations ; aussi, il s’employait avec la plus grande attention à déjouer les pièges tendus par des forces telluriques liguées contre lui.
Les bûcherons avaient façonné toute la coupe de la journée. De loin déjà, il les avait entendus essarter les pentes, ébrancher les rondins, les séparer des grumes dans une ambiance de liesse qui, au cœur de l’hiver, donnait à la coupe des allures de pays de cocagne. Il les avait vus, de la rivière en contrebas, s’appliquer à trouver le bon rythme pour mettre leurs outils au diapason du mouvement de leurs bras en poussant des cris d’émulation. Le soir même, les stères de bois étaient empilés en bon ordre, prêts à être charriés jusqu’au port de jetage. La forêt ne gardait plus de sa nature sauvage que la senteur âpre de la sève qui gorgeait encore l’épaisseur des fûts. Il y avait là, impeccablement rangé, le résultat de l’abattage d’un demi-arpent d’ormeaux de haute futaie. Ziegler en éprouva une satisfaction qui calma aussitôt ses douleurs lombaires.
— La journée a été bonne.
Maître Vuillet l’avait suivi avec la souplesse de l’homme de labeur plié sous le poids d’années d’efforts pour mieux dissimuler la verdeur de ses réactions. Il avait emboîté son pas calmement, d’une démarche féline et presque fantomatique.
Pour l’acquéreur, une bonne journée devait d’abord se traduire en termes comptables, avec des bénéfices et la promesse d’en faire d’autres le lendemain. En homme avisé, il avait jaugé la récolte du jour, fait les conversions avec son esprit calculateur et au plus juste des règles marchandes, établi les perspectives de gains futurs. Il avait ensuite frotté ses mains l’une contre l’autre en laissant les témoins éventuels se demander quelle était la part de la froidure et de l’esprit de lucre dans ce geste.
Des stères de bois à l’alignement, un sourire discret sur les lèvres de maître Vuillet, un petit vent mutin qui devenait plus agressif maintenant que le terrain ridé était nu, laissaient augurer la bonne affaire. Sourire contaminant qui effaça définitivement la grimace de douleur de l’Alsacien. Le vieux commerçant dut s’en rendre compte, car il ajouta aussitôt :
— Il est possible qu’au flottage les rondins se fendillent. Ça réduira un peu le volume utilisable. Le bois d’œuvre, on a beau dire, ça reste fragile. Ceux d’ici en particulier.
Il avait semblé au vieil Alsacien qu’il avait volontairement renforcé son accent franc-comtois. Une manière de lui signifier qu’il n’était qu’un étranger au pays malgré tous les efforts accomplis pour ne jamais rien laisser paraître de ses origines après l’annexion de sa province natale à l’Empire, six ans plus tôt.
Ziegler se renfrogna. Les propos de son partenaire commercial signifiaient-ils une baisse du montant convenu ? La forêt valait son prix et maître Vuillet s’en était aperçu au premier regard. Sept hectares de bois d’œuvre qu’il avait hérités de sa mère et que personne n’avait jamais touchés depuis des décennies. Certains arbres avaient la réputation d’être plusieurs fois centenaires, et tous semblaient avoir attendu de parvenir à maturité pour assurer le meilleur profit à leur propriétaire. Sa mère en parlait déjà comme d’un trésor végétal qui leur garantirait, à son frère et à lui, aisance et prospérité. Avec un tel héritage, leur avenir était assuré, pas de doute. « C’est dans les forêts comtoises qu’on trouve le meilleur bois à travailler. Avec les ormeaux et les résineux de là-bas, les charpentes résistent à tout : la foudre, les moisissures, les insectes, même la méchanceté des hommes, tout. »
La voix de sa mère venait de s’éveiller en lui, péremptoire, charriant en bloc, comme toujours, tout un tas de certitudes. Elle était là, dans cette forêt qui allait si bien à son humeur taciturne. Elle n’était jamais retournée depuis sa prime jeunesse dans le berceau de la famille, cet endroit perdu du département du Doubs. L’armée prussienne s’était chargée de reléguer au rang des derniers soucis les vieilles nostalgies ataviques. Lui pourtant était parti, son frère était resté et leur mère n’avait pas supporté longtemps de respirer l’air de l’Empire teuton. Les quelques avoirs qu’il avait pu emporter lui avaient permis de racheter, à Choisey, près de Dole, une affaire de vente de matériel agricole, prospère, mais dont il avait fini par être évincé par des associés moins scrupuleux que lui dans l’art du négoce.
Maître Vuillet tira sa montre de son gousset, huma l’air que le vent agitait en petites secousses pour mieux laisser deviner les menaces climatiques du lendemain et s’en alla rejoindre les bûcherons qui achevaient d’empiler les rondins pour le prochain transport. Voyant qu’il s’approchait, la dizaine d’hommes vigoureux qui terminaient l’ouvrage de la journée dans un brouhaha de basse-cour se turent. Ce silence donnait la pleine mesure de son autorité, lui qui n’était pourtant pas leur employeur. Le respect chez lui s’imposait à distance et les valeureux travailleurs qui étaient sur la coupe depuis plus de dix jours avaient tout de suite compris à qui ils avaient affaire. Avec lui, personne ne discutait ni le salaire ni le prix de vente, et encore moins les conditions de travail. Toute parole devenait injonction et toute injonction une menace à peine dissimulée. L’obéissance venait naturellement, comme une eau courante débouchant d’une descente abrupte. Un avantage naturel dont Charles Ziegler, Karl pour l’état civil, n’avait jamais été gratifié. Pour lui, les bûcherons prenaient une posture bienveillante toujours assez proche de la pitié. Sur sa vieillesse, on ne lui épargnait rien. Rien de ses forces défaillantes, de son arthrite, de sa lenteur et de la façon qu’il avait de regarder le monde comme s’il devait en recevoir à tout moment l’extrême-onction. Bref, tout le contraire de maître Vuillet qui lui rendait bien dix années sur son âge et dont la silhouette tassée mais alerte n’appelait pas la compassion.
Quand il aperçut l’enfant sur le pont qui enjambait la rivière, il se dit que la nuit était proche. Maître Vuillet s’était esquivé de son pas de tortue après quelques paroles échangées avec le chef des bûcherons. De loin, il les avait imaginées brèves et concises, comme aiguisées par la lame qui devait départir ses rondins dans sa scierie de Parcey. C’était quelqu’un qui fonctionnait à l’économie, en argent et en parole. Un laconisme plutôt rassurant : les fûts allaient pouvoir, dès le lendemain, être transportés jusqu’au port de jetage. Les hommes s’étaient ensuite rassemblés et le chef avait accompli un passage en revue rapide des outils – scies, haches, merlin, coins d’abattage et coins à fendre –, avec un œil avisé et un scrupule qui pouvait aller jusqu’au toucher du métal. Ils étaient ensuite partis à pied en une masse informe qui faisait penser à un millepatte. Ils avaient dû croiser l’enfant, son petit-fils, venu, le soir tombant, à sa rencontre.
C’était un garçon à la physionomie parfaitement proportionnée, qui avouait spontanément être âgé de dix ans alors qu’il en avait deux de moins, mais qui montrait dans cette anticipation sa hâte de quitter une enfance qui lui donnait chaque jour son lot de frustrations. La blondeur de ses cheveux, qu’il s’obstinait à ensauvager en tignasse rebelle, son regard azuré et la blancheur de son teint le ramenaient à ses origines alsaciennes maternelles, tandis que le port altier et la facilité qu’il avait à lancer des défis le rattachaient au lignage paternel.
Le petit s’arrêta près des stères qu’il jaugea comme autant de bûchers de ses bonheurs d’enfant. Tout ce qui représentait aux yeux de son grand-père une promesse de bénéfices lui apparaissait comme le symbole de son propre malheur. Depuis quelque temps, il avait compris que le remariage de sa mère Gerda allait immanquablement l’éloigner d’elle parce que le fils d’une veuve ne doit pas vivre à ses côtés. Il était sa brûlure au fer rouge au-dessus de son sein et il avait bien saisi que, pour le salut de cette femme encore jeune, on devait recouvrir sa poitrine d’un corset pour dissimuler ses lésions.
Dans ses yeux clairs, il y avait toujours comme une lueur de reproche qui ne passait jamais inaperçue chez l’aïeul. Tous deux savaient qu’une autre vie attendait Gerda dès que le prix de la coupe serait perçu. Celle d’Édouard, son fils, se poursuivrait dans un pensionnat religieux en attendant son admission au prytanée militaire d’Auxonne ; celle de Karl se figerait dans la vieillesse et l’ennui. Le destin était ainsi scellé. Édouard embrasserait le métier des armes comme son père avant lui, le capitaine Thouvenin, mort un matin du mois de janvier 1871 lors du siège de Belfort. La nation reconnaissante avait d’ailleurs alloué à son fils un petit capital pour l’aider dans ce projet.
Le vieil homme s’appuya sur l’épaule juvénile du garçon et ils marchèrent ensemble, silencieux, l’esprit tourmenté par des pensées qui devaient sans doute être les mêmes.
Il était loin maintenant, le temps où Charles Ziegler avait investi une partie de sa fortune dans le mariage de sa fille unique avec un jeune et vaillant officier fraîchement sorti de Saint-Cyr. Il avait sacrifié nombre de ses rentes, ses bons de capitalisation émis par la Banque alsacienne de crédit, et quelques arpents de bonne terre. Il pensait, avec cette alliance, acquérir une fois pour toutes un statut de notable qui l’éloignerait de ses racines paysannes. Le seul représentant de sa lignée qui fut pourvu de quelques fonctions d’autorité était son grand-père qui, après les campagnes napoléoniennes, revint dans son village d’Alsace, auréolé d’une gloire un peu usurpée mais que personne ne songea jamais à lui contester, et qui, pour services rendus à la patrie, devint le garde champêtre de sa commune. Une fonction purement administrative à laquelle on ajouta quelques prérogatives de police.
Avec l’impétueux et brillant sous-lieutenant Thouvenin, sa soif d’ascension sociale fut étanchée d’une manière quasi inespérée. Lui-même issu d’une famille modeste de Picardie, il n’apportait à sa femme que sa solde d’officier débutant. Aussi, en reconnaissance des bienfaits que lui procurait cette union, son beau-père consacra une grande partie de ses ressources à l’installation et au confort du couple. Le statut de militaire les condamnait à mener une vie itinérante de garnison en garnison ; aussi fut-il décidé que leur point d’attache serait la ville de Belfort où le capitaine finit par être affecté dans un régiment d’artillerie de forteresse.
Pour le bonheur de sa fille qui venait d’enfanter pour la première fois, rien n’était trop beau. Il fallait rendre sa réussite ostentatoire, même par procuration, et pour cela il ne lésina pas sur les dépenses somptuaires. La petite famille emménagea dans une villa cossue des beaux quartiers de la ville, qui avait des allures de petit château, debout au milieu d’un parc dont on devinait, plus qu’on ne percevait, les limites qui le séparaient du voisinage. Dans le milieu bourgeois très fermé où chacun se voyait comme le garant des hiérarchies établies, on ne manqua pas de cancaner en douce sur ce jeune officier subalterne qui étalait sans scrupule la richesse d’un patrimoine que l’on pensait réservée au chef de corps d’un régiment, voire au général commandant la région militaire. Ce fut pourtant le chef de son régiment, qui aurait pu entonner l’air de la jalousie, qui coupa court à toutes les rumeurs. Le colonel Denfert-Rochereau prit le jeune capitaine sous son aile pour en faire, durant le siège de Belfort, plus que son officier d’ordonnance, la pièce maîtresse de son état-major qui organisa la résistance à l’armée prussienne, seul fait de gloire militaire de la guerre, qui valut à la ville d’échapper à l’annexion. La mort héroïque du jeune capitaine au champ d’honneur, loin de sa femme et de son fils repliés à Besançon avec leur père et grand-père, marqua pour eux le début de ce qui devint, même sans que cela fût jamais dit, leur déchéance. La maison et le domaine, après avoir abrité l’état-major de campagne de l’ennemi, furent détruits par un bombardement. Après la guerre, Gertrude Thouvenin ne put que retirer de la vente un prix dix fois inférieur à l’investissement de départ et les promesses de dédommagement du ministère de la Guerre restèrent lettre morte pour d’obscurs motifs que cette administration savait invoquer lorsqu’il s’agissait de préserver ses intérêts.
Charles Ziegler ne dut alors qu’à quelques placements judicieux de pouvoir échapper à la ruine complète. La pension de veuve de guerre de Gertrude représentait à peine les gages que percevait un employé de maison du temps de sa magnificence. Il s’était montré optimiste en se disant qu’il ne manquerait pas de jeunes officiers, fonctionnaires ou magistrats – et pourquoi pas un solide entrepreneur doté de quelques avantageuses positions de rente ? –, que sa beauté autant que son éducation lui permettaient légitimement de convoiter. En fait de prétendants, les jeunes lieutenants de la garnison n’étaient intéressés que par d’éphémères aventures, celles qui ne forcent pas à s’enchaîner pour la vie à une veuve ayant charge d’enfant. Les seuls qui se montraient attirés par la bagatelle étaient des sous-officiers, soudards belliqueux, souvent analphabètes, ou des agents de perception qui ambitionnaient, par leurs fonctions, de rejoindre la caste des puissants sans que leurs maigres revenus leur en fournissent les moyens. Ce fut alors une période de restriction, et le vieil Alsacien, qui pensait pouvoir se retirer et gérer un patrimoine pour maximiser ses rentes, dut à nouveau reconstruire tout ce qu’il avait perdu. Des années de labeur s’en étaient suivies et il avait gardé auprès de lui sa fille et l’enfant de celle-ci.
Gertrude les attendait dans un chemin, moitié sable, moitié limon, qui prenait par endroits une texture de boue gélifiée, s’agrippant aux roues des charrettes et faisant un cataplasme aux pattes des chevaux. Frigorifiée, elle cachait ses mains dans un manchon de fourrure de renard, seule touche de coquetterie sur un ensemble qui la mettait à peine au-dessus des femmes paysannes chez qui l’idée de séduire se retirait dès leurs noces. Elle attendait, assise sur la banquette de la carriole dont seuls quelques montants en fer forgé donnaient un peu de fantaisie et la séparaient de l’outil agraire.
Son père prit place à ses côtés. Le chemin était long, une lieue de cahots qui faisaient bringuebaler l’attelage à la moindre ornière. Ils n’échangèrent que quelques mots d’un usage adapté à la fraîcheur de ce soir hivernal. Elle ajouta simplement qu’elle avait croisé maître Vuillet et qu’elle avait remarqué sa mine contrite, son renfermement sur lui-même comme s’il faisait ses comptes. Le monde se limitait pour lui aux quelques mètres que sa vue basse ouvrait devant lui. Elle lui avait adressé un salut poli qui resta sans réponse. L’homme calculait, échafaudait, plongé dans des spéculations qui effaçaient tout autour de lui.
— A-t-il modifié le prix ?
C’était la seule réflexion qui lui était venue à l’esprit. Quand elle posa la question à son père, celui-ci se voulut rassurant.
— Je ne crois pas. Il veut aller vite et en finir rapidement.
Il aurait souhaité ajouter que lui aussi, mais l’évidence aurait rendu sa réplique superfétatoire.
Maître Vuillet l’avait étonné la première fois qu’il l’avait vu. Un bon professionnel du bois qui en parlait avec une tendre familiarité et une science qui forçaient l’admiration. D’un œil avisé, il entrait dans l’intimité de la matière, en diagnostiquait les faiblesses et les vertus. Dès son arrivée sur la coupe, il était parti seul, sans rien dire, par les sentiers qui parsemaient la forêt. L’exploration prit plusieurs heures, faite d’observations attentives, d’évaluations et de diagnostics qui préludaient à des pensées de lucre.
Ziegler l’avait laissé faire en le regardant de loin entrer en conversation silencieuse avec les arbres de haute futaie dont les branches basses semblaient venir caresser sa silhouette en signe de bon accueil. Au retour de ses pérégrinations solitaires, il avait annoncé son prix, ferme et définitif. L’homme n’était pas du genre à facilement transiger. Une fois que l’estimation était faite, rien ne pouvait le faire revenir en arrière. La confiance qu’il mettait dans ses techniques de mesurage comme dans ses intuitions renforçait ses certitudes. Pour ça, nul besoin d’outil. Il n’utilisait pas d’équerres forestières ni de toise pour quantifier le cubage. Son regard avisé, affûté par des années d’expérience, suffisait. De fait, il ne se trompait jamais, ni sur le volume, ni sur la qualité du bois, ni sur le montant auquel il pourrait l’écouler.
— Monsieur Ziegler, le prix que je vous propose sera celui que je vous donnerai si vous faites parvenir avant trois semaines les rondins jusqu’à ma scierie à Parcey. J’ai des engagements ; les délais seront de rigueur. De rigueur.
Une répétition à mi-voix qui n’avait rien d’une redondance. Le manquement à la parole donnée ferait perdre à l’Alsacien une somme généreuse et estimable et tous les espoirs qu’il avait fondés.
Cet argent était pour lui une nécessité vitale. Lui seul lui permettrait d’éviter la saisie de la maison de Choisey grevée d’une inscription hypothécaire dont il lui fallait obtenir rapidement la mainlevée pour que la demeure fasse partie de la dot de sa fille. C’était à cette condition qu’elle pourrait épouser l’homme à qui elle était promise et qui était d’un rang social suffisant pour donner au vieil homme la certitude que le blason familial, après de nombreuses vicissitudes, serait redoré.
— Vous aurez votre livraison dans trois semaines.
Le ton était péremptoire, mais laissa son interlocuteur soucieux.
— Cette promesse vous engage, mon cher Ziegler. Le flottage sur la Loue au mois de février, au cœur de l’hiver, est plutôt risqué. Il fait froid et c’est la période des hautes eaux.
Il n’avait rien répondu, confirmant par ce silence son hasardeuse promesse. Maître Vuillet avait, par ses petites insinuations, tenté d’éprouver la calme détermination de son partenaire en affaires, mais celui-ci avait arboré un visage sur lequel il s’efforçait de plaquer une expression de sérénité. Il savait que cette promesse était une gageure dont l’exécution mettrait à rude épreuve ceux qui seraient chargés du transport. Rien, cependant, ne le ferait revenir dessus. Il prendrait toutes les dispositions nécessaires pour accélérer le cours des choses, comme se dispenser du marquage du bois. Une omission qui pouvait s’avérer risquée en cas de contestation sur la propriété des fûts. Un risque à courir.
— Vous êtes un homme de parole, mon cher Ziegler. Comptez bien douze à quinze jours au moins de flottage en plein hiver. Il vous reste à trouver des hommes assez forts ou assez fous pour réaliser une telle prouesse.
L’auberge de Montgesoye était des plus modestes. On y trouvait à pareille époque quelques flotteurs qui s’aventuraient encore en ces périodes de frimas pour quelques voyages de flottage à bûches perdues. Généralement du bois de chauffe, venu des abattages des hautes pentes, qui restait encore après l’élagage des arbres dont la meilleure partie avait servi de bois de mine ou de traverse. Quelques colporteurs s’y étaient également donné rendez-vous pour se répartir le pays en zones de chalandise. Des paysans aussi pour des visites familiales, qui expédiaient ainsi en saison froide une corvée qu’ils n’auraient ni l’envie ni le temps d’accomplir à la belle saison. Un monde de petits métiers fait d’humbles tâcherons qui ne supportaient les rigueurs de l’hiver qu’à coups de gnôle en attendant la prochaine embauche et au milieu desquels Ziegler, sa fille et Édouard, déjà acquis à la bourgeoisie urbaine, détonnaient. Une présence presque incongrue que Gertrude tentait d’atténuer par ses toilettes empreintes d’une simplicité un peu forcée.
Elle avait pris soin de réserver une chambre à son père et, devant l’impossibilité de consulter un médecin, elle s’était rabattue, presque en désespoir de cause, sur les services d’une rebouteuse, âgée tout au plus de vingt ans, recommandée par l’aubergiste. Elle avait ainsi convaincu le vieil homme de faire confiance à la dextérité de la jeune paysanne qui, bien que ne sachant ni lire ni écrire, possédait l’art et la manière d’apaiser la douleur par la seule imposition de ses mains.
Maître Vuillet avait également pris pension dans le même établissement. Une chambre simple, sans apprêt, d’un tarif bien inférieur au train de vie que son aisance matérielle lui autorisait. Mais les deux hommes fuyaient tous deux la promiscuité avec les autres clients. Un motif suffisant pour éviter de cohabiter et pour limiter leurs rencontres à celles ayant des visées strictement commerciales. Lorsqu’ils se retrouvaient, c’était autant pour sauvegarder les apparences que par politesse. Aucune envie ne les taraudait d’en connaître davantage sur les desseins de l’autre. Une pudeur ancestrale les poussait à la plus extrême discrétion qui finissait par tourner à l’indifférence. Il leur arrivait ainsi de partager leurs repas dans la salle commune, dans une encoignure à l’abri des regards des autres et de leurs remugles avinés.
Un soir, maître Vuillet invita Gertude en tête à tête. Il était lui aussi grand-père et ne n’avait aucune ambition de séduire la jeune veuve. Leur conversation se limita aux sujets les plus anodins, ceux qui n’exposent jamais à un affrontement et se laissent dériver vers une superficielle unanimité qui donne quelquefois l’illusion de la connivence. Elle subodora alors que le marchand ne l’avait invitée que pour pouvoir la contempler à son aise. Pas pour user d’un charme que ni sa physionomie rabougrie, ni sa prestance d’homme éternellement endeuillé, ni l’âge, ne lui conféraient, mais seulement pour voir si l’investissement que son père réalisait pour le mariage de sa fille en valait bien la peine. Quand elle eut la certitude de ne s’être pas trompée sur les arrière-pensées de son hôte, elle prit un malin plaisir à se montrer brillante et séductrice. Juste de quoi émoustiller le négociant et achever de le convaincre que l’effort financier consenti par son partenaire était bien à la hauteur de l’enjeu.
Gertude – Gerda quand elle se retrouvait dans l’intimité paternelle – avait dépassé la trentaine, et la maturité n’avait pas encore éteint la flamme juvénile qui pouvait de nouveau l’exposer à une passion amoureuse. Son visage aux traits réguliers, éclairés par des yeux bleus, s’accordait, disait-on, aux canons d’une beauté classique, aux accents romantiques, qui plaisaient tant aux promoteurs de la mode parisienne. Sa blondeur et sa peau à la blancheur laiteuse étaient également en harmonie avec le goût du jour, qui, depuis la perte de l’Alsace et de la Lorraine, avait fait de la femme alsacienne l’incarnation du charme patriotique. Elle s’était bien sûr un peu épaissie en quelques années sans que ce léger surpoids menace en rien l’attrait des regards masculins qu’elle pouvait encore susciter. Pour tous ceux qui apprenaient son union prochaine avec un fils de famille à la réputation de débauché, la sentence était toujours la même : il ne la méritait pas.
Pour dissuader quiconque de la prendre en pitié, elle arborait un air sévère de femme d’affaires intraitable. C’était elle, d’ailleurs, qui avait mené au plus serré la négociation avec maître Vuillet ; Charles Ziegler n’avait eu ensuite qu’à avaliser le résultat de la transaction, croyant, ou feignant de croire, qu’il en avait été l’initiateur.
« Je vous paye comme convenu la moitié du prix par lettre de change que vous pourrez remettre à l’escompte dans deux jours. Cela sera suffisant, je crois, pour que les créanciers de votre père prennent patience », lui avait dit l’acquéreur de la cargaison de grumes en lui tendant l’effet de commerce. Gertrude avait soupiré ostensiblement. La maison de Choisey était hypothéquée et le prêt arrivait à terme sans que le débiteur, Charles Ziegler, ait de quoi solder ce qui restait dû. Un temps, la bonhomie du vieil homme lui avait fait espérer qu’il s’acquitterait immédiatement de la totalité de la somme convenue, ce qui aurait permis de rembourser l’ensemble des créanciers et de conjurer le risque que la maison domaniale ne soit vendue. Mais il était resté intraitable sur ce qui avait été décidé entre eux.
— Je serai à Dole avant la fin de la semaine. Je ferai endosser cette lettre de change par le banquier de mon père. Il est prévenu.
— Avec cette première traite, je pense qu’il ne se fera guère de soucis. Le prix est quand même supérieur au solde du prêt garanti par l’hypothèque sur votre future maison. Le reverserez-vous à votre oncle ?
L’oncle ne faisait plus partie de ses pensées depuis bien longtemps. Le souvenir qu’elle en gardait était celui d’un homme ombrageux qui accumulait en lui toutes les contradictions. Catholique presque dévot, il était porté à l’avarice et sa générosité ne se répandait jamais au-delà du cercle familial. Politiquement, alors qu’il n’avait jamais économisé sa fibre patriotique, il s’était laissé imprégner par un pangermanisme venu d’outre-Rhin, qui ne l’avait pas fait hésiter une seconde quand l’annexion de sa province à l’Empire avait pour beaucoup d’Alsaciens sonné l’heure du choix. La même seconde avait suffi à son frère pour prendre l’option inverse.
Cet oncle était désormais passé à l’ennemi, et plus personne, de ce côté-ci de la frontière, n’avait jamais éprouvé l’envie de renouer le contact. Charles s’était fendu un jour d’une lettre aimable et conciliante qui ne reçut de réponse qu’un message comminatoire lui enjoignant de lui faire parvenir la contrevaleur des terres comprises dans la succession de leur mère. Il vivait depuis dans la crainte d’une amélioration des relations diplomatiques entre la France et l’Empire voisin, qui aurait pu inciter son frère à venir réclamer en personne sa part d’héritage.
— Bien sûr, répondit-elle avec une fermeté qui coupait court à toute réplique. Nous avons perdu nos biens en Alsace, pas notre honnêteté.
— Bien, bien. Ne vous inquiétez donc pas pour la levée d’hypothèque. Les hommes de confiance inspirent la confiance. Les femmes aussi.
Le lendemain, Charles Ziegler ne se rendit pas sur la coupe. Maître Vuillet qui assistait à toutes les opérations de débardage lui avait assuré qu’avec un temps clément les derniers rondins seraient prêts au transport dans les trois jours à venir.
— Vous m’excuserez de ne pas vous accompagner sur place, maître Vuillet, mais…
— Je comprends, je comprends, répondit l’autre en agitant sa main à la peau en parchemin froissé. Le prix est désormais ferme et définitif, comme disent les notaires et les avoués. Vous pourrez obtenir la mainlevée de votre hypothèque d’ici peu. Une dizaine de jours si la conservation des hypothèques fait bien les choses. Aussi, je crois utile de vous conseiller de garder la rangée de hêtres qui se trouve à l’ouest de la parcelle. Visiblement, leur plantation est plus tardive et le bois est encore jeune et tendre. Épargnez-les pour cette année et donnons-nous rendez-vous dans deux ans si Dieu nous prête vie.
— Faites à votre guise, maître Vuillet. Je ne demande qu’une chose : que l’hypothèque de ma maison soit levée pour y installer ma fille et payer la pension de mon petit-fils. Je n’ai plus l’âme d’un spéculateur. Que ces hêtres restent en vie ! Qui sait ? Cela me portera peut-être bonheur. Celui-ci s’est plutôt montré avare de sa générosité à mon égard ces dernières années.
Qu’importait, après tout, les quelques arpents de coupe qui restaient ? Le vieux marchand n’en aurait donné qu’un prix lésionnaire, et la petite rente que lui prodiguaient des fermages épars dans la région lui assurait un revenu suffisant pour rémunérer les bûcherons qui, au printemps venu, se chargeraient de dessoucher le sol avec des charges de chlorate de soude. Il faudrait bien un an avant de songer à replanter le fonds. Si tout se passait bien, c’est-à-dire si son frère ne sortait de nulle part pour récupérer son dû.
Finalement, il aurait pu retourner à la coupe si la rebouteuse ne s’était pas présentée plus tôt à l’auberge. Assurément, elle ne payait pas de mine. Plutôt grossière et malhabile, avec un corps fondu dans des rondeurs cristallisées qui faisaient des bosses sous sa jupe longue. De plus, parler n’était pas à sa convenance et son mode d’expression se résumait aux gestes simples du quotidien, si bien que l’Alsacien pensa d’abord qu’elle était muette. Elle ne l’était pas, mais seules ses mains parlaient avec des bruits de peau frottée.
Ses mouvements étaient précis et son contact apaisant. Rien entre ses mains nues et la peau malaxée, ni pommade ni onguent, seulement une énergie fébrile qui s’infiltrait dans le tréfonds des chairs, là où s’enchâssait le mal.
— Dans quelques jours, il faudra recommencer.
Ce furent ses seules paroles. Elle encaissa le prix du service rendu sans en discuter le montant ni même vérifier que le compte y était. Un don ne se rémunère pas, disait-on. Il la regarda s’éloigner sous la pluie glaçante avec la conviction qu’elle serait sans doute un jour prochain une femme désirée.
Gertrude avait prévu, de son côté, de se consacrer uniquement à son fils. Sous le fallacieux prétexte d’une maladie infantile, il avait été dispensé de cours au collège de Dole. Elle avait tenu à l’avoir près d’elle pendant ce court voyage jusqu’à Ornans, pour le préparer au changement qui s’annonçait. Ce serait certainement aussi leurs derniers moments de complicité. Après, il y aurait, pour elle, sa nouvelle vie d’épouse et de maîtresse de maison, de mère aussi sans doute, et, pour lui, l’internat et sa discipline militaire comme prélude à sa future vie de caserne.
Elle avait inscrit de la lecture au programme de la journée. Un libraire de Dole lui avait recommandé un ouvrage récent de Jules Verne, L’Île mystérieuse. Elle l’avait acheté, l’avait lu et voulait maintenant transmettre son bonheur de lecture à Édouard, dans l’espoir que ce souvenir commun serait assez tenace pour renforcer entre eux ce lien, fait d’amour pudique et de respect, qui ne survivrait à leur séparation qu’au rythme d’une visite hebdomadaire, le dimanche. Elle passerait donc la journée avec son fils pour ne rien perdre de leurs derniers moments ensemble. Ils partageraient sans doute un peu de leur désespoir comme si cette mise en commun leur ferait garder quelque chose de l’autre.
Elle avait annoncé à son fils la nouvelle de son futur mariage un dimanche, après la messe dans la grande cathédrale de Dole. Elle l’avait serré dans ses bras avec une gravité inaccoutumée pour bien montrer que cette union était sérieuse et que rien de ce qu’ils avaient vécu dans le passé ne se reproduirait.
La fois précédente concernait un certain Damien de Bizien. Le garçon, au premier abord, avait les attraits d’un personnage avenant et à l’humeur enjouée. Plutôt bien fait de sa personne, il était de deux ans moins âgé que celle sur qui il avait jeté son dévolu, la belle Gertrude, qui voyait déjà s’éloigner les beaux jours de sa jeunesse où sa beauté resplendissante faisait merveille. Il s’était présenté comme un étudiant en droit de l’université d’Aix-en-Provence, qui achevait un mémoire de droit commercial. Il disait hésiter entre la magistrature et le notariat pour finalement pencher pour l’achat d’une étude d’officier ministériel, pour peu qu’une banque généreuse l’aide à financer l’acquisition de la charge.
C’était son père qui, réconforté par deux belles années fortement bénéficiaires, s’était occupé de trouver une étude que sa fille apporterait en dot. L’une d’elles, située à Mont-sous-Vaudrey, voyait son titulaire partir à la retraite à plus de soixante-dix ans. L’affaire fut conclue rapidement, à l’issue d’un dîner que les deux hommes prirent dans le meilleur restaurant de Dole. Le prix serait payé comptant pour la moitié et, pour l’autre, par un prêt garanti par une hypothèque prise sur la maison de Choisey. Aucun risque ne viciait l’investissement. Tout respirait la confiance et la sérénité.
Le couple, avant même la cérémonie des noces et contre toute bienséance, cohabita dès les fiançailles dans la vaste demeure paternelle. Les douze pièces de la bâtisse qui passait aisément pour un petit château de style Renaissance, avec un grand parc ombré de tilleuls, amortissaient les quelques rumeurs vénéneuses qui couraient au dehors. Une vie de famille prenait corps dans une ambiance d’insouciance et de félicité retrouvée. À la petite communauté s’adjoignit bientôt une jeune femme, Éléonore, la sœur du futur notaire, d’une beauté fragile, répudiée par un mari fortuné qui n’estimait pas son épouse digne de fréquenter la société dans laquelle il évoluait désormais. Charles Ziegler, qui débordait de bonté au fur et à mesure que s’ébauchait sous les meilleurs auspices l’avenir de sa fille, accepta de bonne grâce l’arrivée de cette sœur, au point d’envisager de la marier à l’une de ses connaissances. Celle-ci se montra ouverte à cette perspective et accepta sans rechigner de rencontrer les prétendants qui, une fois son divorce prononcé, endosseraient les habits des plus conformistes des époux.
Ce fut elle qui, un soir, alla voir dans sa chambre Gertrude, sa future belle-sœur. Elle pleurait abondamment. Elle ne s’exprimait que par un chaos de mots d’où il ressortait qu’un malheur venait de frapper son frère, mais que par discrétion il n’en avait rien dit.
Elle n’eut aucune retenue pour s’épancher, sans doute sous l’influence d’une complicité exclusivement féminine. Damien venait de recevoir sa feuille de route pour être enrégimenté à Besançon, ce qui mettait à mal ses projets d’installation. Depuis trois ans, il avait repoussé l’échéance et croyait avoir tiré un trait définitif sur la perspective de connaître un jour la vie de caserne. À tort. Le tirage au sort avait été supprimé quelques années plus tôt, et par là même le rachat par des candidats moins fortunés, mais la pratique existait encore de manière clandestine. Pour échapper à la conscription, il avait noué contact avec un jeune paysan que l’idée d’aller servir la patrie sous d’autres latitudes n’effarouchait pas. Depuis, le garçon avait répondu à l’appel d’un autre conscrit et se trouvait aujourd’hui dans un régiment d’infanterie coloniale en Algérie, avec le grade de caporal. D’autres pourraient sans doute faire l’affaire, vu que la solde dépassait avantageusement les bénéfices et les avantages que l’on retirait du métier de paysan. Pour le jeune notaire en voie de reprendre l’office de Mont-sous-Vaudrey, il en coûterait davantage que le modeste pécule promis au premier pressenti.
Le vieux Ziegler avait donc avancé à son futur gendre la somme importante qui lui permettrait de se libérer de ses obligations militaires. Il avait d’abord empoché lui-même l’argent destiné à désintéresser son remplaçant, sous prétexte d’assurer ainsi la confidentialité de la transaction. Sa générosité avait un coût qui se traduisit aussitôt par une augmentation sensible d’avances en trésorerie par la banque qui gérait son compte courant. En contrepartie, le commerçant dut consentir une extension de l’hypothèque qui grevait déjà le domaine de Choisey.
Le mariage se précisait et Damien s’était montré attentionné avec sa promise. Sa sœur et lui s’étaient pratiquement occupés de tous les préparatifs, contactant les fournisseurs, le prêtre de la paroisse de Dole et les membres de la profession notariale qui seraient autant ses rivaux que ses pairs.
Le cataclysme se produisit deux semaines avant la cérémonie. Damien s’était absenté deux jours avec sa sœur pour régler les derniers détails de la reprise de l’étude. Personne ne s’émut d’une telle absence que rien ne pouvait rendre suspecte. Ce ne fut qu’au bout d’une semaine que l’inquiétude se fit sentir. Le vieux marchand de matériel agricole et sa fille se déplacèrent jusqu’à Mont-sous-Vaudrey pour s’entendre dire par le cédant de l’office ministériel que depuis que le jeune homme lui avait été présenté, il y avait quelques mois, il ne l’avait plus revu. De fait, la charge notariale allait être bientôt vendue à un jeune clerc de Pontarlier et seul manquait l’arrêté de nomination pour conclure l’affaire. À cette annonce, la mine du futur beau-père s’était décomposée. Une lividité accompagnée d’une prostration qui lui retira la parole pendant plusieurs jours. Il venait de comprendre que son ex-futur gendre, Damien de Bizien, n’était qu’un escroc qui avait encaissé le prix d’achat de l’étude.
Pour lui, le monde venait de s’effondrer, mais il avait mis, cependant, un point d’honneur à conserver sa dignité et à se hisser hors de portée des quolibets dont il se savait l’objet. Choisey était une petite commune et la confrérie des hommes de loi avait beau être fermée, il n’en était pas moins devenu la risée du pays, tant sa naïveté avait été sans limites. Il ne déposa aucune plainte, régla les fournisseurs des réjouissances nuptiales et inventa une histoire à dormir debout quant à une rupture subite pour bigamie, destinée à éteindre sur-le-champ la curiosité malsaine de l’entourage. La bonne société doloise fut avisée de la façon la plus officielle, par une lettre qu’il adressa à ses représentants les plus en vue et qui devaient être les convives les plus prestigieux de la noce. Les réponses s’efforcèrent à une commisération plus ou moins feinte à l’endroit de sa fille. Il chercha malicieusement dans leur lecture l’évocation, même pudique, d’une liberté recouvrée pour Gerda, propice à de nouvelles rencontres. En vain. Personne ne s’intéresserait à une femme, veuve et mère, qui s’était laissé ainsi abuser par un personnage aussi peu recommandable que ce Damien de Bizien. En fait de noblesse, l’homme – ce qu’il n’apprit que bien plus tard – était le fils d’un cordonnier de Reims, en rupture de famille, et sa sœur n’était autre que son épouse légitime avec qui il avait eu deux enfants, placés en nourrice chez des paysans, le temps de parcourir la province pour escroquer d’honorables citoyens nantis d’un confortable capital de crédulité. Avec ce que lui avait rapporté l’argent soutiré au père Ziegler, le couple pouvait envisager d’arrêter ses escroqueries, de reprendre ses enfants et de filer vers des horizons qui le mettraient à l’abri des poursuites et de la vindicte de ses victimes.
Charles Ziegler devint un homme fatigué et susceptible, une humeur qui n’était guère propice au négoce. En quelques semaines, il vendit son affaire à des associés qui n’avaient pas attendu pour profiter de l’aubaine, perdit quelques sources de rentes, réduisit l’effectif de son personnel de maison jusqu’à n’avoir plus personne à son service. Quand il se rendit compte que tous ses efforts n’éteindraient pas l’intégralité de sa dette, il vieillit, en quelques heures, de plusieurs années. De loin, il ressemblait de plus en plus à un gastéropode à la démarche ondulante et encombré d’une carapace trop lourde devenue pour lui un réservoir de ressentiment. Les forces qu’il trouvait encore en résidus dans son corps rabougri, il les consacra à se battre pour obtenir un report d’échéance auprès de la banque, le temps de finaliser la vente de terres en pâtures, perdues au détour d’un bois. Une vente finalement bien décevante. Ce fut vers cette époque que son frère se manifesta par une lettre comminatoire dans laquelle il réclamait la part de biens lui revenant. Sa réponse fut laconique et apaisante. La relation épistolaire s’interrompit alors que le sort des biens de la succession de leur mère n’était pas réglé. Un silence compensé par les relances de plus en plus insistantes du créancier hypothécaire.
Les Vaudemont comptaient parmi ses clients habituels. Ils possédaient, dans le nord du département, des terres qu’ils avaient confiées à des métayers à qui ils menaient la vie dure. Ils fournissaient le matériel et le cheptel, et ils s’appropriaient sans souci d’équité une grande partie de la production et des récoltes. Comme beaucoup de monde dans la petite ville franc-comtoise du bord du Doubs, ils étaient au courant de la disgrâce de leur fournisseur. Le chef de famille, que Ziegler connaissait comme un homme plutôt bourru, âpre au gain et foncièrement malhonnête en affaires, lui proposa une alliance familiale, lui faisant comprendre qu’il s’agissait là de sa seule planche de salut.
Vaudemont apportait son nom, la caution d’une famille honorable et la promesse de tirer Gertrude des affres d’un veuvage stérile ; en contrepartie, lui, Ziegler, abandonnait Choisey qui deviendrait ainsi le domicile conjugal des époux. Il comprit que le choix de vivre dans sa maison ne lui était pas laissé. À l’évidence aussi, toute trace du passé de sa fille devait disparaître, ce qui signifiait qu’Édouard non plus n’y avait plus sa place. De son patrimoine, il ne lui restait plus qu’un placement, destiné à financer la pension de son petit-fils, et des arpents de forêt en indivision avec son frère. De quoi désintéresser encore quelques créanciers et peut-être de quoi lever la sûreté immobilière qui grevait sa maison. L’idée s’était imposée, sans hésitation possible, que la vente des hêtres et des chênes, qui appartenaient en commun à son frère et à lui, était le seul moyen de conjurer le spectre d’une déconfiture à laquelle, de toutes les façons, il n’aurait pas survécu. La vente du bois d’œuvre à maître Vuillet était bien pour lui une question de survie.
Gertrude n’avait guère eu le choix. Les deux futurs époux avaient donc été présentés. Lui, prénommé Victor, avait un an de moins qu’elle, suivant le calendrier en usage, mais des décennies les séparaient du point de vue de leur maturité. Plus intéressé par les tables de jeux des arrière-salles des débits de boissons dolois que par la bagatelle, c’est tout juste s’il formula à son père et à sa future épouse la promesse de cesser de fréquenter les prostituées, moins pour la morale que pour des motifs strictement prophylactiques. Le mariage était pour lui la sanction de ses écarts de conduite. Il ne fit pourtant pas appel de la sentence et se résolut au sort qu’on lui réservait.
Le plus difficile à accepter pour la jeune femme, outre la séparation annoncée d’avec son fils, fut de devoir composer avec Berthe, la sœur aînée de son promis. D’une humeur constamment grincheuse, et volontiers condescendante, elle assistait à la messe trois fois par semaine au moins et fréquentait assidûment le salon de Mgr l’évêque, celui-là même dont les positions royalistes inquiétaient les milieux républicains locaux. « Vous ne croyez tout de même pas que le peuple puisse accorder la moindre confiance à ce général de Mac-Mahon dont le seul nom respire l’étranger, et pas forcément des odeurs les plus agréables. »
On y échangeait volontiers ce genre de répliques et il était bien certain que, si la douairière, mariée à un négociant en vins assez prospère et mère de famille dévouée, n’avait qu’indulgence pour son frère cadet débauché, elle n’éprouvait que mépris pour la veuve qui allait faire une entrée fracassante dans la famille, avec sa cohorte de rumeurs malfaisantes dont elle subirait inévitablement les effets délétères.
Édouard manifesta une réticence à partager un moment d’intimité avec sa mère. Par dépit de la voir se résigner à un destin qui verrait inévitablement se flétrir sa joie de vivre. Il préféra s’enfuir, le livre à la main, pour s’installer seul dans la grande salle de l’auberge où une vaste cheminée laissait se consumer des bûches noueuses sur lesquelles les flammes glissaient.
Elle était trop lasse pour le rejoindre et lui octroyer un moment de réconfort qu’il attendait et qu’elle était réticente à spontanément lui offrir, de peur de lui donner de faux espoirs, ou, pire encore, qu’elle ne cède aux appels à le garder à ses côtés. Dans la chambre, elle se retrouva seule. Le miroir mural lui renvoya l’image d’une femme insatisfaite qui s’en voulait d’avoir des hanches un peu épatées, un profil pas assez élancé et un fond de tristesse qui résistait aux toilettes les plus sophistiquées. Elle porta sa main sur son ventre qui allait bientôt s’arrondir si tout se passait comme prévu. Ce qui adviendrait d’ici là serait les derniers feux de son veuvage avec leur part de liberté et peut-être d’insouciance qu’elle entendait bien partager avec son fils.
* * *
« La rivière, c’est comme une femme, on ne la satisfait pas sans effort. »
Albert Mourot avait, comme ça, quantité de formules sentencieuses qu’il énonçait tout haut comme pour s’encourager. La pluie lavait son visage à grande eau, le forçant à grimacer pour que sa voix couvre le bruit des bourrasques. Elle ne faiblissait pas, redoublait de colère à certains moments, mettant en permanence son corps sous tension pour maintenir en équilibre la frêle embarcation prise dans une enfilade de rapides. Les rochers semblaient entraver le cours de la rivière rien que pour le mettre à l’épreuve. Le moindre ravier était un répit pendant lequel le meneur d’eau, à l’avant de l’esquif, fait d’un agglomérat sommaire de rondins, tentait de se remettre dans l’axe à l’aide de son croc avant d’aborder l’obstacle suivant. Rosto, à qui incombait cette tâche, jurait en provençal, sa langue natale, quand la vitesse de navigation l’obligeait à improviser la manœuvre. Mourot, à l’arrière, les mains agrippées à l’arc-boutant de fortune, calquait ses mouvements sur ceux du meneur pour rester dans la trajectoire. Le passage d’un rapide, qui inclinait le radeau à quarante-cinq degrés, lui donnait un regain d’optimisme qui, un bref instant, anéantissait le froid, la pluie et le découragement qu’ils traînaient dans leur sillage. Depuis leur départ au lever du jour, ils avaient, à ce rythme, parcouru une faible distance, mais avec un dénivelé de plus d’une centaine de mètres.
— On en voit le bout, cria Mourot.
Rosto restait incrédule. Le lit s’était réduit, dans sa largeur, à quatre ou cinq mètres, mais la rivière avait à cet endroit la force d’un torrent, et les rochers, bien qu’éparpillés, étaient encore là, visibles sous l’écume, semblables à des crocs plantés pour faciliter l’échouage de ceux qui bravaient la furie des éléments.
Petite accalmie pendant laquelle Rosto plaça en travers du courant le radeau qui filait droit vers un rocher menaçant, à une cinquantaine de mètres. Il commençait à bien les connaître, ces rochers pleins de traîtrise, enfouis jusqu’aux épaules ou bombant le torse, et qui, au moindre frôlement, pouvaient envoyer au fond la plus solide des embarcations. L’eau heurtait l’obstacle de front, partait tout autour en tourbillons concentriques jusqu’à un rapide assez abrupt pour qu’on entende déjà le bruit de la chute. La démonstration de force pouvait faire hésiter les plus téméraires, mais elle renforça, au contraire, la détermination des deux hommes.
Passer debout, en équilibre plus qu’instable sur le pont du radeau, était pure folie. Sans se concerter, ils avaient eu le même réflexe, celui de s’allonger sur les rondins dont les attaches distendues désarticulaient l’assemblage. Le radeau avait passé la cascade, était parti en vol plané, puis était retombé à plat dans le gour qui mettait provisoirement la rivière au calme entre deux forêts de résineux.
Les bûches et quelques grumes avaient suivi et flottaient autour d’eux, troupeau de moutons tressautant au milieu du gué. Elles continuaient sur leur lancée, dans le désordre de leur éparpillement. Elles pouvaient aller comme ça jusqu’à Ornans sans surveillance, sans qu’une prise les retienne et fasse barrage. C’était maintenant la rivière qui les prenait en main, et les hommes, là-dessus, pouvaient lui faire confiance.
— On s’arrête. On a besoin de se réchauffer.
Rosto aurait bien continué un peu tant que le jour était encore là, mais Mourot était le patron.
Le radeau avait accosté sur une gravière. Rosto était toujours pieds nus. Un parti pris qui intriguait son compagnon, mais sur lequel il ne fit aucune remarque. Le Provençal voulait, par n’importe quel temps, sentir les aspérités de la grume sous la plante de ses pieds.
Pour l’heure, finalement, après ce qu’ils venaient de vivre, la chaleur d’un foyer était la bienvenue. Ils firent un feu avec un margotin, ce petit fagot de bois mort laissé par des flotteurs sous une couche de paille, à l’usage de leurs suivants. Il avait commencé à neiger et la grisaille du ciel ne se voyait plus qu’au travers d’un écran de pointillés.
— La nuit va tomber dans une heure. Mieux vaut s’arrêter ici.
« Ici » désignait pour Rosto un territoire étranger, une nature hostile traversée par une rivière capricieuse et inconnue, la Loue, une simple déformation du mot de louve, lui avait-on dit. Celle-là, depuis qu’ils avaient fait connaissance, avait la morsure cruelle, jusque dans ses rêves. Mourot ne valait pas mieux. Il l’avait rencontré il y avait quelques jours à peine, parce que celui-ci recherchait un partenaire pour un transport de bois de chauffe et de quelques fûts de bois d’œuvre, de la source de la Loue jusqu’à Ornans. Trois ou quatre jours de travail qui lui rapporteraient de quoi tenir deux semaines, en attendant une mission plus importante et plus rémunératrice.
— Pas très loin, il y a une ferme. Avec un peu de chance, on dormira près de la cheminée. Sinon, ce sera la grange.
Rosto n’aimait guère s’éloigner du lieu d’ancrage du radeau. Plus une superstition, chez lui, qu’une précaution. Souvent, sur la Durance, il avait préféré dormir à la belle étoile, même sous la pluie, plutôt que de jouir du confort rustique généreusement offert par un paysan. C’était pareil sur toutes les rivières ou tous les fleuves sur lesquels il avait navigué : son radeau faisait corps avec lui comme un organe qu’un créateur facétieux aurait rajouté à sa physionomie. Un état de symbiose qui en étonnait plus d’un, mais qu’il assumait, quitte à ce qu’il mécontente quelquefois une âme charitable.
Cette fois-ci, la protection d’un toit et la chaleur d’un foyer faisaient taire ses scrupules habituels. Il était peu accoutumé aux flottages en plein hiver. Là d’où il venait, même si l’eau des rivières descendue des reliefs était fraîche aussi en été, les flottages de bois ne commençaient jamais avant le printemps. L’hiver était une saison morte pendant laquelle les radeliers comme lui s’occupaient des quelques animaux de leur ferme, quand ils en avaient une, ou de ceux des autres plus sûrement.
Mourot avait sorti de sa gibecière une boule de pain noirci à la farine de seigle, celle qui résistait le mieux à la moisissure. Depuis leur départ de Hautepierre, il n’en prenait qu’avec mesure, une seule tranche par repas, finement coupée au fil de la lame de son coutelas comme il l’aurait fait pour un jambon à l’os. Une quantité ridiculement petite pour la carrure de son employé qui engloutissait ce maigre casse-croûte, agrémenté d’une poignée de pommes de terre cuites sous la cendre et d’un morceau de lard rance, en quelques coups de mâchoire. La nourriture était comprise dans le salaire, raison pour laquelle Mourot se montrait pingre. Aussi, Rosto, habile braconnier, avait déjà pris à la main un ombre et deux petites truites piquetées d’auréoles bleues. Il les avait empalés sur des tiges de joncs et les avait grillés au feu nocturne. Un mets délicat qui lui rappelait encore sa Provence d’origine, qu’il avait quittée il y avait deux mois à peine. De quoi susciter l’envie de son patron qui s’en tenait, lui, à ses boules de pain en voie de pourrissement et à un morceau de fromage sur le point de subir le même sort. L’homme ne l’épargnait guère, ni à la tâche sur le radeau ni au bivouac, et ce traitement ne l’encourageait pas à lui témoigner une compassion quelconque. Les poissons braconnés étaient donc restés sa pitance sans qu’il eût l’idée de la partager.
Le paysan s’était montré d’une convivialité moyennement généreuse. Ils purent aménager leur couche dans une crèche au-dessus de l’étable et ils eurent droit à une écuelle de soupe, mais l’hospitalité n’était pas gratuite. Leur hôte était plutôt d’une humeur taciturne que tout le monde au logis semblait craindre. Le prix de la prestation hôtelière équivalait à celui pratiqué dans des auberges qui parsemaient les rives de la Loue. Là, on leur aurait servi du vin, un petit morceau de viande et le sourire bienveillant d’une employée qui savait quelquefois se montrer peu farouche. Ici, ils avalaient un peu de tristesse ambiante à chacune de leurs bouchées.
Recrus de fatigue, ils se couchèrent de bonne heure. Dos à dos, enroulés dans leurs couvertures, ils s’endormirent aussitôt. Des rêves où ils voyaient leurs femmes, d’autres peut-être, au milieu de quelque chose qu’on aurait pu appeler le bonheur, les assaillirent.
Le lendemain, la soupe, celle de la veille, coûtait un supplément de prix. La fille aînée, une belle plante de seize ans aux penchants vénéneux, à en juger par les œillades à peine voilées en direction du Provençal, leur avait rajouté dans chaque écuelle une tranche de couenne. Elle ne disait rien, sauf que son silence leur racontait sa peine de rester ici et l’envie qu’ils lui proposent de partir avec eux, au bout du monde, même si ce n’était qu’à quelques kilomètres. Tous deux s’efforçaient de ne pas la regarder, de peur qu’elle ne surprenne dans l’expression de leur visage la réponse qu’elle redoutait. Elle ne partirait donc pas, demeurerait ici jusqu’à ce qu’un homme, bien plus âgé qu’elle et réputé bon parti, vienne faucher ses illusions comme un pré d’herbe tendre à la rosée matinale. Elle perdrait sa silhouette longiligne après plusieurs grossesses, s’épuiserait dans les tâches domestiques, en pensant à une autre vie qu’incarnerait peut-être un jour une de ses filles à qui, à des années de distance, elle ressemblerait.
Ils partirent à la naissance du jour. Pour le prix, le paysan, dans sa grande sollicitude, avait consenti à leur laisser un peu de pain. En réalité, c’était sa fille qui avait eu ce geste, mais, ne pouvant se raviser, il avait repris à son compte cet élan de générosité. Déjà la crainte était décelable chez la fille à qui, en coulisse, on ferait payer ses largesses.
Rosto jeta un dernier regard sur elle en s’éloignant, comme pour lui témoigner un peu de compassion et lui souhaiter du courage. Mourot était déjà passé à d’autres préoccupations.
— Avec la pluie d’hier, l’eau a monté. Certains passages seront trop dangereux. On fera le chemin à pied.
Rosto parut contrarié, marmonna quelques paroles de dépit, une manière de refouler sa déception. Il était un radelier, homme de la rivière avec qui il avait contracté un mariage d’amour et de raison, et il s’obligeait envers elle à une entière fidélité. Accompagner les trains de bois ou les bûches en flottaison libre à partir de la terre ferme lui semblait être une hérésie, le reniement de son idéal. Mourot lui parut être un de ces félons pour qui le cours d’eau n’était rien d’autre qu’un moyen de transport qui usait les hommes comme une larve de capricorne une poutre. C’était d’ailleurs ce qu’il exprimait ouvertement. Les rares fois où il lui adressait la parole, c’était pour tenir des propos défaitistes sur le métier. « Tu vois, mon gars. Pas sûr que l’année prochaine j’y sois encore sur la Loue. J’ai mon compte. Le flottage tire à sa fin. Ça ne nourrit plus son homme. Les marchands préfèrent le chemin de fer, c’est plus rapide. Et ça fait moins de morts. Faut que je pense à me reconvertir, faire autre chose. J’ai de bonnes terres, de belles forêts. Penses-y toi aussi. »
Rosto n’écoutait plus. Mourot avait passé la quarantaine et portait les stigmates d’une existence déjà remplie de traumatismes divers. Lui avait un peu plus que la moitié de cet âge, si ses facultés de compter pouvaient aller jusqu’à ce calcul. Il lui restait une vie entière à affronter les rivières d’ici et d’ailleurs. Surtout d’ailleurs. Celles de l’Amérique, par exemple. Ce pessimisme sur l’avenir de la profession avait le don de lui mettre les nerfs en pelote.
Chez lui, le radelier ne marchait jamais sur les berges. Sa vie était dédiée à la rivière. Une intimité qui la faisait quelquefois apparaître comme son double, même dans les endroits où sa colère ramenait son cours à d’interminables turbulences qui secouaient les hommes aussi sûrement que les peupliers battus par le vent du midi. Il avait l’impression que chez lui l’humidité était saine, pas sournoise. C’était le souffle de la rivière qu’il respirait. Ici, elle s’insinuait malicieusement partout, menait une guerre de conquête contre tout ce qui l’entourait, animée du seul souci de rendre la vie dure aux hommes. En espiègle, elle poursuivait son avancée en dansant sauvagement sur les accidents du relief, pour mieux leur faire subir son inconstance, à eux, les radeliers, qui ne voyaient pourtant en elle qu’une alliée de leur propre besogne. L’expérience ne faisait pourtant pas défaut à Rosto. Depuis l’âge de treize ans, il naviguait sur les cours d’eau de ses montagnes natales. Mourot l’avait d’abord pris pour un novice, mais il avait rapidement changé d’avis. Un rictus narquois avait peu à peu disparu des lèvres du Franc-Comtois et ce n’était pas l’ombrageuse toison de barbe qui recouvrait ses bajoues qui en était la cause. Au fil des jours, le flotteur avait fini par reconnaître Rosto comme faisant partie de la confrérie. De fait, sans que s’installe entre eux une familiarité que condamnaient leurs rapports abrupts du début, une relation apaisée, mêlée de confiance embryonnaire, avait fait place à l’hostilité des premiers jours. Les tranches de pain qu’il lui offrait étaient de plus en plus épaisses. Et surtout, il lui parlait de sa femme.
Elle s’appelait Louise et elle était rousse. Il assurait que cinq maternités, et une en cours, n’avaient pas terni sa beauté féline. Elle restait à Dole, où ils habitaient, et faisait encore l’objet d’une sollicitude masculine qui le mettait en fierté.
Les manières des gens de rivière, il les connaissait, lui, Rosto, pour en avoir usé et sans doute abusé. Brutes, sans apprêt, toujours spontanées, elles lui allaient parfaitement, vu qu’il ne possédait qu’un maigre capital de séduction. Un regard, un geste, et l’affaire était conclue. Puis il y avait eu Maria.





























