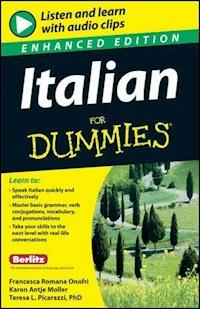Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "L'hiver est la plus agréable saison de l'année pour les amis de la table, et janvier sous ce rapport, est un des mois les plus favorisés. C'est le temps des joyeux banquets et des repas de famille où, des le 6, malgré tout le respect dû à la république, on célèbre joyeusement la fête des rois. Puis vient la Saint-Charlemagne, non moins chère aux écoliers que la Saint-Nicolas ; puis encore la fête anniversaire de Saint-Pierre, et de plusieurs autres bienheureux..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335087161
©Ligaran 2015
On a dit du Tableau de Paris de Mercier, que ce livre, pensé dans la rue, avait été écrit sur la borne. Cette critique, à notre avis, est un véritable éloge, et nous nous trouverions heureux, pour notre part, que l’on reconnût en nous lisant, que notre traité, médité dans la cuisine, a été écrit sur les fourneaux.
En effet, ce n’est pas un ouvrage d’esprit ni de science que nous avons voulu faire, mais un livre pratique, exact, précis, un recueil complet de recettes et de prescriptions d’une intelligence et d’une application faciles.
Nous avions dès longtemps été frappé de l’insuffisance et de l’imperfection d’un grand nombre de dispensaires de cuisine, faits pour la plupart à coups de ciseaux, ou copiés les uns sur les autres, et dans lesquels les erreurs, les indications ruineuses ou inapplicables fourmillent ; nous avons cru qu’il était utile et bon de faire enfin un véritable livre de cuisine, et nous nous sommes mis à l’œuvre.
Tout d’abord nous avons dû hésiter sur la disposition et l’ordre qu’il serait préférable d’adopter pour un semblable travail : jusqu’à ce jour, ç’a été par catégorie de comestibles, comme bœuf, veau, mouton, etc., ou par division de services, comme potage, hors-d’œuvre, entrée, etc., que l’on a présenté l’ensemble des prescriptions culinaires. Il en résulte, croyons-nous, un grave inconvénient ; c’est qu’avant de faire la recherche d’un mets, il faut savoir à quelle catégorie il appartient, ou recourir à une recherche toujours fastidieuse, à la table générale. L’ordre alphabétique n’offre aucun inconvénient semblable ; avec sa simple classification il rend toute investigation facile ; aussi l’avons-nous adopté de préférence à tout autre.
C’est donc un véritable Dictionnaire de cuisine que nous publions, à l’usage de tous les amis de la bonne chère et du bon marché ; un Dictionnaire complet, où nous avons admis, à côté de toutes les recettes que l’expérience a consacrées, toutes les récentes découvertes, toutes les innovations acceptées ; notre conviction étant que c’est en cuisine surtout, que tout ce qui est nouveau, quand il est bon, doit être bien accueilli.
Enseigner le moyen de bien vivre au meilleur marché possible, tel est le but que nous nous sommes proposé. Ce n’est pas à dire que nous approuvions sans réserve toutes les préparations dont nous donnons les recettes ; au cuisinier comme à tout autre, il est permis d’avoir ses préférences, car s’il est vrai qu’on ne puisse sagement discuter des goûts ni des couleurs, il ne l’est pas moins que tout ce qui se mange n’est pas également bon, également sain, également réparateur.
En général, les mets les plus simples sont aussi les meilleurs et les plus digestifs, défiez-vous d’un mets dont la substance principale est devenue méconnaissable sous la profusion des ingrédients qu’une manipulation plus ou moins savante y a introduits. Les accessoires en cuisine ont leur prix sans doute, mais il ne faut jamais qu’ils l’emportent sur le principal ; nous ne sommes pas partisan, bien que nous en donnions la recette, du potage à la tortue, qui se fait avec de la tête de veau ; on doit toujours pouvoir reconnaître ce que l’on mange ; nous ne craignons pas d’affirmer que ce sera chose facile quand on se sera conformé à nos prescriptions.
Dans ce livre, que nous avons divisé en deux parties, car nous voudrions qu’il devînt le Guide-Manuel de toute bonne ménagère, nous avons cru d’abord devoir nous occuper des intérêts du maître et de la maîtresse de maison. Leur responsabilité, en effet, pour tout ce qui est du ressort de la cuisine, de la cave et de l’office, est la première engagée ; car, si de la capacité du cuisinier ou de la cuisinière dépendent la satisfaction et le bien-être des convives, c’est à la condition que les éléments premiers qu’on leur livrera seront de qualité irréprochable. Or, pour qu’il en soit ainsi, le maître et la maîtresse de maison doivent posséder en économie domestique quelques connaissances que généralement on n’acquiert que par l’expérience.
C’est afin de rendre plus facile, plus prompte surtout, l’acquisition de ces connaissances indispensables, que nous avons spécialisé chacune d’elles dans de petits traités qui précèdent notre dictionnaire, et que nous avons intitulés : Almanach des productions mensuelles ; – Moyen de faire bonne chère au meilleur marché possible ; – Examen des principes nutritifs des aliments ; – Ordre du service ; – Menus ; – Théorie du dîner chez le restaurateur ; – Instruction sur l’art de découper et de servir à table ; – Traité des vins et des soins de la cave ; – Préceptes sur la conservation des substances alimentaires ; – Enfin, moyens de reconnaître les altérations et sophistications des substances solides et liquides, etc.
Nous ne pousserons pas plus loin ces détails ; c’est à l’expérience qu’il appartiendra de marquer la place de ce travail, que nous nous sommes appliqué à faire aussi consciencieux que possible ; nous ne savons quel sort lui est réservé, mais le cœur est placé si près de l’estomac que nous osons presque compter sur un peu de reconnaissance de la part de ceux qui pratiqueront nos enseignements.
L’hiver est la plus agréable saison de l’année pour les amis de la table, et janvier, sous ce rapport, est un des mois les plus favorisés. C’est le temps des joyeux banquets et des repas de famille où, dès le 6, malgré tout le respect dû à la république, on célèbre joyeusement la fête des rois. Puis vient la Saint-Charlemagne, non moins chère aux écoliers que la Saint-Nicolas ; puis encore la fête anniversaire de Saint-Pierre, et de plusieurs autres bienheureux qui tiennent à honneur de nous faire goûter ces joies honnêtes qui ne font fermer à personne les portes du ciel.
En fait de légumes, il est vrai, les primeurs manquent, ou ne sont que le produit de l’art qui, en les faisant naître, leur a enlevé la plus grande partie des dons de la nature ; mais combien sont nombreuses et riches les compensations qui font oublier ce léger inconvénient ! N’est-ce pas en janvier que le bœuf, le veau, le mouton, ont acquis toute leur succulence ? N’est-ce pas à cette heureuse époque de l’année que la chair des bienfaisants protégés de saint Antoine est le plus onctueuse, et que, sur l’étal des charcutiers abondent saucisses, boudins, andouillettes, hures de Troyes, pieds à la Sainte-Menehould ? C’est aussi pendant ce mois que le gibier est le plus abondant, et que depuis le sanglier jusqu’à l’alouette, tous ces hôtes de nos forêts, de nos plaines et de nos marais passent par bataillons dans nos cuisines. Les poules d’eau, les oies, les canards sauvages, les plongeons y arrivent du même pas que la bécasse, la bartavelle, le lièvre et le chevreuil. Alors aussi la volaille est plus grasse, la truffe a plus de parfum ; les poissons les plus beaux et les plus rares peuvent être transportés à de grandes distantes, et quelque éloigné qu’on soit de la mer, on peut manger des huîtres délicieuses.
Si les primeurs manquent, comme nous venons de le dire, les légumes conservés offrent une ample compensation : les choux qui ont subi la gelée sont bien supérieurs à ceux qui n’ont vécu que sous les rayons du soleil ; les cardons, les navets, les choux de Bruxelles, les choux-fleurs sont aussi savoureux que s’ils sortaient du jardin ; les salades sont nombreuses, et les plus beaux fruits, poires, pommes, oranges, sont dans tout leur éclat.
Enfin janvier est par-dessus tout le temps des bonbons, des doux propos, du gai champagne, et l’on peut dire avec vérité qu’alors pour les amants et les gourmets l’hiver n’a point de glaces (hormis celles des bals et des soirées).
Sous le rapport des joies culinaires, le second mois de l’année n’a lieu à envier au premier. Le gibier, il est vrai, commence à être un peu moins abondant, mais il n’a rien perdu de ses précieuses qualités, et la volaille est alors dans toute sa splendeur. Le cochon continue à répandre ses bienfaits, et sous l’influence du carnaval il prend toutes sortes de déguisements qui le font admettre à toutes les tables.
C’est pendant ce mois que triomphent la polka et la scotisch : on danse beaucoup, mais on mange davantage. Les huîtres et le poisson ne sont pas moins abondants et moins délicieux que dans le mois précédent, non plus que les légumes de garde et les fruits.
La pâtisserie est surtout en grand honneur, tant que n’a point sonné l’heure de la pénitence, et les sucreries de l’office conservent toute leur faveur pendant ce temps de jubilation. Février est le mois le plus court de l’année ; mais c’est celui des plus grandes joies ; il semble qu’on sente mieux le prix du temps, et pour n’en rien perdre on mange autant pendant la nuit que pendant le jour. Des buffets dressés pour le bal, où passe presque sans transition au déjeuner, lequel se prolonge d’autant plus que l’on a davantage à réparer. Le dîner arrive, les trois services défilent en bon ordre, soutiennent le choc à armes courtoises, et le champagne pétille encore dans les verres, que déjà les joyeux accords de l’orchestre appellent les convives et stimulent la digestion.
Certes cet heureux mois a des titres nombreux à la reconnaissance des estomacs ; mais il en est un surtout qu’on ne saurait oublier : il est le père du mardi-gras !
Nous voici en carême. Les viandes deviennent plus rares et moins savoureuses ; mais le poisson est plus abondant et plus délicieux que jamais ; aussi dit-on d’une chose qui se produit à propos, qu’elle arrive comme marée en carême. C’est qu’en effet la marée est, pendant ce mois, la base de tout édifice culinaire. Des profondeurs de l’Océan sortent comme par enchantement et roulent dans toutes les directions ces myriades de turbots, de saumons, de merlans, de limandes, de raies, de soles, de homards qui, après avoir fait pendant quelques instants la splendeur des halles, viennent exciter la verve du cuisinier et rehausser l’éclat des meilleures tables.
Les huîtres sont, au mois de mars, dans toute leur perfection ; les langoustes, les homards, les crevettes ont atteint leur plus haut degré de délicatesse ; le turbot est délicieux à toutes les sauces. C’est aussi vers le milieu de ce mois que commencent à se montrer les primeurs, les petits radis, l’oseille nouvelle, les laitues de la passion, les asperges.
Les poules commencent aussi à pondre abondamment, les étangs et les rivières sont fructueusement explorés ; la carpe, l’anguille, le brochet, sont plus délicats qu’en aucun autre temps de l’année, et les écrevisses ont une saveur toute particulière.
C’est donc à tort que des esprits chagrins ou des estomacs mal satisfaits ont médit des produits culinaires de ce mois, et, on doit le reconnaître, de même que le carnaval peut avoir ses douleurs, le carême a aussi ses joies.
On se lasse de tout, même des meilleures choses ; aussi est-ce chose toute naturelle que la défaveur dans laquelle tombe le poisson dès que l’air tiède du printemps commence à reverdir les bois. Le cochon semble reprendre alors son allure de carnaval ; le jambon ordinaire, le jambon de Mayence, le jambon de Bayonne, se montrent partout et sont bien accueillis de tout le monde ; l’agneau apparaît modestement ; le bœuf reprend le rang qui lui appartient, le mouton recouvre tous ses avantages.
À cette époque de renaissance, on se sent plus heureux de vivre et l’on s’efforce plus volontiers de vivre le mieux possible ; aussi mange-t-on plus longuement. L’appétit est d’ailleurs stimulé par de délicieuses primeurs ; ce ne sont plus seulement de petits radis, de fades et aqueuses laitues, quelques rares asperges qu’offrent les jardins ; les belles asperges violettes abondent, la romaine commence à pommer, et les petits pois font leur entrée dans le monde.
C’est aussi vers la fin de ce mois qu’apparaît le maquereau, qu’on a justement surnommé le meilleur et le plus spirituel des poissons d’avril, et qu’on revoit toujours avec un nouveau plaisir ; l’austérité du carême est oubliée, et deux ou trois semaines ont suffi à la marée pour rentrer en grâce ; car si dans les bons estomacs il y a toujours place pour la reconnaissance, il ne s’y en trouve jamais pour la rancune.
Avec les fleurs nous arrivent, dans ce mois charmant, les pigeonneaux, ces amis intimes des petits pois, lesquels sont à l’apogée de leur gloire. Le maquereau reste en faveur ; les petites pommes de terre hâtives commencent à se montrer, et les poulets nouveaux viennent encore augmenter les ressources gastronomiques. Le laitage et les œufs sont alors choses délicieuses.
C’est en mai qu’apparaissent les choux cœur-de-bœuf, et les petites carottes hâtives. Les boutiques des marchands de comestibles prennent un aspect nouveau et tout à fait enchanteur ; à côté des terrines de Nérac, des pâtés de Strasbourg, de Pithiviers, de Chartres, d’Amiens, se pressent les paniers de fraises, les asperges monstrueuses, les cerises anglaises, les haricots verts. C’est un tableau délicieux qui fait battre le cœur et fait venir l’eau à la bouche.
La romaine a grandi ; ses formes sont mieux dessinées, plus accentuées, et son cœur n’en est pas moins tendre, au contraire. Enfin le mois de mai nous ramène la caille, le râle de genêt, la bécasse.
Certes il se peut que le mois de mai ne soit pas le plus beau mois de l’année, et que, sous ce rapport, il ait volé sa réputation : il est souvent froid, humide, son soleil est parfois bien pâle, mais que de bonnes choses militent en sa faveur et font oublier ses torts ! Pour résister à de tels charmes, il faudrait avoir un cœur de bronze, et les gastronomes n’ont pas de ces cœurs-là ; s’il s’agissait de l’estomac, à la bonne heure.
Oh ! le beau mois, le bon mois, l’heureux mois ! Et pourtant un gourmand de mauvaise humeur a osé dire, a eu le triste courage d’écrire et d’imprimer qu’au mois de juin un amphitryon est presque forcé de mettre ses convives au vert. Quelle abominable hérésie ! Sans doute les productions des jardins et des champs sont alors très nombreuses : aux asperges, aux petits pois, aux haricots verts sont venus se joindre, sans les éclipser, les artichauts, les fèves de marais, les choux fleurs, les oignons et les navets. Les fraises ont maintenant pour cortège les cerises de Montmorency, les groseilles, les framboises, les petites poires ; mais loin de se plaindre de ces abondants produits de nos marais et de nos vergers, il faut s’en réjouir ; car, dans ce même temps, le bœuf n’a pas cessé d’être excellent ; les moutons et les veaux, nourris au vert, sont devenus meilleurs que jamais.
Il est vrai qu’en juin le poisson est à la fois plus rare et moins bon que pendant l’hiver, et que la marée a beaucoup de peine à arriver fraîche à une certaine distance des chemins de fer ; mais ce n’est là qu’un léger mal, largement compensé par les produits que nous venons d’énumérer, et auxquels il faut joindre le dindonneau et le coq vierge, ces excellents volatiles dont le mérite est aussi incontestable qu’incontesté.
Convenons-en, chaque mois à sa valeur comme chaque âge a ses plaisirs, et la plus grande des vérités c’est que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.
La température élevée qui règne constamment pendant le mois de juillet, fait en quelque sorte dédaigner la viande de boucherie, et cela est d’autant plus fâcheux que la basse-cour offre encore peu de ressource, et que le gibier est très rare. Ce n’est pas à dire pour cela qu’il y ait disette absolue de ces bonnes choses ; le dindonneau et le coq vierge n’ont rien perdu de leur mérite, et les cailles peuvent faire attendre patiemment les perdreaux, sauf les rigueurs de la loi sur la chasse. Le veau est aussi très bon à cette époque, et la nature de sa chair convient parfaitement aux besoins particuliers de l’estomac en cette saison.
C’est en juillet que l’horticulture étale tous ses trésors : les petits pois n’ont rien perdu ; les haricots verts ont beaucoup gagné ; les blancs sont excellents. Les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les artichauts sont dans tout leur éclat. Les melons commencent à répandre leur parfum ; les romaines et les laitues sont toujours belles et tendres ; les chicorées se frisent, les tomates commencent à rougir. On voit paraître les délicieuses prunes de reine-claude, les amandes vertes, les abricots, les cerneaux. Les cerises et les groseilles ont atteint leur parfaite maturité. C’est le mois où l’on fait les confitures rouges.
Il est donc vrai qu’en aucun temps la nature ne se montre aussi prodigue ; en bonne et sage mère, mieux que nous elle juge de nos besoins, et les choses qui conviennent le mieux à notre santé sont toujours celles qu’elle met le plus abondamment à notre disposition.
De même qu’en juillet, la viande de boucherie ne jouit pas d’une grande faveur pendant le mois d’août ; mais les ressources de la basse-cour commencent à s’accroître : aux pigeonneaux, aux poulets nouveaux, aux dindonneaux sont venus se joindre les jeunes oies et les cannetons.
Le gibier commence aussi à reparaître : les cailles sont plus nombreuses que pendant le mois précédent, et il faut se hâter d’en profiter ; car un mois plus tard toutes auront disparu. Les perdreaux commencent à tomber sous les coups des braconniers, lapereaux et levrauts ont le même sort. C’est aussi le moment de manger les meilleurs cochons de lait.
La chaleur est toujours grande, ce qui fait que l’on mange peu de poisson, peu de marée surtout ; cependant les truites, pourvu qu’elles ne fassent en quelque sorte qu’un saut de la rivière à la cuisine, sont toujours une excellente chose.
Les produits des jardins sont toujours nombreux ; les haricots blancs et les artichauts restent en faveur, les melons cantaloups ont augmenté de grosseur et de parfum ; les choux-fleurs se maintiennent.
Les fruits du mois d’août sont à la fois plus nombreux et plus savoureux que ceux du mois précédent ; les prunes et les abricots ont atteint leur parfaite maturité, les cerneaux et les amandes sont plus consistants ; plusieurs espèces de pommes et de poires peuvent être cueillies ; les figues commencent à être bonnes et les pêches sont dans tout leur éclat. Encore un peu de temps et les beaux jours seront passés ; mais que de bonnes choses nous resteront !
La température baisse beaucoup dès les premiers jours de ce mois et la consommation de la viande de boucherie augmente sensiblement. L’air, devenu plus vif, accélère la digestion ; on se trouve mieux à table que pendant les mois précédents, et l’on y reste plus longtemps.
La chasse est ouverte, le gibier abonde ; les grives et les bécassines ont atteint toute leur perfection, et c’est alors qu’apparaissent les premiers et les meilleurs canards sauvages.
Les habitants de la basse-cour continuent à croître et multiplier, et le canard domestique rivalise alors avec le canard sauvage.
Le poisson commence à reprendre, sur les bonnes tables, le rang que les chaleurs caniculaires l’avaient contraint d’abandonner, et les huîtres sont relevées de l’excommunication dont elles ont été frappées pendant tous les mois dans le nom desquels n’entre pas la lettre R. Il faut dire pourtant que cette réhabilitation est un peu trop précoce, et la vérité est que les huîtres ne valent guère mieux en septembre qu’en août.
Les légumes et les fruits sont encore nombreux et savoureux. Presque aucun des légumes du mois précédent n’a perdu de son mérite ; on mange encore d’excellentes pêches qu’accompagnent les noix vertes, le chasselas, et quelques espèces de poires, notamment celles de Messire-Jean.
En somme, le mois de septembre est un des meilleurs de l’année pour les écoliers, les gens de robe, les chasseurs et les gourmands, et qui est-ce qui n’est pas un peu quelque chose comme cela ?
La température baisse de plus en plus, et l’appétit suit une progression ascendante fort remarquable. Mais aussi il serait par trop malheureux de ne pas avoir faim à cette succulente époque de l’année. Nous ne parlerons pas de la viande de boucherie qui est excellente alors, puisqu’elle vient de passer six mois au vert ; mais nous devons rappeler que la basse-cour regorge de sujets admirables : les dindons, les poulets et les chapons n’ont plus rien à acquérir ; plus tard, ils pourront être plus gras, mais ils ne seront jamais plus tendres et plus onctueux.
Ce que nous venons de dire des hôtes de la basse-cour s’applique également au gibier : à cette époque, lièvres, lapins, faisans, perdrix, grives et alouettes n’ont plus rien à acquérir ; ils sont réellement parfaits.
La faveur du poisson va grandissant ; les nuits sont froides et la marée voyage sans danger : les huîtres entrent dans leur véritable période de gloire.
Le nombre des légumes frais a diminué, cependant on a encore des haricots blancs frais, des artichauts, des choux-fleurs, et les salades sont abondantes.
Quant aux fruits, ils sont en nombre très respectable : ce sont toutes les espèces de raisin, les noix, les noisettes, les amandes fraiches ; les poires, les pommes d’automne, et enfin les marrons.
Un homme d’esprit a dit du mois d’octobre que c’était l’époque où un amphitryon devait rouvrir à deux battants les portes de sa salle à manger ; nous croyons cette opinion suffisamment justifiée.
L’hiver vient ; les jours diminuent ; mais les dîners s’allongent prodigieusement : qui est-ce qui oserait s’en plaindre ?… La viande de boucherie, la volaille et le gibier sont choses excellentes à cette époque ; il ne faut donc pas s’étonner qu’on ait fait de la Saint-Martin, qui tombe le onzième jour de ce mois, une fête de table… (Rabelais dirait le mot propre, mais aujourd’hui l’on est moins hardi.) Le cochon, qui s’est tenu à l’écart depuis Pâques, revendique et recouvre tous ses droits aux hommages des estomacs bien constitués.
Le poisson, et particulièrement la marée, sont de plus en plus triomphants, et les modestes harengs, que peu de gens estiment à leur juste valeur, viennent prendre une petite part à ce triomphe des habitants de l’empire des eaux, paisibles conquérants dont la domination est douce et bienfaisante.
Les légumes sont à peu près ceux du mois précédent ; les fruits ont diminué : il n’y a plus que les poires, les pommes d’hiver et le raisin savamment conservé, mais les confitures offrent une ressource immense, une mine inépuisable. Enfin l’ère des conserves de toute espèce commence ; heureux ceux qui ont songé à l’avenir et qui dans les joies du présent ont fait une part pour les joies futures ! La saison des soirées et des bals s’ouvre ; le règne du champagne commence. Le soleil est rare et pâle ; mais qu’importe ! on dîne mieux aux bougies.
Nous ne savons quel esprit morose a osé dire que le mois de décembre était un mois lugubre… L’infortuné qui a formulé cette pensée biscornue n’avait donc pas des yeux pour voir, des oreilles pour entendre ? Il n’avait donc, le malheureux ! son couvert mis à la table d’aucun amphitryon digne de ce nom ?… S’il en est ainsi, nous lui pardonnons de grand cœur son hérésie : le malheur rend injuste, et quand l’estomac est vide, le jugement n’est pas sûr.
La vérité est que le mois de décembre tient parmi ses pairs une des places les plus honorables, joyeusement et gastronomiquement parlant, et un seul mot nous suffirait pour fermer la bouche à ses détracteurs : Noël tombe le 25 décembre, et toute cloche qui sonne sa première heure, appelle les gourmets aux joies du réveillon !
Que lui manque-t-il d’ailleurs à ce bienheureux mois pour être parfait ? des primeurs, des fruits fraîchement cueillis ?… Allons donc ! Est-ce qu’il n’a pas à ses ordres les conserves de toutes sortes ? Est-ce que le règne animal tout entier n’est pas prêt à le servir à bouche que veux-tu ?
De par le calendrier grégorien, le mois de décembre est le dernier de l’année ; à la bonne heure ; mais dans le calendrier gastronomique, son mérite est plus judicieusement apprécié, ce qui prouve la supériorité du sentiment sur la raison, et l’insuffisance de la logique en matière de goût.
C’est une opinion généralement reçue qu’on ne saurait aspirer au bien vivre, si l’on ne possède une fortune considérable. On estime que les personnes qui n’ont qu’une honorable aisance, et à plus forte raison celles dont le revenu est médiocre, doivent renoncer à ces joies du confortable de la vie, qui ont tant de charme. Une pareille manière de voir, si elle était fondée, exclurait des jouissances les plus réelles, les seules positives, l’immense majorité de la société : le bien-vivre deviendrait un privilège, un monopole entre les mains de quelques élus ; et les trois quarts de l’espèce humaine, déshérités par le sort, vivraient dans le supplice de Tantale. Rassurons-nous, et absolvons la Providence, telle n’est point la nécessité des choses. La nature n’a pas divisé l’humanité en deux classes inégales, l’une destinée à vivre, l’autre condamnée à végéter.
L’artisan, s’il ne peut aspirer aux mets savants qui chargent la table du riche, peut se réfugier dans la cuisine bourgeoise, source féconde de plaisirs réels. Il est en effet des mets simples, vulgaires même, qu’une préparation intelligente peut rendre excellents. S’il est contraint de s’abstenir de la truffe, des coulis, des gibiers rares, des poissons recherchés, des vins fins, n’a-t-il pas le pot-au-feu, cet élixir du pauvre ; l’aloyau succulent, le dindon gras, tout le peuple de la basse-cour ; les crèmes, les légumes, les fruits ? n’a-t-il pas une foule de poissons qu’on repousse parce qu’ils sont communs, et qu’on paierait au poids de l’or s’ils étaient rares ? Le secret de rendre tout cela exquis, c’est de savoir le préparer ; voilà toute la difficulté. C’est l’art qu’il faut enseigner et non la cupidité qu’il faut inspirer. Législateurs, voulez-vous rendre le peuple heureux ; instituez des chaires publiques de l’art culinaire, faites professer la cuisine comme la chimie ; popularisez cette science difficile ; et vous aurez réalisé plus encore que la poule au pot de Henri IV.
Ce n’est pas toutefois aux classes pauvres que nous voulons adresser ici des conseils ; mais nous dirons aux personnes qui n’ont qu’une honorable aisance : Vous êtes dans le fait aussi riches que de grands seigneurs. Les trois quarts et demi de la fortune du millionnaire épuisés en dépenses inutiles, qu’en avez-vous besoin ? avec le demi-quart restant, vous êtes aussi riche et même plus riche que lui. Votre table, en effet, est moins nombreuse, vos relations moins étendues ; vous avez moins d’obligations à remplir, d’engagements à satisfaire ; sagement distribué, votre revenu peut vous procurer plus de jouissances réelles, plus de plaisirs vrais, qu’avec tout son faste, le riche n’en saurait jamais obtenir.
Faites choix d’une cuisinière active, propre et surtout experte dans son art ; et soyez vous-même votre intendant et votre maître-d’hôtel. Donnez, sans intermédiaire, vos ordres journaliers ; établissez pour votre maison un ordinaire décent ; que les plats y soient plus soignés que nombreux ; accordez à la cuisinière tout ce qu’il faut pour les rendre excellents, et rien au-delà. En lui laissant faire son marché, ayez soin d’être informé du prix-courant des denrées les plus importantes, et il vous sera aisé d’apprécier sa fidélité.
Mettez une attention particulière au choix des vins, et pour cet article ne vous en reposez sur personne. N’achetez point de vin à Paris ; mais soyez en rapport avec des propriétaires connus dans chaque vignoble, et adressez-vous à eux directement.
Dans une ville comme Paris, où toutes les productions arrivent, grâce à la rapidité des voies de fer, comme dans un centre commun, la concurrence règne au plus haut degré, et il est facile, avec quelque intelligence, de se procurer presque toutes les denrées à bon marché ; mais cette intelligence a besoin de guide. Le premier principe est de ne jamais rien prendre à crédit : cette dangereuse méthode prive l’acheteur de tous ses avantages, et permet au marchand de lui glisser tout ce dont il veut se défaire. En ne payant pas comptant, vous vous obligez à aller toujours dans les mêmes maisons ; vous perdez le droit d’être difficile et l’autre droit non moins important de marchander. Un maître de maison prudent, par esprit d’ordre non moins que par calcul, ne souffrira pas qu’on demande crédit pour lui chez aucun fournisseur. Il préviendra d’avance tous les marchands dont il se sert de n’en accorder à personne venant de sa part. Ce sera encore le moyen de prévenir toutes les erreurs.
Le second principe consiste à savoir qu’il est des jours et même des heures où certaines denrées sont moins chères, parce qu’elles sont moins demandées. À moins que des circonstances particulières ne lui commandent de prendre tel ou tel mets, la cuisinière saura que le dimanche et le lundi, le poisson ne coûte que la moitié du prix des jours maigres ; elle saura qu’à deux ou trois heures de l’après-midi, le moment de la vente étant passé, on a meilleure composition des marchands de la halle. Vers cette heure encore, on réussit mieux au marché à la volaille. Quelquefois cette heure avancée ne s’accorde point avec l’exigence du dîner ; mais cet avis est particulièrement donné pour les provisions que l’on peut faire la veille. Pour toutes les denrées qui peuvent se conserver, on évitera l’inconvénient d’aller au jour la journée. En province, on exagère le système des provisions ; mais à Paris on l’ignore complètement. Il n’est pas rare de voir, dans des maisons aisées, les domestiques acheter à la fois quelques grammes de poivre, un demi-kilo d’huile d’olives, une hotte de carottes. Cette division dans les achats est à la fois coûteuse et incommode. N’avez-vous point de campagne qui puisse vous entretenir de légumes, de ferme qui vous fournisse le beurre ; faites faire aux époques les plus favorables de l’année des provisions raisonnables, ou tout au moins, achetez à la semaine dans des magasins en gros les plus fréquentés, et surveillez l’emploi des denrées avec exactitude.
L’ordinaire d’une personne avisée doit être continuellement soigné ; aucun jour de la semaine ne doit être privilégié. Un homme sensé dîne bien tous les jours ; il ne souffre sur sa table rien de médiocre ni de vulgaire ; mais en même temps il repousse la profusion. Il hait ce vain étalage de mets, cette multiplicité de plats qui nuit évidemment a leur qualité respective. Cette abondance extrême, il la réserve pour le jour où il traite ses amis. C’est alors qu’un amphitryon ne doit rien négliger pour faire régner sur sa table l’abondance et la sensualité. Il faut que les convives se retirent persuadés que nulle part ils n’eussent mieux dîné. Mais au milieu de cette abondance même, un ordre sévère doit régner ; le service le plus brillant peut encore avoir son économie.
On a beaucoup discuté sur ce point : L’homme est-il naturellement carnivore ou frugivore ? Les plus grands philosophes se sont évertués sur cette question sans la résoudre d’une manière satisfaisante. Quant à nous, nous sommes convaincu que l’homme n’est ni carnivore, ni frugivore exclusivement ; mais bien omnivore, c’est-à-dire que les aliments du règne végétal et du règne animal conviennent également à son estomac, doué d’une grande puissance digestive.
L’homme peut ne se nourrir que de viandes, sans mériter pour cela l’épithète d’animal dépravé dont le gratifie J.-J. Rousseau ; de même qu’une nourriture composée uniquement de végétaux ne saurait altérer ses facultés intellectuelles. Cependant il est incontestable que, en général, les hommes dont la chair est la principale nourriture, l’emportent de beaucoup en intelligence sur ceux qui ne vivent ordinairement que de végétaux ; ils sont aussi plus actifs, plus aventureux, plus courageux. En revanche, on remarque que les peuples qui ne mangent point ou qui mangent peu de viande, ont des mœurs douces, patriarcales ; ils sont exempts de passions violentes, et ils n’ont, en général, que de bons instincts.
Bien que le nombre des aliments qui peuvent servir à la nourriture de l’homme soit considérable, leurs principes nutritifs sont peu variés. Ces principes, dans les substances animales, sont : l’albumine, l’osmazôme, la fibrine, la partie extractive de la fibrine, qu’on nomme jus, et la graisse.
La fibrine et l’osmazôme sont les parties les plus nutritives ; mais, séparées des deux autres, elles sont difficiles à digérer ; unies à l’albumine, la digestion en est facile.
Ces divers principes se trouvent réunis dans les chairs brunes comme celles du bœuf, du mouton, du lièvre, de la perdrix. Les chairs blanches, telles que celles du veau, de l’agneau, du poulet, ne contiennent point d’osmazôme, ou n’en contiennent que fort peu aussi sont-elles beaucoup moins succulentes que les viandes brunes. Ces dernières conviennent aux estomacs vigoureux et à ceux qu’une cause quelconque a passagèrement affaiblis ; les chairs blanches sont celles dont les estomacs irrités s’accommodent le mieux.
On comprend toutefois que les diverses qualités des viandes sont nécessairement modifiées par les préparations qu’elles subissent. Ainsi, la viande rôtie est à la fois la plus saine, la plus nutritive et la plus facile à digérer, parce que l’action d’un feu vif lui a fait retenir toutes ses parties solubles ; la viande frite est, au contraire, d’une digestion difficile, bien qu’elle ait également retenu toutes ses parties solubles ; elle doit cet inconvénient à la graisse qui couvre sa surface. Le bœuf cuit et laissé dans son jus est une viande essentiellement succulente, d’une digestibilité parfaite ; tandis que le bouilli, ou bœuf dont on a fait du bouillon, n’est ni digestif, ni succulent ; cela vient de ce que le premier est toujours accompagné des parties que l’action du feu en a extraites, tandis que le second n’est plus composé que de fibrine sèche, ce qui a fait dire à Brillat-Savarin que le bouilli est la chair moins son jus. Les mêmes principes se trouvent dans les poissons, à l’exception de l’osmazôme ; mais la chair de ces animaux contient en outre du phosphore et de l’hydrogène, principes auxquels elle doit ses qualités aphrodisiaques.
Les principes nutritifs des végétaux sont : la fécule, le gluten, le sucre, le mucilage et la gomme.
La fécule se trouve presque sans mélange dans l’orge, le maïs, le riz et quelques autres graines. Dans le froment et le seigle elle est mêlée au gluten, ce qui donne aux farines de ces céréales la propriété de fermenter quand on les pétrit avec de l’eau, et d’en former une pâte qui constitue le pain. Dans les pois, les lentilles, les pommes de terre, les haricots, l’avoine, etc., la fécule est jointe au sucre.
Enfin, les principes gommeux et mucilagineux se trouvent réunis dans les légumes et les fruits. Quant au principe sucré, on le trouve partout, ainsi que cela résulte d’un mémoire lu à l’Académie des sciences, dont l’auteur affirme être parvenu à extraire une notable quantité de sucre d’un paquet de vieux chiffons.
L’amphitryon ne doit jamais oublier ces paroles d’un grand maître : « Quelque recherchée que soit la bonne chère, quelque somptueux que soient les accessoires, il n’y a pas de plaisir de table si le vin est mauvais, si les convives ont été invités sans choix, si les physionomies sont tristes, et le repas consommé avec précipitation. »
Le couvert doit être dressé avant l’arrivée des convives ; à chaque place doit être inscrit le nom du convive auquel elle est destinée.
Trois verres sont l’escorte obligée de chaque couvert : un pour le vin d’ordinaire, c’est le plus grand ; un pour le coup du milieu (Madère ou Rhum), et un pour les vins fins de dessert et d’entremets. Un quatrième verre, celui à vin de Champagne, est également indispensable ; mais il suffit qu’il paraisse sur la table en même temps que ce vin.
Le buffet, voisin de la table, doit être abondamment pourvu de couverts de rechange. Dans les maisons grandement montées, on change de fourchette et de couteau chaque fois qu’on change d’assiette ; dans les maisons de second ordre, on change de fourchette et de couteau à chaque service, et après avoir mangé du poisson.
Aux quatre points cardinaux de la table sont placées les carafes et les bouteilles. Lorsque la table est de plus de douze couverts, on établit des subdivisions entre ces quatre points.
La température convenable pour une salle à manger est de 17 à 18 degrés centigrades au-dessus de zéro ; il importe surtout qu’elle soit parfaitement éclairée ; les lampes Carcel et les bougies sont les seuls modes d’éclairage qu’on puisse employer.
On comprend que nous ne parlons ici que des dispositions principales ; il est une foule de petits détails relatifs qui ne peuvent avoir d’autres règles que le sentiment intime et l’ingénieuse délicatesse de l’amphitryon. En pareille matière, le libre arbitre peut et doit avoir une large part ; mais il importe de se défendre des excentricités, car, de quelque côté qu’elles se montrent, elles tendent au ridicule, aussi invinciblement que l’aiguille de la boussole tend vers le nord. Un esprit supérieur peut, il est vrai, s’écarter sans danger des sentiers battus ; mais les esprits ordinaires, et souvent même moins qu’ordinaires, ont une si grande tendance à se poser en supérieurs, que le plus sûr est de se tenir dans la voie commune, la seule qui soit d’ordinaire irréprochable.
Tout le monde étant à table, l’amphitryon, prenant les assiettes empilées près de lui, sert le potage, en faisant passer successivement ces assiettes à droite et à gauche. Il découpe ensuite les pièces les plus importantes, ou il en charge quelqu’un des convives dont la capacité lui est connue. Quant aux mets qui se trouvent naturellement découpés ou qui se servent à la cuillère, l’amphitryon n’a pas à s’en occuper : tout convive a droit de les aborder, et de les traiter en pays conquis.
L’amphitryon n’a pas non plus à s’occuper du vin d’ordinaire, ni de celui immédiatement supérieur, qui doivent être livrés sans réserve à la discrétion des convives ; mais à l’apparition des vins fins, de nouveaux devoirs lui sont imposés. Les bouteilles de ces vins, servies couchées dans leurs paniers, doivent être débouchées avec un soin extrême ; aussitôt le bouchon enlevé, l’amphitryon verse à ses voisins de droite et de gauche, puis à lui-même, et il laisse ensuite circuler la bouteille jusqu’à extinction. Il est mieux encore de faire placer de toutes les espèces de vins aux quatre points cardinaux ; mais cela ne se fait que lorsque les convives sont nombreux.
Après l’entremets, lorsque le dessert est sur la table, les domestiques doivent se retirer pour ne reparaître que sur l’appel du maître. Le service dès lors est presque nul ; la table n’est plus qu’un charmant champ de bataille livré à de joyeux fourrageurs.
Il n’est pas facile d’établir une échelle de proportion entre le nombre des plats et celui des convives. Toutefois on convient généralement que quatre hors-d’œuvre, un potage, un relevé, deux entrées, un rôt et quatre entremets, suffisent pour six personnes. Six hors-d’œuvre, deux potages, deux relevés, quatre entrées, trois rôts et six entremets peuvent suffire à douze ou quinze ; un tiers de plus suffira à vingt personnes, et ainsi de suite. Observons d’ailleurs, que le volume de chaque mets doit suivre la progression des convives ; en même temps que souvent on accroît l’élégance du service, en substituant à une pièce un peu forte deux pièces plus délicates.
Le premier article d’un menu, et qui mérite une attention particulière, c’est le potage. Le potage est aussi nécessaire à un dîner qu’une clef à une voûte. Ce mets, qui sert d’introduction à tout dîner, exige plus de soins qu’aucun autre.
On n’attend pas de nous, que nous entrions ici dans le détail des nombreux potages qui peuvent figurer sur une table bien servie ; à ce sujet c’est notre Dictionnaire qu’il faut consulter.
Après le potage, l’ordre veut que nous fassions mention des hors-d’œuvre. Cet article seul mériterait un traité particulier. On les divise en deux classes : les hors-d’œuvre froids et les hors-d’œuvre chauds. Les premiers n’ont d’autre but que de préparer les voies : ce sont les radis, le beurre frais, les anchois, le thon mariné, les olives, les cornichons, le melon, les huîtres. Quant aux hors-d’œuvre chauds, ils se distinguent des autres mets par un signe caractéristique, c’est qu’ils n’ont jamais de sauce. Ce sont les grillades de menue charcuterie, le pied de cochon truffé, la côtelette de pré salé, le rognon de mouton à la brochette, enfin les petits pâtés, qui sont même le seul hors-d’œuvre chaud que l’on serve sur beaucoup de bonnes tables.
On enlève le potage et on le remplace par une en plusieurs grosses pièces auxquelles on a donné le nom de relevés. Le premier de tous ces relevés est le bœuf ou bouilli, qui figure encore avec avantage sur quelques bonnes tables, lorsque, tiré de cette partie de la bête que l’on nomme la culotte, il présente une masse tremblante qui se laisse couper à la fourchette, et lorsqu’il est environné de quelques garnitures délicates. Mais le plus grand nombre des amphitryons dédaigne ce mets comme trop simple et trop vulgaire, et alors on lui substitue le filet de bœuf piqué, le rosbif environné de pommes de terre, le brochet, la carpe ou le turbot au bleu ; la tête, la fraise, ou les pieds de veau au naturel, la poularde mollement couchée sur une ottomane de riz, ou seulement accompagnée d’un peu de jus, de gros sel ou d’estragon ; et ces mets prennent le nom de relevés. Au reste, il ne faut pas ignorer qu’entre certains relevés et les entrées, la distinction est souvent arbitraire, et que de très bonnes tables offrent sous le premier nom ce que d’autres non moins distinguées présentent sous le second. Cette observation ne doit pas être dédaignée de l’amphitryon, qui peut sans crainte donner à ses plats le nom qui conviendra le mieux à son service. On observera également que plusieurs mets sont donnés tantôt à titre de relevés, tantôt à titre de rôts ; tels sont les poissons au bleu, et même les dindes truffées.
Tous les mets dont nous avons déjà offert la nomenclature et la description ne sont que des mets préparatoires, puisque ceux dont nous allons nous occuper se nomment des entrées, comme si le dîner ne commençait réellement qu’avec eux. Les entrées sont l’un des éléments fondamentaux d’un dîner ; on peut servir un dîner sans hors-d’œuvre, même sans relevés, mais jamais il n’en exista sans entrées.
Nous avons tâché d’offrir plus haut l’échelle de proportion qui doit être suivie entre le nombre des convives et celui des entrées. Nous ne reviendrons pas sur ce sujet, mais nous dirons à l’amphitryon, que, quelque nombre qu’il en offre, il doit s’arranger de manière à réunir une ou deux entrées de viandes de boucherie, une de volaille, une de poisson, une de gibier, une de pâtisserie. La table, couverte d’entrées, doit représenter une fidèle image des productions variées de la nature et de l’art. Il est indispensable, sur quatre entrées, d’en offrir deux, ou au moins une aux truffes. Ensuite, comme on sait que par entrées on entend toujours des ragoûts, on doit ordonner le menu de manière que la moitié soit au blanc, et l’autre moitié au brun ; qu’une moitié soit garnie de légumes, et l’autre seulement de jus ou de coulis. Cette attention, qui a pour but de satisfaire tous les goûts, attestera la sage prévoyance de l’amphitryon.
Jamais la même nature de mets, quelle que soit la différence qui existe dans la préparation, ne doit se présenter deux fois dans le cours d’un dîner. Avez-vous offert des poulets au premier service, il vous est interdit d’en offrir au second. Cette règle est sans exception. Il n’y a que les garnitures qui puissent et doivent être reproduites.
Passons au second service. Il se forme des rôts et des entremets. Dans la classe des rôts, on comprend ordinairement certains plats froids qui pourraient être rangés dans un ordre particulier, et de grosses pièces destinées à garnir les extrémités de la table. Ainsi la salade passe souvent pour un rôt ; il en est de même des pâtés de foies gras, des poissons au bleu ou frits, des écrevisses ; les homards, les langoustes, les crevettes, peuvent a volonté passer pour rôts ou pour entremets. Au reste, ce qui constitue essentiellement cette partie du service est assez indiqué par le nom même ; ce sont les viandes à la broche.
À côté des rôtis on sert les entremets ; l’estomac, arrivé à un degré de plénitude satisfaisant, n’a plus besoin que de ces mets légers qui le délectent sans le surcharger. Il ne demande plus d’aliments substantiels, mais il exige que la délicatesse tienne lieu de vertu nutritive. Des légumes fins et savoureux, saturés de coulis, de beurre ou de sucre ; la timbale de macaroni, les fritures sucrées, des pâtisseries légères, des crèmes parfumées, des soufflés qui offrent une masse dorée et tremblante, des charlottes françaises ou russes, des pyramides de meringues, des petits-fours, etc. ; tels sont les mets dont se compose cette partie du dîner qu’on peut appeler l’avant-coureur du dessert.
Après les entremets, les domestiques desservent complètement la table. Alors le dessert fait son entrée triomphale. Ce troisième service exige une attention non moins vigilante que les deux premiers.
À la campagne, il est d’usage d’orner le service de quelques vases de fleurs. À la ville, où ce système est moins en usage, il est bon que les fruits soient dressés sur un lit de verdure ; feuilles de vigne en été, mousse en hiver.
De tous les mets qui doivent figurer au dessert, le plus indispensable est le fromage affiné, tel que le Roquefort, le Chester, le Neuchâtel, le Gruyère. C’est par ce plat indispensable que l’on doit commencer le service du dessert. Tant que les vins rouges circulent, on ne doit offrir que le fromage, les noix, les amandes ; les fruits sucrés ne doivent être présentés qu’avec les vins d’Espagne ou de Grèce ; et les pâtisseries doivent marcher de front avec les vins de Champagne, de Malaga, de Malvoisie, etc.
Nous dirons peu de chose sur le café. Deux usages sont également admis ; quelques amphitryons l’offrent sur la table même où l’on a dîné ; un plus grand nombre le fait servir dans le salon, sur une table de marbre destinée à cet usage.
À la suite du café, on offre les liqueurs, qui doivent être d’une qualité supérieure.