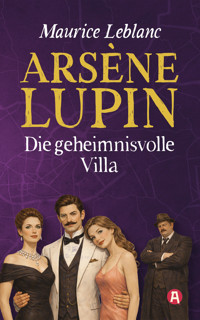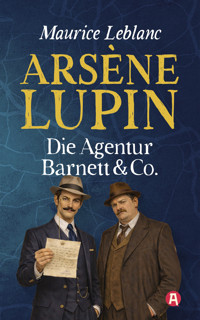3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Cette édition est unique ;
- La traduction est entièrement originale et a été réalisée pour l'Ale. Mar. SAS ;
- Tous droits réservés.
Le Triangle d'or (également connu sous le titre Le retour d'Arsène Lupin) est un livre de Maurice Leblanc, publié pour la première fois en 1917. Il s'agit du neuvième livre de la série Arsène Lupin. Le capitaine Patrice Belval, vétéran de la guerre, déjoue une tentative d'enlèvement d'une infirmière affectueusement connue sous le nom de Petite Mère Coralie. Cet acte odieux est lié à un projet de pillage des réserves d'or de la France dans le chaos de la Première Guerre mondiale, et il dévoile également un lien mystérieux entre les deux individus. Pour démêler ces complexités et affronter un adversaire implacable, les anciens camarades du capitaine lui conseillent de demander l'aide d'Arsène Lupin, malgré la croyance répandue en la mort de ce dernier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Table des matières
I. Coralie
II. Main droite et jambe gauche
III. La clé rouillée
IV. Avant les flammes
V. Mari et femme
VI. Sept heures dix-neuf minutes
VII. Douze heures vingt-trois minutes
VIII. L'œuvre d'Essarès Bey
IX. Patrice et Coralie
X. La corde rouge
XI. Au bord du gouffre
XII. Dans l'abîme
XIII. Les clous dans le cercueil
XIV. Un étrange personnage
XV. La Belle Hélène
XVI. Le quatrième acte
XVII. Siméon donne la bataille
XVIII. La dernière victime de Siméon
XIX. Fiat Lux !
Le triangle d'or
Maurice Leblanc
I. Coralie
Il était près de six heures et demie et les ombres du soir se faisaient plus denses lorsque deux soldats atteignirent le petit espace, planté d'arbres, en face du musée Galliéra, où se rejoignent la rue de Chaillot et la rue Pierre-Charron. L'un d'eux, , portait un grand manteau bleu ciel de fantassin ; l'autre, un Sénégalais, ces vêtements de laine non teintée, avec culotte ample et veste ceinturée, dont les zouaves et les troupes indigènes africaines sont vêtus depuis la guerre. L'un d'eux avait perdu sa jambe droite, l'autre son bras gauche.
Ils contournent l'espace ouvert, au centre duquel se trouve un beau groupe de figures de Silène, et s'arrêtent. Le fantassin jette sa cigarette. Le Sénégalais la ramassa, tira quelques bouffées rapides, l'éteignit en la serrant entre l'index et le pouce et la fourra dans sa poche. Tout cela sans un mot.
Presque au même moment, deux autres soldats sortirent de la rue Galliéra. Il aurait été impossible de dire à quelle branche ils appartenaient, car leur tenue militaire était composée des vêtements civils les plus incongrus. Cependant, l'un d'eux portait une chéchia de zouave, l'autre un képi d'artilleur. Le premier marche avec des béquilles, l'autre avec deux bâtons. Ces deux-là se tiennent près du kiosque à journaux qui se trouve au bord du trottoir.
Trois autres arrivèrent isolément par la rue Pierre-Charron, la rue Brignoles et la rue de Chaillot : un tirailleur manchot, un sapeur boiteux et un marine dont la hanche semblait tordue. Chacun d'eux se dirige vers un arbre et s'y appuie.
Pas un mot n'a été prononcé parmi eux. Aucun des sept soldats estropiés ne semblait connaître ses compagnons, ni se préoccuper de leur présence, ni même la percevoir. Ils se tenaient derrière leurs arbres, derrière le kiosque ou derrière le groupe de Silènes sans bouger. Et les quelques passants qui, en cette soirée du 3 avril 1915, traversaient cette place peu fréquentée, à peine éclairée par les réverbères voilés, ne ralentissaient pas le pas pour observer les silhouettes immobiles de ces hommes.
Une horloge sonna six heures et demie. A ce moment, la porte d'une des maisons donnant sur la place s'ouvrit. Un homme en sortit, referma la porte derrière lui, traversa la rue de Chaillot et fit le tour de l'espace ouvert devant le musée. C'est un officier en kaki. Sous sa casquette rouge à trois rangs de galons d'or, sa tête était enveloppée d'un large bandage de lin qui lui cachait le front et la nuque. Il est grand et très mince. Sa jambe droite se termine par un moignon de bois auquel est attaché un pied en caoutchouc. Il s'appuie sur un bâton.
Quittant la place, il s'engagea dans la rue Pierre-Charron. Là, il se retourna et regarda tranquillement ce qui l'entourait de tous les côtés. Cette inspection minutieuse l'amena à l'un des arbres faisant face au musée. Du bout de sa canne, il tapa doucement sur un ventre qui dépassait. L'estomac s'est rentré.
L'officier s'éloigne à nouveau. Cette fois, il descendit définitivement la rue Pierre-Charron en direction du centre de Paris. Il arriva ainsi à l'avenue des Champs-Élysées, qu'il remonta en prenant le trottoir de gauche.
Deux cents mètres plus loin se trouvait une grande maison transformée, comme le proclamait un drapeau, en hôpital. L'officier se place à une certaine distance, pour ne pas être vu par les sortants, et attend.
Il est sept heures moins le quart et sept heures. Quelques minutes s'écoulent encore. Cinq personnes sortent de la maison, suivies de deux autres. Enfin, une dame apparut dans le hall, une infirmière portant un large manteau bleu marqué de la Croix-Rouge.
"La voilà qui arrive", dit l'officier.
Elle prit le chemin par lequel il était arrivé et tourna dans la rue Pierre-Charron, gardant le trottoir de droite et se dirigeant ainsi vers l'espace où la rue rejoint la rue de Chaillot. Sa démarche était légère, son pas aisé et équilibré. Le vent, qui la frôle en avançant rapidement sur son chemin, gonfle le long voile bleu qui flotte sur ses épaules. Malgré la largeur du manteau, le balancement rythmique de son corps et la jeunesse de sa silhouette étaient révélés. L'officier restait derrière elle et marchait d'un air distrait, en faisant tourner son bâton, comme un homme qui se promène sans but.
A ce moment-là, il n'y avait personne en vue, dans cette partie de la rue, à part elle et lui. Mais, juste après qu'elle eut traversé l'avenue Marceau et quelque temps avant qu'il ne l'atteigne, une automobile stationnée dans l'avenue se mit à rouler dans la même direction que l'infirmière, à une distance fixe d'elle.
Il s'agissait d'un taxi. Et l'agent a remarqué deux choses : d'abord, qu'il y avait deux hommes à l'intérieur et, ensuite, que l'un d'eux s'est penché à la fenêtre presque tout le temps, en parlant au chauffeur. Il a pu apercevoir un instant le visage de cet homme, coupé en deux par une lourde moustache et surmonté d'un chapeau de feutre gris.
Pendant ce temps, l'infirmière continuait à marcher sans se retourner. L'officier avait traversé la rue et pressait le pas, d'autant plus qu'il s'aperçut que le taxi augmentait également sa vitesse à mesure que la jeune fille s'approchait de l'espace situé devant le musée.
De l'endroit où il se trouvait, l'officier pouvait embrasser d'un seul coup d'œil la quasi-totalité de la petite place ; et il avait beau regarder avec acuité, il ne discernait rien dans l'obscurité qui pût révéler la présence des sept infirmes. Personne, d'ailleurs, ne passait à pied ou en voiture. Au loin seulement, dans le crépuscule des grandes avenues transversales, deux tramways, aux stores baissés, troublaient le silence.
La jeune fille, supposant qu'elle était attentive aux curiosités de la rue, ne parut pas non plus voir de quoi l'alarmer. Elle ne donna pas le moindre signe d'hésitation. Et le comportement du taxi qui la suivait ne sembla pas non plus la frapper, car elle ne regarda pas une seule fois autour d'elle.
Le cab, cependant, gagnait du terrain. Lorsqu'il s'approcha de la place, il était à dix ou quinze mètres, au plus, de l'infirmière ; et, au moment où celle-ci, ne remarquant toujours rien, atteignait les premiers arbres, il se rapprochait encore et, quittant le milieu de la route, commençait à longer le trottoir, tandis que, du côté opposé au trottoir, du côté gauche, l'homme qui continuait à se pencher en dehors avait ouvert la portière et se tenait maintenant sur le marchepied.
L'officier traversa à nouveau la rue, d'un pas vif, sans craindre d'être vu, tant les deux hommes semblaient maintenant se désintéresser de tout ce qui ne concernait pas leurs affaires immédiates. Il porta un sifflet à ses lèvres. Il ne fait aucun doute que l'événement attendu est sur le point de se produire.
Le taxi, en effet, s'arrête brusquement. Les deux hommes sautèrent des portières de chaque côté et se précipitèrent sur le trottoir de la place, à quelques mètres du kiosque. Au même moment, la jeune fille pousse un cri de terreur et l'officier émet un sifflement strident. Et, toujours au même moment, les deux hommes rattrapent et saisissent leur victime et la traînent vers le taxi, tandis que les sept soldats blessés, semblant jaillir des troncs mêmes des arbres qui les cachaient, tombent sur les deux agresseurs.
La bataille n'a pas duré longtemps. Ou plutôt, il n'y a pas eu de bataille. Dès le début, le chauffeur du taxi, s'apercevant que l'attaque était contrée, a déguerpi et s'est éloigné aussi vite qu'il le pouvait. Quant aux deux hommes, constatant l'échec de leur entreprise et se trouvant face à un ensemble menaçant de bâtons et de béquilles levés, sans compter le canon d'un revolver que l'officier braquait sur eux, ils lâchèrent la jeune fille, virèrent de bord pour empêcher l'officier de viser, et disparurent dans l'obscurité de la rue Brignoles.
"Cours pour tout ce que tu vaux, Ya-Bon", dit l'officier au Sénégalais manchot, "et ramène-moi l'un d'entre eux par la peau du cou !".
Il soutient la jeune fille avec son bras. Elle tremblait de tous ses membres et semblait prête à s'évanouir.
"N'ayez pas peur, Petite Mère Coralie", dit-il, très inquiet. "C'est moi, le capitaine Belval, Patrice Belval."
"Ah, c'est vous, capitaine ! balbutie-t-elle.
"Oui, tous vos amis se sont rassemblés pour vous défendre, tous vos anciens patients de l'hôpital, que j'ai retrouvés dans la maison de convalescence.
"Merci. Merci." Et elle ajoute, d'une voix tremblante : "Les autres ? Ces deux hommes ?"
"Fuyez. Ya-Bon est parti à leur recherche."
"Mais qu'est-ce qu'ils me voulaient ? Et quel miracle vous a tous amenés ici ?"
"Nous en parlerons plus tard, Petite Mère Coralie. Parlons d'abord de vous. Où dois-je t'emmener ? Tu ne crois pas que tu ferais mieux de venir ici avec moi, jusqu'à ce que tu te sois remise et que tu te sois un peu reposée ?"
Assisté d'un des soldats, il l'aida doucement à rejoindre la maison qu'il avait lui-même quittée trois quarts d'heure auparavant. La jeune fille le laissa faire à sa guise. Ils entrèrent tous dans un appartement du rez-de-chaussée et passèrent dans le salon où brûlait un bon feu de bois. Il alluma la lumière électrique :
"Asseyez-vous", a-t-il dit.
Elle se laissa tomber dans un fauteuil et le capitaine donna aussitôt ses ordres :
"Toi, Poulard, va chercher un verre dans la salle à manger. Et toi, Ribrac, va puiser une carafe d'eau froide dans la cuisine. . . . Chatelain, tu trouveras une carafe de rhum dans l'office. . . . Ou alors, restez, elle n'aime pas le rhum. . . . . Alors..."
"Alors, dit-elle en souriant, un verre d'eau, s'il vous plaît.
Ses joues, naturellement pâles, retrouvent un peu de leur chaleur. Le sang remontait à ses lèvres, et le sourire qu'elle arborait était plein de confiance. Son visage, tout en charme et en douceur, avait un contour pur, des traits presque trop délicats, un teint clair et l'expression ingénue d'un enfant émerveillé qui regarde la vie avec des yeux toujours grands ouverts. Et tout cela, qui était délicat et exquis, donnait cependant à certains moments une impression d'énergie, due sans doute à ses yeux brillants et sombres et à la ligne de cheveux noirs et lisses qui descendait de chaque côté sous le bonnet blanc dans lequel son front était emprisonné.
"Aha ! s'écria gaiement le capitaine quand elle eut bu l'eau. "Vous vous sentez mieux, je crois, n'est-ce pas, Petite Mère Coralie ?"
"Beaucoup mieux".
"Capitale. Mais c'est une mauvaise minute que nous venons de vivre ! Quelle aventure ! Il va falloir qu'on en parle et qu'on fasse la lumière, n'est-ce pas ? En attendant, mes gars, présentez vos respects à la petite mère Coralie. Eh, mes bons amis, qui aurait cru, quand elle vous dorlotait et qu'elle tapotait vos oreillers pour que vous y enfonciez vos gros culs, qu'un jour nous prendrions soin d'elle et que les enfants dorloteraient leur petite mère ?"
Tous se pressent autour d'elle, les manchots et les unijambistes, les infirmes et les malades, tous heureux de la voir. Elle leur serra affectueusement la main :
"Eh bien, Ribrac, comment va ta jambe ?"
"Je ne le sens plus, Petite Mère Coralie."
"Et vous, Vatinel ? Cette blessure à l'épaule ?"
"Pas le moindre signe, Petite Mère Coralie."
"Et toi, Poulard ? Et toi, Jorisse ?"
Son émotion s'est accrue en les revoyant, ces hommes qu'elle appelait ses enfants. Et Patrice Belval s'exclama :
"Ah, Petite Mère Coralie, voilà que tu pleures ! Petite mère, petite mère, c'est ainsi que tu as conquis tous nos cœurs. Quand nous nous efforcions de ne pas crier, sur notre lit de douleur, nous voyions tes yeux se remplir de grosses larmes. Petite Mère Coralie pleurait sur ses enfants. Alors nous serrions les dents encore plus fort".
"Et je pleurais encore plus", dit-elle, "parce que tu avais peur de me faire du mal".
"Et aujourd'hui, tu recommences. Non, tu as le cœur trop tendre ! Tu nous aimes. Nous t'aimons. Il n'y a pas de quoi pleurer. Allons, Petite Mère Coralie, un sourire. . . . Et moi, je dis, voilà Ya-Bon qui arrive ; et Ya-Bon rit toujours."
Elle se leva brusquement :
"Pensez-vous qu'il ait pu rattraper l'un des deux hommes ?"
"Est-ce que je le pense ? J'ai dit à Ya-Bon d'en ramener un par le cou. Il n'échouera pas. Je n'ai peur que d'une chose... . ."
Ils s'étaient dirigés vers le hall. Le Sénégalais était déjà sur les marches. De sa main droite, il enserrait le cou d'un homme, d'une loque molle plutôt, qu'il semblait porter à bout de bras, comme une poupée de danse.
"Lâchez-le", dit le capitaine.
Ya-Bon a desserré ses doigts. L'homme tombe sur les drapeaux du hall.
"C'est ce que je craignais, murmura l'officier. "Ya-Bon n'a que la main droite, mais quand cette main prend quelqu'un à la gorge, c'est un miracle si elle ne l'étrangle pas. Les Boches en savent quelque chose."
Ya-Bon était une sorte de colosse, de la couleur du charbon luisant, avec une tête laineuse et quelques poils frisés au menton, avec une manche vide attachée à l'épaule gauche et deux médailles épinglées à sa veste. Ya-Bon avait eu une joue, un côté de la mâchoire, la moitié de la bouche et tout le palais fracassés par un éclat d'obus. L'autre moitié de cette bouche est fendue jusqu'à l'oreille dans un rire qui ne semble jamais cesser et qui est d'autant plus surprenant que la partie blessée du visage, rafistolée tant bien que mal et recouverte d'une peau greffée, reste impassible.
De plus, Ya-Bon a perdu la parole. Tout au plus pouvait-il émettre une suite de grognements indistincts dans lesquels son surnom de Ya-Bon était répété à l'infini.
Il la prononça à nouveau d'un air satisfait, jetant tour à tour un regard sur son maître et sur sa victime, comme un bon chien de sport se tient devant l'oiseau qu'il a récupéré.
"Bien", dit l'officier. "Mais la prochaine fois, allez travailler plus doucement."
Il se penche sur l'homme, lui palpe le cœur et, voyant qu'il s'est seulement évanoui, demande à l'infirmière :
"Vous le connaissez ?"
"Non, dit-elle.
"Vous êtes sûr ? Tu n'as jamais vu cette tête nulle part ?"
C'était une très grosse tête, avec des cheveux noirs, enduits de graisse, et une barbe épaisse. Les vêtements de l'homme, qui étaient en serge bleu foncé et bien coupés, indiquaient qu'il était dans une situation aisée.
"Jamais... jamais", déclare la jeune fille.
Le capitaine Belval fouille les poches de l'homme. Elles ne contiennent aucun papier.
"Très bien, dit-il en se levant, nous attendrons qu'il se réveille et nous l'interrogerons alors. Ya-Bon, attache-lui les bras et les jambes et reste ici, dans la salle. Vous autres, retournez à la maison : il est temps que vous soyez à l'intérieur. J'ai ma clé. Dites au revoir à la petite mère Coralie et partez au trot."
Il les poussa dehors, revint vers l'infirmière, la conduisit dans le salon et lui dit :
"Maintenant, parlons, Petite Mère Coralie. D'abord, avant d'essayer d'expliquer les choses, écoute-moi. Ce ne sera pas long."
Ils étaient assis devant le feu qui flambait joyeusement. Patrice Belval glissa une chaussette sous les pieds de Petite Mère Coralie, éteignit une lumière qui semblait l'inquiéter et, lorsqu'il s'assura qu'elle était bien installée, il commença :
"Comme vous le savez, Petite Mère Coralie, j'ai quitté l'hôpital il y a une semaine et je loge boulevard Maillot, à Neuilly, dans la maison réservée aux convalescents de l'hôpital. J'y dors la nuit et je fais panser mes plaies le matin. Le reste du temps, je flâne : Je flâne, déjeune et dîne au gré de mes envies et vais rendre visite à mes amis. Eh bien, ce matin, j'attendais l'un d'eux dans un grand café-restaurant du boulevard, quand j'ai surpris la fin d'une conversation. . . . Mais je dois vous dire que l'endroit est divisé en deux par une cloison d'environ six pieds de haut, avec les clients du café d'un côté et ceux du restaurant de l'autre. J'étais tout seul dans le restaurant ; et les deux hommes, qui me tournaient le dos et qui de toute façon étaient hors de vue, pensaient probablement qu'il n'y avait personne, car ils parlaient un peu plus fort qu'ils n'auraient dû le faire, vu les phrases que j'ai entendues... et que j'ai notées par la suite dans mon petit carnet".
Il sortit le carnet de sa poche et poursuivit :
"Ces phrases, qui ont attiré mon attention pour des raisons que vous comprendrez tout à l'heure, étaient précédées de quelques autres dans lesquelles il était question d'étincelles, d'une pluie d'étincelles qui s'était déjà produite deux fois avant la guerre, une sorte de signal nocturne dont on se proposait de surveiller la répétition éventuelle, afin d'agir rapidement dès qu'elle se produirait. Tout cela ne vous dit rien ?"
"Non. Pourquoi ?"
"Vous verrez. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que ces deux-là parlaient anglais, tout à fait correctement, mais avec un accent qui m'a assuré qu'aucun d'eux n'était anglais. Voici ce qu'ils ont dit, fidèlement traduit : Pour finir, donc, dit l'un, tout est décidé. Vous et lui serez à l'endroit convenu un peu avant sept heures ce soir. Nous y serons, colonel. Nous avons engagé notre taxi. Bien. N'oubliez pas que la petite femme quitte son hôpital à sept heures. N'ayez crainte. Il ne peut y avoir d'erreur, car elle prend toujours le même chemin, la rue Pierre-Charron. Et tout votre plan est réglé ? " " En tous points. La chose se passera sur la place au bout de la rue de Chaillot. Même s'il y a des gens, ils n'auront pas le temps de la secourir, car nous agirons trop vite. Vous êtes sûr de votre chauffeur ? Je suis sûr que nous le paierons suffisamment pour obtenir son obéissance. C'est tout ce que nous voulons. Capitale. Je vous attendrai à l'endroit que vous connaissez, dans une voiture. Tu me remettras la petite femme. A partir de ce moment, nous serons maîtres de la situation. Et vous de la petite femme, colonel, ce qui n'est pas plus mal pour vous, car elle est diablement jolie" "Diablement, comme vous dites. Je la connais de vue depuis longtemps et, sur ma parole... . .' Ils se mirent à rire grossièrement et demandèrent leur addition. Je me levai aussitôt et me dirigeai vers la porte du boulevard, mais un seul d'entre eux sortit par cette porte, un homme avec une grosse moustache tombante et un chapeau de feutre gris. L'autre était sorti par la porte de la rue au coin de la rue. Il n'y avait qu'un seul taxi sur la route. L'homme l'a pris et j'ai dû abandonner tout espoir de le suivre. Seulement... seulement, comme je savais que vous quittiez l'hôpital tous les soirs à sept heures et que vous passiez par la rue Pierre-Charron, j'étais en droit, n'est-ce pas, de croire... ? ?"
Le capitaine s'est arrêté. La jeune fille réfléchit, d'un air pensif. Puis elle demanda :
"Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?"
"Vous avertir !" s'exclame-t-il. "Et si, après tout, ce n'était pas vous ? Pourquoi vous alarmer ? Et si, au contraire, c'était vous, pourquoi vous mettre sur vos gardes ? Après l'échec de la tentative, vos ennemis vous auraient tendu un autre piège, et nous, ne le sachant pas, nous n'aurions pas pu l'empêcher. Non, le mieux était d'accepter le combat. J'enrôlai une petite bande de vos anciens malades traités à la maison ; et, comme l'ami que j'attendais habitait sur la place, ici, dans cette maison, je lui demandai de mettre ses chambres à ma disposition de six à neuf heures. C'est ce que j'ai fait, Petite Mère Coralie. Et maintenant que vous en savez autant que moi, qu'en pensez-vous ?"
Elle lui tend la main :
"Je pense que vous m'avez sauvé d'un danger inconnu qui semble très grand ; et je vous remercie."
"Non, non, dit-il, je ne peux accepter aucun remerciement. J'étais si heureux d'avoir réussi ! Ce que je veux savoir, c'est ce que vous pensez de l'entreprise elle-même."
Sans hésiter, elle a répondu :
"Je n'en ai aucune. Pas un mot, pas un incident, dans tout ce que vous m'avez dit, ne me suggère la moindre idée".
"Vous n'avez pas d'ennemis, à votre connaissance ?"
"Personnellement, non.
"Et cet homme à qui vos deux agresseurs devaient vous remettre et qui dit vous connaître ?
"Toutes les femmes, dit-elle en rougissant légèrement, ne rencontrent-elles pas des hommes qui les poursuivent plus ou moins ouvertement ? Je ne sais pas qui c'est."
Le capitaine reste silencieux pendant un moment, puis poursuit :
"En fin de compte, notre seul espoir d'éclaircir l'affaire réside dans l'interrogatoire de notre prisonnier. S'il refuse de répondre, je le remettrai à la police qui saura faire toute la lumière sur cette affaire".
La jeune fille sursaute :
"La police ?
"Bien sûr. Que voulez-vous que je fasse de cet homme ? Il ne m'appartient pas. Il appartient à la police."
"Non, non, non ! s'exclame-t-elle, excitée. "En aucun cas ! Quoi, ma vie est partie en fumée ? . . . Devoir comparaître devant le magistrat ? ... Avoir mon nom mêlé à tout cela ? . . ."
"Et pourtant, Petite Mère Coralie, je ne peux pas...".
"Oh, je vous en prie, je vous en conjure, en tant qu'ami, trouvez un moyen de vous en sortir, mais ne faites pas parler de moi ! Je ne veux pas qu'on parle de moi !"
Le capitaine la regarde, un peu surpris de la voir dans un tel état d'agitation, et dit :
"On ne parlera pas de vous, Petite Mère Coralie, je vous le promets."
"Alors que ferez-vous de cet homme ?"
"Eh bien, dit-il en riant, je vais commencer par lui demander poliment s'il veut bien condescendre à répondre à mes questions, puis je le remercierai de son comportement civil à votre égard, et enfin je le prierai d'avoir la gentillesse de s'en aller.
Il se lève :
"Voulez-vous le voir, Petite Mère Coralie ?"
"Non, dit-elle, je suis si fatiguée ! Si tu ne veux pas de moi, interroge-le toi-même. Tu pourras m'en parler après. . . ."
Elle semblait tout à fait épuisée par cette nouvelle excitation et cette nouvelle tension, ajoutées à toutes celles qui rendaient déjà sa vie d'infirmière si difficile. Le capitaine n'insista pas et sortit, fermant la porte du salon après lui.
Elle l'a entendu dire :
"Eh bien, Ya-Bon, tu as bien veillé ! Pas de nouvelles ? Et comment va ton prisonnier ? . . Ah, te voilà, mon bonhomme ! As-tu retrouvé ton souffle ? Oh, je sais que la main de Ya-Bon est un peu lourde ! ... Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu ne veux pas répondre ? . . . Hallo, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendu si je ne pense pas..."
Un cri lui échappe. La jeune fille se précipite dans le hall. Elle rencontra le capitaine qui tenta de lui barrer la route.
"Ne viens pas", dit-il, très agité. "A quoi bon !"
"Mais tu es blessé ! s'exclame-t-elle.
"I ?"
"Il y a du sang sur le poignet de votre chemise."
"C'est vrai, mais ce n'est rien : c'est le sang de l'homme qui a dû me souiller.
"Il a donc été blessé ?"
"Oui, ou du moins sa bouche saignait. Un vaisseau sanguin..."
"Pourquoi, Ya-Bon n'a sûrement pas serré aussi fort que ça ?"
"Ce n'était pas Ya-Bon."
"Alors qui était-ce ?"
"Ses complices".
"Sont-ils revenus ?"
"Oui, et ils l'ont étranglé."
"Mais ce n'est pas possible !"
Elle passe et se dirige vers le prisonnier. Il ne bouge pas. Son visage avait la pâleur de la mort. Autour de son cou, il y avait une corde de soie rouge, torsadée très finement et munie d'une boucle à chaque extrémité.
II. Main droite et jambe gauche
"Un voyou de moins dans le monde, petite mère Coralie ! s'écria Patrice Belval, après avoir reconduit la jeune fille au salon et fait une rapide enquête auprès de Ya-Bon. "Rappelez-vous son nom - je l'ai trouvé gravé sur sa montre - Mustapha Rovalaïof, le nom d'un voyou !"
Il parlait gaiement, sans aucune émotion dans la voix, et continuait, tout en marchant de long en large dans la pièce :
"Toi et moi, Petite Mère Coralie, qui avons assisté à tant de tragédies et vu mourir tant de braves gens, n'avons pas besoin de verser des larmes sur la mort de Mustapha Rovalaïof ou sur son assassinat par ses complices. Pas même une oraison funèbre, hein ? Ya-Bon l'a pris sous le bras, a attendu que la place soit libre et l'a porté jusqu'à la rue Brignoles, avec l'ordre de jeter le monsieur par-dessus les grilles dans le jardin du musée Galliéra. Les grilles sont hautes. Mais la main droite de Ya-Bon ne connaît pas d'obstacles. Ainsi, Petite Mère Coralie, l'affaire est enterrée. On ne parlera plus de vous et, cette fois, je réclame un mot de remerciement."
Il s'est arrêté pour rire :
"Un mot de remerciement, mais pas de compliments. Parbleu, je ne fais pas un très bon gardien ! La façon dont ces mendiants se sont emparés de mon prisonnier était astucieuse. Pourquoi n'ai-je pas prévu que votre autre agresseur, l'homme au chapeau de feutre gris, irait prévenir le troisième, qui attendait dans sa voiture, et qu'ils reviendraient tous deux ensemble pour sauver leur compagnon ? Et ils sont revenus. Et, pendant que vous et moi bavardions, ils ont dû forcer l'entrée des domestiques, traverser la cuisine, arriver à la petite porte entre l'office et le vestibule et la pousser. Là, tout près d'eux, gisait leur homme, toujours inconscient et solidement ligoté sur son canapé. Que faire ? Il était impossible de le faire sortir du hall sans alarmer Ya-Bon. Et pourtant, s'ils ne le relâchaient pas, il parlerait, dénoncerait ses complices et ruinerait un plan soigneusement préparé. L'un des deux a donc dû se pencher furtivement en avant, tendre le bras, passer sa corde autour de cette gorge que Ya-Bon avait déjà bien malmenée, rassembler les boucles aux deux extrémités et tirer, tirer, sans bruit, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Pas un bruit. Pas un soupir. Toute l'opération s'est déroulée en silence. Nous venons, nous tuons et nous partons. Bonne nuit. Le tour est joué et notre ami ne parlera pas."
La gaieté du capitaine Belval s'amplifie :
"Notre ami ne parlera pas, répéta-t-il, et la police, lorsqu'elle trouvera son corps demain matin dans un jardin grillagé, ne comprendra pas un mot de l'affaire. Nous non plus, petite mère Coralie, et nous ne saurons jamais pourquoi ces hommes ont essayé de vous enlever. Ce n'est que trop vrai ! Je ne suis peut-être pas à la hauteur en tant que gardien, mais je suis méprisable en tant que détective !"
Il continua à marcher de long en large dans la pièce. L'amputation de sa jambe ou plutôt de son mollet ne semblait guère le gêner ; et, comme les articulations du genou et du fémur avaient conservé leur mobilité, il y avait tout au plus un certain manque de rythme dans l'action de ses hanches et de ses épaules. D'ailleurs, sa haute taille tendait à corriger cette boiterie, réduite à des proportions insignifiantes par l'aisance de ses mouvements et l'indifférence avec laquelle il paraissait l'accepter.
Il avait un visage ouvert, plutôt foncé, brûlé par le soleil et tanné par les intempéries, avec une expression franche, joyeuse et souvent badine. Il devait avoir entre vingt-huit et trente ans. Ses manières évoquaient celles des officiers du Premier Empire, auxquels la vie au camp donnait un air particulier qu'ils apportaient ensuite dans les salons des dames.
Il s'arrêta pour regarder Coralie, dont le profil galbé se détachait sur les lueurs de la cheminée. Puis il vint s'asseoir à côté d'elle :
"Je ne sais rien de vous", dit-il doucement. "A l'hôpital, les médecins et les infirmières vous appellent Madame Coralie. Vos patients préfèrent dire Petite Mère. Quel est votre nom de femme mariée ou de jeune fille ? Avez-vous un mari ou êtes-vous veuve ? Où habitez-vous ? Personne ne le sait. Vous arrivez tous les jours à la même heure et vous repartez par la même rue. Parfois, un vieil homme de service, aux longs cheveux gris et à la barbe hirsute, avec un édredon autour du cou et une paire de lunettes jaunes sur le nez, vous amène ou vient vous chercher. Parfois aussi, il vous attend, toujours assis sur la même chaise dans la cour couverte. On lui a posé des questions, mais il ne donne jamais de réponse. Je ne sais donc qu'une chose de vous, c'est que vous êtes adorablement bonne et gentille et que vous êtes aussi - je peux le dire, n'est-ce pas - adorablement belle. Et c'est peut-être, Petite Mère Coralie, parce que je ne sais rien de votre vie que je l'imagine si mystérieuse, et, d'une certaine façon, si triste. Vous donnez l'impression de vivre dans le chagrin et l'inquiétude, le sentiment d'être seule. Il n'y a personne qui se consacre à vous rendre heureux et à prendre soin de vous. Alors j'ai pensé - j'ai longtemps pensé et attendu l'occasion de te le dire - j'ai pensé que tu devais avoir besoin d'un ami, d'un frère, qui te conseille et te protège. N'ai-je pas raison, Petite Mère Coralie ?"
A mesure qu'il avançait, Coralie semblait se replier sur elle-même et mettre une plus grande distance entre eux, comme si elle ne voulait pas qu'il pénètre dans ces régions secrètes dont il parlait.
"Non, murmura-t-elle, vous vous trompez. Ma vie est très simple. Je n'ai pas besoin d'être défendue."
"Vous n'avez pas besoin d'être défendu", s'écrie-t-il, de plus en plus animé. "Et ces hommes qui ont essayé de vous enlever ? Ce complot ourdi contre vous ? Ce complot que vos agresseurs ont tellement peur de voir découvert qu'ils vont jusqu'à tuer celui qui s'est laissé prendre ? N'est-ce rien ? Est-ce une illusion de ma part quand je vous dis que vous êtes entouré de dangers, que vous avez des ennemis qui ne reculent devant rien, qu'il faut vous défendre contre leurs tentatives et que, si vous déclinez l'offre de mon aide, je.... Eh bien, je... ?"
Elle persiste dans son silence, se montre de plus en plus distante, presque hostile. L'officier frappa du poing le marbre de la cheminée et, se penchant sur elle, termina sa phrase d'un ton déterminé :
"Si vous refusez mon aide, je vous l'imposerai."
Elle secoue la tête.
"Je vous l'imposerai", répéta-t-il avec fermeté. "C'est mon devoir et mon droit."
"Non", dit-elle d'une voix basse.
"Mon droit absolu, dit le capitaine Belval, pour une raison qui l'emporte sur toutes les autres et qui fait que je n'ai même pas besoin de vous consulter.
"Qu'est-ce que tu veux dire ?"
"Je t'aime."
Il a prononcé les mots sans ambages, non pas comme un amoureux qui se risque à une déclaration timide, mais comme un homme fier du sentiment qu'il éprouve et heureux de le proclamer.
Elle baissa les yeux et rougit, et il s'écria, exalté :
"Tu peux le prendre, Petite Mère, de ma part. Pas d'élans passionnés, pas de soupirs, pas d'agitation des bras, pas de battements de mains. Juste trois petits mots, que je te dis sans me mettre à genoux. Et c'est d'autant plus facile pour moi que vous le savez. Oui, Madame Coralie, c'est bien beau d'avoir l'air si timide, mais vous connaissez mon amour pour vous et vous le connaissez depuis aussi longtemps que moi. Nous l'avons vu naître ensemble lorsque vos chères petites mains ont touché ma tête meurtrie. Les autres me torturaient. Avec toi, ce n'était que caresses. Tout comme la pitié dans tes yeux et les larmes qui coulaient parce que je souffrais. Mais peut-on te voir sans t'aimer ? Tes sept patients qui étaient là tout à l'heure sont tous amoureux de toi, Petite Mère Coralie. Ya-Bon vénère le sol sur lequel vous marchez. Seulement, ils sont privés. Ils ne peuvent pas parler. Je suis officier, et je parle sans hésitation ni gêne, croyez-moi."
Coralie avait porté les mains à ses joues brûlantes et était restée silencieuse, penchée en avant.
"Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas, poursuivit-il d'une voix retentissante, quand je dis que je parle sans hésitation ni gêne ? Si j'avais été avant la guerre ce que je suis maintenant, un homme mutilé, je n'aurais pas eu la même assurance et j'aurais déclaré mon amour pour vous humblement et vous aurais demandé pardon pour mon audace. Mais maintenant ! . . . Croyez-moi, Petite Mère Coralie, quand je suis assis ici, face à la femme que j'adore, je ne pense pas à mon infirmité. Pas un instant je n'ai l'impression de pouvoir paraître ridicule ou présomptueux à vos yeux."
Il s'arrêta, comme pour reprendre son souffle, puis se leva et continua :
"Il faut qu'il en soit ainsi. Les gens devront comprendre que ceux qui ont été mutilés dans cette guerre ne se considèrent pas comme des parias, des canards boiteux ou des lépreux, mais comme des hommes tout à fait normaux. Oui, normaux ! Une jambe en moins ? Qu'en est-il ? Est-ce que cela prive un homme de son cerveau ou de son cœur ? Alors, parce que la guerre m'a privé d'une jambe, d'un bras, voire des deux jambes ou des deux bras, je n'ai plus le droit d'aimer une femme qu'au risque de me faire rabrouer ou d'imaginer qu'elle a pitié de moi ? La pitié ! Mais nous ne voulons pas que la femme nous plaigne, ni qu'elle fasse un effort pour nous aimer, ni même qu'elle pense qu'elle fait la charité en nous traitant avec gentillesse. Ce que nous exigeons des femmes et du monde entier, de ceux que nous rencontrons dans la rue et de ceux qui appartiennent au même groupe que nous, c'est l'égalité absolue avec les autres, qui ont été sauvés de notre sort par leur bonne étoile ou leur lâcheté".
Le capitaine frappe à nouveau la cheminée :
"Oui, l'égalité absolue ! Nous tous, que nous ayons perdu une jambe ou un bras, que nous soyons aveugles d'un oeil ou de deux, que nous soyons infirmes ou difformes, nous prétendons être aussi bien, physiquement et moralement, que n'importe qui, et peut-être mieux. Les hommes qui se sont servis de leurs jambes pour se précipiter sur l'ennemi seront-ils distancés dans la vie, parce qu'ils n'ont plus ces jambes, par des hommes qui se sont chauffés les orteils au feu d'un bureau ? Quelle absurdité ! Nous voulons notre place au soleil aussi bien que les autres. Elle nous est due, et nous saurons l'obtenir et la conserver. Il n'y a pas de bonheur auquel nous n'ayons droit, ni de travail dont nous ne soyons capables avec un peu d'exercice et d'entraînement. La main droite de Ya-Bon vaut déjà n'importe quelle paire de mains dans le vaste monde ; et la jambe gauche du capitaine Belval lui permet de faire ses cinq milles à l'heure s'il le désire."
Il se met à rire :
"La main droite et la jambe gauche, la main gauche et la jambe droite : qu'importe ce que nous avons sauvé, si nous savons nous en servir ? En quoi sommes-nous tombés ? Qu'il s'agisse d'obtenir un poste ou de perpétuer notre race, ne sommes-nous pas aussi bons qu'avant ? Et peut-être même mieux. J'ose dire que les enfants que nous donnerons au pays seront aussi bien bâtis que jamais, avec des bras, des jambes et tout le reste... sans parler d'un puissant héritage de courage et d'esprit. C'est ce que nous prétendons, Petite Mère Coralie. Nous refusons d'admettre que nos jambes de bois nous retiennent ou que nous ne pouvons pas nous tenir aussi droit sur nos béquilles que sur des jambes de chair et d'os. Nous ne considérons pas que notre dévouement soit un sacrifice ou qu'il faille parler d'héroïsme quand une fille a l'honneur d'épouser un soldat aveugle ! Encore une fois, nous ne sommes pas des créatures hors normes. Nous n'avons en rien déchu, et c'est une vérité devant laquelle tout le monde s'inclinera pendant les deux ou trois prochaines générations. On comprend que, dans un pays comme la France, où les mutilés se rencontrent par centaines de milliers, la conception de l'homme parfait ne soit plus aussi rigide qu'elle l'était. Dans la nouvelle forme d'humanité qui se prépare, il y aura des hommes à deux bras et des hommes à un seul bras, comme il y a des hommes clairs et des hommes foncés, des barbus et des rasés. Et cela semblera tout à fait naturel. Et chacun mènera la vie qu'il voudra, sans avoir besoin d'être complet dans tous ses membres. Et comme ma vie est enveloppée en toi, Petite Mère Coralie, et que mon bonheur dépend de toi, j'ai pensé ne pas attendre plus longtemps avant de te faire mon petit discours. . . . Eh bien ! C'est fini ! J'ai encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais tout ne peut pas être dit en un jour, n'est-ce pas ? . . ."
Il s'interrompit, décontenancé malgré tout par le silence de Coralie. Elle n'avait pas bougé depuis les premiers mots d'amour qu'il avait prononcés. Ses mains s'étaient portées à son front, et ses épaules tremblaient légèrement.
Il se penche et, avec une infinie douceur, écarte les doigts fins et découvre son beau visage :
"Pourquoi pleures-tu, Petite Mère Coralie ?"
Il l'appelait tu maintenant, mais cela ne la dérangeait pas. Entre un homme et la femme qui s'est penchée sur ses blessures naissent des relations d'un genre particulier ; et le capitaine Belval en particulier avait ces manières plutôt familières, mais toujours respectueuses, dont il semble impossible de s'offusquer.
"Je t'ai fait pleurer ?" demande-t-il.
"Non, dit-elle à voix basse, c'est vous tous qui me contrariez. C'est votre gaieté, votre fierté, votre façon non pas de subir le sort, mais de le maîtriser. Le plus humble d'entre vous s'élève au-dessus de sa nature sans effort, et je ne connais rien de plus beau ni de plus touchant que cette indifférence."
Il s'est assis à côté d'elle :
"Alors tu ne m'en veux pas d'avoir dit... ce que j'ai dit ?"
"En colère contre vous ?" répondit-elle, feignant de se méprendre sur son propos. "Toutes les femmes pensent comme vous. Si les femmes, en accordant leur affection, devaient choisir parmi les hommes qui reviennent de la guerre, le choix se porterait, j'en suis sûre, sur ceux qui ont souffert le plus cruellement."
Il secoue la tête :
"Vous voyez, je demande plus que de l'affection et une réponse plus précise à ce que j'ai dit. Dois-je vous rappeler mes paroles ?"
"Non.
"Alors votre réponse... ?"
"Ma réponse, cher ami, est que vous ne devez plus prononcer ces mots".
Il prend un air solennel :
"Vous me l'interdisez ?"
"Je le fais".
"Dans ce cas, je jure de ne plus rien dire jusqu'à ce que je vous revoie."
"Tu ne me reverras plus", murmura-t-elle.
Le capitaine Belval s'en amuse beaucoup :
"Je le dis, je le dis ! Et pourquoi ne vous reverrai-je pas, Petite Mère Coralie ?"
"Parce que je ne le souhaite pas."
"Et votre raison, s'il vous plaît ?"
"Ma raison ?"
Elle tourna les yeux vers lui et dit, lentement :
"Je suis mariée."
Belval ne semble nullement déconcerté par cette nouvelle. Au contraire, il dit, du ton le plus calme :
"Eh bien, vous devez vous remarier ! Sans doute ton mari est-il un vieil homme et tu ne l'aimes pas. Il comprendra donc que, puisque vous avez quelqu'un qui vous aime... . ."
"Ne plaisantez pas, s'il vous plaît."
Il lui saisit la main, au moment où elle se levait pour partir :
"Vous avez raison, Petite Mère Coralie, et je m'excuse de ne pas avoir adopté une attitude plus sérieuse pour vous parler de choses très sérieuses. Il s'agit de nos deux vies. Je suis profondément convaincue qu'elles vont l'une vers l'autre et que vous êtes impuissante à les retenir. C'est pourquoi votre réponse est hors sujet. Je ne vous demande rien. J'attends tout du destin. C'est le destin qui nous réunira."
"Non, dit-elle.
"Oui, a-t-il déclaré, c'est ainsi que les choses se passeront.
"Ce n'est pas le cas. Ils ne se passeront pas et ne se passeront pas comme ça. Vous devez me donner votre parole d'honneur de ne pas essayer de me revoir ni même d'apprendre mon nom. J'aurais pu vous accorder plus si vous vous étiez contenté de rester amis. L'aveu que vous avez fait met une barrière entre nous. Je ne veux personne dans ma vie... personne !"
Elle fit cette déclaration avec une certaine véhémence et en même temps essaya de dégager son bras de son emprise. Patrice Belval résista à ses efforts et dit :
"Vous avez tort. . . Vous n'avez pas le droit de vous exposer à un tel danger. . . . Réfléchissez, s'il vous plaît..."
Elle le repousse. Ce faisant, elle fait tomber de la cheminée un petit sac qu'elle y avait déposé. Il tomba sur le tapis et s'ouvrit. Deux ou trois objets s'en échappèrent, qu'elle ramassa, tandis que Patrice Belval s'agenouillait par terre pour l'aider :
"Tenez", dit-il, "vous avez manqué ceci".
C'était un petit étui en paille tressée, qui s'était également ouvert ; les grains d'un chapelet en dépassaient.
Ils se lèvent tous deux en silence. Le capitaine Belval examine le chapelet.
"Quelle curieuse coïncidence, murmura-t-il. "Ces perles d'améthyste ! Cette monture en filigrane d'or à l'ancienne ! . . . C'est étrange de retrouver les mêmes matériaux et la même facture. . . ."
Il eut un sursaut, et ce fut si marqué que Coralie demanda :
"Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ?"
Il tenait dans ses doigts une perle plus grande que la plupart des autres, formant un lien entre la chaîne de dizaines et la chaîne de prière plus courte. Cette perle était cassée sur la moitié de sa longueur, presque au niveau de la monture en or qui la contenait.
"La coïncidence, dit-il, est si inconcevable que j'ose à peine.... Et pourtant, le visage peut être vérifié immédiatement. Mais d'abord, une question : qui vous a donné ce chapelet ?"
"Personne ne me l'a donné. Je l'ai toujours eu."
"Mais il a dû appartenir à quelqu'un avant ?"
"A ma mère, je suppose."
"Votre mère ?"
"Je m'y attends, de la même manière que les différents bijoux qu'elle m'a laissés."
"Votre mère est-elle morte ?"
"Oui, elle est morte quand j'avais quatre ans. Je n'ai qu'un vague souvenir d'elle. Mais quel est le rapport avec un chapelet ?"
"C'est à cause de ça", a-t-il dit. "A cause de cette perle d'améthyste cassée en deux."
Il défit sa veste et sortit sa montre de la poche de son gilet. Elle était ornée d'un certain nombre de colifichets attachés par une petite lanière de cuir et d'argent. L'une de ces babioles consistait en la moitié d'une perle d'améthyste, également brisée, également maintenue dans une monture en filigrane. La taille originale des deux perles semblait identique. Les deux améthystes étaient de la même couleur et contenues dans le même filigrane.
Coralie et Belval se regardent avec inquiétude. Elle balbutie :
"Ce n'est qu'un accident, rien d'autre..."
"Je suis d'accord", dit-il. "Mais, à supposer que ces deux moitiés s'emboîtent exactement l'une dans l'autre..."
"C'est impossible", dit-elle, elle-même effrayée à l'idée du simple petit geste nécessaire à la preuve indiscutable.
L'officier, cependant, décida de faire ce geste. Il rapprocha sa main droite, qui tenait le chapelet, et sa main gauche, qui tenait le bibelot. Les mains hésitent, se tâtent et s'arrêtent. Le contact est établi.
Les saillies et les indentations des pierres brisées correspondaient exactement. Chaque partie saillante a trouvé un espace à sa mesure. Les deux demi-améthystes étaient les deux moitiés d'une même améthyste. Une fois réunies, elles formaient une seule et même perle.
Il y eut une longue pause, chargée d'excitation et de mystère. Puis, parlant à voix basse :
"Je ne sais pas non plus d'où vient exactement ce bibelot", dit le capitaine Belval. "Depuis mon enfance, je le vois parmi d'autres objets de peu de valeur que je garde dans une boîte en carton : des clés de montre, de vieilles bagues, des sceaux démodés. Il y a deux ou trois ans, j'ai choisi ces bibelots parmi eux. D'où vient celui-ci ? Je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est que..."
Il avait séparé les deux pièces et, après les avoir examinées attentivement, avait conclu :
"Ce que je sais, sans l'ombre d'un doute, c'est que la plus grosse perle de ce chapelet s'est détachée un jour et s'est brisée, et que l'autre, avec sa monture, est allée former le bibelot que j'ai maintenant. Vous et moi possédons donc les deux moitiés d'un objet que quelqu'un d'autre possédait il y a vingt ans."
Il s'est approché d'elle et, de la même voix basse et plutôt sérieuse, lui a dit :
"Vous avez protesté tout à l'heure quand j'ai affirmé ma foi dans le destin et ma certitude que les événements nous conduisaient l'un vers l'autre. Le niez-vous encore ? Car, après tout, il s'agit soit d'un accident si extraordinaire qu'on n'a pas le droit de l'admettre, soit d'un fait réel qui prouve que nos deux vies se sont déjà touchées dans le passé en un point mystérieux et qu'elles se retrouveront dans l'avenir pour ne plus se quitter. Et c'est pourquoi, sans attendre un avenir peut-être lointain, je vous offre aujourd'hui, alors que le danger vous guette, le soutien de mon amitié. Remarquez que je ne parle plus d'amour mais seulement d'amitié. Acceptes-tu ?"
Elle était nonchalante et tellement perturbée par ce miracle des deux améthystes brisées, s'ajustant exactement l'une à l'autre, qu'elle sembla ne pas entendre la voix de Belval.
"Acceptez-vous ?" répète-t-il.
Au bout d'un moment, elle a répondu :
"Non.
"La preuve que le destin vous a donnée de ses désirs ne vous satisfait donc pas", dit-il avec bonhomie.
"Nous ne devons plus nous revoir", a-t-elle déclaré.
"Très bien. Je m'en remets au hasard. Ce ne sera pas pour longtemps. En attendant, je vous promets de ne pas faire d'effort pour vous voir."
"Ni pour connaître mon nom ?"
"Oui, je vous le promets."
"Au revoir", dit-elle en lui donnant la main.
"Au revoir, répondit-il.
Elle s'éloigne. Arrivée à la porte, elle semble hésiter. Il se tenait immobile près de la cheminée. Elle répéta :
"Au revoir."
"Au revoir, Petite Mère Coralie".
Puis elle est sortie.
Ce n'est que lorsque la porte de la rue se fut refermée derrière elle que le capitaine Belval s'approcha d'une des fenêtres. Il vit Coralie passer entre les arbres, toute petite dans l'obscurité environnante. Il eut un pincement au cœur. La reverra-t-il un jour ?
"Dois-je ? Plutôt !" s'exclama-t-il. "Demain, peut-être. Ne suis-je pas le favori des dieux ?"
Et, prenant son bâton, il partit, comme il le disait, la jambe de bois en avant.
Ce soir-là, après avoir dîné au restaurant le plus proche, le capitaine Belval se rendit à Neuilly. La maison d'accueil de l'hôpital est une agréable villa sur le boulevard Maillot, avec vue sur le bois de Boulogne. La discipline n'est pas trop stricte. Le capitaine pouvait entrer à n'importe quelle heure de la nuit et l'homme obtenait facilement une permission de la part de la matrone.
"Ya-Bon est là ? demande-t-il à cette dame.
"Oui, il joue aux cartes avec sa chérie."
"Il a le droit d'aimer et d'être aimé", a-t-il déclaré. "Des lettres pour moi ?"
"Non, seulement un colis".
"De qui ?"
"Un commissionnaire l'a apporté et a simplement dit que c'était pour le capitaine Belval. Je l'ai mis dans votre chambre."
L'agent monte dans sa chambre au dernier étage et voit le colis, emballé dans du papier et de la ficelle, sur la table. Il l'ouvre et découvre une boîte. Celle-ci contenait une clé, une grosse clé rouillée, d'une forme et d'une fabrication manifestement anciennes.
Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Il n'y avait ni adresse ni marque sur la boîte. Il supposa qu'il y avait là une erreur qui se révélerait d'elle-même, et il glissa la clef dans sa poche.
"Assez d'énigmes pour aujourd'hui", pensa-t-il. "Allons nous coucher."
Mais quand il alla à la fenêtre pour tirer les rideaux, il vit, à travers les arbres du Bois, une cascade d'étincelles qui se répandait à quelque distance dans le noir épais de la nuit. Et il se souvint de la conversation qu'il avait entendue au restaurant et de la pluie d'étincelles évoquée par les hommes qui complotaient l'enlèvement de la petite mère Coralie. . . .
III. La clé rouillée
A l'âge de huit ans, Patrice Belval est envoyé de Paris, où il vivait jusqu'alors, dans un pensionnat français à Londres. Il y restera dix ans. Au début, il recevait des nouvelles de son père toutes les semaines. Puis, un jour, le directeur lui annonça qu'il était orphelin, qu'il avait été pourvu aux frais de son éducation et qu'à sa majorité, il recevrait par l'intermédiaire d'un notaire anglais l'héritage paternel qui s'élevait à environ huit mille livres.
Deux cent mille francs ne pouvaient suffire à un jeune homme qui se révéla vite avoir des goûts de luxe et qui, envoyé en Algérie pour y faire son service militaire, trouva le moyen d'accumuler vingt mille francs de dettes avant d'entrer dans l'argent. Il commença donc par dilapider son patrimoine et, cela fait, se mit au travail. Doté d'un tempérament actif et d'un cerveau ingénieux, sans vocation particulière, mais capable de tout ce qui demande de l'initiative et de la résolution, plein d'idées, ayant à la fois la volonté et les connaissances pour mener à bien une entreprise, il inspire confiance aux autres, trouve des capitaux au fur et à mesure de ses besoins et se lance dans des entreprises qui se succèdent, qu'il s'agisse d'aménagements électriques, d'achats de rivières et de chutes d'eau, d'organisation de services automobiles dans les colonies, de lignes de bateaux à vapeur, de sociétés minières. En quelques années, il a lancé une douzaine d'entreprises de ce type, qui ont toutes réussi.