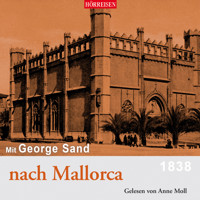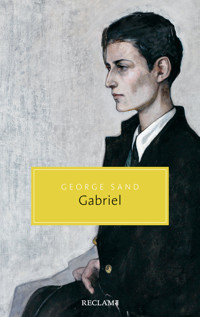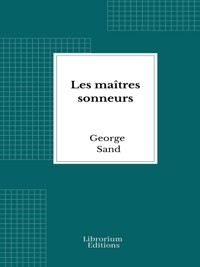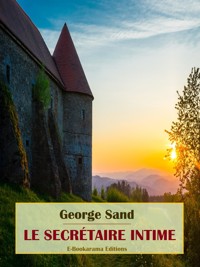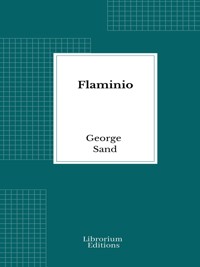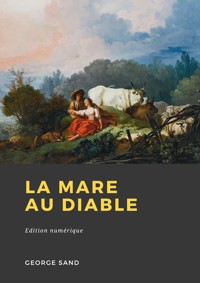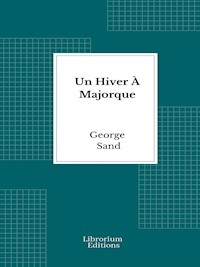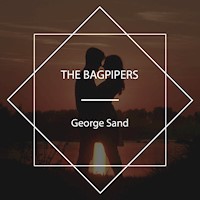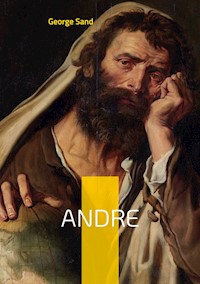Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CLAAE
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Plongée en plein cœur du terroir
Mon cher fils,
Tu as recueilli diverses traditions, chansons et légendes, (…) car ces choses se perdent à mesure que le paysan s’éclaire, et il est bon de sauver de l’oubli qui marche vite, quelques versions de ce grand poème du merveilleux, dont l’humanité s’est nourrie si longtemps et dont les gens de campagne sont aujourd’hui, à leur insu, les derniers bardes...
George Sand
George Sand a écrit les
Légendes rustiques à partir de récits fantastiques recueillis dans la campagne berrichonne par son fils Maurice.
Un recueil d'histoires courtes fantastiques rédigées par une grande plume de la littérature française !
EXTRAIT DE
LES LAVEUSES DE NUIT OU LAVANDIÈRES
Nous avons entendu souvent le battoir des laveuses de nuit résonner dans le silence autour des mares désertes. C’est à s’y tromper. C’est une espèce de grenouille qui produit ce bruit formidable. Mais c’est bien triste d’avoir fait cette puérile découverte et de ne plus pouvoir espérer l’apparition des terribles sorcières, tordant leurs haillons immondes, dans la brume des nuits de novembre, à la pâle clarté d’un croissant blafard reflété par les eaux.
Cependant, j’ai eu l’émotion d’un récit sincère et assez effrayant sur ce sujet.
À PROPOS DE L'AUTEUR
George Sand (1804-1876) est le pseudonyme d’Amandine Aurore Lucile Dupin. Elle a écrit de nombreux romans, nouvelles, contes, pièces de théâtre, une autobiographie, des critiques littéraires et des textes politiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CLAAEFrance
George SAND
Légendes rustiques
CLAAE
2015
© CLAAE, 2015
Tous droits réservés. Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
EAN ebook 9782379110405
George Sand, (1804-1876) est le pseudonyme d’Amandine Aurore Lucile Dupin. Elle a écrit de nombreux romans, nouvelles, contes, pièces de théâtre, une autobiographie, des critiques littéraires et des textes politiques.
Avant-propos
Il faudrait trouver un nom à ce poème sans nom de la fabulosité ou merveillosité universelle, dont les origines remontent à l’apparition de l’homme sur la terre, et dont les versions, multipliées à l’infini, sont l’expression de l’imagination poétique de tous les temps et de tous les peuples.
Le chapitre des légendes rustiques sur les esprits et les visions de la nuit serait, à lui seul, un ouvrage immense. En quel coin de la terre pourrait-on se réfugier pour trouver l’imagination populaire (qui n’est jamais qu’une forme effacée ou altérée de quelque souvenir collectif) à l’abri de ces noires apparitions d’esprits malfaisants qui chassent devant eux les larves éplorées d’innombrables victimes ? Là où règne la paix, – la guerre, la peste ou le désespoir ont passé, terribles, à une époque quelconque de l’histoire des hommes. Le blé qui pousse a le pied dans la chair humaine dont la poussière a engraissé nos sillons. Tout est ruine, sang et débris sous nos pas, et le monde fantastique qui enflamme ou stupéfie la cervelle du paysan est une histoire inédite des temps passés. Quand on veut remonter à la cause première des formes de sa fiction, on la trouve dans quelque récit tronqué et défiguré, où rarement on peut découvrir un fait avéré et consacré par l’histoire officielle.
Le paysan est donc, si l’on peut ainsi dire, le seul historien qui nous reste des temps antéhistoriques. Honneur et profit intellectuel à qui se consacrerait à la recherche de ces traditions merveilleuses de chaque hameau, qui, rassemblées ou groupées, comparées entre elles et minutieusement disséquées, jetteraient peut-être de grandes lueurs sur la nuit profonde des âges primitifs.
Mais ceci serait l’ouvrage et le voyage de toute une vie, rien que pour explorer la France. Le paysan se souvient encore des récits de son aïeule, mais le faire parler devient chaque jour plus difficile. Il sait que celui qui l’interroge ne croit plus, et il commence à sentir une sorte de fierté, à coup sûr estimable, qui se refuse à servir de jouet à la curiosité.
D’ailleurs, on ne saurait trop avertir les faiseurs de recherches que les versions d’une même légende sont innombrables, et que chaque clocher, chaque famille, chaque chaumière a la sienne. C’est le propre de la littérature orale que cette diversité. La poésie rustique, comme la musique rustique, compte autant d’arrangeurs que d’individus.
J’aime trop le merveilleux pour être autre chose qu’un ignorant de profession. D’ailleurs, je ne dois pas oublier que j’écris le texte d’un album consacré à un choix de légendes recueillies sur place, et je m’efforcerai de rassembler, parmi mes souvenirs du jeune âge, quelques-uns des récits qui complètent la définition de certains types fantastiques communs à toute la France. C’est dans un coin du Berry, où j’ai passé ma vie, que je serai forcée de localiser mes légendes, puisque c’est là, et non ailleurs, que je les ai trouvées. Elles n’ont pas la grande poésie des chants bretons, où le génie et la foi de la vieille Gaule ont laissé des empreintes plus nettes que partout ailleurs. Chez nous, ces réminiscences sont plus vagues ou plus voilées. Le merveilleux de nos provinces centrales a plus d’analogie avec celui de la Normandie, dont une femme érudite, patiente et consciencieuse a tracé un tableau complet1.
Cependant, l’esprit gaulois a légué à toutes nos traditions rustiques de grands traits et une couleur qui se rencontrent dans toute la France, un mélange de terreur et d’ironie, une bizarrerie d’invention extraordinaire, jointe à un symbolisme naïf qui atteste le besoin du vrai moral au sein de la fantaisie délirante.
Le Berry, couvert d’antiques débris des âges mystérieux, de tombelles, de dolmens, de menhirs et de mardelles2, semble avoir conservé, dans ses légendes, des souvenirs antérieurs au culte des druides : peut-être celui des dieux kabyres, que nos antiquaires placent avant l’apparition des Kymris sur notre sol. Les sacrifices de victimes humaines semblent planer, comme une horrible réminiscence, dans certaines visions. Les cadavres ambulants, les fantômes mutilés, les hommes sans têtes, les bras ou les jambes sans corps, peuplent nos landes et nos vieux chemins abandonnés.
Puis viennent les superstitions plus arrangées du Moyen Âge, encore hideuses, mais tournant volontiers au burlesque ; les animaux impossibles dont les grimaçantes figures se tordent dans la sculpture romane ou gothique des églises, ont continué d’errer vivantes et hurlantes autour des cimetières ou le long des ruines. Les âmes des morts frappent à la porte des maisons. Le sabbat des vices personnifiés, des diablotins étranges, passe, en sifflant, dans la nuée d’orage. Tout le passé se ranime, tous les êtres que la mort a dissous, les animaux mêmes, retrouvent la voix, le mouvement et l’apparence ; les meubles, façonnés par l’homme et détruits violemment, se redressent et grincent sur leurs pieds vermoulus. Les pierres mêmes se lèvent et parlent au passant effrayé ; les oiseaux de nuit lui chantent, d’une voix affreuse, l’heure de la mort qui, toujours fauche et toujours passe, mais qui ne semble jamais définitive sur la face de la terre, grâce à cette croyance en vertu de laquelle tout être et toute chose protestent contre le néant, et, réfugiés dans la région du merveilleux, illuminent la nuit de sinistres clartés ou peuplent la solitude de figures flottantes et de paroles mystérieuses3.
__________________
1. La Normandie romanesque et merveilleuse, par Amélie Bosquet.
2. Voyez pour ces mystérieux vestiges l’Histoire du Berry, par M. Raynal.
3. Quiconque voudra faire un ouvrage sérieux et savant sur le centre de la Gaule devra consulter les excellents travaux de M. Raynal, l’historien du Berry, le texte des Esquisses pittoresques de MM. de la Tremblays et de la Villegille, les recherches de M. Laisnel de la Salle sur quelques locutions curieuses.
À Maurice Sand
Mon cher fils,
Tu as recueilli diverses traditions, chansons et légendes, que tu as bien fait, selon moi, d’illustrer ; car ces choses se perdent à mesure que le paysan s’éclaire, et il est bon de sauver de l’oubli qui marche vite, quelques versions de ce grand poème du merveilleux, dont l’humanité s’est nourrie si longtemps et dont les gens de campagne sont aujourd’hui, à leur insu, les derniers bardes.
Je veux donc t’aider à rassembler quelques fragments épars de ces légendes rustiques, dont le fond se retrouve à peu près dans toute la France, mais auxquelles chaque localité a donné sa couleur particulière et le cachet de sa fantaisie.
George Sand
Nohant, 17 août 68
Quand nous vînmes à passer au long des pierres, dit Germain, il était environ la mi-nuit. Tout d‚un coup, voilà qu’elles nous regardent avec des yeux. Jamais, de jour, nous n’avions vu ça, et pourtant, nous avions passé par là plus de cent fois. Nous en avons eu la fièvre de peur, plus de trois mois encore après la moisson.
Maurice Sand.
Les pierres-sottes ou pierres-caillasses
Au beau milieu des plaines calcaires de la vallée Noire, on voit se creuser brusquement une zone jonchée de magnifiques blocs de granit. Sont-ils de ceux que l’on doit appeler erratiques, à cause de leur apparition fortuite dans des régions où ils n’ont pu être amenés que par les eaux diluviennes des âges primitifs ? Se sont-ils, au contraire, formés dans les terrains où on les trouve accumulés ? Cette dernière hypothèse semble être démentie par leur forme ; ils sont presque tous arrondis, du moins sur une de leurs faces, et ils présentent l’aspect de gigantesques galets roulés par les flots.
Il n’y a pourtant là maintenant que de charmants petits ruisseaux, pressés et tordus en méandres infinis par la masse de ces blocs ; ces riantes et fuyardes petites naïades murmurent, à demi-voix et par bizarres intervalles, des phrases mystérieuses dans une langue inconnue. Ailleurs, les eaux rugissent, chantent ou gazouillent. Là, elles parlent, mais si discrètement, que l’oreille attentive des sylvains peut seule les comprendre. Dans le creux où leurs minces filets s’amassent, il y a quelquefois des silences ; puis, quand la petite cave est remplie, le trop plein s’élance et révèle, en quelques paroles précipitées, je ne sais quel secret que les fleurs et les herbes, agitées par l’air qu’elles foulent, semblent saisir et saluer au passage.
Plus loin, ces eaux s’engouffrent et se perdent sous les blocs entassés :
Et, là, profonde,Murmure une ondeQu’on ne voit pas.
Sur ces roches humides croissent des plantes également étrangères au sol de la contrée. La ményanthe, cette blanche petite hyacinthe frisée et dentelée, dont la feuille est celle du trèfle ; la digitale pourprée, tachetée de noir et de blanc, comme les granits où elle se plaît ; la rosée du soleil (Rosea solis) ; de charmants saxifrages, et une variété de lierre à petites feuilles, qui trace sur les blocs gris de gracieuses arabesques où l’on croit lire des chiffres mystérieux.
Autour de ce sanctuaire croissent des arbres magnifiques, des hêtres élancés et des châtaigniers monstrueux. C’est dans un de ces bois ondulés et semés de roches libres, comme celles de la forêt de Fontainebleau, que je trouvai, une année, la végétation splendide et l’ombre épaisse au point que le soleil, en plein midi, tamisé par le feuillage, ne faisait plus pénétrer sur les tiges des arbres et sur les terrains moussus que des tons froids semblables à la lumière verdâtre de la lune.
Il n’est pas un coin de la France où les grosses pierres ne frappent l’imagination du paysan, et, quand de certaines légendes s’y attachent, vous pouvez être certain, quelle que soit l’hésitation des antiquaires, que le lieu a été consacré par le culte de l’ancienne Gaule.
Il y a aussi des noms qui, en dépit de la corruption amenée par le temps, sont assez significatifs pour détruire les doutes. Dans une certaine localité de la Brenne, on trouve le nom très bien conservé des druiders. Ailleurs, on trouve les durders ; à Crevant, les dorderins. C’est un semis de ces énormes galets granitiques au sommet d’un monticule conique… Le plus élevé est un champignon dressé sur de petits supports. Ce pourrait être un jeu de la nature, mais ce ne serait pas une raison pour que cette pierre n’eût pas été consacrée par les sacrifices. D’ailleurs, elle s’appelle le grand dorderin. C’est comme si l’on disait, le grand autel des druides.
Un peu plus loin, sur le revers d’un ravin inculte et envahi par les eaux, s’élèvent les parelles. Cela signifie-t-il pareilles, jumelles, ou le mot vient-il de patres, comme celui de marses ou martes vient de matres selon nos antiquaires1 ? Ces parelles ou patrelles sont deux masses à peu près identiques de volume et de hauteur, qui se dressent, comme deux tours, au bord d’une terrasse naturelle d’un assez vaste développement. Leur base repose sur des assises plus petites. J’y ai trouvé une scorie de mâchefer, qui m’a donné beaucoup à penser. Ce lieu est loin de toute habitation et n’a jamais pu en voir asseoir aucune sur ses aspérités aux fonds inondés. Qu’est-ce qu’une scorie de forge venait faire sous les herbes, dans ce désert où ne vont pas même les troupeaux ? Il y avait donc eu là un foyer intense, peut-être une habitude de sacrifices ?
J’ai parlé de ce lieu parce qu’il est à peu près inconnu. Nos histoires du Berry n’en font mention que pour le nommer et le ranger hypothétiquement et d’une manière vague parmi les monuments celtiques. Il est cependant d’un grand intérêt aux points de vue minéralogique, historique, pittoresque et botanique.
À une demi-lieue de là, on voyait encore, il y a quelques années, le trou aux Fades (la grotte aux fées) que le propriétaire d’un champ voisin a jugé à propos d’ensevelir sous les terres, pour se préserver apparemment des malignes influences de ces martes. C’était une habitation visiblement taillée dans le roc et composée de deux chambres, séparées par une sorte de cloison à jour. Les paysans croyaient voir, dans un enfoncement arrondi, le four où ces anachorètes faisaient cuire leur pain. Toutefois, cet ermitage n’avait pas été consacré par le séjour de bonnes âmes chrétiennes. Autrement, la dévotion s’en fût emparée comme partout ailleurs, pour y établir des pèlerinages et y poser, tout au moins, une image bénite. Loin de là, c’était un mauvais endroit, où l’on se gardait bien de passer. Aucun sentier n’était tracé dans les ronces ; les paysans vous disaient que les fades étaient des femmes sauvages de l’ancien temps, et qu’elles faisaient manger les enfants par des louves blanches.
Pourquoi l’antique renommée des prêtresses gauloises est-elle, selon les localités, tantôt funeste, et tantôt bénigne ? On sait qu’il y a eu différents cultes successivement vainqueurs les uns des autres, avant et l’on dit même depuis l’occupation romaine. Là où les antiques prêtresses sont restées des génies tutélaires, on peut être bien sûr que la croyance était sublime ; là où elles ne sont plus que des goules féroces le culte a du être sanguinaire. Les martes, que nous avons nommées à propos des fades, sont des esprits mâles et femelles. Dans les rochers où se précipite le torrent de la Porte-Feuille, près de Saint-Benoît-du-Sault, elles apparaissent sous les deux formes, et à quelque sexe qu’elles appartiennent, elles sont également redoutables. Mâles, elles sont encore occupées à relever les dolmens et menhirs épars sur les collines environnantes ; femelles, elles courent, les cheveux flottants jusqu’aux talons, les seins pendant jusqu’à terre, après les laboureurs qui refusent d’aider à leurs travaux mystérieux. Elles les frappent et les torturent jusqu’à leur faire abandonner en plein jour la charrue et l’attelage. Une cascade très pittoresque au milieu de rochers d’une forme bizarre s’appelle l’aire aux Martes2. Quand les eaux sont basses, on voit les ustensiles de pierre qui servent à leur cuisine. Leurs hommes mettent la table, c’est-à-dire la pierre du dolmen sur ses assises. Quant à elles, elles essaient follement, vains et fantasques esprits qu’elles sont, d’allumer du feu dans la cascade de Montgarnaud et d’y faire bouillir leur marmite de granit. Furieuses d’échouer sans cesse, elles font retentir les échos de cris et d’imprécations. N’est-ce pas là l’histoire figurée d’un culte renversé, qui a fait de vains efforts pour se relever ?
Dans la plaine de notre Fromental, rien n’est resté de ces traditions symboliques. Seulement, quelques pierres isolées, dans la région intermédiaire du calcaire au granit, sont regardées de travers par les passants attardés. Ces pierres prennent figure et font des grimaces plus ou moins menaçantes, selon que les regards curieux des profanes leur déplaisent plus ou moins. On dit qu’elles parleraient bien si elles pouvaient, et que même les sorciers fins, c’est-à-dire très savants, peuvent les forcer à dire bonsoir. Mais elles sont si têtues et si bornées, qu’on n’a jamais pu leur en apprendre davantage. Quelquefois, on passe auprès d’elles sans les voir : c’est qu’en réalité, dit-on, elles n’y sont plus. Elles ont été faire un tour de promenade, et il faut vite s’éloigner le plus possible du chemin qu’elles doivent prendre pour revenir à leur place accoutumée. On ne dit pas si, comme les peulvans