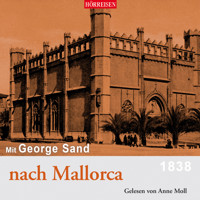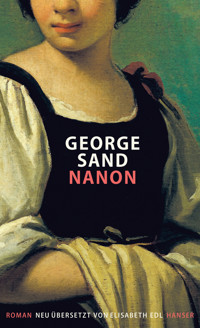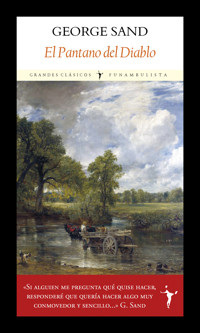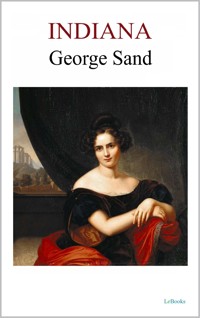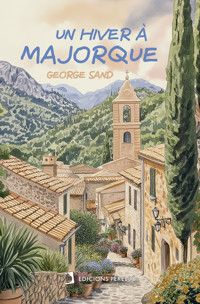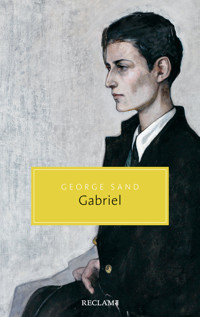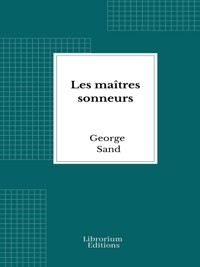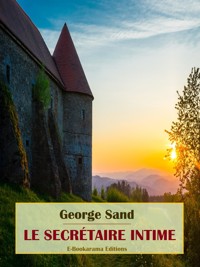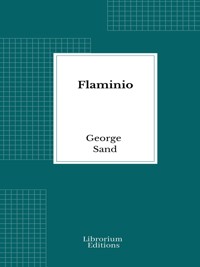0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quand j’ai connu M. Hartz, il était marchand naturaliste et faisait tranquillement ses affaires en vendant, aux amateurs de collections, des minéraux, des insectes ou des plantes. Chargé d’une commission pour lui, je m’intéressais médiocrement aux objets précieux qui encombraient sa boutique, lorsque, tout en causant avec lui de l’ami commun qui nous avait mis en rapport, et en touchant machinalement une pierre en forme d’œuf qui s’était trouvée sous ma main, je la laissai tomber. Elle se brisa en deux parties assez égales que je m’empressai de ramasser en demandant pardon au marchand de ma maladresse.
– Ne vous en tourmentez pas, répondit-il avec obligeance : elle était destinée à être cassée d’un coup de marteau. C’est une géode sans grande valeur, et, d’ailleurs, qui est-ce qui n’est pas curieux de voir l’intérieur d’une géode ?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Laura
ou
Voyage dans le cristal
George Sand
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385744199
I
Quand j’ai connu M. Hartz, il était marchand naturaliste et faisait tranquillement ses affaires en vendant, aux amateurs de collections, des minéraux, des insectes ou des plantes. Chargé d’une commission pour lui, je m’intéressais médiocrement aux objets précieux qui encombraient sa boutique, lorsque, tout en causant avec lui de l’ami commun qui nous avait mis en rapport, et en touchant machinalement une pierre en forme d’œuf qui s’était trouvée sous ma main, je la laissai tomber. Elle se brisa en deux parties assez égales que je m’empressai de ramasser en demandant pardon au marchand de ma maladresse.
– Ne vous en tourmentez pas, répondit-il avec obligeance : elle était destinée à être cassée d’un coup de marteau. C’est une géode sans grande valeur, et, d’ailleurs, qui est-ce qui n’est pas curieux de voir l’intérieur d’une géode ?
– Je ne sais, lui dis-je, ce que c’est au juste qu’une géode, et n’ai nulle envie de le savoir.
– Pourquoi ? reprit-il ; vous êtes artiste pourtant ?
– Oui, j’essaye de l’être ; mais les critiques ne veulent pas que les artistes se donnent l’air de savoir quelque chose en dehors de leur art, et le public n’aime pas que l’artiste paraisse en savoir un peu plus long que lui sur n’importe quoi.
– Je crois que le public, la critique et vous êtes dans l’erreur. L’artiste est né voyageur ; tout est voyage pour son esprit, et, sans quitter le coin de son feu ou les ombrages de son jardin, il est autorisé à parcourir tous les chemins du monde. Donnez-lui n’importe quoi à lire ou à regarder, étude aride ou riante : il se passionnera pour tout ce qui lui sera nouveau, il s’étonnera naïvement de n’avoir pas encore vécu dans ce sens-là, et il traduira le plaisir de sa découverte sous n’importe quelle forme, sans avoir cessé d’être lui-même. Pas plus que les autres humains, l’artiste ne choisit son genre de vie et la nature de ses impressions. Il reçoit du dehors le soleil et la pluie, l’ombre et la lumière, comme tout le monde. Ne lui demandez pas de créer en dehors de ce qui le frappe. Il subit l’action du milieu qu’il traverse, et c’est fort bien fait, car il s’éteindrait et deviendrait stérile le jour où cette action viendrait à cesser. Donc, poursuivit M. Hartz, vous avez parfaitement le droit de vous instruire, si cela vous amuse et si l’occasion se rencontre. Il n’y a point de danger à cela pour qui est vraiment artiste.
– De même qu’un vrai savant peut être artiste, si cette excursion dans le domaine de l’art ne nuit pas à ses graves études ?
– Oui, reprit l’honnête marchand : toute la question est d’être quelque chose de bien déterminé et d’un peu solide dans un sens ou dans l’autre. Cela, j’en conviens, n’est pas donné à tout le monde ! Et, ajouta-t-il avec une espèce de soupir, si vous doutez de vous-même, ne regardez pas trop cette géode.
– Est-ce quelque pierre à influence magique ?
– Toutes les pierres ont cette influence-là, mais surtout, selon moi, les géodes.
– Vous piquez ma curiosité... Voyons, qu’entendez-vous par géode ?
– Nous entendons par géode, en minéralogie, toute pierre creuse dont l’intérieur est tapissé de cristaux ou d’incrustations, et nous appelons pierre géodique tout minéral qui présente à l’intérieur ces vides ou petites cavernes que vous pouvez remarquer dans celle-ci.
Il me donna une loupe, et je reconnus que ces vides représentaient, en effet, des grottes mystérieuses toutes revêtues de stalactites d’un éclat extraordinaire ; puis, considérant l’ensemble de la géode et plusieurs autres que me présenta le marchand, j’y vis des particularités de forme et de couleur qui, agrandies par l’imagination, composaient des sites alpestres, de profonds ravins, des montagnes grandioses, des glaciers, tout ce qui constitue un tableau imposant et sublime de la nature.
– Tout le monde a remarqué cela, dis-je à M. Hartz ; moi-même, cent fois j’ai comparé dans ma pensée le caillou que je ramassais sous mes pieds à la montagne qui se dressait au-dessus de ma tête, et j’ai trouvé que l’échantillon était une sorte de résumé de la masse : mais, aujourd’hui, j’en suis plus frappé que les autres fois, et ces cristaux choisis que vous me montrez me donnent l’idée d’un monde fantastique où tout serait transparence et cristallisation. Ce ne serait point une confusion et un éblouissement vague comme je me l’imaginais en lisant ces contes de fées où l’on parcourt des palais de diamant. Je vois ici que la nature travaille mieux que les fées. Ces corps transparents sont groupés de manière à produire des ombres fines, des reflets suaves, et la fusion des nuances n’empêche pas la logique et l’harmonie de la composition. Vraiment, ceci me charme et me donne envie de regarder votre magasin.
– Non, dit M. Hartz en me retirant des mains les échantillons, il ne faut pas aller trop vite sur ce chemin-là : vous voyez un homme qui a failli être victime du cristal !
– Victime du cristal ? L’étrange rapprochement de mots !
– C’est parce que je n’étais encore ni savant ni artiste que j’ai couru le danger... Mais ce serait une trop longue histoire, et vous n’avez pas le temps de l’écouter.
– Si fait, m’écriai-je, j’adore les histoires dont je ne comprends pas le titre. J’ai tout le temps, contez !
– Je conterais fort mal, répondit le marchand, mais j’ai écrit cela dans ma jeunesse.
Et, cherchant au fond d’un tiroir un manuscrit jauni, il me lut ce qui suit :
J’avais dix-neuf ans quand j’entrai comme aide du sous-aide conservateur du cabinet d’histoire naturelle, section de minéralogie, dans la docte et célèbre ville de Fischausen, en Fischemberg. Ma fonction, toute gratuite, avait été créée pour moi par un de mes oncles, directeur de l’établissement, dans l’espoir judicieux que, n’ayant absolument rien à faire, je serais là dans mon élément et pourrais développer à merveille les remarquables aptitudes que je manifestais pour l’oisiveté la plus complète.
Ma première exploration de la longue galerie qui contenait la collection ne produisit en moi qu’un affreux serrement de cœur. Quoi ! j’allais vivre là, au milieu de ces choses inertes, en compagnie de ces innombrables cailloux de toute forme, de toute dimension, de toute couleur, tout aussi muets les uns que les autres, et tous étiquetés de noms barbares dont je me promettais bien de ne jamais retenir un seul !
Ma riante existence n’avait été qu’une école buissonnière dans le sens le plus littéral du mot, et mon oncle, ayant remarqué avec quelle sagacité, dès mon enfance, je découvrais les mûres sauvages et les verts pommiers nains des clôtures, avec quelle patience je savais fureter la haie pour y surprendre les nids des grives et des linottes, s’était flatté de voir s’éveiller tôt ou tard en moi les instincts d’un sérieux amant de la nature ; mais, comme ensuite j’avais été, au collège, le plus habile en gymnastique quand il s’agissait d’escalader un mur et de prendre la clef des champs, mon oncle voulait me châtier un peu en me renfermant dans l’austère contemplation des ossements du globe, me faisant, du reste, envisager comme dédommagement futur l’étude des plantes et des animaux.
Qu’il y avait loin de ce monde mort où j’étais relégué aux délices sans but et sans nom de mon vagabondage ! Je passai plusieurs semaines assis dans un coin, morne comme les colonnes de basalte prismatique dont s’enorgueillissait le péristyle du monument, triste comme le banc d’huîtres fossiles sur lequel je voyais mes patrons jeter des regards d’attendrissement paternel.
Chaque jour, j’entendais les leçons, c’est-à-dire une suite de paroles qui ne m’offraient aucun sens et qui me revenaient en rêve comme des formules cabalistiques, ou bien j’assistais au cours de géologie que faisait mon digne oncle. Le cher homme n’eût pas manqué d’éloquence, si l’ingrate nature n’eût affligé d’un bégaiement insurmontable le plus fervent de ses adorateurs. Ses bienveillants collègues assuraient que sa leçon n’en valait que mieux, et que son infirmité avait cela d’utile qu’elle exerçait une influence mnémotechnique sur l’auditoire, charmé d’entendre répéter plusieurs fois les principales syllabes des mots.
Quant à moi, je me soustrayais au bienfait de cette méthode en m’endormant régulièrement dès la première phrase de chaque séance. De temps en temps, une explosion aiguë de la voix chevrotante du vieillard me faisait bondir sur mon banc ; j’ouvrais les yeux à demi, et j’apercevais, à travers les nuages de ma léthargie, son crâne chauve où luisait un rayon égaré du soleil de mai, ou sa main crochue armée d’un fragment de rocher qu’il semblait vouloir me lancer à la tête. Je refermais bien vite les yeux et me rendormais sur ces consolantes paroles : « Ceci, messieurs, est un échantillon bien déterminé de la matière qui fait l’objet de cet enseignement. L’analyse chimique donne, etc. »
Quelquefois, un voisin enrhumé me surprenait encore en se mouchant avec un bruit de trompette. Je voyais alors mon oncle dessiner avec de la craie des profils d’accidents géologiques sur l’énorme planche noire placée derrière lui. Il tournait le dos au public, et le collet démesuré de son habit, coupé à la mode du Directoire, faisait remonter ses oreilles de la façon la plus étrange. Alors, tout se confondait dans mon cerveau, les angles de son dessin avec ceux de sa personne, et j’arrivais à ne voir en lui que redressements insensés et stratifications discordantes. J’avais d’étranges fantaisies qui tenaient de l’hallucination. Un jour qu’il nous faisait une leçon sur les volcans, je m’imaginai voir, dans la bouche béante de certains vieux adeptes rangés autour de lui, autant de petits cratères prêts à entrer en éruption, et le bruit des applaudissements me parut le signal de ces détonations souterraines qui lancent des pierres embrasées et vomissent des laves incandescentes.
Mon onde Tungsténius (c’est le nom de guerre qui avait remplacé son nom de famille)était passablement malicieux sous son apparente bonhomie. Il avait juré de venir à bout de ma résistance, en ayant l’air de ne pas s’en apercevoir. Un jour, il imagina de me faire subir une épreuve redoutable, qui fut de me remettre en présence de ma cousine Laura.
Laura était la fille de ma tante Gertrude, sœur de feu mon père, dont mon onde Tungsténius était le frère aîné. Laura était orpheline, bien que son père à elle fût vivant. C’était un négociant actif qui, à la suite de médiocres affaires, était parti pour l’Italie, d’où il avait passé en Turquie. Là, il avait trouvé, disait-on, moyen de s’enrichir : mais on n’était jamais sûr de rien avec lui, il écrivait fort peu, et reparaissait à de si rares intervalles, que nous le connaissions à peine. En revanche, nous nous étions beaucoup connus, sa fille et moi, car nous avions été élevés ensemble à la campagne : puis était venu l’âge de nous séparer pour nous mettre en pension, et nous nous étions oubliés, ou peu s’en faut.
J’avais laissé une enfant maigre et jaune ; je retrouvais une fille de seize ans, mince, rosée, avec des cheveux magnifiques, des yeux d’azur, un sourire où l’enjouement et la bonté avaient des grâces incomparables. Si elle était jolie, je n’en sais rien : elle était ravissante, et ma surprise fut un éblouissement qui me plongea dans le plus complet idiotisme.
– Or çà, cousin Alexis, me dit-elle, que fais-tu, et à quoi passes-tu ton temps ici ?
J’aurais bien voulu trouver une autre réponse que celle que je lui fis ; mais j’eus beau chercher et bégayer, il me fallut avouer que je passais mon temps à ne rien faire.
– Comment ! reprit-elle avec un étonnement profond, rien ? Est-il possible de vivre sans rien faire, à moins d’être malade ? Es-tu donc malade, mon pauvre Alexis ? Tu n’en as pourtant pas l’air.
Il fallut confesser encore que je me portais bien.
– Alors, dit-elle en portant à mon front le bout de son doigt mignon, orné d’une jolie bague de cornaline blanche, ton mal est là : tu t’ennuies à la ville.
– C’est la vérité, Laura, m’écriai-je avec feu : je regrette la campagne et le temps où nous étions si heureux ensemble.
J’étais fier d’avoir enfin trouvé une si belle réplique ; mais l’éclat de rire dont elle fut accueillie fit retomber sur mon cœur une montagne de confusion.
– Je crois que tu es fou, dit Laura. Tu peux regretter la campagne, mais non pas le bonheur que nous goûtions ensemble : car nous allions toujours chacun de son côté, toi pillant, cueillant, gâtant toutes choses, moi faisant de petits jardins où j’aimais à voir germer, verdir et fleurir. La campagne était un paradis pour moi, parce que je l’aime tout de bon : quant à toi, c’est ta liberté que tu pleures, et je te plains de ne pas savoir t’occuper pour te consoler. Cela prouve que tu ne comprends rien à la beauté de la nature, et que tu n’étais pas digne de la liberté.
Je ne sais si Laura répétait une phrase rédigée par notre oncle et apprise par cœur : mais elle la débita si bien, que j’en fus écrasé. Je m’enfuis, je me cachai dans un coin, et je fondis en larmes.
Les jours suivants, Laura ne me parla plus que pour me dire bonjour et bonsoir, et je l’entendis avec stupeur parler de moi en italien avec sa gouvernante. Comme elles me regardaient à chaque instant, il s’agissait bien évidemment de ma pauvre personne ; mais que disaient-elles ? Tantôt il me semblait que l’une me traitait avec mépris, et que l’autre me défendait d’un air de compassion. Cependant, comme elles changeaient souvent de rôle, il m’était impossible de savoir laquelle décidément me plaignait et cherchait à m’excuser.
Je demeurais chez mon oncle, c’est-à-dire dans une partie de l’établissement où il m’avait assigné pour gîte un petit pavillon, séparé de celui qu’il habitait, par le jardin botanique. Laura passait chez lui ses vacances, et je la voyais aux heures des repas. Je la trouvais toujours occupée, soit à lire, soit à broder, soit à peindre des fleurs ou à faire de la musique. Je voyais bien qu’elle ne s’ennuyait pas : mais je n’osais plus lui adresser la parole et lui demander le secret de prendre plaisir à n’importe quelle occupation.
Au bout d’une quinzaine, elle quitta Fischhausen pour Fischerburg, où elle devait demeurer avec sa gouvernante et une vieille cousine qui remplaçait sa mère. Je n’avais pas osé rompre la glace : mais le coup avait porté, et je me mis à étudier avec ardeur, sans discuter, sans examiner, sans choisir et sans raisonner, tout ce qui entrait dans le programme tracé par l’oncle Tungsténius.
Étais-je amoureux ? Je ne le savais pas, et encore aujourd’hui je n’en suis pas certain. Mon amour-propre avait été cruellement froissé pour la première fois. Insensible jusque-là au dédain muet de mon oncle et aux railleries de mes condisciples, j’avais rougi de la pitié de Laura. Tous les autres étaient pour moi des radoteurs, elle seule m’avait semblé user d’un droit en me blâmant.
Un an plus tard, j’étais complètement transformé. Était-ce à mon avantage ? On le disait autour de moi, et, ma vanité aidant, j’avais très bonne opinion de moi-même. Il n’était pas une parole du cours de mon oncle que je n’eusse pu enchâsser à sa place dans la phrase où elle s’était trouvée, pas un échantillon de la collection lithologique que je n’eusse pu désigner par son nom, avec celui de son groupe, de sa variété, et toute l’analyse de sa composition, toute l’histoire de sa formation et de son gisement. Je savais jusqu’au nom du donateur de chaque objet précieux et la date de l’entrée de cet objet dans la galerie.
Parmi ces derniers noms, il en était un qui se trouvait à diverses reprises sur nos catalogues, et particulièrement à propos des plus belles gemmes. C’était celui de Nasias, nom inconnu dans la science, et qui m’intriguait passablement par son étrangeté mystérieuse. Mes camarades n’en savaient guère plus que moi. Selon les uns, ce Nasias était un juif arménien qui avait fait jadis des échanges entre notre cabinet et d’autres collections du même genre. Selon d’autres, c’était le pseudonyme d’un donateur désintéressé. Mon oncle ne paraissait pas en savoir plus que nous sur son compte. La date de ses envois remontait à une centaine d’années.
Laura revint avec sa gouvernante passer les vacances. Je fus de nouveau présenté à elle avec force compliments sur mon compte de la part de mon oncle. Je me tenais droit comme une colonne, je regardais Laura d’un air confiant. Je m’attendais à la voir un peu confuse devant mon mérite. Hélas ! il n’en fut rien. L’espiègle se mit à rire, me prit la main, et, sans la quitter, me toisa du regard d’un air d’admiration railleuse ; après quoi, elle déclara à notre oncle qu’elle me trouvait fort enlaidi.
Je ne me déconcertai pourtant pas, et, pensant qu’elle doutait encore de ma capacité, je me mis à interroger mon oncle sur un point qu’il me paraissait avoir négligé dans sa dernière leçon, ingénieux prétexte pour faire étalage, devant les dames, de mots techniques et de théories apprises par cœur. Mon oncle se prêta avec une complaisante simplicité à ce manège qui dura longtemps et mit toutes mes lumières en évidence.