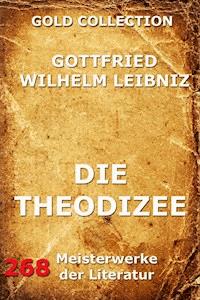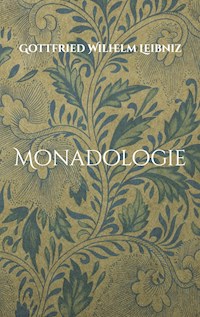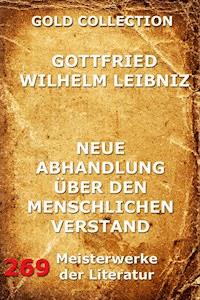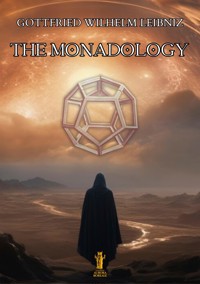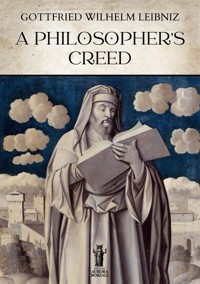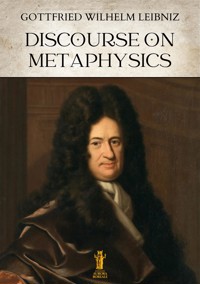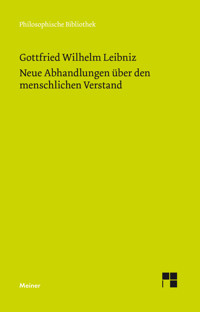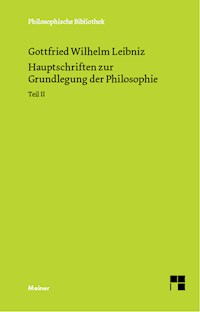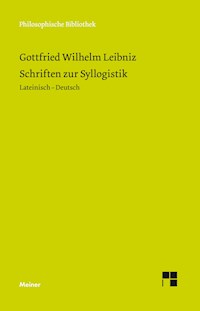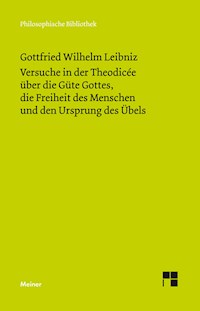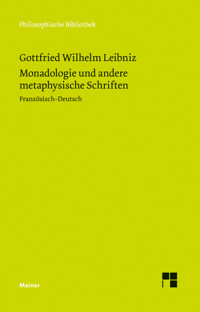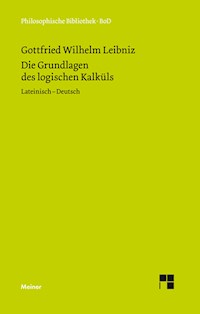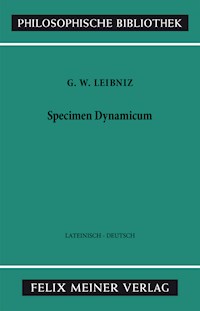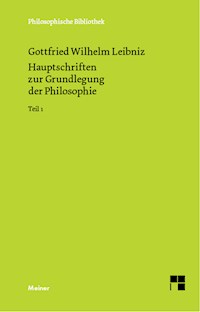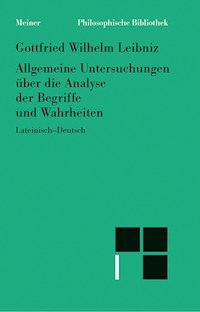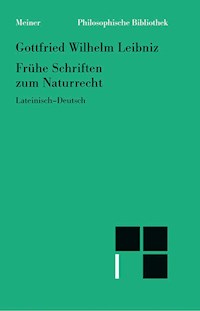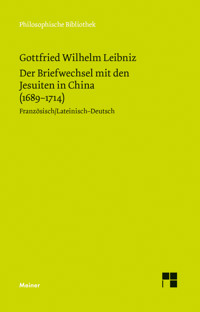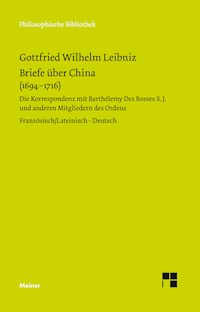Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce livre numérique comprend des oeuvres majeures de Leibniz. L'édition est méticuleusement éditée et formatée. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716) est un philosophe, scientifique, mathématicien, logicien, diplomate, juriste, bibliothécaire et philologue allemand qui a écrit en latin, allemand et français.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leibniz: Oeuvres Majeures
Table des matières
Discours de métaphysique
Leibniz
Discours de Métaphysique 1686
1. - De la perfection divine et que Dieu fait tout de la manière la plus souhaitable.
La notion de Dieu la plus reçue et la plus significative que nous ayons, est assez bien exprimée en ces termes que Dieu est un être absolument parfait, mais on n’en considère pas assez les suites ; et pour y entrer plus avant, il est à propos de remarquer qu’il y a dans la nature plusieurs perfections toutes différentes, que Dieu les possède toutes ensemble, et que chacune lui appartient au plus souverain degré. Il faut connaître aussi ce que c’est que perfection, dont voici une marque assez sûre, savoir que les formes ou natures qui ne sont pas susceptibles du dernier degré, ne sont pas des perfections, comme par exemple la nature du nombre ou de la figure. Car le nombre le plus grand de tous (ou bien le nombre de tous les nombres), aussi bien que la plus grande de toutes les figures, impliquent contradiction, mais la plus grande science et la toute-puissance n’enferment point d’impossibilité. Par conséquent la puissance et la science sont des perfections, et, en tant qu’elles appartiennent à Dieu, elles n’ont point de bornes. D’où il s’ensuit que Dieu possédant la sagesse suprême et infinie agit de la manière la plus parfaite, non seulement au sens métaphysique, mais encore moralement parlant, et qu’on peut exprimer ainsi à notre égard que plus on sera éclairé et informé des ouvrages de Dieu, plus on sera disposé à les trouver excellents et entièrement satisfaisant à tout ce qu’on aurait pu souhaiter.
2. - Contre ceux qui soutiennent qu’il n’y a point de bonté dans les ouvrages de Dieu, ou bien que les règles de la bonté et de la beauté sont arbitraires.
Ainsi je suis fort éloigné du sentiment de ceux qui soutiennent qu’il n’y a point de règles de bonté et de perfection dans la nature des choses, ou dans les idées que Dieu en a ; et que les ouvrages de Dieu ne sont bons que par cette raison formelle que Dieu les a faits. Car si cela était, Dieu, sachant qu’il en est l’auteur, n’avait que faire de les regarder par après et de les trouver bons, comme le témoigne la sainte écriture, qui ne paraît s’être servie de cette anthropologie que pour nous faire connaître que leur excellence se connaît à les regarder en eux-mêmes, lors même qu’on ne fait point de réflexion sur cette dénomination extérieure toute nue, qui les rapporte à leur cause. Ce qui est d’autant plus vrai, que c’est par la considération des ouvrages qu’on peut découvrir l’ouvrier. Il faut donc que ces ouvrages portent en eux son caractère. J’avoue que le sentiment contraire me paraît extrêmement dangereux et fort approchant de celui des derniers novateurs, dont l’opinion est, que la beauté de l’univers et la bonté que nous attribuons aux ouvrages de Dieu, ne sont que des chimères des hommes qui conçoivent Dieu à leur manière. Aussi, disant que les choses ne sont bonnes par aucune règle de bonté, mais par la seule volonté de Dieu, on détruit, ce me semble, sans y penser, tout l’amour de Dieu et toute sa gloire. Car pourquoi le louer de ce qu’il a fait, s’il serait également louable en faisant tout le contraire ? Où sera donc sa justice et sa sagesse, s’il ne reste qu’un certain pouvoir despotique, si la volonté tient lieu de raison, et si, selon la définition des tyrans, ce qui plaît au plus puissant est juste par là même ? Outre qu’il semble que toute volonté suppose quelque raison de vouloir et que cette raison est naturellement antérieure à la volonté. C’est pourquoi je trouve encore cette expression de quelques autres philosophes tout à fait étrange, qui disent que les vérités éternelles de la métaphysique et de la géométrie, et par conséquent aussi les règles de la bonté, de la justice et de la perfection, ne sont que les effets de la volonté de Dieu, au lieu qu’il me semble que ce ne sont que des suites de son entendement, qui, assurément, ne dépend point de sa volonté, non plus que son essence.
3. - Contre ceux qui croient que Dieu aurait pu mieux faire.
Je ne saurais non plus approuver l’opinion de quelques modernes qui soutiennent hardiment, que ce que Dieu fait n’est pas dans la dernière perfection, et qu’il aurait pu agir bien mieux. Car il me semble que les suites de ce sentiment sont tout à fait contraires à la gloire de Dieu : Uti minus malum habet rationem boni, ita minus bonum habet rationem mali. Et c’est agir imparfaitement, que d’agir avec moins de perfection qu’on n’aurait pu. C’est trouver à redire à un ouvrage d’un architecte que de montrer qu’il le pouvait faire meilleur. Cela va encore contre la sainte écriture, lorsqu’elle nous assure de la bonté des ouvrages de Dieu. Car comme les imperfections descendent à l’infini, de quelque façon que Dieu aurait fait son ouvrage, il aurait toujours été bon en comparaison des moins parfaits, si cela était assez ; mais une chose n’est guère louable, quand elle ne l’est que de cette manière. Je crois aussi qu’on trouvera une infinité de passages de la divine écriture et des Saints Pères, qui favoriseront mon sentiment, mais qu’on n’en trouvera guère pour celui de ces modernes, qui est à mon avis inconnu à toute l’antiquité, et ne se fonde que sur le trop peu de connaissance que nous avons de l’harmonie générale de l’univers et des raisons cachées de la conduite de Dieu, ce qui nous fait juger témérairement que bien des choses auraient pu être rendues meilleures. Outre que ces modernes insistent sur quelques subtilités peu solides, car ils s’imaginent que rien n’est si parfait qu’il n’y ait quelque chose de plus parfait, ce qui est une erreur. Ils croient aussi de pourvoir par là à la liberté de Dieu, comme si ce n’était pas la plus haute liberté d’agir en perfection suivant la souveraine raison. Car de croire que Dieu agit en quelque chose sans avoir aucune raison de sa volonté, outre qu’il semble que cela ne se peut point, c’est un sentiment peu conforme à sa gloire ; par exemple supposons que Dieu choisisse entre A et B, et qu’il prenne A sans avoir aucune raison de le préférer à B, je dis que cette action de Dieu, pour le moins ne serait point louable ; car toute louange doit être fondée en quelque raison qui ne se trouve point ici ex hypothesi. Au lieu que je tiens que Dieu ne fait rien dont il ne mérite d’être glorifié.
4. - Que l’amour de Dieu demande une entière satisfaction et acquiescence touchant ce qu’il fait sans qu’il faille être quiétiste pour cela.
La connaissance générale de cette grande vérité, que Dieu agit toujours de la manière la plus parfaite et la plus souhaitable qu’il soit possible, est, à mon avis, le fondement de l’amour que nous devons à Dieu sur toutes choses, puisque celui qui aime cherche sa satisfaction dans la félicité ou perfection de l’objet aimé et de ses actions. Idem velle et idem nolle vera amicitia est. Et je crois qu’il est difficile de bien aimer Dieu, quand on n’est pas dans la disposition de vouloir ce qu’il veut quand on aurait le pouvoir de le changer. En effet ceux qui ne sont pas satisfaits de ce qu’il fait me paraissent semblables à des sujets mécontents dont l’intention n’est pas fort différente de celle des rebelles. Je tiens donc que suivant ces principes, pour agir conformément à l’amour de Dieu, il ne suffit pas d’avoir patience par force, mais il faut être véritablement satisfait de tout ce qui nous est arrivé suivant sa volonté. J’entends cet acquiescement quant au passé. Car quant à l’avenir, il ne faut pas être quiétiste ni attendre ridiculement à bras croisés ce que Dieu fera, selon ce sophisme que les anciens appelaient logon aergon, la raison paresseuse, mais il faut agir selon la volonté présomptive de Dieu, autant que nous en pouvons juger, tâchant de tout notre pouvoir de contribuer au bien général et particulièrement à l’ornement et à la perfection de ce qui nous touche, ou de ce qui nous est prochain et pour ainsi dire à portée. Car quand l’événement aura peut-être fait voir que Dieu n’a pas voulu présentement que notre bonne volonté ait son effet, il ne s’ensuit pas de là qu’il n’ait pas voulu que nous fissions ce que nous avons fait. Au contraire, comme il est le meilleur de tous les maîtres, il ne demande jamais que la droite intention, et c’est à lui de connaître l’heure et le lieu propre à faire réussir les bons desseins.
5. - En quoi consistent les règles de perfection de la divine conduite, et que la simplicité des voies est en balance avec la richesse des effets.
Il suffit donc d’avoir cette confiance en Dieu, qu’il fait tout pour le mieux, et que rien ne saurait nuire à ceux qui l’aiment ; mais de connaître en particulier les raisons qui l’ont pu mouvoir à choisir cet ordre de l’univers, à souffrir les péchés, à dispenser ses grâces salutaires d’une certaine manière, cela passe les forces d’un esprit fini, surtout quand il n’est pas encore parvenu à la jouissance de la vue de Dieu. Cependant on peut faire quelques remarques générales touchant la conduite de la Providence dans le gouvernement des choses. On peut donc dire que celui qui agit parfaitement est semblable à un excellent géomètre qui sait trouver les meilleures constructions d’un problème ; à un bon architecte qui ménage sa place et le fonds destiné pour le bâtiment de la manière la plus avantageuse, ne laissant rien de choquant, ou qui soit destitué de la beauté dont il est susceptible ; à un bon père de famille, qui emploie son bien en sorte qu’il n’y ait rien d’inculte ni de stérile ; à un habile machiniste qui fait son effet par la voie la moins embarrassée qu’on puisse choisir ; à un savant auteur, qui enferme le plus de réalités dans le moins de volume qu’il peut. Or les plus parfaits de tous les êtres, et qui occupent le moins de volume, c’est-à-dire qui s’empêchent le moins, ce sont les esprits, dont les perfections sont les vertus. C’est pourquoi il ne faut point douter que la félicité des esprits ne soit le principal but de Dieu, et qu’il ne la mette en exécution autant que l’harmonie générale le permet. De quoi nous dirons davantage tantôt. Pour ce qui est de la simplicité des voies de Dieu, elle a lieu proprement à l’égard des moyens, comme au contraire la variété, richesse ou abondance y a lieu à l’égard des fins ou effets. Et l’un doit être en balance avec l’autre, comme les frais destinés pour un bâtiment avec la grandeur et la beauté qu’on y demande. Il est vrai que rien ne coûte à Dieu, bien moins qu’à un philosophe qui fait des hypothèses pour la fabrique de son monde imaginaire, puisque Dieu n’a que des décrets à faire pour faire naître un monde réel ; mais, en matière de sagesse, les décrets ou hypothèses tiennent lieu de dépense à mesure qu’elles sont plus indépendantes les unes des autres : car la raison veut qu’on évite la multiplicité dans les hypothèses ou principes, à peu près comme le système le plus simple est toujours préféré en astronomie.
6. - Dieu ne fait rien hors de l’ordre et il n’est pas même possible de feindre des événements qui ne soient point réguliers.
Les volontés ou actions de Dieu sont communément divisées en ordinaires ou extraordinaires. Mais il est bon de considérer que Dieu ne fait rien hors d’ordre. Ainsi ce qui passe pour extraordinaire ne l’est qu’à l’égard de quelque ordre particulier établi parmi les créatures. Car, quant à l’ordre universel, tout y est conforme. Ce qui est si vrai que, non seulement rien n’arrive dans le monde qui soit absolument irrégulier, mais on ne saurait même rien feindre de tel. Car supposons, par exemple, que quelqu’un fasse quantité de points sur le papier à tout hasard, comme font ceux qui exercent l’art ridicule de la géomance. Je dis qu’il est possible de trouver une ligne géométrique dont la notion soit constante et uniforme suivant une certaine règle, en sorte que cette ligne passe par tous ces points, et dans le même ordre que la main les avait marqués. Et si quelqu’un traçait tout d’une suite une ligne qui serait tantôt droite, tantôt cercle, tantôt d’une autre nature, il est possible de trouver une notion, ou règle, ou équation commune à tous les points de cette ligne, en vertu de laquelle ces mêmes changements doivent arriver. Et il n’y a, par exemple, point de visage dont le contour ne fasse partie d’une ligne géométrique et ne puisse être tracé tout d’un trait par un certain mouvement réglé. Mais quand une règle est fort composée, ce qui lui est conforme passe pour irrégulier. Ainsi on peut dire que, de quelque manière que Dieu aurait créé le monde, il aurait toujours été régulier et dans un certain ordre général. Mais Dieu a choisi celui qui est le plus parfait, c’est-à-dire celui qui est en même temps le plus simple en hypothèses et le plus riche en phénomènes, comme pourrait être une ligne de géométrie dont la construction serait aisée et les propriétés et effets seraient fort admirables et d’une grande étendue. Je me sers de ces comparaisons pour crayonner quelque ressemblance imparfaite de la sagesse divine, et pour dire ce qui puisse au moins élever notre esprit à concevoir en quelque façon ce qu’on ne saurait exprimer assez. Mais je ne prétends point d’expliquer par là ce grand mystère dont dépend tout l’univers.
7. - Que les miracles sont conformes à l’ordre général, quoi qu’ils soient contre les maximes subalternes, et de ce que Dieu veut ou qu’il permet, par une volonté générale ou particulière.
Or, puisque rien ne se peut faire qui ne soit dans l’ordre, on peut dire que les miracles sont aussi bien dans l’ordre que les opérations naturelles qu’on appelle ainsi parce qu’elles sont conformes à certaines maximes subalternes que nous appelons la nature des choses. Car on peut dire que cette nature n’est qu’une coutume de Dieu, dont il se peut dispenser à cause d’une raison plus forte que celle qui l’a mû à se servir de ces maximes. Quant aux volontés générales ou particulières, selon qu’on prend la chose, on peut dire que Dieu fait tout suivant sa volonté la plus générale, qui est conforme au plus parfait ordre qu’il a choisi ; mais on peut dire aussi qu’il a des volontés particulières qui sont des exceptions de ces maximes subalternes susdites, car la plus générale des lois de Dieu qui règle toute la suite de l’univers est sans exception. On peut dire aussi que Dieu veut tout ce qui est un objet de sa volonté particulière ; mais quant aux objets de sa volonté générale, tels que sont les actions des autres créatures, particulièrement de celles qui sont raisonnables, auxquelles Dieu veut concourir, il faut distinguer : car si l’action est bonne en elle-même, on peut dire que Dieu la veut et la commande quelquefois, lors même qu’elle n’arrive point, mais, si elle est mauvaise en elle-même et ne devient bonne que par accident, parce que la suite des choses, et particulièrement le châtiment et la satisfaction, corrige sa malignité et en récompense le mal avec usure, en sorte qu’enfin il se trouve plus de perfection dans toute la suite que si tout le mal n’était pas arrivé, il faut dire que Dieu le permet, et non pas qu’il le veut, quoiqu’il y concoure à cause des lois de nature qu’il a établies, et parce qu’il en sait tirer un plus grand bien.
8. - Pour distinguer les actions de Dieu et des créatures, on explique en quoi consiste la notion d’une substance individuelle.
Il est assez difficile de distinguer les actions de Dieu de celles des créatures ; car il y en a qui croient que Dieu fait tout, d’autres s’imaginent qu’il ne fait que conserver la force qu’il a donnée aux créatures : la suite fera voir combien l’un ou l’autre se peut dire. Or puisque les actions et passions appartiennent proprement aux substances individuelles (actiones sunt suppositorum), il serait nécessaire d’expliquer ce que c’est qu’une telle substance. Il est bien vrai que, lorsque plusieurs prédicats s’attribuent à un même sujet, et que ce sujet ne s’attribue à aucun autre, on l’appelle substance individuelle ; mais cela n’est pas assez et une telle explication n’est que nominale. Il faut donc considérer ce que c’est que d’être attribué véritablement à un certain sujet. Or il est constant que toute prédication véritable a quelque fondement dans la nature des choses, et lorsqu’une proposition n’est pas identique, c’est-à-dire lorsque le prédicat n’est pas compris expressément dans le sujet, il faut qu’il y soit compris virtuellement, et c’est ce que les philosophes appellent in-esse, en disant que le prédicat est dans le sujet. Ainsi il faut que le terme du sujet enferme toujours celui du prédicat, en sorte que celui qui entendrait parfaitement la notion du sujet, jugerait aussi que le prédicat lui appartient. Cela étant, nous pouvons dire que la nature d’une substance individuelle ou d’un être complet est d’avoir une notion si accomplie qu’elle soit suffisante à comprendre et à en faire déduire tous les prédicats du sujet à qui cette notion est attribuée. Au lieu que l’accident est un être dont la notion n’enferme point tout ce qu’on peut attribuer au sujet à qui on attribue cette notion. Ainsi la qualité de roi qui appartient à Alexandre le Grand, faisant abstraction du sujet, n’est pas assez déterminée à un individu, et n’enferme point les autres qualités du même sujet, ni tout ce que la notion de ce prince comprend, au lieu que Dieu voyant la notion individuelle ou hecceïté d’Alexandre, y voit en même temps le fondement et la raison de tous les prédicats qui se peuvent dire de lui véritablement, comme par exemple qu’il vaincrait Darius et Porus, jusqu’à y connaître a priori (et non par expérience) s’il est mort d’une mort naturelle ou par poison, ce que nous ne pouvons savoir que par l’histoire. Aussi, quand on considère bien la connexion des choses, on peut dire qu’il y a de tout temps dans l’âme d’Alexandre des restes de tout ce qui lui est arrivé, et les marques de tout ce qui lui arrivera, et même des traces de tout ce qui se passe dans l’univers, quoiqu’il n’appartienne qu’à Dieu de les reconnaître toutes.
9. - Que chaque substance singulière exprime tout l’univers à sa manière, et que dans sa notion tous ses événements sont compris avec toutes leurs circonstances et toute la suite des choses extérieures.
Il s’ensuit de cela plusieurs paradoxes considérables ; comme entre autres qu’il n’est pas vrai que deux substances se ressemblent entièrement et soient différentes solo numero, et que ce que saint Thomas assure sur ce point des anges ou intelligences (quod ibi omne individuum sit species infima) est vrai de toutes les substances, pourvu qu’on prenne la différence spécifique comme la prennent les géomètres à l’égard de leurs figures ; item qu’une substance ne saurait commencer que par création, ni périr que par annihilation ; qu’on ne divise pas une substance en deux, ni qu’on ne fait pas de deux une, et qu’ainsi le nombre des substances naturellement n’augmente et ne diminue pas, quoiqu’elles soient souvent transformées. De plus, toute substance est comme un monde entier et comme un miroir de Dieu ou bien de tout l’univers, qu’elle exprime chacune à sa façon, à peu près comme une même ville est diversement représentée selon les différentes situations de celui qui la regarde. Ainsi l’univers est en quelque façon multiplié autant de fois qu’il y a de substances, et la gloire de Dieu est redoublée de même par autant de représentations toutes différentes de son ouvrage. On peut même dire que toute substance porte en quelque façon le caractère de la sagesse infinie et de la toute-puissance de Dieu, et l’imite autant qu’elle en est susceptible. Car elle exprime, quoique confusément, tout ce qui arrive dans l’univers, passé, présent ou avenir, ce qui a quelque ressemblance à une perception ou connaissance infinie ; et comme toutes les autres substances expriment celle-ci à leur tour, et s’y accommodent, on peut dire qu’elle étend sa puissance sur toutes les autres à l’imitation de la toute-puissance du Créateur.
10. - Que l’opinion des formes substantielles a quelque chose de solide, mais que ces formes ne changent rien dans les phénomènes et ne doivent point être employées pour expliquer les effets particuliers.
Il semble que les anciens aussi bien que tant d’habiles gens accoutumés aux méditations profondes, qui ont enseigné la théologie et la philosophie il y a quelques siècles, et dont quelques-uns sont recommandables pour leur sainteté, ont eu quelque connaissance de ce que nous venons de dire, et c’est ce qui les a fait introduire et maintenir les formes substantielles qui sont aujourd’hui si décriées. Mais ils ne sont pas si éloignés de la vérité, ni si ridicules que le vulgaire de nos nouveaux philosophes se l’imagine. Je demeure d’accord que la considération de ces formes ne sert de rien dans le détail de la physique, et ne doit point être employée à l’explication des phénomènes en particulier. Et c’est en quoi nos scolastiques ont manqué, et les médecins du temps passé à leur exemple, croyant de rendre raison des propriétés des corps en faisant mention des formes et des qualités, sans se mettre en peine d’examiner la manière de l’opération ; comme si on se voulait contenter de dire qu’une horloge a la qualité horodictique provenant de sa forme, sans considérer en quoi tout cela consiste. Ce qui peut suffire, en effet, à celui qui l’achète, pourvu qu’il en abandonne le soin à un autre. Mais ce manquement et mauvais usage des formes ne doit pas nous faire rejeter une chose dont la connaissance est si nécessaire en métaphysique que sans cela je tiens qu’on ne saurait bien connaître les premiers principes ni élever assez l’esprit à la connaissance des natures incorporelles et des merveilles de Dieu. Cependant, comme un géomètre n’a pas besoin de s’embarrasser l’esprit du fameux labyrinthe de la composition du continu, et qu’aucun philosophe moral et encore moins un jurisconsulte ou politique n’a point besoin de se mettre en peine des grandes difficultés qui se trouvent dans la conciliation du libre arbitre et de la Providence de Dieu, puisque le géomètre peut achever toutes ses démonstrations, et le politique peut terminer toutes ses délibérations sans entrer dans ces discussions, qui ne laissent pas d’être nécessaires et importantes dans la philosophie et dans la théologie : de même un physicien peut rendre raison des expériences, se servant tantôt des expériences plus simples déjà faites, tantôt des démonstrations géométriques et mécaniques, sans avoir besoin des considérations générales qui sont d’une autre sphère ; et s’il y emploie le concours de Dieu ou bien quelque âme, archée, ou autre chose de cette nature, il extravague aussi bien que celui qui, dans une délibération importante de pratique, voudrait entrer dans les grands raisonnements sur la nature du destin et de notre liberté ; comme en effet les hommes font assez souvent cette faute sans y penser, lorsqu’ils s’embarrassent l’esprit par la considération de la fatalité, et même parfois sont détournés par là de quelque bonne résolution ou de quelque soin nécessaire.
11. - Que les méditations des théologiens et des philosophes qu’on appelle scolastiques ne sont pas à mépriser entièrement.
Je sais que j’avance un grand paradoxe en prétendant de réhabiliter en quelque façon l’ancienne philosophie et de rappeler postliminio les formes substantielles presque bannies ; mais peut-être qu’on ne me condamnera pas légèrement, quand on saura que j’ai assez médité sur la philosophie moderne, que j’ai donné bien du temps aux expériences de physique et aux démonstrations de géométrie, et que j’ai été longtemps persuadé de la vanité de ces êtres, que j’ai été enfin obligé de reprendre malgré moi et comme par force, après avoir fait moi-même des recherches qui m’ont fait reconnaître que nos modernes ne rendent pas assez de justice à saint Thomas et à d’autres grands hommes de ce temps-là, et qu’il y a dans les sentiments des philosophes et théologiens scolastiques bien plus de solidité qu’on ne s’imagine, pourvu qu’on s’en serve à propos et en leur lieu. Je suis même persuadé que, si quelque esprit exact et méditatif prenait la peine d’éclaircir et de digérer leur pensée à la façon des géomètres analytiques, il y trouverait un trésor de quantité de vérités très importantes et tout à fait démonstratives.
12. - Que les notions qui consistent dans l’étendue enferment quelque chose d’imaginaire et ne sauraient constituer la substance des corps.
Mais, pour reprendre le fil de nos considérations, je crois que celui qui méditera sur la nature de la substance, que j’ai expliquée ci-dessus, trouvera que toute la nature du corps ne consiste pas seulement dans l’étendue, c’est-à-dire dans la grandeur, figure et mouvement, mais qu’il faut nécessairement y reconnaître quelque chose qui ait du rapport aux âmes, et qu’on appelle communément forme substantielle, bien qu’elle ne change rien dans les phénomènes, non plus que l’âme des bêtes, si elles en ont. On peut même démontrer que la notion de la grandeur, de la figure et du mouvement n’est pas si distincte qu’on s’imagine et qu’elle enferme quelque chose d’imaginaire et de relatif à nos perceptions, comme le sont encore (quoique bien davantage) la couleur, la chaleur, et autres qualités semblables dont on peut douter si elles se trouvent véritablement dans la nature des choses hors de nous. C’est pourquoi ces sortes de qualités ne sauraient constituer aucune substance. Et s’il n’y a point d’autre principe d’identité dans les corps que ce que nous venons de dire, jamais un corps ne subsistera plus d’un moment. Cependant les âmes et les formes substantielles des autres corps sont bien différentes des âmes intelligentes, qui seules connaissent leurs actions, et qui non seulement ne périssent point naturellement, mais même gardent toujours le fondement de la connaissance de ce qu’elles sont ; ce qui les rend seules susceptibles de châtiment et de récompense, et les fait citoyens de la république de l’univers, dont Dieu est le monarque ; aussi s’ensuit-il que tout le reste des créatures leur doit servir, de quoi nous parlerons tantôt plus amplement.
13. - Comme la notion individuelle de chaque personne renferme une fois pour toutes ce qui lui arrivera jamais, on y voit les preuves a priori de la vérité de chaque événement, ou pourquoi l’un est arrivé plutôt que l’autre, mais ces vérités, quoique assurées, ne laissent pas d’être contingentes, étant fondées sur le libre arbitre de Dieu ou des créatures, dont le choix a toujours ses raisons qui inclinent sans nécessiter.
Mais avant que de passer plus loin, il faut tâcher de satisfaire à une grande difficulté qui peut naître des fondements que nous avons jetés ci-dessus. Nous avons dit que la notion d’une substance individuelle enferme une fois pour toutes tout ce qui lui peut jamais arriver, et qu’en considérant cette notion on y peut voir tout ce qui se pourra véritablement énoncer d’elle, comme nous pouvons voir dans la nature du cercle toutes les propriétés qu’on en peut déduire. Mais il semble que par là la différence des vérités contingentes et nécessaires sera détruite, que la liberté humaine n’aura plus aucun lieu, et qu’une fatalité absolue régnera sur toutes nos actions aussi bien que sur tout le reste des événements du monde. A quoi je réponds qu’il faut faire distinction entre ce qui est certain et ce qui est nécessaire : tout le monde demeure d’accord que les futurs contingents sont assurés, puisque Dieu les prévoit, mais on n’avoue pas, pour cela, qu’ils soient nécessaires. Mais (dira-t-on) si quelque conclusion se peut déduire infailliblement d’une définition ou notion, elle sera nécessaire. Or est-il que nous soutenons que tout ce qui doit arriver à quelque personne est déjà compris virtuellement dans sa nature ou notion, comme les propriétés le sont dans la définition du cercle, ainsi la difficulté subsiste encore. Pour y satisfaire solidement, je dis que la connexion ou consécution est de deux sortes : l’une est absolument nécessaire dont le contraire implique contradiction, et cette déduction a lieu dans les vérités éternelles, comme sont celles de géométrie ; l’autre n’est nécessaire qu’ex hypothesi et pour ainsi dire par accident, mais elle est contingente en elle-même, lorsque le contraire n’implique point. Et cette connexion est fondée, non pas sur les idées toutes pures et sur le simple entendement de Dieu, mais encore sur ses décrets libres, et sur la suite de l’univers. Venons à un exemple : puisque Jules César deviendra dictateur perpétuel et maître de la république, et renversera la liberté des Romains, cette action est comprise dans sa notion, car nous supposons que c’est la nature d’une telle notion parfaite d’un sujet de tout comprendre, afin que le prédicat y soit enfermé, ut possit inesse subjecto. On pourrait dire que ce n’est pas en vertu de cette notion ou idée qu’il doit commettre cette action, puisqu’elle ne lui convient que parce que Dieu sait tout. Mais on insistera que sa nature ou forme répond à cette notion, et puisque Dieu lui a imposé ce personnage il lui est désormais nécessaire d’y satisfaire. J’y pourrais répondre par l’instance des futurs contingents, car ils n’ont rien encore de réel que dans l’entendement et volonté de Dieu, et puisque Dieu leur y a donné cette forme par avance, il faudra tout de même qu’ils y répondent. Mais j’aime mieux satisfaire aux difficultés que de les excuser par l’exemple de quelques autres difficultés semblables, et ce que je vais dire servira à éclaircir aussi bien l’une que l’autre. C’est donc maintenant qu’il faut appliquer la distinction des connexions, et je dis que ce qui arrive conformément à ces avances est assuré, mais qu’il n’est pas nécessaire, et si quelqu’un faisait le contraire, il ne ferait rien d’impossible en soi-même, quoi qu’il soit impossible (ex hypothesi) que cela arrive. Car si quelque homme était capable d’achever toute la démonstration, en vertu de laquelle il pourrait prouver cette connexion du sujet qui est César et du prédicat qui est son entreprise heureuse ; il ferait voir, en effet, que la dictature future de César a son fondement dans sa notion ou nature, qu’on y voit une raison pourquoi il a plutôt résolu de passer le Rubicon que de s’y arrêter, et pourquoi il a plutôt gagné que perdu la journée de Pharsale, et qu’il était raisonnable et par conséquent assuré que cela arrivât, mais non pas qu’il est nécessaire en soi-même, ni que le contraire implique contradiction. A peu près comme il est raisonnable et assuré que Dieu fera toujours le meilleur, quoique ce qui est moins parfait n’implique point. Car on trouverait que cette démonstration de ce prédicat de César n’est pas aussi absolue que celles des nombres, ou de la géométrie, mais qu’elle suppose la suite des choses que Dieu a choisie librement, et qui est fondée sur le premier décret libre de Dieu, qui porte de faire toujours ce qui est le plus parfait, et sur le décret que Dieu a fait (en suite du premier) à l’égard de la nature humaine, qui est que l’homme fera toujours (quoique librement) ce qui paraîtra le meilleur. Or toute vérité qui est fondée sur ces sortes de décrets est contingente, quoiqu’elle soit certaine ; car ces décrets ne changent point la possibilité des choses, et comme j’ai déjà dit, quoique Dieu choisisse toujours le meilleur assurément, cela n’empêche pas que ce qui est moins parfait ne soit et demeure possible en lui-même, bien qu’il n’arrivera point, car ce n’est pas son impossibilité, mais son imperfection, qui le fait rejeter. Or rien n’est nécessaire dont l’opposé est possible. On sera donc en état de satisfaire à ces sortes de difficultés, quelque grandes qu’elles paraissent (et en effet elles ne sont pas moins pressantes à l’égard de tous les autres qui ont jamais traité cette matière), pourvu qu’on considère bien que toutes les propositions contingentes ont des raisons pour être plutôt ainsi qu’autrement, ou bien (ce qui est la même chose) qu’elles ont des preuves a priori de leur vérité qui les rendent certaines, et qui montrent que la connexion du sujet et du prédicat de ces propositions a son fondement dans la nature de l’un et de l’autre ; mais qu’elles n’ont pas des démonstrations de nécessité, puisque ces raisons ne sont fondées que sur le principe de la contingence ou de l’existence des choses, c’est-à-dire sur ce qui est ou qui paraît le meilleur parmi plusieurs choses également possibles ; au lieu que les vérités nécessaires sont fondées sur le principe de contradiction et sur la possibilité ou impossibilité des essences mêmes, sans avoir égard en cela à la volonté libre de Dieu ou des créatures.
14. - Dieu produit diverses substances, selon les différentes vues qu’il a de l’univers, et par l’intervention de Dieu la nature propre de chaque substance porte que ce qui arrive à l’une répond à ce qui arrive à toutes les autres, sans qu’elles agissent immédiatement l’une sur l’autre.
Après avoir connu, en quelque façon, en quoi consiste la nature des substances, il faut tâcher d’expliquer la dépendance que les unes ont des autres, et leurs actions et passions. Or il est premièrement très manifeste que les substances créées dépendent de Dieu qui les conserve et même qui les produit continuellement par une manière d’émanation, comme nous produisons nos pensées. Car Dieu tournant pour ainsi dire de tous côtés et de toutes les façons le système général des phénomènes qu’il trouve bon de produire pour manifester sa gloire, et regardant toutes les faces du monde de toutes les manières possibles, puisqu’il n’y a point de rapport qui échappe à son omniscience, le résultat de chaque vue de l’univers, comme regardé d’un certain endroit, est une substance qui exprime l’univers conformément à cette vue, si Dieu trouve bon de rendre sa pensée effective et de produire cette substance. Et comme la vue de Dieu est toujours véritable, nos perceptions le sont aussi, mais ce sont nos jugements qui sont de nous et qui nous trompent. Or nous avons dit ci-dessus et il s’ensuit de ce que nous venons de dire, que chaque substance est comme un monde à part, indépendant de toute autre chose, hors de Dieu ; ainsi tous nos phénomènes, c’est-à-dire tout ce qui nous peut jamais arriver, ne sont que des suites de notre être ; et comme ces phénomènes gardent un certain ordre conforme à notre nature, ou pour ainsi dire au monde qui est en nous, qui fait que nous pouvons faire des observations utiles pour régler notre conduite qui sont justifiées par le succès des phénomènes futurs, et qu’ainsi nous pouvons souvent juger de l’avenir par le passé sans nous tromper, cela suffirait pour dire que ces phénomènes sont véritables sans nous mettre en peine s’ils sont hors de nous et si d’autres s’en aperçoivent aussi : cependant, il est très vrai que les perceptions ou expressions de toutes les substances s’entre-répondent, en sorte que chacun suivant avec soin certaines raisons ou lois qu’il a observées, se rencontre avec l’autre qui en fait autant, comme lorsque plusieurs s’étant accordés de se trouver ensemble en quelque endroit à un certain jour préfixe, le peuvent faire effectivement s’ils veulent. Or, quoique tous expriment les mêmes phénomènes, ce n’est pas pour cela que leurs expressions soient parfaitement semblables, mais il suffit qu’elles soient proportionnelles ; comme plusieurs spectateurs croient voir la même chose, et s’entre-entendent en effet, quoique chacun voie et parle selon la mesure de sa vue. Or, il n’y a que Dieu (de qui tous les individus émanent continuellement, et qui voit l’univers non seulement comme ils le voient, mais encore tout autrement qu’eux tous), qui soit cause de cette correspondance de leurs phénomènes, et qui fasse que ce qui est particulier à l’un, soit public à tous ; autrement il n’y aurait point de liaison. On pourrait donc dire en quelque façon, et dans un bon sens, quoique éloigné de l’usage, qu’une substance particulière n’agit jamais sur une autre substance particulière et n’en pâtit non plus, si on considère que ce qui arrive à chacune n’est qu’une suite de son idée ou notion complète toute seule, puisque cette idée enferme déjà tous les prédicats ou événements, et exprime tout l’univers. En effet, rien ne nous peut arriver que des pensées et des perceptions, et toutes nos pensées et nos perceptions futures ne sont que des suites, quoique contingentes, de nos pensées et perceptions précédentes, tellement que si j’étais capable de considérer distinctement tout ce qui m’arrive ou paraît à cette heure, j’y pourrais voir tout ce qui m’arrivera ou me paraîtra à tout jamais ; ce qui ne manquerait pas, et m’arriverait tout de même, quand tout ce qui est hors de moi serait détruit, pourvu qu’il ne restât que Dieu et moi. Mais comme nous attribuons à d’autres choses comme à des causes agissant sur nous ce que nous apercevons d’une certaine manière, il faut considérer le fondement de ce jugement, et ce qu’il y a de véritable.
15. - L’action d’une substance finie sur l’autre ne consiste que dans l’accroissement du degré de son expression joint à la diminution de celle de l’autre, autant que Dieu les oblige de s’accommoder ensemble.