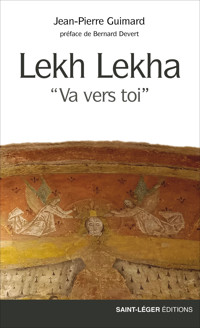
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Saint-Léger Editions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Ce récit est une méditation sur la vie et sur la mort. Il analyse l'évolution de l'univers depuis le chaos initial vers toujours plus de complexité et de conscience. Malgré toutes les horreurs encore présentes dans la vie de l'humanité, cette évolution doit nous mener à une vie plus fraternelle et plus apaisée où le pardon fera signe.
Une dernière mutation en ce sens est nécessaire: elle doit concerner le cœur des humains à travers l'effet réversif de la sélection naturelle vers plus de solidarité et de civilisation, avec l'aide d'un Dieu en kénose mais toujours attentif aux efforts de l'humanité.
Ces efforts doivent concerner à la fois les sphères politique, associative et individuelle. L'Église traverse actuellement une grave crise d'identité. Elle peut néanmoins participer à ce combat de l'humanité si elle sait opérer les grandes réformes indispensables en son sein, en privilégiant la charité du Christ.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Pierre Guimard est né en 1943. Marié depuis 1964, il a deux enfants et quatre petits-enfants.
Ingénieur Arts et Métiers, il a passé l'essentiel de sa carrière à la Direction de l'Equipement d'EDF chargée de la mise en œuvre de centrales de production d'électricité. A la retraite depuis l'an 2000, il a pris plusieurs engagements de bénévolat, tant au Secours Catholique qu'à Habitat et Humanisme, principalement dans la ville d'Aix-les-Bains.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Pierre Guimard
Lekh Lekha
“Va vers toi”
Préface de Bernard Devert
Citations
« Ce n’est qu’en reconnaissant ton humanité que j’accède à la mienne. »
Emmanuel Lévinas
« Considérer les progrès de la société à l’aune de la qualité de vie du plus démuni ou du plus exclu, est la dignité d’une nation fondée sur les droits de l’homme. »
Joseph Wresinski au Conseil Économique, Social et Environnemental
Préface
Jean-Pierre Guimard dans son ouvrage Va vers toi, ne nous donne pas seulement un texte à lire, il nous invite à regarder la vie telle qu’elle est, avec ses horreurs mais aussi sa grandeur.
En fermant le manuscrit il m’est venu spontanément les mots de Paul Éluard : Va vers ton risque, à te regarder ils s’habitueront.
L’auteur a gardé l’idéal de sa jeunesse ; les années, si elles se sont écoulées, n’ont pas altéré sa capacité à s’émouvoir, en d’autres termes, regarder avec cœur et tenter de promouvoir la chance et le risque de l’espérance.
Jean-Pierre Guimard n’a pas cherché à faire une œuvre littéraire mais à nous partager l’œuvre d’une réflexion libérée de toute vérité assénée, dogmatique, pour s’être laissé interroger par le doute sans lui donner la possibilité d’être un butoir, une clôture.
L’ouverture de cœur est le sésame de ce livre qui ne déserte pas les situations qui conduisent inévitablement à ce pourquoi. N’est-il pas celui du Fils de l’homme qui nous fait entendre sa tristesse, plus encore sa détresse de par la violence qui l’assaille jusqu’à le clouer sur une croix.
Pendu sur une poutre, il est aussi perdu. Son cri déchirant, Père, pourquoi m’as-tu abandonné, crée un suspense : n’y aurait-il plus rien ? Or, c’est ici que tout se joue, et c’est aussi là que chacun est appelé, à un moment ou à un autre, à risquer une confiance si désarmante qu’elle nous désarme aux fins de pouvoir esquisser à notre tour un possible balbutiement de notre abandon : « Père, je remets tout entre tes mains. »
La confiance est au croisement de nos chemins. Nous pouvons nous enfermer dans une révolte contre Dieu et contre nous-mêmes, ou bien consentir à aller là où nous n’avions pas prévu pour s’éveiller à des inattendus qui revêtent une telle fragilité qu’ils nous changent.
Dans l’émiettement de nos certitudes, surgissent de possibles convictions mais, pour les habiter, que de temps !
Il convient d’accepter de se bâtir autrement pour se trouver placés sur un chantier sans avoir toujours les plans pour se reconstruire jusqu’au moment où nous comprenons que nous ne sommes pas seuls. Une présence discrète nous conduit, non pas vers le grand architecte, mais réveille en nous ce désir de lâcher-prise si bien évoqué par Etty Hillesun dans son livre Une vie bouleversée.
Jean-Pierre Guimard nous invite à habiter ce désir d’un dépassement de soi qui nous conduit, non à un éloignement, mais plutôt à aller vers soi où demeure Celui qui ne cesse de nous attendre. Qui ne se souvient pas du jaillissement joyeux de l’étonnement de Saint Augustin : « J’étais dehors et Tu étais dedans. »
L’intériorité est le lieu même où nous pouvons enfin nous éveiller à un autrement. Ces pourquoi qui accompagnaient les coups subis ou donnés contre le réel qui cogne - pour reprendre les mots de Lévinas – parviennent à se transformer en un « pourquoi pas ». Alors, le pessimisme destructeur, ensevelissant l’espérance, quitte de son arrogance. Que s’est-il passé ? Dans cette crise dont on ne sort pas indemne, se distille un appel au dépassement de soi, pour aller vers ce que nous sommes appelés à être.
Cette heure est celle d’une liberté qui nous fait avancer sur une route qui n’existe que par ta marche dit encore Saint Augustin. L’évangile ne nous invite-t-il pas à ne pas regarder en arrière.
« Sur un regard, j’ai tout compris », suivant le mot si dense de Claudel. Pas une compréhension intellectuelle, qui sans doute peut déplacer nos limites, mais plutôt celle du cœur laissant à jamais la trace d’un infini possible.
Ici, Jean Pierre évoque le nom d’Arnaud Beltrame, ce lieutenant-colonel qui sut voir le drame auquel il était confronté. Dans l’instant, comprenant qu’il est un autre monde mais qu’il est dans celui-ci (Paul Éluard), il entre dans le royaume du cœur indissociable du Royaume des cieux
Un sacrifice mais plus encore mais une vie si absolument donnée qu’elle offre un infini au sens où Teilhard de Chardin dit que tout ce qui monte converge.
La convergence des essentiels signe la trace de l’éternel.
L’accumulation de trop de situations sordides nourrit le désenchantement de la société, l’amputant d’un dynamisme préjudiciable à son unité et à son avenir.
À Trèbes, dans une petite ville à proximité de Carcassonne, Arnaud Beltrame, jeune lieutenant-colonel de gendarmerie, a pris la place de l’otage retenu par le terroriste après les meurtres qu’il venait de commettre.
L’odieux est confronté à la grandeur. D’un côté, l’homme enfermé dans une idéologie mortifère croit effacer ses échecs en s’autoproclamant martyr, comme si l’on pouvait le devenir en martyrisant ! De l’autre, un homme bénéficiant d’une brillante carrière qui, à quelques semaines de son mariage, a l’audace et le courage de donner sa vie pour qu’un autre la garde.
La Nation est bouleversée par cette abnégation.
Arnaud n’a pas seulement sauvé une personne, il offrit à notre Pays une formidable générosité source de liberté. L’hommage national, sobre et poignant qui lui fut réservé, se révéla un moment de grâce et de lumière, d’unité et de fierté, sans être affecté par des velléités de représailles.
Cet homme juste qu’est Robert Badinter l’exprimera avec pudeur : merci, mon Colonel.
Il faut maintenant rompre les rangs, aller là où nous sommes appelés sans rompre cet émerveillement lié au fait que l’esprit vit.
Si nous ne sommes pas tous destinés à être des héros, transparaît, à la lumière de ce don, le sens de l’existence de la vie.
L’esprit vit quand sont refusées ces idées distillant insidieusement que la misère est une fatalité jusqu’à faire croire que les victimes en sont responsables. Il nous faut encore entendre des jugements aussi iniques. Terrible !
L’esprit vit quand le don est refus de l’indifférence qui crée des abîmes. Il ne nous est pas demandé de prendre la place des plus fragiles mais de se mettre un peu à leur place. Là, commence le chemin vers les cimes, jamais absent de la gratuité.
L’esprit vit quand surgit cette détermination à faire changer ce qui doit et peut l’être, choisissant les priorités qui, alliant méthode et lucidité, bâtissent la cohésion sociale.
L’esprit vit quand l’acte d’entreprendre est trace d’une certaine gratuité ; alors ce sont des hommes et des femmes qui se relèvent ; c’est aussi une civilisation qui s’élève.
L’esprit vit quand les différences se révèlent moins des obstacles que des richesses, à commencer par la compréhension de l’autre. N’est-ce pas un appel à faire place aux blessés de la vie, afin qu’ils trouvent en nous et par nous le respect qui construit, loin des mots faciles.
Jean-Pierre Guimard, le titre de votre livre Va vers toi nous fait entrevoir que l’être est plus grand qu’il ne le pense ou qu’il ne le croit. Vous trouvez de par votre sensibilité, la possibilité de nous le dire en lisant derrière les mots le combat qui a été le vôtre. Vous le livrez avec pudeur pour être exprimé avec l’intelligence du cœur.
Merci.
Bernard Devert
Ancien promoteur immobilier devenu prêtre et président fondateur du Mouvement Habitat et Humanisme.
Le Vercors
Je marche… Je devrais dire je glisse. Avec des copains, je participe, comme à peu près chaque année, à la traversée du Vercors. Oh, bien sûr, il ne s’agit pas de la compétition bien connue, mais d’une bonne balade d’une quarantaine de kilomètres, en hiver, qui vous mène à travers les hauts plateaux du Vercors, du col du Rousset à Corrençon, à proximité de Villard-de-Lans.
Le jeu consiste à prendre un moyen de transport en commun – car, quand il existe, ou taxi – jusqu’au col du Rousset, en laissant une voiture à Corrençon pour le retour.
Le taxi vous mène à un parking au-dessus du col, vers 1 400 mètres d’altitude.
Il faut ensuite chausser les skis de fond et prendre le sentier de grande randonnée GR 93. Ce dernier s’élève d’abord à 1 650 mètres puis descend d’une centaine de mètres au Pas des Econdus. C’est un premier parcours qui permet de tester la qualité de la neige et les précautions qu’il faut prendre en descente. À ce col se trouve une première brèche dans l’impressionnante falaise qui s’ouvre vers la vallée de la Drôme et le Diois, mais il ne faut surtout pas la prendre et continuer en remontant vers le plateau jusqu’à la cabane de Pré Peyret.
Là se trouve le grand carrefour est-ouest/nord-sud : si l’on continue vers l’est, on rejoint le Pas des Bachassons qui permet d’accéder à la route allant de Gresse-en-Vercors à Saint-Michel-les-Portes au nord du mont Aiguille.
Si on va vers le sud, on accède à la vallée de la Drôme. Mais il faut obliquer vers le nord pour rejoindre la Grande Cabane par le GR 91, au milieu d’une végétation plutôt clairsemée, typique des hauts plateaux, après quelques zones plus boisées.
L’itinéraire continue, au pied du Grand Veymont à l’est, jusqu’à la Jasse de la Chau. Le Grand Veymont est le sommet culminant du Vercors, à 2 341 mètres. L’ascension se fait par des sentiers pas trop difficiles, par le Pas des Chattons au sud, ou le Pas de la Ville au nord, ce dernier col étant un accès pour la vallée de Gresse-en-Vercors. Mais je n’ai jamais fait cette ascension en hiver. Au sommet, la vue est fantastique sur toutes les Alpes, du Mont Blanc jusqu’au Ventoux. On y trouve des petits corbeaux au bec rouge, les craves, pas farouches, en attente de quelques miettes…
Après la Jasse de la Chau on se dirige vers Tiolache par la Jasse du Play.
Jusque-là, le sentier ondule au gré des barres, toujours vers 1 600 mètres.
À Tiolache, le sentier plonge assez brutalement vers le nord-ouest, mais selon un tracé relativement rectiligne, dans le canyon des Erges. On perd environ deux cents mètres d’altitude et le parcours est difficile pour des skieurs moyens comme moi. De plus, le tracé est souvent encombré, depuis la grande tempête de 1999, par des arbres déracinés et il faut souvent déchausser.
On rejoint ensuite la grande clairière de Darbounouse à 1 300 mètres.
Le sentier remonte un peu vers la cabane de Carette puis descend jusqu’à Corrençon, à 1 100 mètres d’altitude.
Les cracks, en course, mettent à peu près deux heures pour parcourir ce tracé, mais nous comptons la journée en balade. À partir de Carette, le chemin est utilisé par les skieurs des pistes de Corrençon. Elles sont comme damées et si le temps est clair, le soir, la descente est parfois un peu poétique !…
La chute
En fait, je ne glisse pas. La neige s’est remise à tomber depuis une heure, drue, fine et glacée.
Le vent soulève de grands tourbillons et nous plaque au visage de petits flocons agressifs, piquetant le front et les joues de mille dards, opacifiant les lunettes, collant aux vêtements comme un onguent hostile, glaçant le bout des doigts malgré les gants…
Je marche plutôt que de glisser car cette neige ne favorise pas les pas alternatifs harmonieux.
La météo nous avait signalé ce risque de dégradation mais il devait intervenir plutôt vers la soirée et notre emploi du temps rendait hasardeux un report de la sortie.
Je regrette à présent cette décision. Le vent glacé rend la respiration difficile.
Le plus dur est que la neige efface toutes les traces du chemin. Si en sous-bois, le handicap n’est pas trop pénible, il en va autrement dans les parties dénudées et il ne faut pas trop compter sur les quelques cairns posés çà et là pour nous orienter.
D’ordinaire, nous pouvons bénéficier des sommets comme point de repère mais aujourd’hui, la visibilité n’excède pas cent mètres.
Sur ce plateau karstique, l’eau a, pendant des millénaires, façonné la roche, creusant des lapiaz, sortes de rigoles dans le rocher à nu, ou plus inquiétant des gouffres, plus ou moins larges, plus ou moins profonds, appelés scialets.
Si l’on s’écarte du chemin, on risque de rencontrer ce genre d’obstacles parfois cachés par des ponts de neige.
Je marche en éclaireur devant mes compagnons et, sur cette portion dénudée, je crois bien que nous avons perdu le chemin. Que faire ? La prudence nous commande de faire demi-tour pour rejoindre un tracé plus évident. Mais je ressens une profonde fatigue, envahissant mes jambes et mes bras sur les bâtons, atteignant jusqu’au plus profond de mon corps, inhibant mes capacités de décision.
Je devrais au moins m’arrêter, informer mes compagnons de cette baisse de régime, mais je ne le peux pas.
Il me revient alors des souvenirs atroces des exactions commises par les SS envers les résistants et la population civile sur ces chemins du Vercors, mais c’était à l’été 44… Les résistants, dotés simplement d’armes légères, incapables de tenir tête à quinze mille fantassins, dont des groupes de haute montagne aguerris attaquant par les cols que j’ai cités et d’autres arrivant par planeurs dans la plaine de Vassieux… Dans ce village, il y a un musée montrant ces exactions.
À Valchevrière, au-dessus des gorges de la Bourne, il ne subsiste que la chapelle, épargnée ou oubliée. Un Chemin de croix balise cette tragédie.
Les hommes du maquis, la plupart très jeunes, manquaient sans doute d’expérience. Ont-ils aussi manqué de prudence, s’exposant exagérément aux regards de l’ennemi ? Les a-t-on volontairement abandonnés en fonction des rapports de force existant au sein même de la Résistance ?
Si j’avais eu leur âge à cette époque, aurais-je eu le courage d’entrer dans leurs rangs ?
Ces questions me taraudent et je vois de moins en moins clair devant moi et j’entends cogner mon cœur dans la caverne de ma poitrine… Mes oreilles sont bouchées comme lors d’une descente rapide en voiture et j’ai la sensation de voler…
Soudain, le sol se dérobe sous mes pas. Je crois que je n’ai pas eu le temps de crier, ou alors mes cris ont été aussitôt étouffés. La chute, la chute tant redoutée se produit comme issue d’une menace fatale, une sanction inévitable de l’imprudence.
Je vois les parois du gouffre défiler sur les côtés, tapissées de neige au début, puis c’est la roche à nu, piquetée de temps en temps de maigres arbustes. Au début de la chute, on ressent cette accélération au creux de l’estomac. Et puis, lorsque la vitesse d’équilibre est atteinte, plus de sensation… mais la vitesse d’équilibre dans l’air est proche de deux cents kilomètres par heure… comment dans ce scialet puis-je atteindre une telle vitesse ? Quelle est la profondeur de ce trou ? Le choc va être terrible.
J’ai ressenti un choc mais il n’a pas été aussi terrible que je l’appréhendais. Je suis allongé sur le dos et je n’ai pas de douleur caractérisée. Je suis dans ce que l’on pourrait appeler un état second, une sensation que je ne me souviens pas d’avoir eue auparavant.
J’ai froid et je ne vois rien.
Peu à peu, je perçois une musique discrète. Cette musique très simple consiste en une répétition de quelques notes jouées sur un instrument à cordes, trois notes de hauteur égales, puis trois notes montantes et trois notes descendantes… Musique lancinante mais d’une grande beauté, d’une grande sérénité. Il y a cette lenteur du thème, mais aussi cette avancée vers quelque chose d’inexorable, un peu comme la grande aiguille d’une horloge gigantesque ou bien le témoin d’avancement du téléchargement d’un gros fichier informatique : l’avance est très lente mais on peut néanmoins la repérer.
Mais oui, je finis par reconnaître l’adagio du quintette à cordes en ut majeur de Schubert, avec deux violoncelles. Est-ce que je l’entends vraiment ou est-ce que j’imagine l’entendre ? Je frémis parce qu’un grand musicien disait que c’était la partition qui représentait le mieux le passage… le passage, mais alors ?
Je connais bien cette œuvre. J’ai possédé autrefois un trente-trois tours interprété par le quatuor Alban Berg et Heinrich Schiff en second violoncelle. Plus récemment, mais le CD doit dater de pas mal d’années, le Quartet Amadeus et Robert Cohen.
La partie lancinante dure quelques minutes et, soudain, c’est comme une apparition : le rythme s’accélère, beaucoup plus lumineux et intrusif, sollicitant davantage les sens et l’attention. C’est comme si vous aviez cheminé dans une église orthodoxe russe, très sombre mais laissant voir de fabuleuses fresques sur les parois, au milieu des effluves âcres des cierges et de l’encens… et puis soudain une icône en pleine lumière, non pas simple expression de la beauté d’une œuvre mais témoin d’une véritable pédagogie théologique sur le salut !…
Ou comme si, en montagne, la grisaille des nuages s’accrochait sur les rochers, avant une rapide trouée de ciel bleu.
Ou si vous observiez l’expression grave et répétitive du visage d’un enfant, doutant de sa santé ou témoin d’une anxiété, visage brusquement éclairé par un large sourire apaisant.
Une vision sur autre chose, un autre devenir, un autre possible…
Je prends peu à peu confiance et je me mets sur le côté. Au moment du changement de rythme de l’adagio, je perçois une vague lueur dans les ténèbres. Je distingue alors les parois d’une grotte autour de moi, et je suis couché sur le radier de celle-ci.
Mes yeux s’habituent progressivement à cette demi-obscurité et je commence à voir des ombres s’agitant sur les parois plus loin… La situation ne m’incline guère au sourire mais je n’ai pas pu éviter la pensée « ah oui ! Les ombres dans la caverne !… ».
Combien de temps faudra-t-il que je reste dans cette caverne pour que ces ombres m’apparaissent plus véritables que les silhouettes que je verrai à la sortie ?
On a beaucoup écrit sur ce mythe de la caverne.
Edgar Morin, dans La Méthode(Seuil, 2001), écrit :
Notre civilisation nous permet de détecter notre paléolithique intérieur ; au fond de ses cavernes grouille du « ça » innommable, du « on » anonyme, des monstres, des spectres ; tout ce qui menaçait l’homme des cavernes, périls, ténèbres, faim, soif, fantômes, démons, est passé à l’intérieur de nos âmes, nous inquiète, nous angoisse, nous menace du dedans.
La caverne intérieure n’est pas platonicienne. On doit s’y enfoncer par une interminable descente… en descendant toujours le long de parois couvertes de graffitis enfantins, on parvient à un sanctuaire muet où se tient une petite idole aveugle, souveraine, indifférente, un Rosebud…
Rosebud était le dernier mot énigmatique prononcé avant sa mort par Charles Foster Kane dans le film d’Orson Welles. On apprendra que c’était le nom inscrit sur un traîneau que l’homme chérissait quand il était petit, révélant ainsi sa part de mystère et d’humanité.
Simone Weil, dans La pesanteur et la grâce (Plon, 1948), affirme :
Ce n’est pas la recherche du plaisir et l’aversion de l’effort qui produisent le péché, mais la peur de Dieu… La chair n’est pas ce qui nous éloigne de Dieu, elle est le voile que nous mettons devant nous pour faire écran entre Dieu et nous… L’image de la caverne semble l’indiquer… Quand on arrive à l’orifice, c’est la lumière. Non seulement elle aveugle, mais elle blesse. Les yeux se révoltent contre elle.
À la sortie de cette caverne, verrai-je la lumière ? Aurai-je besoin d’elle ? Ou bien celle-ci m’aveuglera et je ne pourrai pas la voir ? Quand Simone Weil parle de la chair, j’imagine que ce n’est pas seulement la sexualité, mais aussi tout ce qui a trait au corps, la pesanteur, l’attrait pour l’argent et le confort, l’oubli des autres.
Je suis un peu déconcerté quand elle conclut : J’ai besoin que Dieu me prenne de force, car, si maintenant la mort, supprimant l’écran de la chair, me mettait devant lui face à face, je m’enfuirais.
Ainsi le mot est lâché… Je suis de plus en plus conscient et maintenant en mesure d’examiner la situation.
Il y a des années que je n’ai pas fait la traversée du Vercors. C’était donc un rêve, mais maintenant, où suis-je ? Ce que j’ai vécu là ressemble furieusement à ce passage dont parlait ce musicien.
Ai-je seulement prononcé mon Rosebud ?
Voyons, je suis entré il y a peu dans cette clinique pour une banale intervention chirurgicale.
J’avais préalablement rencontré l’anesthésiste, comme le protocole l’impose. Il est vrai qu’il avait prématurément interrompu l’entretien, car il était appelé en urgence pour un grave carambolage sur la voie rapide. Que s’est-il passé au cours de l’opération ?
Pourtant, je n’ai pas peur. Moi qui suis plutôt anxieux, je me trouve assez calme.
Il me revient des textes de poètes et d’écrivains devant le risque du dernier passage.
Ainsi Apollinaire, comme résigné dans les tranchées (Le guetteur mélancolique, Gallimard, 1952) :
La nuit descend comme une fumée rabattue
Je suis triste ce soir que le froid sec rend triste
Les soldats chantent encore avant de remonter
Et tels qui vont mourir demain chantent ainsi que des enfants…
La nuit descend comme une fumée rabattue
Les lièvres et les hases bouquinent dans les guérets
La nuit descend comme un agenouillement
Et ceux qui vont mourir demain s’agenouillent
Humblement
L’ombre est douce sur la neige
La nuit descend sans sourire
Ombre des temps qui précède et poursuit l’avenir.
Ou Marc Ogeret dans La chanson de Craonne :
Adieu la vie, adieu l’amour,
Adieu toutes les femmes.
C’est bien fini, c’est pour toujours,
De cette guerre infâme.
C’est à Craonne, sur le plateau,
Qu’on doit laisser sa peau,
Car nous sommes tous condamnés,
C’est nous les sacrifiés !
Ou Maurice Genevoix dans Les Éparges (J’ai lu, 2014), qui relate une expérience quasi mystique :
Un soir de février 1915 sur la colline des Éparges, après cinq jours d’une bataille de tranchées où le macabre et l’horreur ne nous avaient pas épargnés, un obus de rupture éclata tout près de moi. Je sentis le souffle de l’explosion me brûler jusqu’au fond des entrailles. Quand je repris conscience, seul indemne au milieu de cadavres et de blessés qui gémissaient, toute la colline continuait de trembler au choc de centaines d’obus. Le soir venait, plus lugubre que je ne saurais dire dans la solitude tragique où je me voyais perdu.
Et c’est alors que des paysages de lumière se levèrent autour de moi, me baignèrent d’une douceur, d’une tendresse et d’une paix incroyables, d’une beauté indiciblement amicale, familière et divine à la fois. Des images simples, doucement changeantes : une longue plaine après la moisson, un ciel de juin, des cheminées d’où montent des fumées lentes dans un ciel pâle. Était-ce la Beauce, les toits de Blois ou d’Orléans, la Loire ? Je ne me demandais rien. Je m’abîmais dans cette sérénité…
J’ai pu me lever. Je ne suis pas seul, je sens une présence humaine devant et derrière moi.
Nous avançons lentement dans cette semi-obscurité. Soudain, je sens un courant d’air frais sur mon visage. Nous sommes sortis de la caverne. C’est la nuit, une multitude d’étoiles scintillent au ciel.
On nous tend une torche allumée et nous partons sur le chemin.
L’univers
La vue est saisissante : sur un chemin muletier, sur deux files de front, marche en silence une foule immense, vêtue de blanc, la torche à la main.
J’aperçois nettement, à quelques centaines de mètres, les lacets du chemin escaladant une colline, tout illuminés.
Il me revient aussitôt deux souvenirs.
Le premier est le film Fantasia, deWalt Disney, où des dessins animés cohabitent avec des extraits célèbres de musique classique et dans lequel vers la fin on voit une scène voisine de celle-ci.
Le second est celui de l’Apocalypse de Saint Jean. Dans la Bible, le nom d’Apocalypse n’a pas le sens courant de catastrophe, mais celui de révélation.
Après quoi, voici qu’apparut à mes yeux une foule immense, impossible à dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue ; debout devant le trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main, ils crient d’une voix puissante : « Le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu’à l’Agneau. »
Cette vision en appelle sans doute d’autres, que je n’ai pas d’angoisse à découvrir.
Comme au cours d’une belle nuit d’été à la montagne, loin de toute source de pollution lumineuse, le ciel est ici incrusté d’une multitude d’étoiles. Je n’ai jamais été très fort pour connaître les astres. Tout au plus la Voie Lactée, le grand chariot et l’étoile polaire, quelques planètes. Je suis donc incapable de faire la différence entre le ciel de notre terre dans l’hémisphère nord et le ciel qui se présente ici.
S’agit-il du même ciel ou d’un ciel différent ?





























