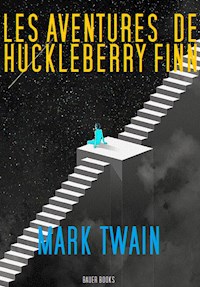
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bauer Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Les Aventures de Huckleberry Finn est un roman picaresque de l'Américain Mark Twain, paru à Londres le 4 décembre 1884 sous le titre The Adventures of Huckleberry Finn, puis à New York en février de l'année suivante sous le titre Adventures of Huckleberry Finn.
Le narrateur est un jeune garçon qui fuit la « sivilisation » en compagnie d'un esclave échappé. Il raconte leur errance de près de 1 800 kilomètres sur un radeau descendant le Mississippi. Le regard ingénu que pose l'enfant sur les tares des civilisés rencontrés nourrit la satire virulente d'une société hypocrite, qui inverse les notions de bien et de mal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mark
Les Aventures de Huckelberry Finn
table des matières
I
Huck Finn se présente au lecteur.L’ami de Tom, c’est moi, Huckleberry Finn. Si vous n’avez pas lu les Aventures de Tom Sawyer, vous ne me connaissez pas. Cela ne fait rien : nous aurons vite lié connaissance. M. Mark Twain vous a raconté l’histoire de Tom, et il y a mis un peu du sien, même en parlant de moi. Cela ne fait rien non plus, puisqu’on m’assure qu’il n’a ennuyé personne. La tante Polly, Mary Sawyer et la veuve Douglas ne disaient jamais que la vérité, et elles n’étaient pas toujours amusantes. Je parle de la tante de Tom, de sa cousine, et de la veuve qui m’avait adopté.
Au fond, sauf quelques enjolivements, M. Mark Twain a rapporté les faits tels qu’ils se sont passés. Pour ma part, je n’ai pas assez d’esprit pour inventer, je raconterai donc simplement la suite de mes aventures.
Or voici comment finit le livre de M. Mark Twain :Tom et moi, nous avions découvert un trésor caché dans une caverne, et nous étions devenus riches. Six mille dollars chacun – une jolie fortune pour des orphelins de douze à treize ans ! Tom avait sa tante qui ne le laissait manquer de rien, si elle le tarabustait un peu. J’étais moins orphelin et plus libre que lui. Mon père vivait encore ; mais il avait disparu depuis longtemps. Je ne tenais pas à le voir revenir, parce qu’il me battait quand il avait bu, c’est-à-dire tous les jours. J’aurais mieux aimé n’avoir qu’une tante.
Du reste, on se montrait bon pour moi, et je ne me rappelle pas avoir jamais eu trop faim. L’été, je dormais dans un tonneau vide ; l’hiver, je couchais dans une grange. Mon genre de vie me convenait. Personne ne s’occupait de moi, parce que j’étais pauvre. Je plaignais Tom, qui ne pouvait pas monter en bateau, se baigner ou pêcher à la ligne plus de deux ou trois fois par semaine. Par malheur, mon argent vint tout gâter, et je me trouvai dans le même cas. L’avocat Thatcher plaça mes six mille dollars à intérêt, de façon à leur faire rapporter un dollar par jour. La veuve Douglas, à qui j’avais rendu un grand service, m’adopta, comme je l’ai dit, et déclara qu’elle voulait essayer de me civiliser. J’étais habitué à vivre à ma guise et ça ne m’allait pas du tout de rester enfermé dans une maison, de me lever, de manger, de me coucher à heure fixe. Et puis, mes habits neufs me gênaient. À la fin, je n’y tins plus et je décampai, après avoir repris mes vieilles nippes. Pour la première fois depuis longtemps je me sentis à l’aise, libre et content. J’avais retrouvé le tonneau où je dormais sans me donner la peine de me déshabiller. Personne ne m’empêchait de flâner dans les bois, de m’allonger sur l’herbe ou au bord de l’eau, et de dégringoler le long des berges. Je pouvais fumer sans avoir besoin de me cacher.
Une seule chose me tracassait. Les provisions dont mes poches étaient pleines ne dureraient pas toujours, et on remettrait le grappin sur moi, si je reparaissais dans les rues. Je n’eus pas le temps de m’inquiéter. Tom me relança au bout du second jour et me gronda plus fort que ne l’avait jamais fait la veuve.
– Tu as beau crier après moi, lui dis-je, j’aime mieux vivre comme autrefois, au lieu de me laisser civiliser.
– Vivre comme autrefois ? Allons donc ! Aujourd’hui personne ne te donnera à dîner en échange de ta pêche.
– Tu crois ?– J’en suis sûr. Maintenant que tu es riche, tu ne dois pêcher à la ligne que pour t’amuser. Si tu te présentes avec un beau poisson, on l’acceptera et grand merci ! On te permettra peut-être de conduire les chevaux à l’abreuvoir ou de mener paître les vaches ; on n’aura pas l’idée de t’offrir une bouchée de pain. On te réclamera plutôt de l’argent, parce qu’on se figurera que cela t’ennuyait de te promener seul.
– Je ne suis pas fier ; je dirai simplement : j’ai faim.– On te rira au nez et on te demandera ce que sont devenus tes six mille dollars. – Un individu ne peut donc pas faire ce qu’il veut quand il est riche ?
– Non ; du moins, pas avant d’avoir vingt et un ans.Comme je ne paraissais pas convaincu, Tom trouva un autre moyen pour me décider. Il me raconta que la bande de voleurs dans laquelle il avait promis de m’admettre serait bientôt organisée. Les autres m’avaient déjà accepté pour lieutenant ; mais ils ne voudraient plus de moi, si je m’obstinais à m’habiller aussi mal et à coucher dans un tonneau.
Je retournai donc chez M meDouglas, qui me reçut à bras ouverts et ne m’adressa pas trop de reproches, de sorte que je fus fâché de lui avoir causé de la peine. Elle me fit endosser mes habits neufs. La vieille histoire recommença. La cloche sonnait pour annoncer le déjeuner, le dîner ou le souper. Que l’on eût faim ou non, on était tenu d’arriver à l’appel et de rester à table jusqu’à ce que le dernier plat eût été servi. Au bout de dix minutes, j’en avais toujours assez, et je ne demandais qu’à m’en aller. Ah ! bien oui. Chez les gens civilisés, les choses ne se passent pas ainsi. Pour peu que l’on mange vite, il faut regarder manger les autres, et sans bâiller encore ! J’eus beau me plaindre, la veuve tint bon.
– Mon pauvre Huck, me dit-elle, c’est là une affaire d’habitude ; tu apprendras bientôt à demeurer assis sans te sentir des fourmis dans les jambes.
Elle se trompait joliment ; les fourmis s’acharnaient contre moi avant que le repas fût à moitié fini. Alors la sœur de la veuve, miss Watson – une vieille fille qui n’était pas méchante au fond – se mettait de la partie. « Huck, ne pose pas les coudes sur la nappe ; Huck, tiens-toi droit ». Puis elle me faisait rire en imitant mes bâillements, et les fourmis décampaient pour le moment. Miss Watson avait été maîtresse d’école. C’est sans doute pour cela qu’elle me reprenait à tout propos. Avec elle pourtant, pas moyen de se fâcher.
Ma mère m’avait un peu appris à lire et à écrire ; mais, comme mon père refusa plus tard de me laisser aller à l’école, c’était presque à recommencer ; grâce à miss Watson, je me rattrapai vite. Les leçons s’allongeaient et ne m’ennuyaient plus autant.
– Est-ce que j’arriverai jamais à écrire aussi bien que Tom ? lui demandai-je un jour.– D’ici à un mois tu écriras beaucoup mieux et tu feras moins de fautes d’orthographe que lui, si tu veux te donner un peu de peine. Je n’ai jamais eu un meilleur élève que toi, Huck.
Pour le coup je me sentis fier et je pensai moins au tonneau, que je regrettais cependant parfois. Un beau matin, Tom fut très étonné quand Jim, le nègre de miss Watson, lui remit une lettre où je l’engageais à venir dîner chez la veuve.
Même durant les vacances, la veuve me tint la bride serrée. J’étais bien plus heureux lorsqu’on ne songeait pas à me civiliser. S’il n’y avait eu que M meDouglas et sa sœur, la vie que je menais ne m’aurait pas semblé trop dure, malgré les leçons. Avec elles je ne me sentais plus gêné ; mais elles invitaient souvent du monde à dîner, et elles se moquaient de moi, parce que je voulais aller manger dans la cuisine. Sans Tom, je me serais encore sauvé. Je le voyais une ou deux fois par semaine et nous prenions rendez-vous pour courir les bois le soir, lorsqu’on nous croyait couchés. L’hiver, un bon lit vaut peut-être mieux qu’un tonneau ; l’été, c’est une autre histoire !
Une nuit, je venais de gagner ma chambre. Je n’étais pas de bonne humeur, car il m’avait fallu demeurer depuis six heures en compagnie de gens que je ne connaissais pas et qui s’obstinaient à me faire causer – pas pendant le dîner, par exemple ; à table, ils étaient trop occupés pour penser à moi. Plus tard, dans le salon, ils ne m’avaient pas laissé aussi tranquille.
– Huck, maintenant que tes moyens te permettent de choisir une profession, n’as-tu pas envie de devenir médecin ? me demanda un vieux monsieur.
– Oh ! non, répliquai-je. Mon père disait toujours que les médecins ne servent qu’à tuer plus vite un malade.
– Docteur, cela vous apprendra à interroger un gaillard bien portant, s’écria un jeune homme, qui ajouta, en s’adressant à moi : Vous préférez sans doute être avocat ? Votre père ne vous a pas prévenu contre les avocats ?
– Si. Ils vendraient leur langue au diable.Alors le docteur salua le monsieur qui venait de me parler et, à mon grand étonnement, tout le monde se mit à rire.
– Il faudra pourtant que tu choisisses un état, Huck, dit la veuve. – Tom et moi nous en avons déjà choisi un. – Je parie que vous songez tous deux à redevenir pirates ? – Plus tard, c’est possible, lorsque nous pourrons acheter un beau navire.– Et en attendant ? – C’est un secret.
Là-dessus, chacun se mit à m’accabler de questions, cherchant à me tirer les vers du nez. Les dames surtout se montraient curieuses. Je crus qu’elles ne s’en iraient jamais. Voilà pourquoi j’étais si tracassé. Après avoir mis ma chandelle sur la table, je m’assis près de la fenêtre et j’essayai en vain de penser à quelque chose de gai. Le souvenir d’une salière que j’avais renversée à dîner me trottait dans la tête. Cela n’annonçait rien de bon. Tandis que je me reprochais de n’avoir pas jeté une pincée de sel par-dessus mon épaule gauche, j’aperçus une petite araignée qui grimpait le long d’une de mes manches. J’eus la bêtise de lui donner une chiquenaude qui l’envoya au beau milieu de la flamme de la chandelle. Tuer une araignée du soir, fût-ce par hasard, porte malheur, tout le monde le sait. Je me levai et je tournai trois fois sur moi-même en faisant le signe de la croix, puis j’attachai une mèche de mes cheveux avec un bout de fil. Ces moyens-là servent à chasser le mauvais sort quand on perd un fer à cheval que l’on a eu la chance de ramasser ; mais suffisaientils dans le cas actuel ? J’en étais rien moins que sûr. Aussi fus-je presque tenté de descendre en tapinois à la cuisine afin de consulter le grand nègre de miss Watson.
Jim était plus à même que personne de me renseigner là-dessus. Tout à coup je me souvins que Tom Sawyer m’avait prévenu que notre bande de voleurs était presque organisée et qu’il fallait me tenir sur le qui-vive les derniers jours, ou plutôt les dernières nuits de la semaine. Or la semaine touchait à sa fin. J’oubliai aussitôt l’araignée, la salière, et j’allumai ma pipe. Rien ne bougeait dans la maison ; je ne risquais pas d’être surpris et grondé par la veuve. Ding, ding, ding ! L’horloge de l’église voisine sonna enfin douze coups, et tout retomba dans le silence.
Au bout de quelque temps, j’entendis comme un bruit de branches brisées au-dessous de la croisée. Je me tins coi et j’écoutai. Bientôt un mi...â...oû discret résonna à peu de distance. C’était le signal convenu. Je répondis mi... â... oû aussi doucement que possible. Je soufflai la lumière, je sortis par la fenêtre et, me laissant glisser le long du toit d’un hangar, j’eus bien vite rejoint Tom qui m’attendait sous les arbres.
II
Jim. – La bande de Tom Sawyer.Nous avançâmes sur la pointe des pieds le long d’une allée qui menait à une des sorties du jardin. Au moment où nous passions devant la cuisine, mon pied s’embarrassa dans une racine d’arbre, je tombai à la renverse et ma chute causa un léger bruit. Tom s’accroupit par terre et nous demeurâmes immobiles. Jim se tenait assis à la porte de la cuisine. Nous le voyions très bien, parce qu’il y avait une lumière derrière lui. Il se leva et avança la tête en prêtant l’oreille.
– Qui est là ? demanda-t-il au bout d’une minute.Après avoir encore écouté un instant, il s’avança de notre côté et s’arrêta entre Tom et moi. Nous aurions presque pu le toucher ; mais nous nous gardions bien de bouger. Une de mes chevilles se mit à me démanger et je n’osai pas me gratter ; ensuite ce fut mon oreille gauche, puis mon dos, juste entre les deux épaules. Il me semblait que je mourrais, si je ne me grattais pas. J’ai souvent remarqué depuis que ces sortes de démangeaisons vous prennent toujours mal à propos, lorsque vous êtes à table, à l’école, ou quand vous essayez de vous endormir. Bientôt Jim dit :
– Ah çà ! qui êtes-vous ? Où êtes-vous ? Pour sûr, j’ai entendu quelque chose... Bon, je sais ce que je vais faire. Je ne bougerai pas d’ici, et de cette façon je verrai bien si je me suis trompé.
Et le voilà qui s’assoit par terre, s’adosse à un arbre et allonge les jambes de mon côté.Alors ce fut le nez qui commença à me démanger au point que les larmes me vinrent aux yeux. Cela dura six ou sept minutes ; mais le temps me parut beaucoup plus long – j’avais une peur atroce d’éternuer. Heureusement la respiration de Jim annonça qu’il s’endormait, et en effet il ne tarda pas à ronfler.
– Filons, Huck, dit Tom à voix basse.Je le suivis en rampant. À peine nous fûmesnous relevés, à une dizaine de pieds plus loin, que Tom me proposa de revenir en arrière et d’attacher Jim à l’arbre. Moi, je ne voulais pas risquer de réveiller le nègre ; il aurait donné l’alarme et on se serait aperçu que je manquais à l’appel.
– Tu as raison, dit Tom. Tant pis, car la farce était bonne. Seulement il faut revenir tout de même. J’ai laissé la bande au bas de la colline. Nous devons visiter notre caverne ce soir, et je n’ai pas assez de chandelles. Tu la connais, la caverne ; elle n’est pas gaie, et si elle ne se trouvait pas bien éclairée, surtout la première fois, on ne voudrait plus revenir. Puisque Jim dort, profitons-en pour nous glisser dans la cuisine et augmenter notre provision.
Je ne trouvai rien à répondre. Nous regagnâmes donc à pas de loup la cuisine, où Tom prit une demi-douzaine de chandelles, laissant cinq cents sur la table en guise de paiement. Dès que nous fûmes dehors, je voulus prendre mes jambes à mon cou ; mais Tom tenait à jouer un tour au nègre, et je dus l’attendre tandis qu’il rampait sur les genoux jusqu’à l’arbre.
Lorsqu’il m’eut rejoint, nous courûmes le long de l’allée. Arrivés au bout du jardin, la haie franchie, nous fîmes halte au haut d’une colline, derrière la maison de la veuve. Tom me raconta qu’il s’était contenté d’enlever le chapeau du nègre et de l’accrocher à une branche d’arbre, juste au-dessus de la tête du dormeur. Le lendemain, Jim affirma que les fées l’avaient plongé dans un profond sommeil pour le transporter aux quatre coins de la ville et l’avaient ensuite ramené en face de la cuisine, sous le gros chêne, à une branche duquel elles avaient suspendu son chapeau afin de montrer d’où venait le coup. Le surlendemain, Jim se rappela fort bien avoir passé au moins une heure à la Nouvelle-Orléans, et plus tard il se vanta d’avoir fait le tour du monde à cheval sur un manche à balai. Cette aventure, dont il n’entretenait que ses camarades, le rendit très fier. Les nègres, entre eux, ne se lassent jamais de parler des exploits des fées ou des sorcières, et Jim se montrait trop convaincu pour ne pas rencontrer beaucoup d’auditeurs crédules.
Du haut de la colline au sommet de laquelle Tom s’était arrêté pour reprendre haleine, nous dominions la petite ville de Saint-Pétersbourg (État de Mississipi), où quelques rares lumières brillaient encore çà et là, éclairant sans doute quelque chambre de malade. Au bas de la ville coulait le Mississipi, large d’au moins un mille, calme et resplendissant à la lueur des étoiles. Nous dégringolâmes le long de la pente, et dans la vieille tannerie abandonnée nous trouvâmes Joe Harper, Ben Rogers et plusieurs autres camarades qui s’étaient cachés sous le hangar. Quelques minutes plus tard, nous détachions un canot, et la bande montait à bord pour débarquer à deux milles plus bas, en face d’un point de la côte que Tom et moi connaissions fort bien.
Après avoir amarré le bateau et gagné la berge, on s’arrêta devant le buisson qui cachait une des entrées de la grotte où Tom avait failli périr de faim. Le capitaine – il n’était pas permis de lui donner un autre nom durant une expédition – fit jurer à chacun de garder le secret, ordonna d’allumer les chandelles et montra le chemin. Pour entrer, il fallut se traîner à quatre pattes. Peu à peu l’ouverture s’agrandit et forma un couloir où chacun pouvait marcher debout et voir plus clair. Il n’était que temps, car la moitié des recrues semblait déjà prête à déserter. Enfin, toujours guidé par Tom, on arriva, en se faufilant à travers une autre fente que personne n’avait remarquée, dans la grande cave où nous avions découvert le trésor.
– C’est ici le repaire où nous établirons notre quartier général, dit Tom.La vue du repaire, dont les murs étaient humides et où les sièges manquaient, n’excita pas autant d’enthousiasme que je m’y attendais. Tom s’en aperçut sans doute, car il reprit aussitôt :
– On ne se réunira ici que dans les grandes occasions ; l’été, nous camperons dans le bois voisin.
– Tant mieux, dit Joe Harper ; la cachette est bonne ; mais il faut s’écorcher les genoux et les coudes pour y arriver. Mon pantalon est tout déchiré.
– Bah ! répliqua Tom, on croira que tu as grimpé à un arbre. Du reste, s’il y a des capons parmi nous, ils sont libres de s’en aller, puisqu’ils n’ont pas encore prêté serment. Que les capons lèvent la main.
Aucune main ne se leva.– À la bonne heure ! s’écria Tom. Je vois que j’ai bien choisi mes hommes et que je puis compter sur eux. Maintenant, je vais vous lire le serment, et vous le signerez de votre sang.
Il tira de sa poche une feuille de papier sur laquelle il avait écrit le serment. Les membres de la bande juraient d’obéir aux ordres du capitaine et de se soutenir les uns les autres. Si quelqu’un révélait les secrets de la bande, on tirerait au sort pour savoir qui le tuerait, et le justicier désigné s’engageait à ne pas manger ou dormir jusqu’à ce qu’il eût plongé son poignard dans le cœur du coupable et tracé une croix sur sa poitrine. Cette croix était la marque de la bande de Tom Sawyer, qui, seule, avait le droit de s’en servir. Si un des affiliés se révoltait contre le capitaine, il passerait devant un conseil de guerre et on lui brûlerait la cervelle séance tenante. Il y en avait beaucoup plus long ; mais je ne me rappelle pas le reste.
Ben Rogers déclara que c’était un très beau serment et demanda si Tom l’avait inventé d’un bout à l’autre. Tom reconnut avoir presque tout copié dans des histoires de chefs de voleurs ou de pirates, qui savaient mieux que lui ce qu’il fallait faire jurer à leurs hommes.
Quelqu’un opina qu’il serait peut-être bon de tuer aussi les familles de ceux qui trahiraient les secrets de la bande. Tom, ayant approuvé cette idée, prit son crayon et griffonna une ligne sur le papier qu’il venait de lire.
– C’est fort bien, dit alors Ben Rogers ; mais voilà Huck Finn, qui n’a pas de famille. – Est-ce qu’il n’a pas son père ? demanda Tom.– Oui, un père que nous ne saurons jamais où trouver ; il y a plus d’un an qu’on ne l’a pas revu. Ça ne serait pas juste envers les autres, qui ont des familles à tuer.
Le cas était embarrassant ; mais, grâce à Tom, on finit par consentir à ne pas rayer mon nom de la liste. En somme, chacun de nous se piqua le doigt avec une épingle et signa le serment avec son sang.
– À présent, dit Tom, il est bien entendu que notre bande est une bande de voleurs de grand chemin, pas autre chose. Nous nous mettrons en embuscade pour arrêter les voitures ou les voyageurs.
– Et s’ils ne veulent pas s’arrêter ? demanda un sceptique.– Oh ! dans les livres ils ne manquent jamais de s’arrêter lorsque des gens masqués leur crient : « La bourse ou la vie ! » Les chevaliers du grand chemin portent toujours un masque – autrement ils ne pourraient pas aller dans le monde sans être reconnus.
– Nous n’avons pas de masques !Tom paraissait avoir prévu l’objection. Il jeta à terre sa casquette, tira de sa poche un foulard de sa tante Polly – un beau foulard tout neuf dans lequel il avait taillé deux trous ronds à l’aide d’une paire de ciseaux, et dont il se coiffa en un clin d’œil.
– La bourse ou la vie ! cria-t-il... Que pensestu de ce masque-là, Jack ? – C’est vrai que ça doit effrayer les gens, dit Jack, qui venait de faire un bond en arrière.– Rien de plus facile à fabriquer, reprit Tom en retirant son masque. Il n’y a qu’à bien marquer la place des yeux.
Très facile, en effet ! ainsi que l’apprirent bientôt douze ou quinze ménagères de SaintPétersbourg, qui ne connurent que beaucoup plus tard l’utilité des mouchoirs troués. En attendant, le coup de théâtre imaginé par Tom lui valut un plein succès, et son plan de campagne fut adopté sans hésitation ni nouvelle discussion. Il fut nommé capitaine à l’unanimité des voix, et on m’accepta pour lieutenant. Lorsque je regagnai ma chambre, au point du jour, j’étais aussi heureux que fatigué.
Le lendemain, j’osai à peine descendre à l’heure du déjeuner, tant l’expédition de la veille avait bien arrangé mes habits. J’eus beau gratter les gouttes de suif avec mon canif et brosser, ils n’avaient plus l’air neufs, tant s’en faut. La veuve se douta bien de quelque chose ; mais elle ne me gronda pas. Au contraire, elle empêcha sa sœur de me gronder en lui disant doucement : « Laissele tranquille, nous finirons par l’apprivoiser. » J’avais presque envie de lui tout raconter.
Pendant six semaines, la bande fut convoquée de loin en loin. Elle ne se trouvait presque jamais au grand complet, bien que Tom eût menacé de brûler la cervelle à quiconque s’absenterait deux fois de suite. Beaucoup de ses hommes n’étaient libres que le dimanche, et pour rien au monde ils n’auraient consenti à être des voleurs ce jour-là. Au fond ce n’était pas très amusant. Nous n’avions arrêté personne. Nous nous contentions de sortir à l’improviste du bois pour effrayer les gens qui apportaient des légumes ou conduisaient des porcs au marché. Tom appelait les cochons des lingots et les carottes des rubis. Je ne vois pas ce que nous y gagnions, excepté un coup de fouet de temps à autre. Ensuite nous courions nous cacher dans notre caverne, où le capitaine se vantait d’avoir remporté une nouvelle victoire. Un matin, il nous fit avertir par le second lieutenant, Joe Harper, qu’il venait d’apprendre par ses espions qu’une caravane de riches marchands espagnols et arabes devait passer le lendemain à peu de distance de la grotte avec deux cents éléphants, cinq cents mules et six cents chameaux chargés de diamants. L’escorte ne se composait que d’une centaine de soldats. Il s’agissait de nous mettre en embuscade pour tomber au bon moment sur la caravane, disperser l’escorte et emporter les diamants dans notre repaire. Il fallait donc fourbir nos armes et nous trouver au lieu du rendez-vous dès huit heures du matin. Le capitaine nous ordonnait sans cesse de tenir nos armes en bon état, parce que dans ses livres les bandits passaient la moitié de leur temps à fourbir leurs arquebuses. Il savait pourtant très bien que nous ne possédions que des sabres fabriqués avec des lattes et des fusils représentés par des manches à balai.
Je ne croyais pas du tout que nous pourrions effrayer un si grand tas d’Espagnols et d’Arabes ; mais je tenais trop à voir les éléphants et les dromadaires pour laisser échapper l’occasion. Les autres éprouvèrent sans doute la même curiosité, car Tom n’eut pas à se plaindre de leur manque d’exactitude.
Cachés derrière les arbres, nous attendîmes le signal convenu, et lorsque le capitaine cria : En avant ! nous nous lançâmes le long de la colline. Je n’aperçus ni Espagnols, ni Arabes, ni chameaux, ni éléphants ; mais une classe de l’école du dimanche que l’on menait en piquenique dans le bois – et une classe de petites filles encore ! Elles eurent joliment peur et se sauvèrent à la débandade. Notre butin ne fut pas lourd : quelques biscuits, un pot de confitures, un livre de cantiques et une poupée. La vieille sousmaîtresse nous fit tout lâcher ; elle tomba sur nous à coups de parapluie et nous n’en fûmes pas quittes à trop bon marché.
– Avec tout ça, dis-je à Tom, je n’ai pas vu un seul diamant.– Il y en avait des masses, répliqua-t-il, et des Arabes et des dromadaires aussi. – Pourquoi ne les avons-nous pas vus alors ?
– Si tu avais lu les Aventures de Don Quichotte, tu saurais pourquoi. C’est la faute des enchanteurs. Les soldats, les mules et le reste étaient là ; mais les magiciens ont transformé la caravane en école du dimanche, par pure méchanceté.
– Il fallait nous en prendre à eux, au lieu d’effrayer les filles.– Allons donc ! me répondit Tom. Ils auraient appelé à leur aide des génies qui nous écrabouilleraient rien qu’en levant le doigt. Si nous avions pu faire venir d’autres génies pour rosser les premiers, je ne dis pas.
– Comment les magiciens les font-ils venir ? demandai-je.– Dans les Mille et une Nuits, quand vous avez besoin d’un génie, vous frottez une vieille lampe d’étain ou une bague de fer. Alors le génie arrive au milieu d’un nuage de fumée, et se met à vos ordres. Si vous lui commandez de bâtir avec des diamants un palais de quarante milles de long, de le remplir de bonnes choses et d’y amener la fille de l’empereur de Chine, parce que vous voulez vous marier avec elle, il faut qu’il le fasse avant le coucher du soleil. Bien plus, il est obligé de transporter le palais d’un bout du pays à l’autre, si vous lui en donnez l’ordre.
– Eh bien, je le trouve bête de ne pas garder le palais pour lui. Je ne serais pas assez sot pour planter là ma besogne et courir après un individu, tout bonnement parce qu’il a frotté une vieille lampe ou un anneau de fer.
– Tu serais obligé de venir dès qu’il aurait assez frotté ; c’est dans le livre.– Allons, ne te fâche pas. Je viendrais, puisqu’il n’y aurait pas moyen de faire autrement ; mais je te parie que l’individu serait écrabouillé avant d’entrer dans son palais.
– Il n’y a pas moyen de raisonner avec toi, Huck ; tu as la tête trop dure.Je pensai à tout cela pendant deux ou trois jours ; puis je me décidai à en avoir le cœur net. Après m’être procuré une vieille lampe d’étain et un anneau de fer, je les frottai jusqu’à me casser presque les bras. Mon idée était de bâtir un beau palais que j’aurais donné à la veuve, à la condition qu’elle renoncerait à me civiliser. Cela ne me servit à rien. Aucun génie ne se montra. Je restai persuadé que Tom croyait aux Arabes et aux éléphants, mais que sa caravane était bien une école du dimanche.
À la suite de cette mémorable aventure, la plupart des voleurs de grand chemin, honteux d’avoir été dispersés par une vieille dame armée d’un simple parapluie, donnèrent leur démission, et, en dépit des remontrances du capitaine, je suivis leur exemple.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























