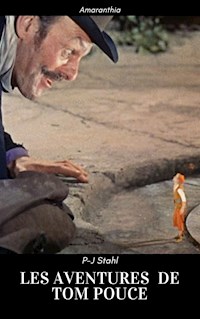Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les Bonnes Fortunes parisiennes de P.-J. Stahl est un roman captivant qui nous plonge au cœur de la société parisienne du XIXe siècle. L'auteur, maître incontesté du réalisme, nous offre une plongée saisissante dans les intrigues et les passions qui animent la haute société de l'époque.
L'histoire se déroule dans le Paris bouillonnant de la Belle Époque, où les apparences sont reines et les secrets bien gardés. Nous suivons le destin de plusieurs personnages, tous issus de milieux différents, mais liés par des liens complexes et souvent inattendus.
Au centre de l'intrigue, nous découvrons la fascinante et mystérieuse Juliette, une jeune femme d'une beauté envoûtante, qui cache de sombres secrets. Elle est entourée d'une galerie de personnages hauts en couleur : des aristocrates décadents, des artistes bohèmes, des courtisanes audacieuses et des hommes d'affaires sans scrupules.
P.-J. Stahl nous offre une plume élégante et raffinée, qui nous transporte dans les salons mondains, les théâtres et les cafés de la capitale française. À travers des descriptions minutieuses et des dialogues ciselés, l'auteur nous fait vivre les émotions et les tourments de ses personnages, nous plongeant au cœur de leurs vies tumultueuses.
Les Bonnes Fortunes parisiennes est un roman captivant qui mêle habilement l'amour, la trahison, l'ambition et les jeux de pouvoir. P.-J. Stahl nous offre un véritable tableau de la société parisienne de l'époque, avec ses codes, ses hypocrisies et ses excès.
Ce livre est un véritable bijou de la littérature réaliste, qui nous transporte dans un Paris vibrant et fascinant. Les Bonnes Fortunes parisiennes de P.-J. Stahl est un incontournable pour tous les amateurs de romans historiques et de sagas familiales.
Extrait : "Vous avez tous connu Georges Turner, un peintre, plus qu'un peintre, un poète, une de ces natures à la fois chevaleresques et mélancoliques qu'embrase l'amour du beau, qui ont le culte de ce dieu invisible qu'elles appellent l'idéal, et qui cherchent partout, même en ce monde, des preuves de la présence de leur dieu. Je le rencontrai un jour sortant du musée de Dresde."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vous avez tous connu Georges Turner, un peintre, plus qu’un peintre, un poète, une de ces natures à la fois chevaleresques et mélancoliques qu’embrase l’amour du beau qui ont le culte de ce dieu invisible qu’elles appellent l’idéal, et qui cherchent partout, même en ce monde, des preuves de la présence de leur dieu.
Je le rencontrai un jour sortant du musée de Dresde.
La vue des chefs-d’œuvre qui abondent dans ce musée, un des plus riches en trésors de toute sorte qu’il soit donné aux hommes de rassembler, cette vue l’avait transporté. Il avait le front comme illuminé. Sa parole vibrait. On sentait qu’il s’était rempli jusqu’au bord d’un saint enthousiasme.
– Que c’est bon ce qui est beau, me dit-il, et qu’il est doux d’admirer !
– Comme vos yeux brillent, mon ami ! On dirait que vous avez pleuré.
– Si j’ai pleuré ! me répondit-il ; oui, certes, et j’espère bien pleurer encore. J’ai pleuré devant ces grandes, devant ces nobles toiles. Que je suis heureux d’être peintre, d’avoir des yeux pour ouvrir à mon âme ce pur ciel de l’art où l’on voit réalisés par d’autres les rêves qu’on n’a pu atteindre encore soi-même, mais qu’on atteindra peut-être à son tour ! Tout est dans ces inappréciables galeries. C’est un monde, un univers toujours réussi, plein d’une vie et d’un mouvement que rien n’égale dans la vie réelle.
C’est plus beau que la nature elle-même, car c’est la nature choisie par ses plus respectueux enfants. Entrez là-dedans, mon cher Maurice : fussiez-vous mort à toutes les émotions, vous en reviendrez ranimé. Tout y brille, tout y rayonne, tout y parle. Il y a dans ce temple vingt tableaux qui sont tout à la fois des poèmes et des symphonies. Je vous défie, quand ces miracles auront passé sous vos yeux, de me dire qu’ils sont muets, qu’ils ne vous ont rien raconté, qu’en les contemplant votre âme n’a fait que voir et n’a rien entendu. Vous sortirez de ce saint lieu comme d’un concert sacré, écoutant encore, comprenant que ce qui est radieux ne se tait pas, que les couleurs chantent, qu’elles ont une voix, et qu’il n’y a, pour tout dire, que les sourds et les aveugles qui séparent l’harmonie des tons de l’harmonie des sons.
Il est douloureux, sans doute, d’avoir contemplé ces merveilles et de n’être que ce qu’on est, mais il est plus triste encore d’être contraint de les quitter et de rentrer, en se séparant de cette foule de génies, dans le néant des rues. Où vais-je aller pour garder complète la mémoire de cette fête de mes yeux ? où vais-je promener mon souvenir ? Tenez, mon cher Maurice, si vous êtes un bon ami, vous ne me quitterez pas, vous vous emparerez de moi et vous me conduirez dans quelque beau lieu, à la Bastei, par exemple. Cela vous va-t-il ? en cinq quarts d’heure, nous serons en pleine Suisse saxonne, et nous aurons échappé aux vulgarités des villes. Il n’y a que les splendeurs écloses sous la main de Dieu qui puissent répondre à tout ce que viennent de me dire les splendeurs de l’art. Partons.
– Partons, lui dis-je ; les montagnes et les rochers, les eaux vives et les forêts profondes, ce sont mes tableaux à moi. L’univers est mon musée. Pourquoi croyez-vous donc que je cours sans trêve ni repos, si ce n’est pour rencontrer l’occasion de pleurer de temps en temps, tout seul, une de ces larmes que vous venez de répandre ? D’ailleurs, je ne cherchais, en ce moment, qu’à user une journée d’impatiente attente. Avec vous, dans le beau pays que vous me promettez, elle passera plus vite.
Grâce au chemin de fer plus prompt que le bateau à vapeur, nous laissâmes bientôt derrière nous la vallée de Dresde et ses guinguettes fameuses.
Loschwitz et Blasewitz, où Schiller prit sa Guttel pour sa tragédie de Wallenstein ; les tourelles du palais romano-chinois de Pilnitz, où fut signé le traité qui ramena la légitimité en France ; Gross Sedlitz et Kopitz, célèbre par son tir au papegai ; Pirna et la forteresse de Sonnenstein défilèrent successivement sous nos yeux. La station de Potzscha apparut.
Nous n’avions plus qu’à traverser l’Elbe pour nous trouver à Vehlen, au pied de la Bastei.
La Suisse a des beautés d’un autre ordre ; elle n’a rien qui ressemble à cet étrange lieu. Le long et bizarre défilé d’Uttewalder-Grund, qui, à travers mille surprises, conduit des bords de l’Elbe au sommet de la Bastei, est comme ces préludes des belles œuvres qui déjà annoncent la pensée de leur auteur. Quoi qu’en ait dit le proverbe, tout chemin ne mène pas à Rome. Il y a chemins et chemins ; et Dieu, en maître habile, n’a jamais fait une préface vulgaire aux grands chapitres de son livre. Un chemin comme celui de la Bastei ne saurait donc conduire à quelque chose de banal. On sent qu’il vous mène à la découverte d’un des secrets de la nature. C’est comme une initiation, comme une préparation, que cette ascension mystérieuse et charmante à travers les monts déchirés.
Le jour ne semble se faire que peu à peu dans ces gorges étranglées, et riantes cependant, que dominent et surplombent parfois tout à coup d’énormes blocs de noirs rochers. On sort de tunnels comme Dieu seul en sait faire par des échappées qu’aucun pinceau n’aurait osées. L’herbe la plus menue, les fleurettes les plus gaies, la mousse la plus tendre, les bruyères les plus roses, les fougères les plus actives, le sable le plus fin, la terre la plus vierge, les fruits les plus naïfs, les ruisseaux les plus fous, les torrents les plus brusques se trouvent sous vos pas, sous vos yeux, sous vos mains, avec une profusion, avec une diversité telle que, n’était la note toujours grave qui sert de dessous à ces mille variations et qui ne vous laisse pas oublier que tout cela n’est encore qu’une broderie, que l’introduction d’un bien autre morceau, vous seriez tenté à chaque instant de dire « N’allons pas plus loin. Nous sommes bien ici ; restons-y pour l’éternité. »
Mais quel amant de la terre, digne de ce bel amour, est jamais resté à mi-chemin d’une montagne ou d’un précipice ? La pointe extrême des cimes et le fond même des gouffres, n’est-ce pas ce que veut toucher quiconque est possédé de la curiosité, de la passion du beau ?
Vous montez donc, laissant tomber çà et là, partout, un regret ; disant du regard à tout ce qui vous ravit : « Je reviendrai. » Quand vous êtes presque en haut, cela s’élargit. C’est une forêt d’abord ; c’est un plateau lumineux ensuite. Le blé y pousse. Vous vous croyez sur un roc : c’est presque une plaine qui s’étale devant vous. Mais vous n’êtes pas au but. Ceci n’est qu’un repos ménagé comme à dessein pour vos yeux, avant que la toile se lève pour leur dévoiler le fantastique décor dont le reste n’était que l’annonce.
À gauche, tout au bord de la route carrossable que vous n’avez pas prise, bien entendu, un petit sentier sous bois vous conduit innocemment, sournoisement, près d’une rustique barrière ; un arbre mal équarri, sur deux supports quelconques, c’est tout ce qui vous sépare du spectacle prestigieux qui vous attend. Si vous êtes sujet au vertige, tenez-vous bien. La scène est à pic sous vos pieds, aussi bas, dans la profondeur, que puisse descendre votre vue. Que dites-vous de cet antre, de cette fosse immense, de cette caverne à ciel ouvert, de ce cirque formidable ? Est-ce assez inquiétant, assez solennel ? Avez-vous jamais rêvé rien de pareil dans le plus puissant, dans le plus fiévreux de vos songes ? Comment décrire cette nation assemblée de géants de pierre, ce conciliabule de rochers, ce sénat de colonnes vermoulues, ces rangées de Titans morts et restés droits dans l’attitude d’une délibération suprême ? Que dites-vous de ces pleurs de soufre que les siècles ont séchés dans les yeux, dans les blessures de ces vieillards de granit ? Que dites-vous de cette sombre prairie de sapins, de ces altiers sapins du Nord qui partout menacent le ciel, et qui, d’où vous les apercevez, semblent étendus sous les pieds de ces colosses comme un tapis de brins d’herbe ?
Je n’ai rien vu de plus majestueux que cette pétrification colossale. On dirait les restes d’un temple antédiluvien. Les sphinx gigantesques de la grande Égypte n’eussent pu ramper qu’à l’état d’insectes autour de ces formidables débris. On domine toutes ces hauteurs, on a tous ces sommets sous les pieds ; mais, de si haut qu’on les contemple, on les sent debout, on les voit énormes, ils vous apparaissent menaçants comme s’ils se dressaient au-dessus de vos têtes. On se dit qu’on n’est que le brin de paille qu’un caprice du vent a emporté par-delà les monts, et que, si élevé qu’on soit au-dessus de ces abîmes, la grandeur est en bas.
Mais il faut s’arracher à ce spectacle. Il n’est lui-même que le plus grand des accidents de la route. Vous faites cent pas encore. Vous quittez les arbres. Vous vous arrêtez : quelle est la surprise nouvelle, et comment va s’appeler votre étonnement ?
Mon étonnement à moi, Georges, depuis longtemps initié, ne le partagea pas ; ce fut de trouver pour premier plan à l’inénarrable horizon qu’il m’avait annoncé ce qu’on appellerait en France une vaste guinguette, et ce qu’on décore en Allemagne d’un nom plus honorable. Eh ! mon Dieu, oui, lecteur, qui voyagez si complaisamment avec moi, c’est une restauration allemande, un gros chalet à deux ou trois étages, un observatoire carré, une sorte de moulin à vent sans ailes, deux ou trois hangars pour les buveurs des jours de pluie, une longue salle à manger dominant toute la contrée, des tables vertes, et une armée de chaises de paille qui nous barrent la vue promise.
Le portier du lieu, un respectable vieux chien blanc, aboya, fort poliment du reste, pour annoncer notre arrivée ; à son appel, un garçon, un kellner de bonne mine, accourut la serviette sous le bras pour nous offrir ses services.
– Ces messieurs veulent-ils dîner ? combien de couverts ? Nous avons de la süppe, des beefsteaks, des truites frites, des pruneaux, des côtelettes, de la langue fumée, des compotes, de la bière, de la limonade, du vin aux œufs, du fromage vert, du maitrank, du café. Que faut-il leur servir ?
Georges ne put s’empêcher de rire de ma déconvenue. Je pris le parti d’en rire moi-même, car, s’il faut l’avouer, je venais de m’apercevoir, à la brillante énumération que venait de nous faire le garçon, que j’avais une faim de dogue.
– Va pour le beefsteak, m’écriai-je.
– Et pour les côtelettes, dit Georges.
– Et pour une bouteille de Rudesheimer, repris-je.
– Et pour les truites frites, dit encore mon compagnon.
– Et pour le café, et pour le kirsch, et pour tout le reste, ajoutai-je, saisi tout à coup d’une sainte ardeur.
– Où ces messieurs veulent-ils se placer ? dit le garçon.
– Pas trop loin des fourneaux, repris-je.
– Pour cela, dit Georges, mon bon Maurice, c’est une autre affaire. Si c’est une manie respectable de chercher la place qu’on préfère au café Riche ou chez Bignon, c’est le plus sacré des devoirs de ne pas faire un choix inconsidéré, quand la salle à manger dont on dispose s’appelle le plateau de la Bastei. Un peu de patience donc, mon ami, et suivez-moi. Le garçon va commander notre festin et nous lui dirons tout à l’heure sur quel point de l’horizon nous verrons coucher le soleil. Nous allons dîner en plein air, s’il vous plaît.
– Si cela me plaît, m’écriai-je, un dîner en plein air ! Mais, mon ami, c’est la joie des joies ! Devant la belle toile de fond qui s’étale là-bas sous nos yeux, un beefsteak de zèbre serait tendre. Une de mes béatitudes en voyage, c’est de rencontrer un beau site à côté d’un bel appétit. Allons, Georges, cherchez-nous vite une salle à manger, c’est vous qui m’avez amené à la Bastei, c’est à vous de m’en faire les honneurs.
Grâce au bon goût de Georges, nous fûmes en moins de dix minutes attablés dans un cabinet particulier comme on aurait peu de chances d’en rencontrer sur les boulevards de Paris. Figure-toi, lecteur, habitué, pour tes péchés peut-être, du café Anglais, figure-toi, à mille ou douze cents pieds au-dessus du sol, à l’extrémité d’une grosse roche témérairement penchée sur le plus délicieux abîme, un ancien nid d’aigle, une sorte de repaire de bêtes fauves, un admirable trou de sept ou huit pieds carrés, taillé brutalement dans la pierre par quelque cataclysme inconnu ; figure-toi dans l’une des parois de ce trou un autre trou, résultat probable de quelque colère de la foudre, s’ouvrant brusquement en guise de fenêtre sur un paradis, et, dans ce lieu de délices, deux chrétiens en état de grâce, faisant face tout à la fois à un potage fumant servi sur une nappe bien blanche et au plus éblouissant des panoramas.
Il était cinq heures environ. Tous les feux du jour étincelaient encore au fond de l’horizon, et le calme du soir descendait déjà sur nos têtes. À nos pieds coulait l’Elbe aux ondes d’argent, plus allemand que le Rhin. Devant nous se détachait, sous la forme d’une énorme jardinière, la citadelle de Kœnigstein et sa ceinture de vieilles roches ; une forteresse imprenable pour qui n’a pas deux thalers dans sa poche, et le roc célèbre de Lilienstein qui lui fait pendant du côté de Schandau. À droite s’étendait un paysage infini ; à gauche, si j’ai bonne mémoire, la montagne Boerenstein aux flancs creux et le Jungfernsprungl.
Quel dîner ! quel spectacle que le coucher de soleil d’un beau jour vu au bout d’une fourchette bien garnie, et la belle alliance que celle de deux faims ensemble satisfaites, la faim des yeux et celle d’un estomac généreusement ouvert !
– Dites donc, Maurice, soupira Georges entre le fromage et le dessert, regrettez-vous Vachette, Bignon, Tortoni ? Regrettez-vous le macadam, le bruit des fiacres, la vue des colonnes-affiches et celle des demoiselles qui fument jusqu’à minuit sur les chaises du café Riche ? Regrettez-vous la Patrie du soir ?
– Ma foi, non, lui répondis-je ; encore si les boulevards étaient sur les quais ! car les quais de Paris, c’est beau de partout, mon ami Georges. Mais vous, mon cher peintre, ne regrettez-vous ici ni Raphaël, ni Rubens, ni Rembrandt, ni les portraits du Titien ? Ne regrettez-vous pas votre favori Claude Lorrain ?
– Pas même Claude Lorrain, me répondit Georges : j’en ai un sous les yeux de vingt-cinq lieues de long ; pas même Rubens : ce beau nuage empourpré de toutes les couleurs du ciel, c’est sa palette ; pas même Rembrandt : cette roche qui fait la loi au soleil là-bas, qui semble emprisonner tout un coin de terre, c’est le combat de Rembrandt avec la lumière, c’est un Rembrandt ; pas même le Titien, car à demi doré comme vous l’êtes en ce moment, Maurice, vous êtes un superbe Titien ; pas même Raphaël enfin, car ce fond bleuâtre et charmant sur lequel se profilent ces trois ou quatre arbres fins et élégants qui semblent les derniers de la terre et les premiers du ciel, c’est le fond préféré de Raphaël. Je ne regrette rien, rien ; et voilà où est le beau du beau, c’est que partout où il est, qu’il soit l’immensité elle-même, comme ici, ou qu’il tienne dans un cadre pendu à un clou, il est complet. Grâce à Dieu, le beau n’a point de mesure : il est tout entier dans un détail aussi bien que dans le plus vaste ensemble…
J’interrompis Georges :
– Tiens, tiens, lui dis-je, qu’est-ce qui me tombe donc sur la main ? comme c’est chaud !
– Eh mais, dit Georges, entendez-vous ? qu’est-ce qui rugit donc là-bas ?
– C’est un lion, Georges, ou un orage.
– Un lion, Maurice, un lion égaré en Saxe, en Saxonie comme disent les Allemands quand ils parlent français ? Je ne crois pas.
– Mettons alors que ce soit le tonnerre, mon ami, et n’en parlons plus. Cette armée de tambours a dix lieues à faire avant d’être ici.
– Ne vous y fiez pas, répondit Georges ; le tonnerre a les jambes plus longues que vous ne pensez. C’est, parbleu ! bien un bel et bon orage qui nous arrive.
– Qu’il soit le bienvenu, mon cher Georges. Le concert s’ouvre à point pour justifier vos propos de tantôt. Notre tableau va parler.
Georges avait raison. Le tonnerre avait fait en un clin d’œil une si grande enjambée qu’il me coupa la parole.
– Tudieu ! voilà qui est s’exprimer en maître, dit Georges ravi ; quel coup d’archet magistral, quelle basse-taille il a, mon cher Maurice, – le tonnerre de la Bastei !
– Eh ! quoi ! Georges, vous faites des calembours ?
– Hélas ! oui, reprit Georges d’un air contrit, mais c’était sans le savoir, mon ami.
– Messieurs, dit le kellner nous hélant, j’ai servi votre café dans la salle commune, vous n’aurez que le temps d’accourir si vous ne voulez pas être arrosés.
Le kellner avait dit vrai. Nous n’avions pas fait vingt pas que le déluge commençait.
Je ne voudrais pas faire de tort à l’orage des plaines ; le tonnerre roulant à son aise sur les champs de blé de la Beauce m’a trouvé plus d’une fois respectueux ; mais quelle infériorité il a, bon Dieu ! à bonne volonté égale, sur le tonnerre de la montagne ! et combien je préfère le tumulte des batailles shakspeariennes de ce maître des tonnerres, le tonnerre des lieux élevés, aux tranquilles et classiques grondements du sage tonnerre des terrains plats !
Georges était sans doute de mon avis.
– Du moins, me dit-il en s’épongeant avec la serviette que lui tendait le kellner, du moins, dans les montagnes tout orage est une tempête. Tenez, Maurice, rien ne manque à la fête. C’est la nuit dans le jour. Et comme c’est bien compris, ces ténèbres soudaines ! comme l’effet y gagne ! quel art ! un orage sans nuit, c’eût été un feu d’artifice à midi.
Le kellner allait fermer les fenêtres.
– Non pas, dit Georges ; laissez-nous-en deux, mon garçon ; une pour chacun. Ce ne sera pas trop pour bien voir.
– Yes, mylord, dit le kellner répondant à Georges.
– Comment, yes ? Est-ce que vous parlez anglais quand il tonne, mon garçon ?
– Faites excuse, dit le kellner ; c’est qu’en voyant tout à l’heure que Votre Seigneurie faisait quelque chose qui n’est pas raisonnable, je me suis dit : « Imbécile, ce monsieur est Anglais, et tu as tort de lui adresser la parole en français. »
– Merci pour les Anglais et pour moi, dit Georges riant de bon cœur. Votre explication me satisfait, mon ami. Je ne m’attendais pas à trouver sur la Bastei un garçon aussi futé.
– Ne dis pas de mal des garçons, dis-je à Georges ; j’ai remarqué que rien ne développe l’esprit d’observation comme d’avoir une serviette sous le bras et un tablier blanc autour des reins dans les lieux publics. J’ai connu au café Cardinal un garçon qui en aurait remontré à Balzac pour deviner, à première vue, le caractère et le goût des gens qu’il avait à servir. Il m’était devenu impossible de déjeuner sans son assistance.
– Je ne te savais pas cette estime pour ces messieurs, me répondit Georges en allumant son cigare.
– Estime justifiée, répondis-je. Te rappelles-tu le grand Louis, un Piémontais, je crois, l’ami intime de toute sa clientèle, laquelle pourtant est une clientèle distinguée ? Il me servait un matin deux œufs frais. Un monsieur entre fort affairé :
– Garçon ! dit-il.
Louis me quitta.
– Que veut monsieur ?
– Donnez-moi la carte.
Louis passa la carte à l’homme pressé qui la feuilleta et la refeuilleta, livré, à ce qu’il paraissait, à toutes les angoisses d’une déplorable incertitude.
Louis me regarda d’un air narquois, et, ouvrant la petite porte qui donnait sur l’office :
– Un beefsteak aux pommes pour le 8, cria-t-il au chef.
– Mais, lui dis-je, ce monsieur n’a encore rien demandé !
– Règle générale, me dit Louis d’un ton où perçait le juste sentiment de son infaillibilité, quand un client consulte la carte pendant trop longtemps, il est impossible qu’il ne finisse pas par demander un beefsteak.
Le flair de Louis ne l’avait pas trompé. Le numéro 8, découragé, venait de jeter la carte sur la table avec humeur et, s’adressant à Louis :
– Donnez-moi un beefsteak, lui disait-il.
Et maintenant, ô Georges ! comprenez-vous mon admiration pour les garçons de café ?
Je ne répondrais pas que Georges eût écouté mon histoire jusqu’au bout, mais j’avais derrière moi deux oreilles qui n’en avaient pas perdu un mot. C’étaient celles du garçon de la Bastei, que je croyais bien loin. La bonne opinion que j’avais exprimée pour les gens de sa profession me parut l’avoir attendri.
– Si monsieur revient à la Bastei et que j’y sois encore, me dit-il, il peut être sûr d’être bien servi par Nickel.
– Tiens ! lui dit Georges, vous êtes encore là, vous ? mais nous n’avions plus besoin de rien, mon ami ; vous pouviez vous retirer.
– C’est que, dit Nickel en s’adressant plus spécialement à moi, qui avais visiblement pris le pas sur Georges dans ses faveurs, c’est que je voulais demander à monsieur s’il faut lui retenir un lit.
– Un lit ! m’écriai-je, et pourquoi faire ? Nous comptons coucher à Dresde, mon garçon.
– On ne redescend pas la nuit de la Bastei quand il a plu, me répondit M. Nickel ; l’orage a grossi les ruisseaux, et cela serait impossible même à mylord.
– Comment, mylord ? dit Georges.
– Si ce garçon tient à ce que tu sois Anglais, dis-je à Georges, laisse-le faire.
– Au fait… dit Georges.
– Nous n’avons que trois lits, reprit le kellner sans se déferrer.
– Eh bien ! dit Georges, trois lits pour deux, cela n’a rien d’inquiétant.
– Pour deux, non, dit le kellner, mais pour dix ! Si mylord m’avait laissé dire, il saurait déjà qu’une demi-heure avant son arrivée nous avions ici huit personnes. Ces personnes ont été faire un tour dans les rochers ; dès que l’orage le leur permettra, elles rentreront ; elles ne redescendront pas plus que ces messieurs de la Bastei, et les lits seront pour ceux qui les auront demandés les premiers.
– Diable ! dit Georges, cela change la thèse. Retenez-nous deux chambres, monsieur le garçon ; deux belles, qui aient la vue de ce côté… et appelez-moi mylord tant que vous voudrez. Je commence à me sentir pour les garçons de café en général, et pour le kellner de la Bastei en particulier, la même sympathie que mon ami Maurice.
Le kellner salua Georges d’un air satisfait, il me fit un signe de tête particulièrement amical, et nous laissa seuls devant les cieux déchaînés.
– Rester ici ne serait rien, dit Georges, après quelques minutes d’une muette contemplation, car voir le soleil se lever sur la Bastei après l’y avoir vu ce soir disparaître dans un orage n’a rien en soi de désobligeant ; mais ce qui me chiffonne, c’est que si la société que nous a prédite votre Nickel n’est pas noyée tout entière par cette inondation, nous ne serons plus seuls dans ce cabaret. Vous verrez, Maurice, que tout ce monde-là va nous gâter notre tempête de ce soir et notre aurore de demain : trop heureux si notre nuit ne s’en ressent pas !
– Bah ! dis-je à Georges, la maison est grande.
– Oui, me répondit Georges ; mais trois lits ne sont toujours que trois lits, et il ne faudrait pas trop nous étonner si, dans un pays où c’est une politesse à se faire que de boire dans le même pot, quelque bon Allemand, effrayé de la perspective d’un gros rhume, nous demandait sans façon la permission de partager nos chambres et peut-être nos lits ! Nous sommes dans une contrée patriarcale, ô Maurice !
– Partager nos lits !… m’écriai-je consterné, nos lits ! mais j’aimerais mille fois mieux les donner tout à fait et coucher sur cette table.
– Vous n’êtes pas dégoûté, répliqua Georges. La nappe est presque blanche, et elle vaudrait toujours mieux, pour nous couvrir cette nuit, que les mouchoirs de poche et les damnés plumeaux qui nous sont probablement réservés.
– Ah ! Georges, m’écriai-je douloureusement, mon cher Georges, pourquoi m’avez-vous amené ici ?
– Ingrat ! répliqua Georges ; mais regardez donc ces splendides éclairs ! mais écoutez donc ce vacarme ! mais admirez donc ce ciel bouleversé !
Je me dressai subitement sur mes pieds.
– Ah çà ! qu’est-ce qui vous prend ? dit Georges. J’ai cru, Dieu me pardonne, que vous aviez avalé ce coup de tonnerre.
– Ce qui me prend, m’écriai-je, ce qui me prend !… Ah ! comment ai-je pu l’oublier ? Si je ne suis pas à Dresde ce soir, à minuit, ni avant ni après, je suis un homme perdu, déshonoré, et, qui pis est, désespéré, Georges.
– Allons, bon ! dit Georges avec un flegme qui redoubla ma colère, voilà bien une autre histoire ! Mais calmez-vous, Maurice ; le sage est celui qui sait prendre son parti de ce qu’il ne peut empêcher. Le garçon que vous aimez a dit vrai : retourner à Dresde est aussi impossible que de monter dans la lune. Vous ne pouvez arriver ce soir, ni vivant ni mort, à l’hôtel de Bellevue. Et cela étant ainsi, maudissez-moi, mais asseyez-vous !
– M’asseoir ! dis-je à Georges, vous n’y pensez pas. J’ai du feu dans les veines, et je ne m’assoirai de ma vie.
– Que diable ! me dit Georges, je n’imagine pas qu’un galant homme puisse jamais être déshonoré parce que la terre lui manque sous les pieds. Vous deviez être à minuit à Dresde ; mais par une circonstance plus forte que toutes les volontés humaines, vous n’y pouvez rentrer que demain matin. Eh bien ! vous en serez quitte pour dire demain à la nécessité quelconque qui vous y appelait ce soir, qu’attendu que vous n’êtes ni un nuage ni un ballon, qu’attendu que vous n’êtes qu’un bipède, vous n’avez pu fendre les airs et vous y rendre. Vous le direz, je le dirai ; et ceux qui ne le croiront pas sur notre double affirmation, eh bien ! que le plus grand des diables d’Allemagne les emporte ! Mais nous trouverons bien, je vous le jure, quelque moyen d’avoir raison de leur incrédulité.
Je me promenais de long en large, fort agité.
– De par tous les saints du paradis, me dit Georges, dites-moi quelle mouche vous pique ; dites-moi ce que vous aviez à faire à Dresde, à minuit. Minuit, ce n’est l’heure de rien qui ne puisse se remettre. On ne se bat pas à minuit, que je sache ; ce n’est donc pas d’une affaire d’honneur qu’il s’agit, et, fût-ce une affaire d’honneur, le coup d’épée le plus mérité peut attendre. Parlez, mon bon Maurice, ou cela va être à mon tour de devenir enragé.
Je m’étais assis sans répondre, et les dents très serrées.
– Êtes-vous muet ? me dit Georges.
– Non…
– Êtes-vous fou ? me cria-t-il.
– On le serait à moins…
– Pour cette fois, j’y suis, reprit Georges en se frappant le front. Ah ! mon pauvre ami, pardonnez-moi ; il y a là-dessous une affaire de cœur, je le vois. Il n’y a qu’une femme, il n’y a qu’une folie d’amour qui puisse mettre un homme raisonnable dans l’état déplorable où vous êtes.
– Eh bien ! dis-je à Georges en poussant un gémissement à côté duquel ceux de la tempête n’étaient qu’un zéphyr, mettez qu’il y ait une femme en effet au fond de mon chagrin.
– Diable ! dit Georges en se grattant la tête, diable ! Mais enfin, Maurice, une affaire de cœur, c’est un duel aussi, et, comme un duel, cela peut se retrouver sans doute. Allons, mon ami, ayez confiance en moi, et, dussé-je faire cent lieues à pied pour réparer la sottise dont je suis la cause involontaire, je les ferai. J’irai demain trouver celle qui vous attend ce soir, je me jetterai à ses genoux…
– Non pas ! m’écriai-je.
– Mais… reprit Georges, souriant de la vivacité de ma réplique.
– Ne m’interrogez pas davantage, lui répondis-je ; ce qui est fait est fait, et c’est irréparable. Il y a deux ans, deux siècles ! que je cours après le rêve que j’allais atteindre aujourd’hui, et ce rêve est perdu à jamais ; et si je dis à jamais, c’est que c’est à jamais en effet. Voyons, Georges, supposez que, par une bonne fortune inouïe, une bulle d’air quelconque, quelque chose d’impalpable comme un sylphe, un oiseau rare, un être insaisissable, par vous longtemps et ardemment poursuivi, supposez que cet être unique, que ce phénix soit dans votre main… je vous distrais un instant, votre main s’ouvre, l’oiseau s’envole et disparaît dans les nuées ; croyez-vous que je pourrais vous le ramener en me jetant à ses genoux ?…
Georges courba la tête.
– Je suis un scélérat, me dit-il ; vous devez avoir envie de me tuer ; tuez-moi…
Je ne sais ce que j’allais lui répondre, quand une espèce de fantôme, se dressant tout à coup sous ma fenêtre, l’enjamba sans plus de façon.
– Qui êtes-vous ? dit Georges en se jetant au-devant de ce singulier visiteur.
– Je suis un naufragé de la Méduse