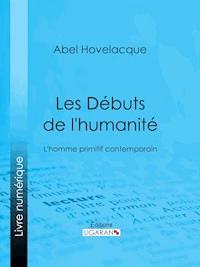
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "Le célèbre voyageur Dumont d'Urville ne passa que fort peu de temps en Australie, mais il sut mettre à profit ce court séjour. Dès son arrivée, il fut à même de rencontrer et d'étudier les indigènes du pays ; on sait avec quel soin et quelle exactitude étaient faites ses observations. Il apprend qu'à un mille environ du mouillage résidait une tribu composée d'une quinzaine d'individus, — mais laissons-lui la parole."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
On rencontre de nos jours encore des populations humaines qui sont la vivante image des anciennes races préhistoriques. Un des résultats les plus instructifs de l’anthropologie moderne est d’avoir reconnu la lointaine civilisation qui a caractérisé partout les débuts de l’humanité. Nous savons, par les témoignages mêmes de sa première industrie, comment l’homme, se dégageant peu à peu des frères inférieurs, a passé, par une série d’évolutions, de la vie vagabonde et famélique à la condition de pasteur plus ou moins nomade, puis à celle d’agriculteur.
Notre écrit sur les débuts de l’humanité n’est point consacré à l’étude de la préhistoire, de la paléoethnologie : nous nous occupons de races toutes contemporaines, nous nous occupons de ces populations stationnaires qui présentent à nos yeux un tableau fidèle de la civilisation humaine primitive.
Certes, les Australiens, les Andamanites, les Veddahs de Ceylan, les Botocudos du Brésil, les habitants de la Terre-de-Feu, les Bochimans de l’Afrique Australe, ne sont pas les seules populations qui occupent à l’heure actuelle les derniers (ou les premiers) degrés de l’échelle humaine. Il en est d’autres que nous aurions pu comprendre dans cette étude, notamment certaines races de l’extrême Orient. Nous n’avons pas cherché à être complet dans cette énumération. Nous avons voulu, du moins, être descripteur fidèle. On attribuera à ce souci les nombreuses citations dont notre écrit est chargé et que nous avons choisies parmi les plus caractéristiques.
Le lecteur tirera sans peine de chacune de nos monographies les enseignements qui s’en dégagent. Nous avons pensé, toutefois, qu’il pouvait être bon de consacrer un chapitre terminal, sous forme de conclusion, à une espèce de récapitulation et de coup d’œil général. On voudra bien remarquer que notre exposé n’a point le caractère cherché d’un plaidoyer. Nous avons réuni des faits, nous avons voulu les présenter avec méthode, et ces faits doivent parler d’eux-mêmes. Peut-être n’auront-ils pas le don de plaire à tous ceux qui parcourront ce livre. Mais l’ethnographie demande à ses disciples une grande dose de sang-froid et de tolérance : elle nous apprend à nous pardonner réciproquement nos défaillances et nos sottises ; elle nous apprend que les plus honnêtes gens peuvent donner à des points de morale des solutions tout à fait différentes ; qu’il est sans utilité de s’entrégorger pour des diversités d’opinions ; que toutes les disciplines religieuses ayant été essentiellement intolérantes et cruelles, il est utile et moral d’en délivrer pacifiquement l’humanité ; elle nous apprend enfin comment nous pouvons et comment nous devons arriver au but de la civilisation, à l’égalité sociale.
A.H.
Le célèbre voyageur Dumont d’Urville ne passa que fort peu de temps en Australie, mais il sut mettre à profit ce court séjour. Dès son arrivée, il fut à même de rencontrer et d’étudier les indigènes du pays ; on sait avec quel soin et quelle exactitude étaient faites ses observations.
Il apprend qu’à un mille environ du mouillage résidait une tribu composée d’une quinzaine d’individus, – mais laissons-lui la parole : « D’après les rapports des matelots dit-il, c’étaient des hommes tout à fait inoffensifs, et qui, de temps à autre, venaient rendre aux Européens des visites amicales. Comme je témoignais au capitaine le désir d’étudier promptement cette race si curieuse pour la science ethnologique : "Mon dieu, répliqua-t-il, vous serez servi à point ! Voici un de ces sauvages. Regardez là, sur l’avant de la baleinière. " – Je jetai un coup d’œil sur le point qu’il m’indiquait, et je vis un objet qui ne pouvait, en aucune manière, passer pour un homme. C’en était pourtant un qui ne montrait alors que la partie dorsale. Dans cette position, on l’eût pris pour une peau de bête étendue au soleil. Sur un appel des matelots, cet objet se tourna de notre côté. Rien de plus hideux au monde. Qu’on se figure une grosse tête garnie de cheveux ébouriffés, avec une face plate, élargie transversalement, des arcades sourcilières très saillantes, des yeux d’un blanc jaunâtre très enfoncés, des narines écrasées et écartées, des lèvres passablement grosses, des gencives blafardes et une bouche très grande ; qu’on ajoute à cela un teint de suie, un corps maigre et grêle, et des jambes plus grêles encore. La disproportion des bras et des jambes est telle qu’on peut très bien comparer ces individus à certains oiseaux de la famille des échassiers. Maintenant, qu’à un corps ainsi constitué on donne pour vêtement une peau de kangourou bien râpée, ne couvrant guère d’un côté que la moitié de la poitrine et tombant à peine, de l’autre, jusqu’à la chute des reins, et l’on aura une idée assez complète des autochthones de l’Australie ».
Et pourtant, l’individu qu’avait sous les yeux Dumont d’Urville, n’était point, comme il l’ajoute, « parmi les êtres les plus disgraciés de cette race ». Devenu l’hôte des Anglais et connaissant quelques mots de leur langue « il se plaisait à leur rendre une foule de petits services, heureux d’obtenir en retour une nourriture plus abondante et plus substantielle que celle qu’il pouvait se procurer sur le continent ». Sans doute, ce portrait n’est point flatteur, mais nous verrons qu’il n’est pas au-dessous du modèle et que le peintre a représenté avec une parfaite exactitude ce que ses yeux avaient vu et bien vu.
Les premiers navigateurs européens qui reconnurent le continent australien, particulièrement sur les côtes du nord-ouest, du nord et du nord-est, furent, selon toute vraisemblance, des Portugais, au cours du seizième siècle. Avec le dix-septième siècle, commencent les expéditions des Hollandais (la première en 1606), et le nouveau continent reçoit le nom de Nouvelle-Hollande, qu’il devait perdre au temps des expéditions anglaises, pour prendre celui d’Australie. Mais avant l’arrivée des Européens, bien longtemps avant sans doute, l’Australie avait déjà été visitée par d’autres populations : par des Malais venant des îles nombreuses de la région du nord-ouest, par des Papous venant du nord, particulièrement de la Nouvelle-Guinée.
Cette double et fort ancienne immigration ne saurait être mise en doute ; elle est prouvée jusqu’à l’évidence par l’existence d’assez nombreux métis chez lesquels se trahit plus ou moins le type malais, et d’un plus grand nombre encore d’individus qui présentent d’une façon incontestable tels ou tels caractères de la race des Papous.
Dans le pays d’Arnbem, tout au nord de l’Australie septentrionale, la presqu’île de Cobourg renferme des métis non douteux de Malais et d’Australiens ; la peau est toujours obscure, mais parfois cuivrée ; la chevelure est celle des Malais. Aux îles Bathurst et Melville, voisines occidentales de la presqu’île de Cobourg, même métissage, même cheveux roides ayant l’apparence du crin de cheval. Par contre, il faudrait rattacher à la race des Papous la plus grande partie des Australiens appartenant au type inférieur.
On distingue, en effet, chez les Australiens, et cela à très juste titre, deux types bien distincts l’un de l’autre ; tous les voyageurs qui ont été en contact avec les indigènes de la Nouvelle-Hollande, sur plusieurs points du territoire occupé par eux, s’accordent, unanimement à reconnaître ces deux types. En quelques mots, les principales différences sont les suivantes : dans le type inférieur, taille petite, cheveux plus ou moins crépelus, faible musculature, proportion quasi-simienne des membres, apparence générale abjecte ; dans l’autre type, taille élevée, cheveux droits, musculature développée, proportions régulières pour des yeux européens. C’est ce qu’a formulé M. Topinard dans la conclusion de son Étude sur les races indigènes de l’Australie : « En résumé, j’admets qu’il existe en Australie deux éléments ethniques primordiaux qui, par leur mélange en proportions variables, forment une série dont les deux extrêmes correspondent à deux races distinctes.
La première est dolichocéphale, de haute taille, robuste et bien proportionnée de corps ; elle a les cheveux longs, droits et lisses, les traits vigoureusement dessinés, et la peau couleur chocolat ou cuivre foncé. D’une intelligence proportionnée à des besoins restreints et appropriée au milieu où elle se meut, ses générations actuelles se refusent à accepter la vie sociale comme la comprennent les Aryens. Donc, comme toute créature jetée hors de son milieu, elle devra succomber. Ses représentants sont encore nombreux et constituent la masse de la population indigène du continent.
La seconde est plus dolichocéphale, encore de petite taille, mal faite de corps ; elle a le teint noir foncé, les cheveux frisés ou crépus, le crâne petit et rond, les mâchoires très prognathes, la sclérotique jaunâtre, les pieds plats, pas de mollets, etc. Ces caractères, plus ou moins négroïdes à l’origine, restent d’ailleurs à préciser. D’une intelligence moindre que la précédente, elle semble presque incapable de subvenir à ses besoins. De notre civilisation elle n’adopte que les vices, et s’éteint d’autant plus rapidement que les européens sont entrés en contact avec elle les premiers. Depuis longtemps, elle obéissait à la loi de concurrence vitale vis-à-vis de l’autre race ; l’intervention aryenne lui a porté le dernier coup. Il y a donc urgence d’en étudier les misérables restes, représentés çà et là dans les tribus mixtes, par les femmes surtout et par les cas d’avatisme, et peut-être aussi dans quelques rares tribus inférieures ».
Le même auteur a développé plus tard celle même idée dans une autre étude d’ensemble (Revue d’anthropologie, t. I, page 301) : « Lorsqu’on analyse sans se laisser influencer par les idées admises les récits mêmes des voyageurs dont M. Wake invoque l’autorité, on ne tarde pas à s’apercevoir que le type des Australiens n’est pas aussi uniforme qu’ils le disent, et qu’ils pourraient bien, comme le professe M. de Rochas, ne pas plus se ressembler entre eux que le Normand ne ressemble au Basque ou le Flamand au Provençal. On arrive même à cette conviction que l’Australien actuel est le résultat de plusieurs mélanges dont les deux éléments principaux sont une race grande, au teint brun cuivré, bien proportionnée de corps et aux cheveux lisses, et une race petite, noire, aux cheveux frisés et crépus dont les diverses parties du corps sont dans des proportions différentes.
Le type pur de l’élément supérieur est très commun, à ce point qu’il a presque seul fixé l’attention ; mais le type inférieur se retrouve-t-il encore à l’état tout à fait pur, sous forme de tribus entières ? Voilà la question. En tous cas on peut l’étudier, grâce à l’atavisme, en particulier chez les femmes, qui, comme on le sait conservent mieux les caractères de leur souche originelle.
La proposition que nous formulons est confirmée par des différences de caractère, d’aptitude et d’intelligence parmi les Australiens qui rendent compte de bien des discordances dans les appréciations des auteurs.
Que l’on compare d’abord la description des sauvages que Tasman en 1644 et Dampier en 1686 virent sur la côte nord-ouest, à celle des sauvages avec lesquels le capitaine Cook entra en relation en 1770 à la baie d’Endeavour sur la côte nord-est. Les premiers ont des cheveux frisés (Tasman) ou curled, comme ceux des nègres, et non lisses comme ceux des Indiens (Dampier). Pas de barbe, un teint très noir, des traits hideux d’un aspect misérable. Ils n’ont ni abri ni procédé de navigation. Les seconds ont les cheveux généralement lisses, une barbe touffue, un teint brun chocolat, une physionomie agréable et un corps bien proportionné ; leur nez n’est pas plat, leurs lèvres ne sont pas grosses comme chez les premiers ; ils se construisent des huttes, et ont des pirogues, quelques-unes même accouplées et pourvues d’une plateforme intermédiaire.
Dès l’occupation de Botany-Bay par les Anglais, en 1788, le capitaine Hunter remarquait que le teint de certaines femmes était aussi clair que celui des mulâtresses et faisait un contraste avec la coloration noire des indigènes environnants. Collins de son côté, en 1802, trouvait que les naturels que l’on rencontrait dans les bois en arrière du littoral n’avaient pas la même physionomie que ceux du rivage. De même Freycinet après avoir dépeint sous l’aspect le plus hideux les sauvages de cette localité, s’étonnait de découvrir parmi eux de jolies figures et des formes tout européennes, et ajoutait que ceux de l’inférieur avaient les membres plus longs et mieux développés. Lesson, Dumont d’Urville, Pickering et autres font de semblables remarques. Un colon de Bathurst va jusqu’à dire d’un chef, en 1826, qu’il pourrait poser pour la statue d’Apollon.
Dumont d’Urville a même généralisé davantage. Après avoir donné la description des naturels du port du Roi George que chacun connaît, il continue ainsi :
Plusieurs tribus offrent des caractères plus nobles d’organisation, comme les tribus de Marrigong, de la baie de Jervis et de Port-Western. » À l’île des Kangourous, côte du sud, en présence de deux indigènes différents sous quelques rapports de ceux qu’il venait de voir, il laisse échapper cette réflexion : Ils semblent appartenir à une autre race.
Hombron est plus catégorique : « Il existe, dit-il, plusieurs espèces d’hommes sur le continent australien ; il est pour nous indubitable que les naturels de la Nouvelle-Galles du Sud ne ressemblent pas à ceux de la côte du Nord de l’Australie. »
En fait, nous le répétons, tous les voyageurs qui ont parcouru différentes régions de l’Australie, ont reconnu sans peine et ont décrit les deux types. « Parmi les Australiens que j’ai observés, dit Pickering, les uns étaient d’une laideur indicible, mais d’autres, contre toutes prévisions, avaient une figure réellement belle, et nulle part je ne rencontrai l’amaigrissement extrême dont on gratifie habituellement les Australiens. Quelque étrange que cela paraisse, je considère au contraire l’Australien comme le plus beau modèle des proportions humaines : ses muscles Syrmétriquement développés expriment la force et l’agilité, sa tête peut être comparée au masque du philosophe antique. » Jardine parle de tribus à nez aquilin, à traits bien accusés, à cheveux droits, puis il mentionne d’autres aborigènes à tête laineuse et qu’il place au dernier degré de l’humanité. M. Topinard, dans les articles plus haut mentionnés, a accumulé les témoignages de la coexistence de ces deux types, et a signalé certaines contrées où le mélange des deux races avait formé un type mixte, un type intermédiaire.
Le capitaine Péron a tracé un assez bon portrait du type inférieur ; nous le reproduisons ici. Ce portrait peut faire comprendre bien des points sur lesquels nous aurons tout à l’heure à revenir, et il concorde tout à fait avec le passage de Dumont d’Urville que nous avons rapporté ci-dessus : « Malgré le bon accueil que les naturels de l’île reçoivent à Sydney-Cove, ils fréquentent peu cet établissement. Ils ont les cheveux crépus, le visage long, les yeux grands, la prunelle petite, le globe de l’œil très clair, les sourcils épais, les cils très longs, les cils supérieurs dirigés en haut et les inférieurs en bas, d’une manière tranchante ; les pommettes des joues élevées et saillantes, ce qui creuse le bas de la joue ; leur nez est court et plat ; ils y passent un os de kanguroo, de la grosseur d’un tuyau de plume et d’une longueur de dix à douze pouces ; leur bouche est une fois plus grande que celle des Européens et s’avance à la rencontre des oreilles ; celles-ci sont ornées de lanières étroites de cuivre ; leurs lèvres, épaisses et toujours entrouvertes, laissent apercevoir de belles dents ; leur menton est pointu et couvert de barbe ; la peau du visage et du reste du corps est d’un beau noir.
Leur taille varie de quatre pieds et demi à cinq pieds deux ou trois pouces ; le tronc du corps est court, ce qui donne à leurs bras et à leurs cuisses une longueur démesurée ; ils ont les mains sèches, les doigts maigres et longs, les cuisses décharnées ; leurs jambes cambrées et sans mollet, sont comme fichées au milieu du pied, qui est plat et allongé ; le talon forme une saillie d’au moins un pouce et demi en arrière du bas de la jambe. »
On pourrait opposer à ce tableau la description que donne Burke, de la race forte et bien développée qu’il rencontra dans l’intérieur des terres ; la description par Gregory de la race à grande taille qu’il vit dans l’Australie du nord-ouest, puis les descriptions de Mac Kinlay et de Stuart ; ce dernier, d’ailleurs, parle aussi des misérables tribus avec lesquelles il fut en contact aux environs des rivages de la mer.
Il a été dit par quelques auteurs que les tribus les plus hideuses étaient précisément celles qui se rencontrent dans le voisinage des établissements européens ; on se trouvait, dans ce cas, en présence d’individus que le contact avec notre civilisation avait rapidement dégradés. Cette assertion demande à peine à être réfutée. Il est vrai que la juxtaposition brusque de deux races très différentes en civilisation est toujours fatale à la race inférieure ; mais il est clair, en la circonstance, que le temps depuis lequel Européens et Australiens se trouvent en contact, est fort loin d’être suffisant pour faire passer les belles tribus de l’intérieur à la condition abjecte et soi-disant dégradée des tribus qui habitent les côtes.
C’est bien sur les côtes, et par conséquent, immédiatement en rapport avec les établissements anglais, que se trouvent les tribus du type inférieur. Ici encore nous avons les témoignages concordants de tous les voyageurs. C’est par exception qu’une tribu supérieure se rencontre dans les environs du littoral ; c’est par exception que quelqu’une des tribus les plus misérables se rencontre dans l’intérieur des terres. M. Topinard (op. cit.) a étudié cette question de la distribution géographique des deux types ; il a relevé les indications que lui a fournies la lecture des nombreux auteurs qui ont écrit sur l’Australie, et il a donné la raison très simple et très juste de ce fait que les tribus supérieures, contrairement à ce qui se passe dans presque toutes les autres régions, occupent l’intérieur du pays, tandis que les tribus du type inférieur avoisinent le littoral : « Contrairement à ce qui a lieu d’ordinaire, la race supérieure, c’est-à-dire selon la règle la race conquérante, occuperait, d’une façon générale, le centre de l’île ; et la race inférieure ou soumise, la périphérie. La disposition des lieux l’explique. Presque tout autour de l’Australie s’étend une zone aride et sablonneuse au-delà de laquelle le sol s’élève pour donner lieu à une contrée luxuriante. La race intelligente s’est donc emparée des cantons favorisés laissant à la race paria le littoral ingrat.
Dès que le rivage redevient favorable, la race supérieure y apparaît, comme sur la côte nord-est au fond du golfe de Carpentarie, au voisinage de Melbourne et en cent autres endroits. Il résulte de cette alternance de tribus différentes le long des côtes que les premiers navigateurs, selon le point où ils abordaient, se trouvaient en contact, tantôt avec des êtres malingres, petits et plus ou moins négroïdes, tantôt avec de beaux gaillards grands et bien faits. Mais la zone envahie par la civilisation européenne est précisément celle qu’occupaient ces races inférieures. Ce sont elles qui les premières ont attiré l’attention. C’est sur elles, ne sachant ni reculer, ni subvenir à leurs besoins dans le milieu nouveau qu’on leur imposait, ni résister à leurs appétits pour l’alcool, qu’a frappé la mortalité. Aussi, la race supérieure se maintient-elle un peu, comme celle des Indiens aux États-Unis, tandis que l’inférieure disparaît à vue d’œil. »
En fait, les Australiens du type inférieur se rencontrent principalement sur la côte nord-ouest, sur la côte ouest, sur la côte sud-ouest : c’est-à-dire sur tout le littoral de la province d’Australie occidentale ; sur quelques points du littoral de l’Australie méridionale (en particulier à l’ouest du golfe Spencer) ; à l’est, non loin de Port-Philippe et de Sydney, puis, dans l’intérieur des terres, sur les bords de la rivière Murrumbidgee ; au centre, dans les environs du lac Eyre ; au nord, sur certains points à l’est et à l’ouest des rivages du Golfe de Carpentarie. Quant aux Australiens du type supérieur, ils sont établis, au nord, parfois sur le littoral, mais presque toujours à une certaine distance de la mer ; puis, à l’est, dans le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud dans l’intérieur du pays. Il y en a parfois, cependant, qui fréquentent le littoral, particulièrement entre Sydney et le cap Howe. En tout cas on peut dire d’une façon générale, avec l’auteur ci-dessus cité, que les indigènes de l’ouest (Australie occidentale) sont inférieurs à ceux du sud et à ceux de la Nouvelle-Galles méridionale, et que ces derniers sont eux-mêmes inférieurs à ceux du Queensland.
Il est à peine besoin d’ajouter que par ce fait qu’ils occupent les régions les plus favorables à leur bien-être – si tant est que l’on puisse parler pour eux de bien-être ! – et qu’ils sont peu en contact avec les blancs, les Australiens du type supérieur ont une carrière bien plus longue à parcourir que celle des Australiens du type inférieur. Ces derniers, placés entre les détenteurs de l’intérieur et les nouveaux possesseurs des côtes, diminuent rapidement et sont voués à une prochaine extinction.
Mais la disparition de la race australienne est un sujet qui nous occupera en temps voulu et sur lequel nous n’avons pas à empiéter en ce moment.
Quoi que l’on puisse penser de l’origine même des Australiens et des liens ethniques qu’ils peuvent avoir avec telles ou telles autres races – soit avec les Papous à chevelure crépue, soit avec les indigènes du sud de l’Inde, à cheveux droits, – quelle que soit la différence que présentent chez les Australiens les deux types nommés ci-dessus ; il n’en est pas moins certain, que, par bien des caractères, il existe entre les deux types en question des affinités évidentes. Dans les pages qui suivent nous emploierons donc d’une façon générale le mot australien ; en principe, ce sont des tribus appartenant au type inférieur que nous allons nous occuper, mais parfois nous relaterons des renseignements qui s’appliquent à des individus du type supérieur. Lorsqu’il y aura intérêt à prévenir qu’il est question d’une façon plus particulière de l’un de ces deux types, nous ne manquerons pas d’en avertir le lecteur.
Pour procéder avec méthode, nous devons commencer par l’examen anatomique ; l’examen des caractères ethnographiques viendra en dernier lieu.
Parmi les caractères les plus frappants ; il en est trois qu’il convient de signaler de prime abord : la taille, la couleur de la peau, la nature des cheveux. L’étude de ces trois caractères démontre sans peine qu’il n’y a point chez les Australiens unité de race, et que différents types ont donné naissance à la population indigène actuelle de la Nouvelle-Hollande.
En ce qui concerne la taille, point de difficultés ; les tribus du type supérieur, qui habitent généralement – comme il a été dit ci-dessus – l’intérieur du pays, sont, par rapport à la moyenne des Européens, ou de taille ordinaire, ou de grande taille ; il y a ici un accord constant de tous les explorateurs de l’Australie. Pickering, et après lui nombre de voyageurs, ont déclaré que certaines tribus australiennes, étaient par leur taille et par l’ensemble des proportions du corps de véritables modèles, comparables à ce que peuvent offrir de plus accompli les peuples de race blanche. Stuart, dans le récit de son Exploration de 1858 à 1862, rapporte qu’au nord du lac Torrens (province de l’Australie méridionale, vers le trentième degré de latitude) il rencontra des Australiens bien plus grands, bien plus forts, bien mieux musclés que ceux avec lesquels il avait été en contact dans la région du littoral. M. Topinard, dans ses différentes études sur les races australiennes, a reproduit les mesures prises par les divers voyageurs qui ont parcouru soit les côtes, soit l’intérieur du pays. Plusieurs auteurs s’accordent à donner aux indigènes du centre, une taille moyenne supérieure à 1m70 centimètres ; il ne serait pas rare, paraît-il, de rencontrer des individus mesurant 1m 85, 1m 90, et Stuart parle d’un indigène qui atteignait 2m 13. Il est de toute évidence qu’il s’agit ici d’un fait exceptionnel ; mais le nombre des témoignages concordants est plus que suffisant pour établir sans conteste que les individus appartenant au type supérieur et habitant le centre du pays, sont de taille fort élevée, variant pour l’ordinaire de 1m 70 à 1m 80, se rapprochant plutôt de cette dernière taille que de la première, et, par conséquent, l’emportant d’une façon sensible sur la moyenne des grandes races germaniques : ils ne le céderaient qu’aux Patagons et aux Polynésiens ; la taille moyenne des Patagons semble être de 1m78, celle des Polynésiens de 1m 76.
Mais, ne l’oublions pas, il ne s’agit ici que des Australiens appartenant au type supérieur, nullement de ceux qui vivent misérablement dans les environs du littoral, et qui représentent le type le plus bestial : non pas, répétons-le, un type dégradé, mais un type disparaissant de jour en jour pour cette double raison que les Européens s’emparent des côtes où il menait sa triste existence, et qu’il ne peut, dans l’intérieur même du pays, déposséder des contrées plus favorables les tribus du type supérieur.
Ici, nous sommes en présence soit de petites, soit de très petites tailles. La moyenne de 1 mètre soixante centimètres (à peu près la taille des Malais, des Cochinchinois) se rencontre chez plusieurs tribus australiennes du littoral, mais il en est un grand nombre qui ne donnent pas plus de 1m 55 ; et si l’on considère non plus l’ensemble des groupes, mais bien les individualités, on arrive fréquemment à des tailles de 1m 50, parfois de 1m 45 seulement. On peut donc dire, d’une façon générale, que l’Australien de la race inférieure ne l’emporte guère, par la taille, que sur les Négritos – dont nous parlerons plus loin – et sur les Bochimans de l’Afrique du sud, les plus petits de tous les hommes.
Nous trouvons de même des différences sensibles en ce qui concerne la couleur de la peau : d’après le dire des voyageurs, elle varie du noir plus ou moins fuligineux au chocolat foncé, à un noir rougeâtre, à une teinte plus ou moins cuivrée. À sa naissance, l’enfant serait moins foncé qu’il ne devrait l’être plus tard. Il n’y a rien d’étonnant dans ce phénomène. Le nègre nouveau-né est rougeâtre ; le Botocudo est d’un jaunâtre beaucoup plus clair que celui qu’il présentera plus tard. Cela tient simplement à une évolution du pigment, de la matière colorante de la face profonde de l’épiderme. En tout cas, bien que dans les tribus à haute taille on rencontre fréquemment des individus de peau franchement noire, c’est plus particulièrement dans les groupes du littoral que la couleur de la peau est de la teinte la plus foncée, et c’est aussi chez eux que la sclérotique, la cornée opaque, membrane qui forme la plus grande partie de la coque extérieure de l’œil, est toujours plus ou moins jaune, même durant la jeunesse.
Quant à l’odeur même de la peau, il est assuré qu’elle doit être caractéristique, mais nous n’avons point sur ce sujet de renseignements bien précis. Les voyageurs signalent toutefois cette odeur et affirment (Mackenzie) que les bestiaux la reconnaissent à distance. Mais il n’y a là ni un caractère d’infériorité, ni un caractère de supériorité ; chaque race a son odeur spéciale plus ou moins repoussante pour une race étrangère.
La diversité qui existe pour la taille et pour la couleur de la peau, semble exister aussi pour le système pileux.
Grant rapporte, dans son Voyage à la Nouvelle-Galles méridionale (1800-1802), que les indigènes de haute taille qui vivent dans l’intérieur des terres ont les cheveux longs, tandis que les indigènes du littoral ont les cheveux bouclés, nullement laineux d’ailleurs. Péron parle également des cheveux crépus qui se rencontrent dans certaines tribus. De tous les renseignements que fournissent les explorateurs de l’Australie il semble résulter que la chevelure est, en principe, lisse et assez souple dans les deux types, plus ou moins ondulée, mais que le type inférieur a généralement les cheveux pour ainsi dire crépus, des cheveux, comme dit Stokes « qui ne sont ni droits ni bouclés ». C’est ce que M. Topinard appelle des cheveux naturellement « crêpés ». Nous trouvons, d’ailleurs, des spécimens assez fréquents de cette sorte de cheveux dans les races d’Europe.
À la vérité, plus d’une tribu appartenant par la taille et la proportion des membres au type supérieur possède des cheveux « crêpés », et plus d’une tribu du type inférieur a des cheveux à peu près lisses ; mais il semble difficile d’admettre avec M. Stan. Wake que ce dernier cas soit la règle. Il y a ici, selon toute vraisemblance, une question de métissage et de degrés de métissage.
En tout cas, le système pileux paraît être assez développé sur tout l’ensemble du corps chez les individus des deux races. Celle du type inférieur posséderait ce caractère à un bien plus haut degré que la race de haute taille : ses épaules, sa poitrine seraient presque entièrement couvertes de poils plus ou moins crépus. Quelques voyageurs ont bien parlé d’Australiens relativement glabres, mais ces faits particuliers ne peuvent être relevés qu’en tant qu’ils se rencontrent fort rarement.
Pour terminer cette première et sommaire description il y a quelques mots à ajouter sur la proportion des membres. Les tribus de haute taille offrent sans nul doute de fort beaux types, tous les explorateurs de l’Australie centrale s’accordent à le déclarer et parlent d’individus qui, au milieu de nous, pourraient servir de modèles ; mais dans toutes les tribus de petite taille, c’est-à-dire dans la plus grande partie des tribus avoisinant le littoral il est bien loin d’en être ainsi ; les membres sont tout à fait grêles « les jambes exiguës » (Voyage de l’Astrolabe), et particulièrement émaciées, en tout cas hors de toute proportion avec le buste. Le mollet est presque absent. Le pied est plat et large, le talon fortement saillant. Stuart raconte qu’il reconnaissait le passage des indigènes du type le plus élevé à ce fait que les vestiges imprimés par leurs pieds sur la terre indiquaient un creux au milieu de la plante. Rien de semblable chez les individus du type inférieur dont le pied se marque sans discontinuité aucune. Mackenzie parle un termes formels de la facilité de préhension des orteils : une arme, dit-il, une lance vient-elle à tomber, les indigènes la saisissent avec les orteils, la jettent en l’air et la reçoivent dans la main. Ce caractère est particulier d’ailleurs à toutes les races inférieures : on l’a constaté maintes fois, par exemple, chez les Nègres africains. Nous verrons plus loin que, lorsque, pour les besoins de la chasse, l’Australien doit grimper sur un arbre élevé, il entaille le tronc peu à peu, de bas en haut, et que le pouce du pied lui permet de s’accrocher à ces entailles, de les saisir, et de s’attacher à l’arbre qu’il ne pourrait entourer de ses bras.
Il est à peine utile d’ajouter que ces membres grêles et émaciés ne laissent supposer qu’une force musculaire peu considérable. C’est un fait que l’on a constaté maintes et maintes fois. « Leurs corps, dit Rienzi, sont mous comme ceux des femmes ». Il semble même que l’Australien, bien qu’errant et vagabond et habitué à marcher chaque jour, suive avec difficulté l’allure d’un Européen ; s’il l’accompagne, c’est à la condition de s’arrêter souvent pour reprendre des forces : il ne peut fournir, sans repos, une seule et longue traite.
Deux mots enfin pour compléter ce tableau du premier coup d’œil : chez l’homme et chez la femme un ventre extraordinairement proéminent ; chez la femme des seins allongés et tombant d’une façon exceptionnelle.
Nous avons à parler maintenant de quelques caractères plus particuliers, moins frappants au premier abord, mais dont l’examen, même rapide, a quelque intérêt.
Tout d’abord la tête.
À première vue elle semble démesurément grosse, mais ce n’est qu’une apparence à laquelle il ne faut pas se laisser prendre. La face est considérable sans doute, par suite de la projection des mâchoires, projection dont nous aurons tout à l’heure à parler, mais le crâne même est d’une très minime capacité.
Le cubage, régularisé avec une extrême exactitude par la méthode Broca, donne pour la capacité du crâne celtique moderne (hommes et femmes de l’Auvergne, de la France centrale, de la Bretagne) environ 1 485 centimètres cubes. La moyenne des Basques espagnols et celle des Corses est moindre de vingt centimètres. Pour les nègres de l’Afrique occidentale, la moyenne des hommes est de 1 430 ; celle des femmes de 1 250. Si nous arrivons aux Australiens, nous sommes aux derniers échelons de la série : 1 345 cent cubes pour les hommes, 1 180 pour les femmes. Ce qui revient à dire que l’organe contenu dans la cavité du crâne a pour se loger, 85 centimètres cubes de moins chez l’Australien (homme) que chez le riverain du Niger, et chez l’Australienne 60 centimètres cubes de moins que chez la négresse.
Sur 15 Australiens (hommes et femmes) M. B. Davis a trouvé une moyenne de capacité de 1 295 cc. (Thesaurus craniorum) ; c’est à très peu près la moyenne donnée par Broca. Sur 31 autres pièces de même provenance MM. de Quatrefages et Hamy ont pris une moyenne de 1 265 cc. (Crania ethnica, page 323). Pour 8 spécimens Morton donne 1 228 cc. ; pour un même nombre de pièces M. Topinard a trouvé 1 332 cc. : son examen n’a peut-être porté que sur des crânes d’hommes ; il faut ajouter d’ailleurs que le procédé de Morton ne donne pas le maximum de capacité. Dans un mémoire ultérieur, M. Topinard, sans mentionner le sexe des sujets examinés, déclare que les cubages faits par lui sur des crânes d’Australiens, lui ont donné de 1 164 à 1 350 cc. La plus petite capacité entrant dans la moyenne de M. B. Davis ci-dessus indiquée est de 1 093. M. Flower donne une moyenne de 1 224, avec cubage à la graine de moutarde ; Revue d’anthrop. t. VIII, p. 725.
Sans aucun doute le volume du cerveau n’est point la seule caractéristique de la dignité de cet organe, mais cette différence de 80 cc entre la capacité du crâne australien et celle du Nègre d’Afrique, de plus de deux cents entre la capacité du crâne australien et celle du crâne européen est un fait exceptionnellement significatif.
Sans nul doute encore, entre les 1,80 centimètres de la femme australienne et les 530 centimètres que cube en moyenne le crâne du gorille, il y a une différence considérable – et cette différence s’accroît encore de ce que le gorille est, par la taille, supérieur à la femme australienne – mais il faut se rappeler, avec M. Huxley, ce fait intéressant que les capacités crâniennes de quelques singes inférieurs descendent au-dessous de celles des singes les plus élevés autant que ces dernières s’éloignent de celles de l’homme.
La tête est allongée d’une façon très frappante, l’Australien est fortement dolichocéphale, Ici un mot d’explication : la tête est dite allongée (dolichocéphalie) lorsque le diamètre antéro-postérieur maximum du crâne étant exprimé par le nombre 100, le diamètre transverse maximum équivaut à 77, 76, 75, etc., en autres termes, n’est pas supérieur à 78 ; ainsi le Nègre de l’Afrique occidentale avec son indice de 74 à 75, est dolichocéphale. Par contre, la tête est dite courte (brachycéphalie) lorsque le diamètre de largeur est au diamètre de longueur au moins comme 80 est à 100 ; ainsi l’Auvergnat et le Savoyard avec leur indice d’environ 84 sont brachycéphales. Eh bien, la moyenne de l’indice céphalique des crânes australiens est à peu près de 71 et demi, c’est-à-dire que la longueur maximum de ce crâne étant formulée par 100, la largeur maximum l’est par 71,5. Dans leur important ouvrage Crania ethmca, MM. de Quatrefages et Hamy ont tiré de 82 crânes australiens un indice céphalique de 71,19. En fait, il n’y a pas de race présentant un crâne plus allongé et cet indice est celui des Néo-Calédoniens et des Esquimaux. Les Hottentots et les Nègres de l’Afrique centrale fournissent un indice un peu plus élevé.
Il y a lieu d’ailleurs de remarquer un fait bien important : c’est que chez les Australiens cet allongement du crâne est surtout un allongement de la partie postérieure. Des races qui sont loin de tenir un mauvais rang dans l’échelle humaine ont, elles aussi, une tête assez longue : de nos jours, les Arabes d’Algérie, les Berbers ; jadis, les Égyptiens. Mais ici la dolichocéphalie n’est pas occipitale : la partie allongée et capace du crâne, est au contraire la partie antérieure, celle où se trouvent logées telles et telles régions des plus nobles de la matière pensante. C’est le fait commun à toutes les races inférieures à crâne allongé (Australiens, Néo-Calédoniens, Papous, Nègres d’Afrique, Hottentots) de présenter ce que l’on appelle une « dolichocéphalie occipitale » et non pas « frontale ». Il est inutile d’insister sur l’importance de cette distinction. Inutile aussi d’ajouter que cet indice de 71 à 72 pris sur les crânes australiens est un indice moyen : on en a signalé quelques-uns qui atteignaient la limite de la brachycéphalie ; on en a signalé d’autres qui étaient exceptionnellement dolichocéphales, avec un indice de 69 et même de 68 ; mais ce ne sont là que des cas particuliers, et l’on peut dire, en principe, avant d’étudier un lot de crânes australiens que presque tous auront un indice de largeur de 70, 71, 72 ou 78 pour cent, en moyenne 71,5.
Un autre caractère de la forme même du crâne, caractère très important, est la disposition de la voûte, de la calotte crânienne en une espèce de toit. C’est une sorte de crête longitudinale qui se rencontre souvent chez les singes anthropoïdes. Tous les crânes australiens ne présentent pas celle disposition ; il y en a chez lesquels elle est peu accentuée, d’autres chez lesquels elle n’est point marquée ; mais il est intéressant de la retrouver chez un assez grand nombre d’individus. En tout cas, à peu près chez tous, les crêtes temporales sont fort relevées, c’est-à-dire se rapprochent beaucoup du sommet de la voûte crânienne, comme chez les Néo-Calédoniens ; ajoutons des fosses temporales creusées et un front singulièrement étroit.
Ces détails sont un peu techniques, mais il semble difficile de ne point les indiquer au moins rapidement. On voudra bien nous permettre d’en signaler encore quelques-autres.
Presque tous les crânes australiens sont remarquables par la saillie des arcades sourcilières, saillie oblongue, correspondant à la partie interne des sourcils. C’est un caractère simien que reproduit bien d’ailleurs la figure ci-jointe. On voit comment la chute assez rapide du front aboutit à un renflement considérable au-dessous duquel est enfoncé la racine du nez.
Il est inutile d’ajouter que ce caractère est des plus frappants sur le vivant ; il n’y a guère de voyageurs, parmi ceux qui ont décrit les types australiens, qui ne l’aient mentionné d’une façon particulière.
Les yeux sont foncés, souvent très noirs, rarement gris ou roux, assez brillants, et semblent fort reculés dans les orbites en raison de la proéminence des arcs sourciliers et de l’épaisseur des sourcils ; cette disposition les fait paraître plus petits qu’ils ne le sont en réalité.
Le nez dans la race du type inférieur est comparable à celui du Nègre africain : « La couleur de ces peuples, dit Pérou (p. 238) en parlant des indigènes de la Nouvelle-Galles du Sud, est chocolat foncé, leurs traits ont beaucoup d’analogie avec le Nègre d’Afrique. Comme lui, ils ont le nez plat, de larges narines, la bouche grande et les lèvres épaisses ». Toutes les photographies que nous avons sous les yeux nous présentent un nez fort large à sa base. Mais il paraît que chez nombre d’individus du type supérieur la forme est beaucoup moins négroïde.
Un caractère des plus frappants est la forte projection des mâchoires, le prognathisme, qui simule une sorte de museau. Ici les Australiens le cèdent encore – et de beaucoup – aux indigènes de l’Afrique australe ; ils le cèdent même aux Nègres de l’Afrique centrale, mais ils paraissent avoir droit au premier rang (le partageant peut-être avec les Néo-Calédoniens) ; sous ce rapport toutes les autres races semblent être moins bestiales. La figure 2, placée ci-dessus donne un assez bon exemple de la projection du maxillaire supérieur chez l’habitant de la Nouvelle-Hollande. Il y a lieu de croire, d’ailleurs, que la moyenne du prognathisme serait bien plus élevée, si l’on ne composait une série que d’individus appartenant au type inférieur.
Quant au menton, il est petit et fuyant, autre signe très connu de bestialité ! Sans doute il n’est point ravalé comme le menton du singe anthropoïde, il l’emporte certainement aussi sur bien des maxillaires préhistoriques, tels que celui de la caverne de Goyet, mais il le cède de beaucoup au maxillaire moyen des individus de race blanche : c’est un menton très fuyant, plus fuyant que celui des Nègres de l’Afrique centrale. Ici encore l’Australien est sur les derniers degrés de l’échelle humaine.
Tous les voyageurs s’accordent à représenter les dents des Australiens comme très belles et très blanches. C’est un fait connu que chez les Nègres les dents sont généralement plus belles que chez les blancs, de meilleure qualité, beaucoup moins sujettes à la carie, et durent bien plus longtemps. L’extrême rareté de la carie dentaire chez les Australiens a été maintes fois signalée.
Mais ce qui est digne de remarque, c’est que, tandis que dans les races supérieures de l’humanité la première molaire est plus volumineuse que la seconde, et la seconde plus volumineuse que la troisième, il arrive chez l’Australien que la progression est croissante, ou qu’il y a au moins égalité : or chez les singes anthropoïdes le volume de la première molaire est moindre que celui de la seconde, et celui de la seconde est moindre que celui de la troisième. C’est là un des cent et cent phénomènes qui imposent à tout esprit dépourvu de préjugés et décidé à accepter ce qu’enseignent les faits, la doctrine de l’évolution. Ici d’ailleurs il est bon d’ajouter que la mâchoire préhistorique de la Naulette, qui par tant de caractères est simienne, bien qu’elle ait sans conteste appartenu à un homme, montre des traces non équivoques de la progression croissante du volume des molaires.
La courbe de l’arcade dentaire a été signalée par Broca chez l’indigène de la Nouvelle-Hollande comme présentant un caractère incontestablement simien : « On sait, dit Broca, que dans la plupart des races humaines la courbe des arcades dentaires est parabolique, c’est-à-dire divergente ; quoique sa concavité soit partout tournée vers la ligne médiane, les deux points symétriques que l’on compare sont d’autant plus éloignés l’un de l’autre, qu’ils sont situés plus en arrière. Ce caractère étant celui des paraboles, on dit que l’arcade dentaire est parabolique, ce qui n’implique pas d’ailleurs la pensée que la courbe en question soit une véritable parabole géométrique. On sait, d’un autre côté, que, chez les grands singes, l’arcade dentaire n’est pas parabolique. Elle va toujours en divergeant depuis le menton jusqu’à la première molaire, mais alors elle cesse de s’écarter de la ligne médiane, puis elle s’en rapproche légèrement de sorte que les deux dents de sagesse sont moins écartées l’une de l’autre que ne le sont les premières molaires. On exprime ce caractère en disant que la courbe est elliptique : expression, qui n’a pas plus que la précédente la prétention d’être géométriquement rigoureuse.
Or la Société d’anthropologie a eu plusieurs fois l’occasion de constater, sur les mâchoires d’Australiens et de Néo-Calédoniens, l’existence d’une conformation intermédiaire entre celle de l’ellipse et de la parabole sur ces mâchoires, nous avons vu l’arcade dentaire inférieure commencer en avant par une courbe divergente jusqu’à la première molaire, et se continuer ensuite en formant deux branches parallèles. La distance des deux dents de sagesse n’est pas plus grande que celle des premières molaires ; comme dans le type le plus général de l’homme, elle lui est égale, ce qui constitue évidemment un acheminement vers la convergence qu’on observe chez les singes ».
Combien de faits pourrions-nous ajouter à ceux que nous venons de relever dans cette rapide revue ! Mais nous n’avons pas à rédiger un cours d’anatomie comparée, et nous avons hâte d’arriver à la description des caractères ethnographiques proprement dits. Quelques mots, cependant, sur le développement des sens et sur les instincts principaux des populations de la Nouvelle-Hollande.
Ce sont, pour tout dire, des dispositions et des aptitudes purement enfantines : une mimique prompte et facile, un grand talent d’imitation. Turnbull l’a observé immédiatement, et, après lui, bien d’autres voyageurs : « Ils imitent exactement, dit-il (Voyage dans l’Océan Pacifique, p. 43) tout ce qui est caractéristique chez les Européens qu’ils ont vus jusqu’à présent, depuis le premier gouverneur Philipps. Ils conservent ainsi entre eux une espèce de registre historique de tout ce qu’ont fait les Anglais. Ils copient avec une perfection inouïe : et s’il y a parmi nos compatriotes, soit officiers, soit déportés, quelqu’un qui ait un défaut corporel, un tic, un accent particulier, ils le saisissent à l’instant et le rendent avec une telle vérité qu’il est impossible de ne pas reconnaître l’original. Ils ont encore singulièrement bien appris le langage grossier des prisons de New-Gate, que les déportés emploient dans leurs querelles entre eux, et l’on peut dire que sur le chapitre des injures les élèves valent bien les maîtres. » Et Turnbull s’empresse d’ajouter, non sans raison : « Mais c’est là tout ce que ces sauvages ont acquis de la fréquentation des Européens ».
Il faut ajouter, d’ailleurs, que les indigènes qui habitent aux environs de Sydney, et qui, sont en contact presque journalier avec la colonie anglaise, apprennent immédiatement et sans peine tous les mots anglais qui peuvent leur être utiles dans leurs rapports avec les nouveaux occupants du sol. Ils les prononcent, à la vérité, comme le leur permet leur très pauvre système phonétique, mais enfui ils les saisissent rapidement et sont en fort peu de temps à même de comprendre et de se faire comprendre.
Le développement du sens de la vue, celui de l’audition, celui de l’odorat, ont paru remarquablement développés chez les Australiens à tous les explorateurs qui ont pu les étudier de près et dans leur vie sauvage ; mais, ainsi que l’a fort justement remarqué l’auteur de la Sociologie, M. Letourneau (Bibliothèque des sciences contemporaines, tome VI), ces sens sauvages n’ont qu’un champ d’activité fort restreint : la vue est perçante, soit, mais l’œil est incapable de saisir une représentation quelconque, une image, un portrait : « Sans doute la sensation est la mère de l’idée ; mais celle-ci, à son tour, vivifie la sensation. Les sens deviennent plus puissants quand il y a derrière eux une attention soutenue et une intelligence développée. C’est pour cette raison que l’Européen, alors qu’il adopte la vie sauvage, finit souvent par l’emporter, au point de vue de la délicatesse des sens, sur les sauvages eux-mêmes ; car, chez lui, le registre de la conscience est plus large et mieux tenu. »
L’Australien a tenté parfois des essais de sculpture, de sculpture décorative, des arabesques, plus ou moins fouillées, sur un manche de lance : jamais sur le bois ou sur l’os il n’a abordé la représentation de l’être vivant, inférieur en cela aux habitants anciens des rochers du Périgord (Letourneau, op. cit





























