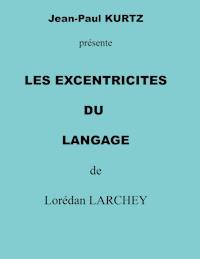
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Cette reprise de l'oeuvre de M. Lorédan Larchey a été complétée par mes soins. Cet ouvrage nous donne l'origine de certaines expressions comme par exemple "boire un canon", "carotter" ou encore "se cavaler", l'origine de mot comme "marlou", "être plein comme un oeuf".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
OUVRAGES DÉJÁ RÉÉDITÉS
LA BRETAGNE VIVANTE – Édition BoD – 2012
FÊTES ET COUTUMES POPULAIRES – Édition BoD – 2012
LES BRETONS– Édition BoD – 2012
LES BÊTISES SACRÉES - Édition BoD – 2013
GUIDE PRATIQUE DES TRAVAUX MANUELS - Édition BoD – 2013
NOUVEAU RECUEIL DE CITATIONS ET DE PENSÉES - Édition BoD – 2013
LA VIE EN CHEMIN DE FER - Édition BoD – 2013
DICTIONNAIRE CRITIQUE DES RELIQUES ET DES IMAGES MIRACULEUSES – Tome I, II et III - Édition BoD – 2013
L’ART DE PAYER SES DETTES ET DE SATISFAIRE SES CRÉANCIERS SANS DÉBOURSER UN SOU - Édition BoD – 2013
HISTOIRE DE LA LORRAINE - Édition BoD – 2014
DICTIONNAIRE RAISONNÉ DE L’ARCHITECTURE FRANÇAISE DU XIème AU XVIème SIÈCLE - Tome I à 9 - Édition BoD – 2015
OUVRAGES DE L’AUTEUR DÉJÁ ÉDITÉS
DICTIONNAIRE DU GENIE CIVIL – CILF - 1997
DICTIONARY OF CIVIL ENGINEERING – Springer (USA) – 2004
NOUVEAU RECUEIL DE CITATIONS ET DE PENSÉES - Édition BoD – 2013
LES OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL - Édition BoD – 2013
DICTIONNAIRE ÉTYMOLOGIQUE, LEXICOLOGIQUE ET HISTORIQUE DES ANGLICISMES et des AMÉRICANISMES – Tomes I, II et III - Édition BoD – 2013
AU NOM DE JÉSUS FILS DE L’HOMME ET DE CHRIST FILS DES DIEUX - Tomes I et II - Édition BoD – 2015
Par quatre fois, les bontés de la critique et les suffrages du lecteur ont appris aux Excentricités du langage qu'elles répondaient non à un caprice, mais à un besoin très-vif et très-particulier, que nous appellerons le besoin de savoir ce qui se dit, - par opposition au besoin de savoir ce qui doit se dire, - le seul que nos lexiques satisfont généralement.
On ne saurait en effet négliger la connaissance de ce qui se dit. - Non pas que nous en recommandions le moins du monde l'emploi ! non pas que nous voulions porter la moindre atteinte au respect de la langue officielle ! Mais, comme le disent si bien nos épigraphes, il est toujours bon de se rendre compte des choses, ne serait-ce que pour les mille nécessités de la vie sociale, à Paris même où un puriste peut se trouver exposé au risque de ne pas comprendre un certain français. Puis, n'y a-t-il rien de plus à gagner dans ces études de langage? Ici encore, nos épigraphes sont là pour le prouver. Le néologisme peut être utile en plusieurs cas. Montaigne le dit, et Montaigne a son poids. On ne saurait dédaigner non plus les réflexions de Nodier, de Balzac, sans omettre celles de M. de Jouy, qui n'était certes pas un révolutionnaire. D'ailleurs l'histoire n'est-elle pas là pour nous empêcher de condamner à la légère des mots sans crédit aujourd'hui, mais que leur fortune peut relever demain? Ne nous montre-t-elle point Caillière, l'auteur des Mots à la mode, signalant comme des intrus les adjectifs haineux, respectable, désœuvré; le substantif impolitesse !...Ceci se passait dès 1693. En 1726, l'abbé Desfontaine, dans son Dictionnaire néologique, condamnait à son tour l'usage de détresse, scélératesse, naguères, encourageant, érudit, inattaquable, entente, improbable, etc., etc.
Ne nous pressons donc point de proscrire, et considérons les Excentricités du langage comme une réserve d'enfants perdus où notre armée régulière peut recruter quelques auxiliaires utiles.
L'argot d'ailleurs est un langage essentiellement français. Il emprunte fort peu à l'étranger, quoi qu'on en ait dit.
Comme beaucoup de patois provinciaux, il a conservé les traces de notre vieille langue. Quant au reste, il ne l'a pas précisément inventé, il se l'est plutôt approprié en modifiant selon ses besoins le parler usuel.
A l'appui de notre dire, voici des exemples purs ou peu altérés de mots anciens:
Abadis, abéquer, agoniser, ambier, arche, arpion, arsouille, auber, bagou, baudru, bécher, biture, blaiche, blavin, carle, copain, coyon, douille, cadenne, esbrouffe, escarpe, esclot, estrangouiller, flouer, fouillouse, frime, gambiller, lichard, ligote, mion, morfiller, abouler, baladeur, balochard, calége, dariole, frusque, gayet, ginglard, gogo, harria, jaboter, jorne, maquiller, naze, niente, pecune, envoyer pisser, paumer, rigoler, pimpion, tractis, frusque, tanner, tabar.
Les substitutions du nom de l'effet à celui de la cause, de la propriété à l'objet, de la fonction à l'individu, sont excessivement nombreuses:
Avaloir, attache, battant, bleu, bouffarde, bouillante, boulanger, cassante, casse-gueule, chaude-lance, crampon, dur, éclairer, fauchant, fourchu, tortillard, glissant, guinal, lance, marcheuse, mince, montant, cogne, curieux, babillard, barbue, caillé, cercle, courbe, moricaud, montante, tirant, tape-dur, tire-jus, tourne-autour, vole-au-vent, pousse-cailloux, toquante, pierreuse, tremblant, trimar, trottin, trottante, frappart, rude, raide, serrante, tournante, trouée, musicien, pétard, pitroux, nageoir, piquante, pique-en-terre, pleurant, pousse, sonnette, raccourcir, rude, reluit, repoussant, roulant, torseur, tapecul, tombeur, rond, cabe, combre, mirzale, calvin.
Plus nombreuses encore sont les analogies cherchées ... soit dans le monde animal:
Aile, aspic, azor, anguille, anchois, barbillon, bélier, biche, bigorneau, blaireau, bœuf, brème, buson, canard, caniche, castor, chameau, chat, cheval, chèvre, chien, cigogne, cigale, cocote, corbeau, coucou, crapaud, daim, dindon, patte, paturon, muffle, bec, cuir, crin, grenouille, grue, huìtre, lion, lapin, merlan, morue, mouche, moucheron, mouton, ours, tigre, vautour, veau, vache, papillon, poulet d'Inde, rat, serin, sardine, souricière, taupage.
... Soit dans le monde végétal:
Cantaloup, carotte, chiendent, chou, citron, clou de girofle, coloquinte, cornichon, fenasse, feuille de choux, melon, navet, nèfle, ognon, orange, poire, pomme, prune, gazon, sapin.
... Soit dans le monde matériel des objets servant à l'homme:
Vermichel, raisiné, andouille, couenne, omelette, flan, fourchette, salière, boudin, dragée, scie, pioche, tuyau de poêle, chanterelle, musette, guimbarde, flageolet, trompette, tambour, guitare, violon, harpe, flûte, sifflet, grosse caisse, quille, roues de devant et de derrière, fagot, filasse, fil de fer, ficelle, tuile, poteau, échalas, espalier, cabriolet, capsule, compas, as de carreau, domino, etc.
Après ces trois grandes classes d'archaïsmes, de substitutions et d'analogies, nous distinguons une suite de petites divisions comprenant:
Des abréviations:
Achar, autor, aristo, bac, benef, delige, démoc-soc, champ, algue, come, consomm, flan, estom, from, jar, job, lansq, liquid, maq, occase, paf, pante, pede, poche, réac, rata, sap, topo, typo, ultra, cipal, radis.
... Des diminutifs et des changements de syllabes finales:
Baluchon, burlin, colas, criblage, hoteriot, tringlos, guichemar, épicemar, paquecin, orphelin, papelard, piou, placarde, ramastiqueur, rigolboche, cabermont, trèfle, trèpe, escrache, vioque, lanturlu, demistroc, alentoir.
... Des onomatopées:
Bouis-bouis, breloque, couac, dig-dig, faffe, fauffe, flafla, flaquer, fric-frac, frou-frou, frousse, plombe, toc, trac, branque, gilbocq, dégouliner, toquante.
... Quelques noms de lieux...
Dijonnier, elbeuf, lillois, lingre, lyonnaise, orléans, panama, soissonné.
... Des jeux de mots:
Auber, bisard, botte de neuf jours, castus, dix-huit, lait chrétien, cœur sur carreau, cuirassier, culbute, fidibus, flanelle, cloporte, sanglier, thomas, homelette, manette, monseigneur, mort, numéro cent, billet de parterre, salade, pendu glacé, large des épaules, passer au 10e, tangente au point Q.
Des souvenirs historiques ou littéraires:
Philistin, balthazar, laïus, putipharder, joseph, pallas, cupidon, cerbère, sophie, romain, monaco, garibaldi, jésuite, sorbonne, bolivar, polichinelle, arlequin, pierrot, carline, chauvin, mayeux, bertrand, macaire, antony, quasimodo, demi-monde, camelia, robinson, calino, etc.
Les divisions que nous venons d'indiquer prouvent surabondamment qu'autour d'un noyau d'anciens mots, dont les glossaires de Du Cange et de Roquefort nous conservent la suite, se sont groupés non des mots nouveaux, mais des interprétions nouvelles de mots déjà connus. Ce langage de convention, essentiellement imagé, particulièrement pittoresque, s'est enrichi d'autant plus que l'exigeaient les besoins de ses auteurs. Sous ce dernier rapport, il est même arrivé à un degré de précision peu croyable.
S'agit-il de suivre tous les degrés de l'ébriété, remarquez la progression parfaite qu'indiquent être bien, avoir sa pointe, être gai, être en train, parti, lancé. Aucune de ces qualifications ne rentre dans l'autre. Chacune indique, dans l'état, une nuance. De même pour l'homme légèrement ému, il sera tout à l'heure attendri, il verra en dedans, et se tiendra des conversations mystérieuses. Cet autre est éméché; il aura certainement demain mal aux cheveux. Pour dépeindre les tons empourprés par lesquels passera cette trogne de Silène, vous n'avez que la liberté du choix entre: teinté, allumé, poivre, pompette, ayant son coup de soleil, son plumet, sa cocarde, se piquant ou se rougissant le nez.
De la figure passons à la marche. L'homme ivre à quatre genres de port qui sont tous également bien saisis. Ou il est raide comme la justice et laisse trop voir par son attitude forcée combien il est obligé de commander à la matière; ou il a sa pente et croit toujours que le terrain va lui manquer; ou il festonne, brodant de zig-zag capricieux la ligne droite de son chemin; ou il est dans les brouillards, tâtonnant en plein soleil, comme s'il était perdu dans la brume.
Attendez dix minutes encore, laissez votre sujet descendre au dernier degré de l'ivresse, et vous pourrez dire indifféremment: Il est plein, complet, rond, humecté, pochard, il a sa culotte, son casque, son sac, son affaire, son compte.
Presque aussi riche est le vocabulaire des voies de fait, - une des conséquences les plus ordinaires de l'ivresse. Plus riche encore serait celui du libertinage s'il était permis de franchir des limites que nous avons serrées d'aussi près que possible, usant du droit qui sauvegarde toute recherche sérieuse.
Voici quelques-unes, des phases les plus intéressantes de la batterie:
Avec la peignée, on se prend aux cheveux, on se crêpe le chignon. On se croche ensuite à bras-le-corps. La valse, la tournée et la danse sans violons, décrivent les mouvements précipités de la lutte. Avec la dégelée, la brossée et la frottée, on a l'épiderme bien échauffé; il est endolori après une raclée. La rossée vous sangle comme un cheval rétif; la trempe et la rincée vous tordent comme du linge à la lessive. Viennent la trépignée, la tripotée, la pile, le travail du casaquin et vous voilà terrassé, à la merci d'un adversaire qui vous pétrit de coups. Encore une seconde, et vous êtes un homme en compote ou démoli. Notez que contre tous ces termes, la loi grammaticale n'en a pas un seul précis.
Et ce n'est point là seulement que nous retrouvons une variété significative de synonymes. Prenons boule, ou balle, ou coloquinte, ou calebasse ! c'est la tête ronde, rien de plus ! Avec binette et trombine, frime et frimousse, il y a quelque chose de nouveau, nous voyons se dessiner la physionomie. La sorbonne, la boussole désignent le cerveau qui conçoit, raisonne et dirige. Le caisson a été fait tout exprès pour représenter le crâne éclatant à l'heure du suicide; la tronche, pour montrer la tête tombant sous le couteau de la guillotine.
De la tête passons à la jambe: grosse, c'est une quille, un poteau; mince, c'est une flûte, un échalas; plus mince encore, c'est un fil de fer; tremblante, c'est un flageolet. Des jambes de danseur sont des gigues ou des gambilles; celles d'un piéton forment un compas.
Cette finesse, cette précision se retrouvent jusque dans les diverses manières de dépenser son argent. L'avare se fend, le prodigue douille, la dupe casque, l'homme qui veut imposer la confiance éclaire.
La mort elle-même semble vouloir prêter un verbe à chaque état. Le joueur dévisse son billard, le chasseur graisse ses bottes, le bavard avale sa langue, le fumeur casse sa pipe, l'apoplectique claque, le troupier reçoit son décompte, descend la garde, passe l'arme à gauche ou défile la parade, le pauvre perd une dernière fois le goût du pain.
Nous avons dit que l'argot forgeait en réalité peu de mots; - ce sont des acceptions nouvelles qu'il invente de préférence. Tantôt il prend le tout pour la partie, tantôt la partie pour le tout; le plus souvent il donne à un objet le nom d'une autre chose qui n'a pas le moindre rapport, mais qui, selon lui, rend mieux l'image de la chose dont on parle.
Ces sortes de travestissements sont beaucoup plus raisonnés qu'on ne se le figure. Ainsi, pour n'en citer qu'un, toquante, ognon ou cadran sont bien plus expressifs que montre. Toquante fait allusion au mouvement de l'objet; ognon, à sa forme, et cadran, à la figure tracée sur sa paroi.
Ces synonymes offrent l'avantage d'une allusion directe à la chose, ils se gravent mieux dans la tête? tandis que montre est, pour la mémoire des simples, beaucoup plus énigmatique. Il en est ainsi de beaucoup d'autres mots qu'il serait trop long de citer ici.
Mais il n'en faut pas déduire que l'idiome dont nous nous occupons soit facile à posséder. Il fourmille, on l'a vu, de nuances dont la distinction demande un certain acquit. C'est ainsi que blague a sept significations si nettement acceptées, qu'on peut y voir tour à tour de la facilité oratoire, une conversation spirituelle ou un mensonge. Chic présente autant de sens non moins contradictoires. Appliqué au crayon d'un artiste, il est un brevet de banalité ou de distinction; il ne lui faut, pour cela, qu'être précédé ou d'avec ou de. - Il fait tout avec chic est un éloge, il fait tout de chic est une critique très-sensible. - Faire a de même six acceptions; ficher, huit; chien entre dans la composition de neuf mots, et œil dans la composition de douze. Chose peut signifier Dignité ou Indignité: paumer veut dire Prendre ou Perdre; bachot s'applique indifféremment à un examen, à un candidat, à une institution; extra représente ou un plat, ou un invité, ou un domestique.
Pour l'observateur, certains termes caractérisent tout un ordre d'idées, d'habitudes, d'instincts.
Ce n'est qu'un malfaiteur qui a pu appeler le premier cafarde la lune voilée et moucharde la lune brillante, qui encore a pu nommer coulant ou collier la cravate avec laquelle il vous étranglera au besoin. Il a besoin de ses yeux. On le devine en voyant qu'il les appelle ardents, reluits, clairs, quinquets et mirettes
Que d'équivalents il a trouvé pour assassiner: faire suer, refroidir, démolir, rebâtir, connir, terrer, chouriner, expédier, donner son compte, faire l'affaire, capahuter, escarper.
Il semble n'avoir pas trop de verbes quand il s’agit d'exprimer une fuite: se la briser, se la casser, se pousser de l'air, s'esbigner, se cavaler, se la couler, se cramper, lâcher, décarer, décaniller.
Et quels noms significatifs décernés aux agents chargés de réprimer ses méfaits ! Par balai, cogne, raclette, raille, pousse et grive, il paraît dire: Le gendarme me balaie ou me cogne, la patrouille me racle, l'agent m'éraille ou me pousse, le soldat me grève.
Par une exception bizarre, il a mêlé les idées de cuisine et de dénonciation. L'homme qui le dénonce à la police est un cuisinier, un coqueur (coquus), une casserole. S'il est arrêté, il dit qu'il est servi. Serait-ce que parce qu'il se voit déjà flambé, fumé, frit, fricassé, rôti et brûlé par dame Justice, cette terrible cuisinière? On a dû le voir avec nous, la fréquence des mots indique mieux que toutes les statistiques morales la place tenue par certaines passions.
Niera-t-on que le peuple français soit susceptible d'enthousiasme en voyant tous les synonymes qu'il a trouvé aux mots bons et beau? - V. Chic, chicard, chicandard, chouette, bath, rup, chocnosof, snoboye, enlevé, tapé, ça, superlifico, aux pommes, aux petits oignons, etc.
Et l'argent n'occupe-t-il pas dans le néologisme autant de place que dans les transactions de ce bas monde? - Nerf, os, huile, beurre, graisse, douille, rond, cercle, bille, jaunet, roue de devant et de derrière, braise, thune, médaille, face, monarque, carte, philippe, métal, dale, pèze, pimpion, picaillon, noyaux, sonnette, cigale, quibus, quantum, sic nomen, cuivre, mitraille, patard, vaisselle de poche, sine qua non ! etc.
Et l'eau-de-vie ! Combien de petits verres dans ces mots: Trois-six, fil en quatre, dur, raide, rude, chenique, schnapps, eau d'aff, sacré chien, goutte, camphre, raspail, jaune, tord-boyaux, casse-poitrine, consolation, riquiqui!
Après la satisfaction des besoins matériels ou l'expression d'une gaîté railleuse, les misères et les laideurs de cette vie sont largement représentés. - On trouve vingt mots pour montrer un niais, une dupe ou un fripon, pas un pour dire: Voici un honnête homme. - La femme digne d'estime est inconnue; celle qu'on affecte de mépriser se trouve sous le coup d'un déluge d'injures. - Enfin la somme des négations est énorme et il n'y a pas une seule affirmation positive.
Et, chose étrange ! l'admiration même se trouve sur ce terrain raboteux tout imprégnée de je ne sais quelle brutalité. - Vous êtes fièrement brave, rudement bon, - se disent avec la meilleure intention du monde. Un discours éloquent devient un discours tapé; une scène émouvante vous enlève, vous empoigne; une belle action épate le public On dit d'une œuvre banale: Cela n'est pas méchant, cela ne mord pas. Le travailleur est un piocheur et le zélé est un féroce.
En toute justice, cependant, on ne saurait traiter avec sévérité l'élément populaire qui sert de base aux observations précédentes.
Comment le peuple se piquerait-il de délicatesse en son langage? Le labeur de chaque jour ne lui laisse apprécier que la satisfaction de ses gros appétits. Aussi, ne nous étonnons pas en voyant ses néologistes s'exercer uniquement là-dessus. Ces rudes chercheurs ont fait des mots accentués comme leurs ragoûts favoris et faits pour traverser les palais plébéiens que n'effraient pas les fortes épices.
Si on veut donc bien ne pas se choquer de la rusticité de cette forme, l'étude de cette langue fera découvrir, au degré le plus éminent, certaines qualités de couleur.
Comme il est bien nommé brutal ce canon qui, après avoir grondé de sa grosse voix, culbute tout sans dire gare !
Et béguin, cet amour terrestre qui vous isole au milieu de la vie mondaine avec les extases du cénobite !
Combien les mots de richesse, de crédit et de fortune paraissent fades à coté de cette annonce magique : Il a le sac! - Il a le sac, c'est-à- dire ses écus sont là sous sa main; d'un geste, il les fera luire à vos yeux ces belles espèces sonnantes.
Il en est de même pour beaucoup d'autres qu'on trouvera sans effort en feuilletant les pages suivantes.
Selon nous, il doit être aussi beaucoup pardonné aux licences du langage populaire, en raison de la souffrance et de l'amertume profondément ironique que décèlent bon nombre de ses termes. Ainsi la plèbe parisienne a trouvé un nom saisissant pour désigner certains quartiers où la misère a fait élection de domicile; elle les appelle Quartiers souffrants.
Je me rappellerai toute ma vie du jour où j'entendis prononcer ce nom pour la première fois: c'était en omnibus. - Le conducteur, un gai compagnon, égayait de son mieux la monotonie du devoir qui l'obligeait à décliner tout haut le nom de certaines rues. - À l'instant où son véhicule quittait la sombre rue des Noyers pour traverser la place Maubert, autour de laquelle rayonnaient alors vingt ruelles noirâtres où grouillait la plus misérable population, - voilà notre homme qui s'écrie: « Place Maubert, rue Saint-Victor, Panthéon ! Il n'y a personne pour le quartier souffrant! » - Et une pauvre vieille hâve, déguenillée, se dressa péniblement et descendit à cet appel comme une justification vivante de l'épithète.
Vous pouvez d'ailleurs leur prêcher la philosophie, à tous ces pauvres diables; ils connaissent le mot, ils l'ont pris pour synonyme de Misère; ils ont même décoré leurs savates du titre de philosophes. Peut-on mieux montrer, - je vous le demande, - la théorie foulée aux pieds par la réalité?
Les synonymes significatifs de dur, raide, tord-boyaux, casse-poitrine disent assez comment les malheureux en sont venus à nommer consolation un verre d'eau-de-vie. Ce n'est pas toujours la boisson en elle-même qu'ils recherchent, car ils en connaissent les tristes effets, c'est un étourdissement momentané, c'est une consolation fictive.
Et la pipe, cet autre palliatif non moins populaire, y a-t-il une seule des cent satires rimées ou non rimées faites depuis cinquante ans contre cet usage, qui vaille tout le sens critique de ce seul mot: brûle-gueule?
N'être pas méchant et avoir du vice sont également deux expressions cousines qui valent un livre sur le moyen de parvenir. - Vous voulez arriver, faites-vous craindre. Le naïf qui ne mord pas, qui n'est pas méchant, reste sans valeur aux yeux du prochain. - Avoir du vice, c'est être ingénieux. Si vous avez du vice, vous saurez exploiter ceux des autres. C'est une garantie d'avenir.
Heureusement, l'usage de dire ça n'est pas drôle, en présence d'un grand malheur, est là pour neutraliser le côté attristant du tableau que nous venons d'offrir. Ça n'est pas drôle prouve que la vieille gaîté française est impérissable. - Il n'y a de réellement fâcheux que ce qui ne peut lui offrir un côté plaisant; et Dieu sait où elle ne vient pas à bout de le découvrir !
……………………………………………………………………………………
Voilà des considérations un peu décousues; si elles n'aspirent pas au sérieux d'une introduction philologique, elles suffiront pour faire apprécier au lecteur et la logique secrète d'un langage qui en paraît fort dépourvu, et la difficulté d'établir une nomenclature raisonnée de ce langage. Elles expliqueront pourquoi cette édition présente, à l'exemple de ses aînées, des remaniements et des additions considérables. C'est ainsi que nous avons été amené à prendre cette fois tout l'argot proprement dit après avoir reconnu qu'une bonne part de notre ancien vocabulaire en dérivait déjà.
- Plus se fraie le chemin et plus s'agrandit l'horizon.
Comme tous les sujets mal définis, celui dont nous nous occupons était difficile à bien traiter du premier coup. Les curieux assez patients pour comparer cette édition aux précédentes, verront que nous n'avons cessé de chercher des exemples probants, des définitions claires et concises, une explication simple et naturelle des causes qui ont déterminé l'emploi de chaque terme. À ce triple point de vue, ils voudront bien reconnaître qu'un succès facile ne nous a point endormi. - Nous avons cherché à devenir non meilleur, mais moins incomplet.
L'humilité de ce dernier adjectif n'est pas feinte. À peine notre livre est-il broché que nous y constatons déjà des faiblesses... Mais au lexicographe pas plus qu'au juste, il n'est donné d'être parfait, et nos contemporains sont trop pressés pour ne pas être cléments envers celui qui n'a pas voulu leur faire attendre cette cinquième édition.
Sommaire
ÉPIGRAPHES
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Z
AUTEURS CONSULTÉS
L.L.
*********
ÉPIGRAPHES
= Le parler que j'aime, tel sur le papier qu'à la bouche, c'est un parler succulent et nerveux, court et serré; non tant délicat et peigné, comme véhément et brusque; plutôt difficile qu'ennuyeux; déréglé, décousu et hardi; - chaque lopin y fasse son corps ! - non pédantesque, mais plutôt soldatesque, comme Suétone appelle celui de Jules César. - Montaigne.
Maynard, le poète toulousain (1582-1646) qui s'était retiré en province, vint à Paris un peu avant sa mort. Dans les conversations qu'il avoit avec ses amis dès qu'il vouloit parler, on lui disoit: Ce mot-là n'est plus d'usage. Cela lui arriva tant de fois qu'à la fin il fit ces quatre vers:
En cheveux blancs, il me faut donc aller
Comme un enfant tous les jours à l'école.
Que je suis fou d'apprendre à bien parler
Lorsque la mort vient m'ôter la parole !
= Voiture (1585-1650) qui était fort ami de Vaugelas, le railloit quelquefois sur le trop de soin qu'il employoit à sa traduction de Quinte-Curce. Il lui disoit qu'il n'auroit jamais achevé; que pendant qu'il en poliroit une partie, notre langue venant à changer, l'obligeroit à refaire toutes les autres. À quoi il appliquoit plaisamment ce qui est dit dans Martial de ce barbier qui étoit si longtemps à faire une barbe qu'avant qu'il l'eut achevée, elle commençoit à revenir... - Raynal Anecdotes littéraires.
= Pour m'expliquer mieux, je vous diray qu'il y a deux sortes d'usages (de mots nouveaux) le bon et le mauvais. Ce dernier est celui qui n'étant appuyé d'aucunes raisons, non plus que la mode des habits, passe comme elle en fort peu de tems. - Il n'en est pas de même du bon usage Comme il est accompagné du bon sens dans toutes les nouvelles façons de parler qu'il a introduites en notre langue, elles sont de durée à cause de la commodité qu'on trouve à s'en servir pour se bien exprimer, et c'est ainsi qu'elle s'enrichit tous les jours Cependant il faut être fort réservé à se servir de nouvelles façons de parler - Caillière, 1693.
= Il est bon de se faire des notions claires des choses quand on le peut. Un autre Despréaux diroit peut-être de cet auteur (Ph. Leroux) ce que ce grand critique a dit de Regnier, que ses ouvrages se ressentent des lieux que fréquentoit l'auteur. Mais il ne faut que jeter les yeux sur la sécheresse de la matière pour laver celui-ci de ce soupçon. Il y a une longue liste de termes populaires qui n'est pas à dédaigner comme elle pourroit le paroître d'abord. Combien de personnes distinguées qui ne sont jamais sorties de la cour ou du grand monde, et qui, se trouvant quelquefois obligées de descendre dans de certains détails avec les gens du peuple ne comprennent rien à ce qu'ils leur disent! - Zacharie Chastelain, 1750 (Critique du Dictionnaire comique de Leroux)
= Dans une séance particulière de l'académie, Voltaire se plaignit de la pauvreté de la langue; il parla encore de quelques mots usités, et dit qu'il serait à désirer qu'on adoptât celui de tragédien par exemple. Notre langue, disait-il, est une gueuse fière; il faut lui faire l'aumône malgré elle - Voltériana.
= Qu'on me permette d'ajouter à ce propos que si la manie du néologisme est extrêmement déplorable pour les lettres et tend insensiblement à dénaturer les idiomes dans lesquels elle se glisse, il n'en serait pas moins injuste de repousser sous ce prétexte un grand nombre de ces expressions vives, caractéristiques, indispensables, dont le génie fait de temps en temps présent aux langues. Il n'appartient à personne d'arrêter irrévocablement les limites d'une langue et de marquer le point où il devient impossible de rien ajouter à ses richesses. - Ch. Nodier, 1808 (Dict. des Onomatopées).
= Quelque ennemi que je sois du néologisme, il faut bien créer ou adopter des mots nouveaux quand on n'en trouve pas dans la langue qui puissent, à moins d'une longue périphrase, rendre l'équivalent de votre idée. - De Jouy, 1815.
= Il s'opère depuis quelque temps une révolution sensible de mœurs et de langage... Le langage surtout a subi d'heureuses altérations, des gallicismes raffinés et polis qui feront pester l'Académie et sourire agréablement les femmes élégantes. C'est tout profit pour les gens de goût. - Roqueplan, 1842.
= Disons-le, peut-être à l'étonnement de beaucoup de gens, il n'est pas de langue plus énergique, plus colorée que celle de ce monde... L'argot va toujours, d'ailleurs ! Il suit la civilisation, il la talonne, il s'enrichit d'expressions nouvelles à chaque nouvelle invention. - Balzac.
= La langue argotique semble aujourd'hui être arrivée à son apogée; elle n'est plus seulement celle des tavernes et des mauvais lieux, elle est aussi celle des théâtres; encore quelques pas et l'entrée des salons lui sera permise. - Vidocq, 1837.
= Il en est de l'argot comme de certaines îles de la Polynésie: on y aborde sans y pénétrer; tout le monde en parle, et bien peu de personnes le connaissent. Nous qui ne sommes ni l'un ni l'autre, et qui ne possédons que notre curiosité pour passe-port, nous avons vainement fouillé les géographies sociales pour nous instruire.... Par-ci, par-là, un voyageur traverse ce Tombouctou parisien, et en ressort la tête farcie de mots bizarres qu'il répète sans les comprendre. - Albert Monnier.
= Quelque mérite qu'on ait, quelque érudition qu'on déploie, il est bien difficile, en étalant les mots hideux du vocabulaire des forçats, de ne jamais soulever le cœur et en rapportant nos lazzis populaires si usés, de ne pas exciter parfois un sourire de dédain; mais quand il ne s'agit plus de notre propre langue tout change d'aspect: les expressions repoussantes deviennent terribles, les locutions vulgaires, spirituelles, et l'on est porté à croire bien injustement d'ailleurs, qu'il faut plus de savoir pour recueillir et expliquer ces termes étrangers que pour commenter ceux qu'on entend répéter chaque jour par les charretiers ou les manœuvres. - Marty-Laveaux.
= En lisant la nomenclature des termes jadis propres aux conversations du brigandage et de la filouterie on devine d'une part qu'un certain nombre de ces termes ne subsisteront pas longtemps, et d'autre part on aperçoit que beaucoup ont pris droit de cité dans l'usage public Quel parisien même rangé, même prude, ignore absolument que l'eau d'affe, c'est de l'eau-de-vie; la bouffarde, une pipe; la dèche, les ennuis de la misère; que balle veut dire tête; curieux, juge; gazon, perruque, etc.? Où n'entend-on pas ces mots-là ? Les gros railleurs ont commencé par s'en servir, pour se donner un air de finesse et de liberté; mais bientôt ces mots narquois seront comme les doublures naturelles des termes correspondants et peut-être prévaudront-ils ? - A. Morel, 1862.
******
LES EXCENTRICITÉS
DU LANGAGE
**************************************
A
ABADIS : Foule, rassemblement (Vidocq). - Vient du vieux mot de langue d'oc: abadia: forêt de sapins. - V. Du Cange. - L'aspect d'une multitude ressemble à celui d'une forêt. On dit: Une forêt de têtes. - « Pastiquant sur la placarde, j'ai rembroqué un abadis du raboin. » - Vidocq.
ABATIS : Pieds, mains. - Allusion aux abatis d'animaux.
Abatis canailles: Gros pieds, grosses mains. - « Des pieds qu'on nomme abatis. » - Balzac.
ABBAYE DE MONTE À REGRET : Échafaud (Vidocq). - Double allusion. - Comme une abbaye, l'échafaud vous sépare de ce bas monde, et c'est à regret qu'on en monte les marches.
ABÉQUER : Nourrir.
Abéqueuse: Nourrice (Vidocq). - De l'ancien mot abécher : donner la becquée. - V. Roquefort.
ABLOQUIR : Acheter en bloc (Vidocq). - Bazarder a, au point de vue de la vente, le même sens. - Du vieux mot bloquer: arrêter un marché. - V. Lacombe.
ABOULER : Entrer - Vient du vieux mot bouler: rouler. - V. Roquefort. - « Maintenant, Poupardin et sa fille peuvent abouler quand bon leur semblera. » - Labiche. - Notre langue a conservé éboulement. Abouler: Donner, faire bouler à quelqu'un: - « Mais quant aux biscuits, aboulez. » - Balzac.
Abouler de maquiller: Venir de faire. - V. Momir.
Aboulage: Abondance.
ABSORPTION : Repas offert chaque année aux anciens de l'École polytechnique par la promotion nouvelle. On y absorbe assez de choses pour justifier le nom de la solennité. - « Lorsque le taupin a été admis, il devient conscrit et comme tel tangent à l'Absorption. Cette cérémonie annuelle a été imaginée pour dépayser les nouveaux, les initier aux habitudes de l'École, les accoutumer au tutoiement. » - La Bédollière.
ACCENT : V. Arçon.
ACCROCHE-CŒURS : Favoris (Vidocq). - Allusion aux accroche-cœurs féminins, petites mèches contournées et plaquées prétentieusement sous la tempe.
ACCROCHER : Mettre au Mont de Piété, c'est-à-dire au clou. Ce dernier mot explique le verbe. - « Ah ! les biblots sont accrochés.» - De Montépin.
Accrocher: Consigner un soldat, c'est-à-dire l'accrocher à son quartier, l'empêcher d'en sortir.
S'accrocher: Combattre corps à corps, en venir aux mains, ou, pour mieux dire, aux crocs. De là le mot.
ACHAR (D') : Avec acharnement. - V. Autor.
ADDITION : Carte à payer. - « C'est l'addition même de l'un de ces repas-là. » - Delvau. Ce néologisme fort juste s'explique de lui-même.
AFF : Abrév. d'Affaire. - V. Débiner.
AFFAIRE (Donner ou Faire son) : Tuer. - « L'un d'eux doit m'faire C'te nuit mon affaire. » - Désaugiers.
Avoir son affaire: Être ivre-mort. - « Je propose l'absinthe ... Après quoi j'avais mon affaire, là, dans le solide. » - Monselet.
Avoir ses affaires: Avoir ses menstrues. - V. Anglais.
AFFRANCHIR : Pervertir, c'est-à-dire affranchir des règles sociales. - « Affranchir un sinve pour grinchir: pousser un honnête homme à voler. » - Vidocq. Affranchir : Mettre au courant, informer.
AFFURAGE, AFFURE : Profit.
Affurer: Gagner (Vidocq). - De l'ancien mot furer: dépouiller. - V. Du Cange. - « Eh vite ! ma culbute, quand je vois mon affure, je suis toujours paré. » - Vidocq.
AFFUT (Homme d') : Malin, roué. - Vient du vieux mot affuster: viser, coucher en joue.
AGONIR, AGONISER : Insulter. C'est l'αγωυιζειυ des Grecs. - « Je veux t'agoniser d'ici à demain, ». - Ricard. - « Si bien que je fus si tourmentée, si agonie de sottises par les envieuses. » - Rétif, 1783.
AGRAFER : Arrêter. - « Le premier rousse qui se présentera pour m'agrafer. » - Canler.
Agrafer: Consigner. Même sens qu'accrocher. - « J'ai jeté la clarinette par terre, et il m'a agrafé pour huit jours. » - Vidal, 1833.
AIDE-CARGOT : Valet de cantine. - « Aide-cargot, un dégoûtant troupier fait semblant de laver la vaisselle. » - Wado.
AILE, AILERON : Bras. - « Appuie-toi sur mon aile, et en route pour Châtellerault.» - Labiche. - « Je suis piqué à l'aileron, tu m'as égratigné avec tes ciseaux.» - E. Sue.
AIR (SE DONNER, SE POUSSER DE L', JOUER LA FILLE DE L') : Fuir. - Les deux premiers termes font image; le troisième a été enfanté par la vogue de La Fille de l'Air, une ancienne pièce du Boulevard du Temple. « La particulière voulait se donner de l'air.» - Vidal, 1833. - « Dépêchez-vous et jouez-moi la Fille de l'air avec accompagnement de guibolles. » - Montépin. - « Allons, môme, pousse-toi de l'air » - Id.
Vivre de l'air du temps: Être sans moyens d'existence. Terme ironique. - « Tous deux vivaient de l'air du temps. » - Balzac.
Être à plusieurs airs: Être hypocrite, jouer plusieurs rôles à la fois.
ALENTOIR : C'est alentour avec changement arbitraire de la dernière syllabe, procédé très-commun en argot.
ALLER OÙ LE ROI NE VA QU'À PIED : Ce rappel à l'égalité est de tous les temps. On disait au dix-septième siècle: « C'est à mots couverts le lieu où l'on va se décharger du superflu de la mangeaille... » - Scarron, qui n'a pas dédaigné de donner l'hospitalité à cette métaphore éminemment philosophique, ajoute: « C'est ce qu'on nomme à Paris, chez les personnes de qualité, la chaise percée; car depuis environ vingt ans la mode est venue de faire ses nécessités sans sortir de sa chambre, et cela par un pur excès de propreté. »
ALLEZ DONC ! : Locution destinée à augmenter dans un récit la rapidité de l'acte dont on parle. - « J'avais mon couteau à la main... et allez donc !... j'entaille le sergent, je blesse deux soldats. » - E. Sue.
ALLONGER (S'): Faire une dépense qui n'entre pas dans ses habitudes. De là sans doute se fendre. - Voyez ce superlatif qui serait alors un terme d'escrime.
ALLUMER : Regarder fixement, éclairer de l'œil pour ainsi dire. - Très- ancien. Se trouve avec ce sens dans les romans du treizième siècle. - V. Du Cange. - « Allume le miston, terme d'argot qui veut dire: Regarde sous le nez de l'individu. » (Almanach des Prisons, 1795).
Allumer: Déterminer l'enthousiasme. - « Malvina remplissait la salle de son admiration, elle allumait, pour employer le mot technique. » - Reybaud.
Allumer: Pour un cocher, c'est déterminer l'élan de ses chevaux à coups de fouet.
Allumer : faire naître le désir, provoquer le désir, émoustiller. – J.-P. Kurtz - « Allume ! allume ! » - H. Monnier.
Allumé: Échauffé par le vin. - « Est-il tout à fait pochard ou seulement un peu allumé ? » - Montépin.
Allumeur: Compère chargé de faire de fausses enchères dans une vente. - « Dermon a été chaland allumeur dans les ventes au-dessous du cours. » - La Correctionnelle, journal.
Allumeuse, dans le monde de la prostitution, est un synonyme de marcheuse. Dans ces acceptions si diverses, l'analogie est facile à saisir. Qu'il s'applique à un tête-à-tête, à un spectacle, à un attelage, à un repas, ou une vente, allumer garde toujours au figuré les propriétés positives du feu. Aguicheuse.
ALTÈQUE : Beau, bon, excellent (Vidocq). - Du vieux mot alt (grand, fort, élevé) accompagné d'une désinence arbitraire, comme dans féodec. V. Roquefort. Frangine d'Altèque: Bonne sœur.
Frime d'altèque: Charmante figure. - V. Coquer.
AMANT DE CŒUR : Les femmes galantes nomment ainsi celui qui ne les paie pas ou celui qui les paie moins que les autres. La Physiologie de l'Amant de cœur a été faite par Marc Constantin en 1842. Au dernier siècle, on disait indifféremment Ami de cœur ou greluchon. Ce dernier n'était pas ce qu'on appelle un souteneur. Le greluchon ou ami de cœur n'était et n'est encore qu'un amant en sous-ordre auquel il coûtait parfois beaucoup pour entretenir avec une beauté à la mode de mystérieuses amours. « - La demoiselle Sophie Arnould, de l'Opéra, n'a personne. Le seul Lacroix, son friseur, très-aisé dans son état, est devenu l'ami de cœur et le monsieur. » (Rapports des inspecteurs de Sartines). - Ces deux mots avaient de l'avenir. Monsieur est toujours bien porté dans la langue de notre monde galant. Ami de cœur a détrôné le greluchon; son seul rival porte aujourd'hui le non d'Arthur.
AMATEUR : Homme s'occupant peu de son métier. - À l'armée revient surtout l'usage de ce mot. Un officier cultivant les lettres, les arts, les sciences même avec le plus grand succès, ne sera jamais qu'un amateur.
Amateur sert aussi dans l'armée d'équivalent au mot de bourgeois. Un officier dira: Il y avait là cinq ou six amateurs; comme un soldat ou un sous-officier dira: Il y avait là cinq ou six particuliers. Un clerc amateur travaille sans émoluments. Amateur: Rédacteur qui ne demande pas le paiement de ses articles. - 1826, Biographie des Journalistes.
Amateur : Individupeucompétentdansundomaine. « - Vousêtesinefficace, c'estvraimentdutravaild'amateur ! ».
Amateur : Acheteuréventuel, client.
AMBIER : Fuir (Vidocq). - Du vieux mot amber: enjamber. - V. Roquefort.
AMÉRICAIN (Œil) : Œil investigateur. - L'origine du mot est dans la vogue des romans de Cooper et dans la vue perçante qu'il prête aux sauvages de l'Amérique. - « Ai-je dans la figure un trait qui vous déplaise, que vous me faites l'œil américain ? » - Balzac - « J'ai l'œil américain, je ne me trompe jamais. » - Montépin.
Œil américain: Œil séducteur. - « L’œillade américaine est grosse de promesses, elle promet l'or du Pérou, elle promet un cœur non moins vierge que les forêts vierges de l'Amérique, elle promet une ardeur amoureuse de soixante degrés Réaumur. » - Ed. Lemoine.
AMÉRICAINE : Voiture découverte à quatre roues. - « Une élégante américaine attend à la porte de l'hôtel Rothschild. Un homme fort bien mis y monte, repousse un peu de côté un tout petit groom, prend lui-même les guides et lance deux superbes pur-sang au galop. » - Figaro.
AMOUR : Aimable comme l'Amour. - « Armée de son registre, elle attendait de pied ferme ces amours d'abonnés. » - L. Reybaud. - « Comme j'ai été folle de Mocker, quel amour de dragon poudré. » - Frémy
ANCHOIS (Œil bordé d') : Œil aux paupières rougies et dépourvues de cils. - « Je veux avoir ta femme - Tu ne l'auras pas. - Je l'aurai, et tu prendras ma guenon aux yeux bordés d'anchois. » - Vidal. 1833.
ANCIEN, CONSCRIT : Élèves de première et de seconde promotion à l'École polytechnique ou à l'École de Saint-Cyr.
ANDOUILLE : Personne molle, sans énergie (Vidocq).
Andouille : Personne sotte et stupide. J.-P. Kurtz
ANDOUILLES (Dépendeurs d') : On sait que les andouilles se pendent au plafond. Le peu d'élévation des planchers parisiens relègue en province ce terme, qui désigne un individu de grande stature.
ANGLAIS : Créancier. - Le mot est ancien, et nous sommes d'autant plus porté à y voir, selon Pasquier, une allusion ironique aux Anglais (nos créanciers après la captivité du roi Jean) que les Français se moquaient volontiers autrefois de leur redoutable ennemi. C'est ainsi que milord est employé ironiquement aussi. Nous en trouvons trace dans Rabelais. - « Assure-toi que ce n'est point un anglais. » - Montépin. - « Et aujourd'hui je faictz solliciter tous mes angloys, pour les restes parfaire et le payement entier leur satisfaire. » - Crétin.
Les anglais sont débarqués. - Dans une bouche féminine, ces mots sont un équivalent de: J'ai mes affaires, V. ce mot. - L'allusion est sanglante pour ceux qui connaissent la couleur favorite de l'uniforme britannique. - « Il est aussi brave Que sensible amant, Des Anglais il brave Le débarquement. » - Chansons, impr. Chastaignon, Paris, 1851.
ANGUILLE : Ceinture (Vidocq). - Une ceinture de cuir noir gonflée d'argent ressemble assez à une anguille.
ANSES (Panier à deux) : Homme qui se promène avec une femme à chaque bras. - De ce terme imagé découle l'expression offrir son anse: offrir son bras.
ANTIFLER, ENTIFLER : Marier (Vidocq). Vient du mot entifle: église. - Là se fait la célébration du mariage. Entifler est donc mot à mot: mener à l'église. - « Ah ! si j'en défouraille, ma largue j'entiflerai. » - Vidocq.
ANTIPATHER : Avoir de l'antipathie. - « Pas une miette ! Je l'antipathe.» - Gavarni.
ANTONY : - « En 1831, après les succès d'Antony, les salons parisiens furent tout à coup inondés de jeunes hommes pâles et blêmes, aux longs cheveux noirs, à la charpente osseuse, aux sourcils épais, à la parole caverneuse, à la physionomie hagarde et désolée... De bonnes âmes, s'inquiétant de leur air quasi cadavéreux, leur posaient cette question bourgeoisement affectueuse: « Qu'avez-vous donc? » À quoi ils répondaient en passant la main sur leur front: « J'ai la fièvre. » - Ces jeunes hommes étaient des Antonys.» - Ed. Lemoine.
ANTONNE : Église (Vidocq). - Diminutif du vieux mot antic: église. - V. Du Cange. On donne de même à l'église le nom de priante.
ANTROLER : Emporter (Vidocq). - Des mots entre roller: rouler ensemble. - V. Du Cange.
APLOMB (Coup d') : Coup vigoureux, tombant verticalement sur le but. - « Sus c' coup là, je m'aligne. L'gonse allume mon bâton, J'allonge sur sa tigne Cinq à six coups d'aplomb. » - Aubert, chanson, 1813. - « Ah ! fallait voir comme il touchait d'aplomb. » - Les Mauvaises Rencontres, chanson.
APÔTRE : Doigt (Vidocq). - Est-ce parce que les apôtres sont souvent représentés avec l'index levé ?
APPAS : Seins. - « Madame fait des embarras, Je l'ai vu mettre en cachette des chiffons pour des appas. » - Matt., Chansons.
AQUIGER : Palpiter. - V. Coquer.
Aquiger: Blesser, battre.
Aquiger les brèmes: Biseauter les cartes.
ARAIGNÉE DANS LE PLAFOND (avoir une) : Être fou. Le cerveau serait ici le plafond et la monomanie y tendrait ses toiles.
ARBALÈTE : Croix de cou, bijou de femme (Vidocq). - Allusion à la ressemblance d'une arbalète détendue avec une croix.
ARCASIEN, SINEUR : Celui qui monte un arcat.
ARCAT (Monter un) : Écrire de prison à un provincial, et lui demander une avance sur un trésor enfoui dans son pays et dont on promet de lui révéler la place. La lettre qui sert à monter l'arcat s'appelle lettre de Jérusalem, parce qu'on l'écrit sous les verrous de la Préfecture. Vidocq assure qu'en l'an VI, il arriva de cette façon plus de 15,000 fr. à la prison de Bicêtre. - Vient d'arcane: mystère, chose cachée.
ARCHE (Aller à) : Chercher de l'argent (Vidocq) - Du vieux mot arche (armoire secrétaire) qui a fait archives. Le secrétaire sert de coffre-fort aux particuliers.
ARÇON, ACCENT : Signe d'alerte convenu entre voleurs. Du temps de Vidocq (1837) c'était un crachement et un C figuré à l'aide du pouce droit sur la joue droite. - Vient d'arçon: archet, petit arc. - V. Roquefort. - La courbe du C représente bien la forme d'un arc. - Accent nous paraît de même une allusion au son du crachat
ARGUEMINE : Main. - « Je mets l'arguemine à la barbue. » - Vidocq.
ARCPINCER : Arrêter quelqu'un. - Pincer au demi cercle est très-usité dans le même sens. Il est à remarquer qu'arc et demi-cercle sont presque synonymes et qu'ils paraissent dériver de la même image.
ARISTO : Aristocrate. - « C'est vrai ! tu as une livrée, tu es un aristo. » - D'Héricault.
ARDENTS : Yeux. - Dict. d'argot moderne, 1844. - Le verbe allumer entraînait naturellement ce substantif.
ARGOT, ARGUCHE : - Diminutifs d'argue: Ruse, finesse. - V. Roquefort. - L'argot n'est en effet qu'une ruse de langage. - V. Truche.
ARLEQUIN : Rogatons achetés aux restaurants et servis dans les gargotes de dernier ordre. - « C'est une bijoutière ou marchande d'arlequins. Je ne sais pas trop l'origine du mot bijoutier; mais l'arlequin vient de ce que ces plats sont composés de pièces et de morceaux assemblés au hasard, absolument comme l'habit du citoyen de Bergame. Ces morceaux de viande sont très-copieux, et cependant ils se vendent un sou indistinctement. Le seau vaut trois francs. On y trouve de tout, depuis le poulet truffé et le gibier jusqu'au bœuf aux choux. » - P. D'Anglemont.
ARME À GAUCHE (Passer l') : Mourir, militairement parlant. Aux enterrements, le soldat passe l'arme sous le bras gauche. - « Toute la famille a passé l'arme à gauche. » - Lacroix, 1832.
Il a reçu une volée que le diable en a pris les armes: Il a reçu une volée mortelle, telle que le diable aurait pu emporter son âme. - arme est souvent pris pour âme au moyen-âge.
ARNACHE : Tromperie (Vidocq). - Du vieux mot harnacher: tromper. ARPION : Pied. - C'est le vieux mot arpion: griffe, ongle (Lacombe). On a dit arpion comme on dit pattes. - « J'aime mieux avoir des philosophes aux arpions. » - E. Sue.
ARSONNEMENT : Onanisme (Vidocq). - Du vieux mot arson: incendie. L'analogie est facile à expliquer. - On emploie le verbe S'arsonner.
ARSOUILLE : Anagramme du vieux mot souillart: homme de néant. La souillardaille était jadis la canaille d'aujourd'hui. - V. Du Cange. - « C'étaient des arsouilles qui tiraient la savate. » - Th. Gautier. Mauvais garçon, voyou.
« Il allume. Lupin est déguisé en apache, longue blouse, chapeau, barbe rousse en éventail. Il prend une glace à main sur la table de toilette et se regarde.) T’en as une bouillotte ! T’as l’air d’une arsouille… Arsouille Lupin ». — (Maurice Leblanc, Une aventure d’Arsène Lupin, 1911.)
Souteneur de tripot; Personne abusant ostensiblement de l'alcool et d'aspect repoussant.
« La première gorgée de bière fut sans doute un plaisir, mais maintenant le jeune homme est ivre. « Où qu'il est le cuistot ? beugle l’arsouille à peine entré dans le hall ». — (Yann Venner, Aller simple pour Trélouzic, page 276, 2006) Enfant espiègle. « Quelle petite arsouille ! »
Bon vivant.
Dans le Midi de la France, l’arsouille est également connu comme étant un bon vivant, amateur de rugby sévissant très souvent dans les fêtes votives au nord de Montpellier (e.g. Teyran), costumé de manière extravagante, mais toujours gentleman. « Ces Arsouilles, quelle bande de gaziers alors ! »
ART (Faire de l'art pour l’) : Cultiver les arts ou les lettres sans y chercher uniquement une occasion de lucre. - V. Métier (Faire du). - « Nous avons connu une école composée de ces types si étranges, qu'on a peine à croire à leur existence; ils s'appelaient les disciples de l'art pour l'art. » - Murger.
ARTHUR : V. Amant de cœur. - « Quant aux Arthurs de ces Dames. » - Delvau.
Arthur: Homme à prétentions galantes. - « Un haut fonctionnaire bien connu, membre d'une académie, Arthur de soixante ans. » - De Boigne.
Se faire appeler Arthur : Se faire engueuler.
ARTICLE (Faire l') : Faire valoir une personne ou une chose comme un article de commerce. - « Malaga ferait l'article pour toi ce soir. » - Balzac. - Examinez-moi ça ! comme c'est cousu! - Ce n'est pas la peine de faire l'article. » - Montépin.
Être à l'article: Être à l'article de la mort, sur le point de mourir.
Porté, fort sur l'article: Enclin à la luxure.
ARTICLIER : « C'est un articlier. Vernon porte des articles, fera toujours des articles, et rien que des articles. Le travail le plus obstiné ne pourra jamais greffer un livre sur sa prose. » - Balzac.
ARTIE, ARTON : Pain. - « En cette piolle On vit chenument; Arton, pivois et criolle On a gourdement.» - Grandval, 1723.
ARTILLEUR À GENOUX : Infirmier. - Allusion au canon du clystère et à la posture que réclame sa manœuvre. Ph. Le Roux (1718) nomme déjà mousquetaires à genoux les apothicaires. - On dit aussi: Canonnier de la pièce humide.
AS DE CARREAU : Havre-sac d'infanterie. - Allusion à sa forme carrée. - «Troquer mon carnier culotté contre l'as de carreau ou l'azor du troupier. » - La Cassagne.
AS DE PIQUE (Fichu comme un) : Mal bâti, mal vêtu. Jadis on appelait as de pique un homme nul. - « Taisez-vous, as de pique ! » - Molière.
ASPIC : Calomniateur (Vidocq). - Grâce à leur venin, ces serpents ont toujours symbolisé la calomnie. L'aspic des voleurs n'est que la vipère des honnêtes gens.
ASSEOIR (S') : Tomber, ironiquement: s'asseoir par terre.
Allez vous asseoir: Taisez-vous. - Allusion à la fin obligée des interrogatoires judiciaires.
Asseyez-vous dessus: Imposez-lui silence. - En 1859, M. Dallès a fait deux chansons intitulées l'une: Allez vous asseoir, et l'autre: Asseyez-vous donc là-d'sus. - Un petit théâtre de Paris a également donné ce premier terme pour titre à une revue de fin d'année.
S’asseoir dessus : Faire fi d'une chose, ne pas tenir compte de, être indifférent à quelque chose; ne plus espérer quelque chose, accepter sa perte. - « Je te dois de l’argent ? Eh bien tu peux t’asseoir dessus ! » - J.-P. Kurtz.
ASTIC : Tripoli, mélange servant à nettoyer les pièces de cuivre. - « Et tirant du bahut sa brosse et son astic, il se met à brosser ses boutons dans le chic. » - Souvenirs de Saint-Cyr.
ASTIQUER : Nettoyer. - « Quand son fusil et sa giberne sont bien astiqués. » - 1833, Vidal.
Un troupier dira de bourgeois élégants: Ce sont des civils bien astiqués. La marine donne à ce mot de nombreux synonymes: - « Peste ! maître Margat, vous avez l'air d'un Dom Juan... - Un peu, que je dis ! on a paré la coque... On s'a pavoisé dans le grand genre ! On est suifé et astiqué proprement. » - Capendu.
Astiquer: Battre. - « Sinon je t'astique, je te tombe sur la bosse. » - Paillet. - Du vieux mot estiquer : frapper d'estoc ou de la pointe. - V. Du Cange





























